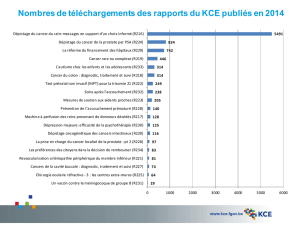Le dépistage du cancer du sein remis en question D E R

25
La Lettre du Sénologue - n° 7 - février 2000
DERNIÈRE MINUTE
Le dépistage du cancer du sein remis en question
Le dépistage du cancer du sein par la mammographie est-il justifié ? (résumé)
Peter C. Gotzsche, Ole Olsen, Lancet 2000 ; 355 : 129-34
Les auteurs, danois, rebondissent sur une étude suédoise parue en 1999 (et confidentielle puisque publiée en suédois !) qui n’a pas retrouvé de
diminution de la mortalité par cancer du sein en Suède alors que le dépistage est recommandé depuis 1985.
Ils ont réalisé une méta analyse des 8 grandes études sur le dépistage (New York, Edimbourg, Canada, Malmö (I et II), Stockholm, Göteborg et
méta-analyse suédoise) en étudiant particulièrement les procédures de randomisation et les caractéristiques des patientes incluses dans les diffé-
rents bras. Ils ont retrouvé un déséquilibre pour 6 de ces études, en particulier pour l’âge et les facteurs de risque.
Or il se trouve que les 2 études considérées comme correctes (Malmö et Canada) ne retrouvent pas de différence dans la survie spécifique et la
survie globale, du fait du DMO, alors que les 6 autres études ont mis en évidence une diminution de la mortalité par cancer du sein d’environ 25 %.
Les auteurs concluent que le dépistage du cancer du sein par mammographie n’est pas justifié.
À la suite de la publication d’un article remettant en cause l’intérêt du dépistage de masse organisé du cancer du sein, paru dans le Lancet
début janvier et largement repris par la presse grand public, nous vous proposons une synthèse des différents avis d’experts en commentaire
de cet article.
Dans le même numéro du Lancet, Harry J. de
Koning (membre de l’équipe nationale d’éva-
luation pour le dépistage du cancer du sein
aux Pays-Bas) commente cet article en consi-
dérant que les auteurs ont une expérience sur
les méta-analyses des essais thérapeutiques
(quelques centaines d’inclusions) alors qu’il
est probable que, dans les études de dépis-
tage, incluant des dizaines de milliers de
femmes, une petite différence peut devenir
statistiquement significative du fait du grand
nombre de femmes incluses alors qu’il ne
s’agit pas d’un biais sérieux pour l’étude. Les
auteurs ont analysé le processus de randomi-
sation, qui est primordial dans un essai théra-
peutique, et ont négligé d’autres facteurs très
importants dans une étude sur le dépistage
tels que le taux de participation, la qualité des
mammographies ou la précision de la lecture
des films. Or, force est de constater que la
mortalité par cancer du sein a diminué aux
Pays-Bas entre 1989 et 1997 pour les femmes
de 60 à 69 ans.
Il cite une phrase amusante de I. Fentiman qui
pourrait approximativement se traduire par
“Les résultats des études (de dépistage de
masse du cancer du sein) représentent les
résultats d’hommes enthousiastes, de pion-
niers dans ce domaine, qui, avec une patience
angélique, ont développé le dépistage et qui,
par une attention obsessionnelle portée à de
petites anomalies sur les mammographies,
ont réduit la mortalité par cancer du sein”.
Le 15 janvier, le British Medical Journal publie
le commentaire de Jacqui Wise (Br Med J
2000 ; 320 : 139). Il rappelle que la mortalité
par cancer du sein a diminué de 14 % au
Royaume-Uni entre 1989 et 1998. Il cite le Dr
Muir Gray, directeur du Comité National de
Dépistage en Grande-Bretagne qui discute les
causes d’exclusion des différentes études
(une étude a été exclue pour déséquilibre de
l’âge entre les 2 bras, or il semblerait que la
différence soit d’un mois !). Il pense que le
Lancet a cédé à un effet d’annonce puisque
l’article a été envoyé le 20/12/99 et publié le 8
janvier, ce qui laisse peu de temps à une
relecture efficace !
Il cite également le professeur Jack Cuzick (de
la Fondation Impériale pour la Recherche
contre le Cancer) qui maintient que la diminu-
tion de la mortalité par cancer du sein
confirme que les cancers sont découverts à un
stade plus précoce, donc traités plus efficace-
ment, ce qui confirme que le DMO diminue la
mortalité de 20 à 30 % comme cela est montré
dans les différentes études.
Marie-Hélène Dilhuydy nous a également
donné son avis.
“Les Danois sont des gens très sérieux de la
très réputée Institution Cochrane qui travaille
sur la randomisation des essais thérapeu-
tiques. Pour des raisons probablement poli-
tiques (et avec la complicité du Lancet qui a
pris le texte sans relecture), ils sont sortis de
leur domaine de compétence. La première
partie de leur article consiste à critiquer la ran-
domisation des essais comme s’il s’agissait
d’essais thérapeutiques où on peut travailler
par paire avec des lots comparables. Ils redé-
couvrent alors ce que tout le monde sait : en
santé publique, que l’on randomise par practi-
tionner, par canton ou même par ordre d’arri-
vée, les deux populations ne sont jamais stric-
tement comparables. Il y a des cantons plus
jeunes, plus pauvres, plus atteints d’autres
affections, plus suicidaires… et comme la dif-
férence attendue est très faible bien que signi-
ficative, il suffit de peu de différence entre les
deux groupes pour annuler les effets sur la
mortalité globale.
Ce qui est incroyable, c’est que les auteurs
affirment que le seul essai correctement ana-
lysé (à part Malmö) est l’étude canadienne
alors que, dans la littérature, on lui a reproché
des problèmes de randomisation, celle-ci
aurait été faite après examen clinique avec la
quasi-totalité des grosses tumeurs palpables
dans le bras dépisté !
La deuxième partie est étonnante : certes on
meurt un peu moins de cancer du sein (- 0,8 %
en mortalité absolue, ce qui correspond à peu
près à – 25 % en mortalité relative) mais on
meurt un peu plus d’autre chose, même si
cette différence s’annule si l’on compense par
l’âge (étude suédoise).
Enfin, Joseph Stinès nous apporte une
conclusion : Pour les médecins impliqués dans
le dépistage du cancer du sein, cette remise en
cause des bénéfices du dépistage par la mam-
mographie apparaît très délétère dans la
mesure où elle risque de détourner un certain
nombre de patientes du dépistage alors que
ses bénéfices sont évidents pour tous ceux qui
travaillent dans le domaine de la sénologie.
Les cancers dépistés sont plus petits et pré-
sentent moins souvent des extensions gan-
glionnaires. Il en résulte des traitements moins
lourds : moins de chirurgies mutilantes et
moins de traitements adjuvants. Il existe par
ailleurs de multiples arguments tendant à
démontrer que lorsqu’on diagnostique suffi-
samment tôt les cancers du sein, ceux-ci n’ont
pas encore pu exprimer leur potentiel métasta-
tique et ils sont donc de ce fait curables.
Il serait tout à fait déraisonnable de remettre
en cause le dépistage mammographique et
les sénologues, qui ont vu sur le terrain com-
ment les choses évoluaient au cours des 25
dernières années, en sont certainement
convaincus. ■
Cela ne remet pas en cause la démonstra-
tion (certes fragile) de l’efficacité du dépis-
tage sur la mortalité par cancer du sein. Elle
n’est pas celle dont on aurait rêvé, raison de
plus pour essayer de faire le moins mal pos-
sible pour au moins ne pas être plus nuisible
qu’utile…
1
/
1
100%