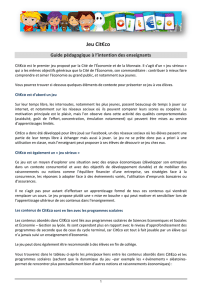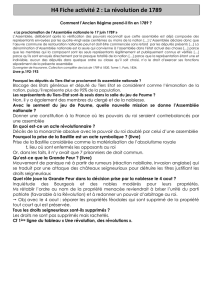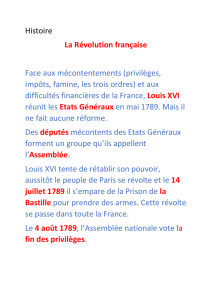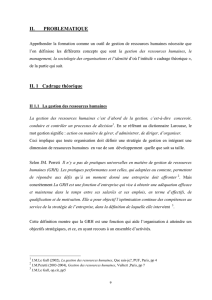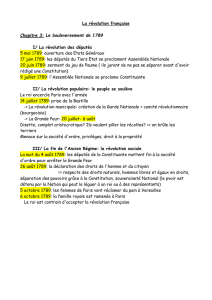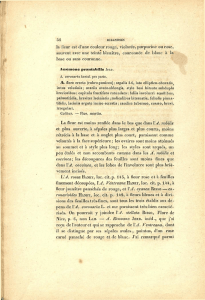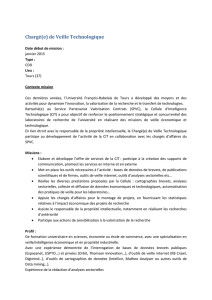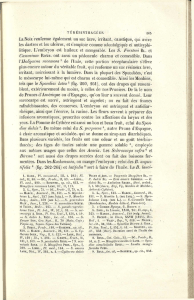Yann-Arzel Durelle-Marc - Revenir sur

Centre d’Histoire du Droit de l’Université de Rennes 1
Yann-Arzel Durelle-Marc (Y.-A. Marc)
Les acteurs politiques de la constituante
(1789-1791)
Mémoire pour le DEA d’Histoire du droit
Présenté et soutenu le 18 octobre 1994
Université de Rennes 1
directeur : M. MORABITO
Suffragant : F. BURDEAU
Table des matières
Exergues
Abréviations
Remerciements
Introduction
Le problème des sources et des archives
Partie préliminaire : l’état des lieux
Section 1. Des causes du dépérissement de la monarchie et de l’échec de ses réformes
§ 1. Une crise économique paradoxale
A. Économie générale
B. L’état des « Phynances » à la veille de la Révolution
§ 2. Velléités réformatrices
Section 2. Les références politiques des Constituants
§ 1. La référence à l’Antiquité
§ 2. Le monde anglo-saxon
A. L’Angleterre
B. Les États-Unis
Section 3. Le passé de la nation
§ 1. Origine historique de la Nation
§ 2. Origines de la nation dans la mythologie constituante
Section 4. Spécificités de l’élaboration de la Constitution de 1791
§ 1. L’absence d’expérience antérieure en France
1

§ 2. La polyvalence de l’Assemblée
§ 3. Vingt-sept mois
Section 5. Les forces en présence
§ 1. Qu’est-ce que le Tiers État ?
A. Unité
B. Diversité
C. Représentation
§ 2. Qu’est-ce que la Noblesse ?
A. Unité
B. Diversité
C. Représentation
§ 3. Qu’est-ce que le Clergé ?
A. Désunion
B. Représentation
Partie I : L’avènement de la nation
Section 1. Proclamation de l’Assemblée nationale constituante
§ 1. Des « États » au « Jeu de Paume »
A. Climat de campagne
B. Ouverture des États Généraux
§ 2. Des « députés des bailliages » aux « représentants de la Nation »
A. La question de la souveraineté
B. La représentation à la française
C. Légitimité et autorité nouvelle de l’Assemblée
Section 2. Les grandes figures
§ 1. Les morts : l’influence des Lumières
A. Montesquieu
B. Mably
C. Rousseau
D. Relativité des Lumières
§ 2. Les vivants : la classe politique de 1789
De quelques grands hommes
Section 3. Réorganiser la monarchie : en finir avec l’absolutisme !
§ 1. « Monarchie ou République ? », la question ne se pose pas !
§ 2. Tempête sur un trône
Section 4. Enjeux des formes délibératives : le débat parlementaire
§ 1. Les formes délibératives
A. La question préalable : bureaux ou comités ?
B. Le pouvoir des comités
§ 2. Le débat du veto
A. Le veto monarchien
B. Le veto conservateur
C. Le veto suspensif
PARTIE II : Fonder la révolution, l’apprentissage de la politique et l’Administration de
la révolution
Section 1. Le peuple devient un acteur politique
§ 1. Le peuple rhétorique : la référence aux « commettants »
§ 2. « L’intrusion des masses »
§ 3. Versailles-Paris
2

A. Octobre : dies irae !
B. « A Paris ! A Paris ! »
Section 2. Le peuple comme instrument politique : les clubs et la presse
§ 1. Les clubs
A. Le Club breton, de la rue de la Pompe à la rue Saint-Honoré
B. Les autres clubs
§ 2. Les journaux
Section 3. La gestion des urgences, orchestrer et enraciner la révolution
§ 1. Les questions financières
A. Les biens du clergé
B. L’assignat
§ 2. Administrer la Révolution
A. La réorganisation administrative et politique du territoire
B. La réforme fiscale
C. La Constitution civile du clergé
Section 4. L’évolution de la situation politique
§ 1. En guise d’augure : « le marc d’argent »
§ 2. Maturation de la contre-Révolution
Partie III : finir la révolution
Section 1. évolution des forces politiques dans et autour de l’assemblée
§ 1. La majorité
§ 2. Les factions
§ 3. Les inclassables
§ 4. Des divergences aux oppositions : les casus belli
Section 2. Varennes et ses conséquences : la nation trahie !
§ 1. La nation orpheline
A. Une fuite annoncée
B. La tentative nulle
C. La réaction de l’Assemblée
§ 2. Le divorce des commis et des commettants
A. La fermentation
B. Le Champ de mars
C. La Province
§ 3. Le schisme Jacobins / Feuillants
Section 3. Pour en finir avec la Révolution
§ 1. La récapitulation de la Constitution
§ 2. Le « verrouillage » de la Constitution
A. La pirouette feuillantine
B. La révision vue par la droite
C. La révision vue par la gauche
D. La révision selon la majorité
CONCLUSION
Bibliographie
A. Sources et documents faisant office de sources
B. Études
C. Illustrations
3

Exergues
« Je vais donc dire des choses que je n’ai jamais ni vues ni ouïes... »
LUCIEN DE SAMOSATE
(« Histoire véritable », livre I)
« Sans doute, ce ne sont pas la religion et les lois qui, à elles seules, suffisent à bien conduire
une cité, et ceux qui ont le plus grand rôle, ce sont les hommes qui successivement conduisent
le peuple à leur volonté. La religion et les lois leur sont utiles s’ils gouvernent bien, inutiles
s’ils gouvernent mal. »
SOLON
(Lettre de « Solon à Épiménide », in Diogène Laërce : « Vies, doctrines et sentences des
philosophes illustres », livre I)
« Y a-t-il sur le globe, des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir
de la liberté, à ne jamais exercer leur raison ?
Cette différence de lumières, de moyens ou de richesse, observée jusqu’à présent chez tous les
peuples civilisés, entre les différentes classes qui composent chacun d’eux ; cette inégalité,
que les premiers progrès de la société ont augmentée, et pour ainsi dire produite, tient-elle à la
civilisation même, ou aux imperfections actuelles de l’art social ? »
CONDORCET
(« Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain », « Dixième époque : Des
progrès futurs de l’es prit humain »)
Abréviations :
AHRF : Annales historiques de la Révolution française
EL : Esprit des lois (Montesquieu)
EHESS : École des hautes Études en Sciences sociales
Remerciements :
Je souhaite quelque peu au-delà de l’exercice de style, rendre hommage à Monsieur le
Professeur Marcel Morabito qui m’a prodigué sans parcimonie ses conseils et son soutient
moral, m’a appuyé dans mes choix, m’a simplement fait confiance, et a été, jusqu’au terme de
ce travail, absolument constant dans cette attitude.
4

Je remercie également Monsieur le Professeur François Burdeau qui m’a permis de suivre ce
Diplôme d’Étude Approfondies, et offert ainsi une aventure intellectuelle que je ne regrette
pas.
Que Monsieur le Recteur Quénet soit assuré de mon profond respect et remercié pour sa
grande disponibilité à l’égard des étudiants, pour les pistes de recherche qu’il a bien voulu
m’indiquer.
De même, je n’oublie pas Monsieur Thierry Müller, qui m’a procuré plusieurs références
bibliographiques précieuses à mon travail.
Merci au personnel de la Bibliothèque municipale de Rennes qui m’a accueilli avec
bienveillance et m’a grandement facilité l’accès aux fonds.
J’exprime ma reconnaissance à celles et ceux qui m’ont aidé dans le travail de frappe et qui
ont accepté de relire et critiquer ma prose ou simplement - c’est-à-dire, difficilement le plus
souvent -, supporté mes humeurs et manifesté leurs encouragements : Anne-Claire, François,
Natacha, Laurence, Estelle, Éric et Caroline.
Et un remerciement très particulier d’une part à mon ami Amaury Chauou qui a bien voulu
relire mon travail et me dispenser ses judicieux conseils, et d’autre part à ma sœur Nolwenn,
dont la patience et le secours quotidien furent si essentiels.
Introduction
« C’est un phénomène inouï dans le cours des événements, qu’à l’époque où tout était confus,
les lois civiles sans forces, le monarque abandonné, le ministère évaporé, il se soit trouvé un
corps politique, faible rejeton de la monarchie confondue, qui prit en mains les rennes,
trembla d’abord, s’affermit, affermit tout, engloutit les partis, et fit tout trembler », écrit Saint-
Just[1].
L’Assemblée nationale constituante inaugure en France une ère constitutionnelle. Elle crée la
première constitution formelle, écrite, de l’histoire de France. L’histoire constitutionnelle des
deux derniers siècles démontre avec éclat l’importance capitale du moment où une réunion
d’hommes exceptionnels, confrontés à des circonstances elles-mêmes extraordinaires,
inventent la Constitution !
Les États Généraux, convoqués en 1789 pour résoudre l’effrayante crise structurelle,
financière et sociale de la monarchie française, révèlent, le 17 juin, les ressources
insoupçonnées d’une nation entrant dans son âge de « raison ». Du 9 juillet 1789 au 30
septembre 1791, les représentants de la nation française, réunis en assemblée constituante,
jettent les bases d’une société entièrement régénérée, ne se contentent pas de rénover
l’absolutisme, mais innovent complètement. Ils construisent des institutions, ils dégagent des
modèles d’organisation administratifs et politiques dont nous restons tributaires aujourd’hui.
L’œuvre herculéenne des Constituants débute dans un concert unitaire et sous le signe de
l’enthousiasme. Dans ses premiers transports, cette assemblée vierge de toute expérience,
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
1
/
134
100%