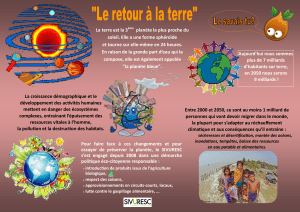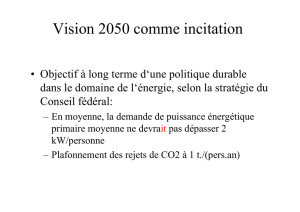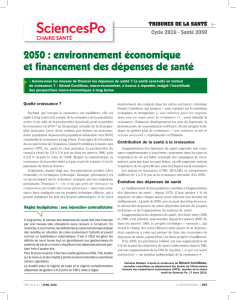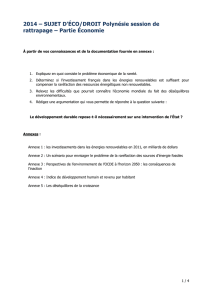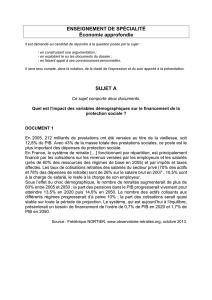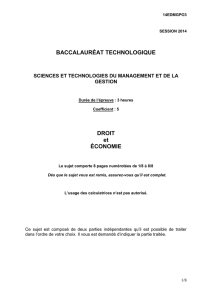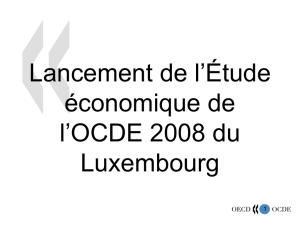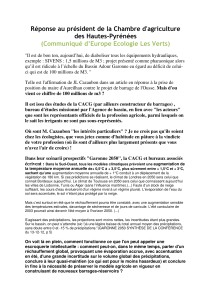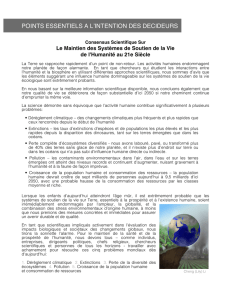bha visions du monde 2050

3332 UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’AVENIR LES TÉMOINS
« Aujourd’hui se décide ce que sera le monde en 2050 et se prépare
ce qu’il sera en 2100. Selon la façon dont nous agirons, nos enfants
et nos petits-enfants habiteront un monde vivable ou traverseront un enfer
en nous haïssant. Pour leur laisser une planète fréquentable, il nous faut
prendre la peine de penser l’avenir, de comprendre d’où il vient
et comment agir sur lui. »
Jacques Attali, Une brève histoire de l’avenir, 2006.
L’exposition Une brève histoire de l’avenir, comme le livre de Jacques Attali qui l’a
inspirée, tente de se projeter dans le futur, en se fondant sur une lecture subjective
du passé, imaginée et portée par la création artistique des millénaires précédents.
Elle invite ainsi à un voyage dans le temps et dans l’espace, à un récit, orienté,
enrichi de digressions délibérées, qui sont autant de pauses poétiques, dans son
parcours muséographique comme dans la maquette de cet ouvrage. Son propos
n’est pas dogmatique ; elle n’a pas cherché à imposer de réponse univoque, mais
à proposer des champs du possible, confiant à ses spectateurs et lecteurs le soin,
et la liberté, d’inventer les leurs. C’est dans cette perspective que nous avons sou-
haité demander à plusieurs personnalités, confirmées ou en devenir, un court texte
pour ce livre, illustré, pour chacun d’entre eux, par une œuvre d’art de leur choix,
qui esquisse leur vision de l’avenir. Nous sommes très heureux et très honorés des
réponses favorables réservées à notre invitation à se projeter en 2050. Architectes,
artistes, économistes, philosophes, entrepreneurs, avocats, tous témoignent, mal-
gré les difficultés de notre temps, de leur confiance en l’avenir, de leurs espérances
de fraternité et de liberté, de leur désir de partage. Leurs écrits mettent en valeur
leur sens de l’engagement ; leur volonté de s’impliquer au sein de nos sociétés pour
les faire grandir, évoluer, apparaît aussi constante que délibérée. S’ébauche ainsi,
grâce à ces textes de qualité, une histoire de l’avenir d’autant plus riche qu’elle
s’inscrit dans la diversité des points de vue. Elle compose une introduction inédite
et singulière à cet ouvrage, dont nous sommes particulièrement fiers.
Vision du monde
pour 2050
9
Xxxxxxxx

3534 UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’AVENIR LES TÉMOINS
Oren Jack Turner,
Albert Einstein,
1947
Née en 1993
à Pau, Imane
Ayach est une
jeune étudiante
en licence
de sciences
politiques et
sociologie à
l’université de
Paris XIII. Ses
études à Paris
lui ont permis
de collaborer à
l’ONG Global
Potential,
basée chez
PlaNet Finance,
en tant que
coordinatrice
de programme.
Elle a participé à
la rédaction du
rapport « Pour
une économie
positive », dirigé
par Jacques
Attali et remis au
président de la
République en
2013. Ce rapport
encourage
notamment
l’implication des
jeunes dans des
projets solidaires
durant leur
scolarité.
La technologie, elle aussi, est en progrès constant.
Son évolution est réellement impressionnante, car, en
l’espace de dix ans, des changements radicaux sont
intervenus. Par exemple, il y a quelques années, un
ordinateur n’était pas indispensable dans le milieu
scolaire. Aujourd’hui, dès le collège, les professeurs
incitent les élèves à utiliser Internet pour envoyer des
devoirs ou des informations par e-mail. L’Homme est
incontestablement un Homo faber, un fabricant d’ou-
tils. Ces fabrications nous facilitent la vie, certes, mais
à quel prix ? Ces nouvelles technologies peuvent aussi
être malsaines et représenter, dans certains cas, plus
un mal qu’un bien. Par exemple, certains jeunes sont
victimes d’arnaques ou de harcèlements sur Internet.
La perte d’intimité, la dégradation des relations entre
les personnes sont les principales craintes qu’inspire la
technologie, car, comme l’avait si bien formulé Albert
Einstein, « il est hélas devenu évident aujourd’hui que
notre technologie a dépassé notre humanité ».
D’un point de vue politique, le grand problème qui
se pose à notre monde, c’est que la démocratie ne par-
vienne pas à s’installer dans tous les pays. Ce régime,
fondé sur des élections, au suffrage direct ou indirect,
est pourtant le meilleur possible. François Mitterrand
a dit « la démocratie, c’est aussi le droit institutionnel
de dire des bêtises ». Or, dans certains pays, les pays
du Maghreb ou l’Égypte, par exemple, ce droit est très
loin d’être reconnu, il n’y a toujours pas de démocratie
et le peuple est même durement réprimé, voire mas-
sacré. Chaque jour, des militants révolutionnaires y
sont condamnés à de lourdes peines. Malgré l’élection
d’Abdel Fattah Al-Sissi, la politique de l’Égypte s’en-
fonce dans l’autoritarisme. En 2050, il faut qu’une solu-
tion soit trouvée contre tous ces régimes qui mettent
leurs pays et leurs habitants en danger. En 2050, il faut
aussi qu’un compromis soit trouvé pour la Palestine et
Israël. Pour ce faire, les autres pays doivent agir, trou-
ver une solution afin que cesse ce conflit si lourd.
Jean-Claude BOULET
2050, c’est dans trente-cinq ans. Si on regarde trente-
cinq ans en arrière, qu’est-ce qui a changé depuis
1980
à l’échelle du monde ?
Les changements plutôt positifs ont été nombreux :
progrès de la médecine, amélioration de la santé,
découvertes scientifiques, internet et technologies de
l’information, mondialisation, chute de l’Union sovié-
tique et du communisme, émergence de la Chine, de
l’Inde, de
l’Afrique, émancipation des femmes dans
un nombre croissant de pays, prise de
conscience de
l’importance du développement durable ; beaucoup
de pays qui rêvent de
croissance, de voitures, de biens
matériels.
La FAO (Food and Agriculture Organization), dans
son étude prospective « Comment nourrir le monde en
2050 », estime à 3 050 Kcal par jour et par personne la
disponibilité énergétique alimentaire à l’horizon 2050,
soit 10 % de plus qu’au cours de la décennie 2000, et
l’ONU (Organisation des Nations unies) projette que
la proportion d’humains en malnutrition devrait conti-
nuer à baisser jusqu’à 3,2 % en 2050, soit 290 millions
de personnes, contre les 850 millions actuels selon la
FAO.
En ce qui concerne la médecine et la recherche,
en 2050, les progrès, sensibles dès à présent dans le
combat mené contre plusieurs maladies incurables,
devraient être au rendez-vous. Nous espérons ainsi
que les succès remportés par la recherche pour vaincre
certaines formes de cancer se généraliseront pour
apporter une solution définitive à cette maladie. Mais
il faudra aussi lutter contre l’inégalité de l’accès aux
soins. Certains pays d’Afrique ne peuvent pas bénéfi-
cier des traitements contre le paludisme, par exemple.
Des associations permettent à ces pays de recevoir des
médicaments et une aide médicale, mais cela ne suf-
fit pas. En 2050, ces inégalités au niveau médical ne
doivent plus exister. Par ailleurs, pour éviter l’augmen-
tation de certaines maladies en 2050, il faudra adop-
ter une alimentation et un mode de vie sains. En effet,
comme l’a dit celui qui est considéré comme « le père
de la médecine », Hippocrate : « Que ton alimentation
soit ton seul médicament. »
Né en 1957,
l’artiste Ai Weiwei
réside et travaille
à Pékin, en Chine.
Réalisations
architecturales,
installations,
réseaux sociaux,
documentaires…,
nombreux sont
les supports qui
lui permettent
de questionner
la société et ses
valeurs. Fervent
défenseur des
droits de l’Homme
et de la liberté
d’expression, il est
souvent confronté
aux autorités de
son pays. Arrêté
et mis au secret
pendant trois
mois en 2011, il
demeure, à ce
jour, privé de
passeport, et donc
du droit de sortir
de son pays, par
le gouvernement
chinois. Ai Weiwei
n’en continue
pas moins à
développer
ses projets et
à présenter
ses œuvres
sur la scène
internationale.
AI WEIWEI
Un regard porté sur les cent dernières années révèle
que ce qui caractérise notre époque n’est pas tant la
prospérité ou le progrès technique que la prise en
compte de la personne humaine en tant que telle, et
notre prise de conscience de nous-mêmes, à la fois
comme individus et membres d’une société. Ce qui
compte est la façon dont nous nous battons pour la vie,
ici et maintenant. Même en période de paix, la guerre
entre individus et structures de pouvoir ne connaît pas
de trêve, c’est une lutte constante, même si nous n’en
sommes pas toujours conscients. Le pouvoir, qu’il soit
politique, économique ou culturel, se manifeste sou-
vent par des limitations de notre liberté. Notre époque
sera jugée aux efforts que nous ferons pour nous libé-
rer de ces entraves, et c’est notre combat pour une plus
grande liberté qui nous définira.
À l’instant même, un de nos chats vient de bondir et
d’ouvrir la porte de la maison. Ce chat ne se soucie pas
de la taille de l’univers. La seule chose qui l’intéresse
est de sauter et d’ouvrir cette porte. Au moment où il
y parvient, son monde, à la fois en lui et hors de lui, se
transforme. Nous devons reconnaître nos limites, nos
entraves. Nous, les êtres humains, avons tellement de
limites ! La durée de notre vie, notre force physique,
nos connaissances (nos amis et notre savoir), notre
travail sont si limités ! En même temps, nous tâchons
de tirer le meilleur parti de ce dont nous disposons.
Je pense que nous avons tous les mêmes désirs :
être reconnus, informés, pouvoir exercer librement
nos droits, nous associer aux personnes et aux idées
qui nous intéressent. On peut espérer que, à la fin de
l’époque que nous vivons, ces valeurs essentielles de
l’existence seront préservées et protégées, peut-être
grâce à de nouvelles technologies et à de nouvelles
structures politiques. Mon souhait est que nos enfants
soient plus libres que nous ; et que nous mettions en
place des bases plus solides pour leur permettre de
réaliser leurs espérances et leurs rêves.
La seule façon d’avoir un impact sur le futur est
de tirer les leçons du passé et d’agir sur le présent. Le
futur, on le crée ; on n’attend pas qu’il arrive.
Imane AYACH
Pour moi, penser à 2050, c’est penser à l’avenir de
notre terre, où les problèmes politiques, économiques,
sociaux sont de plus en plus pressants. La population
augmente de jour en jour. Pourrons-nous tous nous
nourrir et vivre sereins et en paix ? C’est la question
majeure. Nous estimons que la population mondiale
dépassera les neuf milliards d’habitants en 2050, soit
plus autant de personnes à nourrir. Socrate a dit « le
secret du changement consiste à concentrer toute
ton énergie non pas à lutter contre le passé, mais à
construire le futur ». Notre monde a subi des famines,
des guerres, des épidémies, des chefs d’états dégra-
dants, certes. Mais le moindre de ses problèmes n’est
effectivement pas, selon moi, que nous nous préoccu-
pions plus de ce qui s’est passé que de ce qui va se
passer et surtout de réfléchir ensemble à une solution
pour vivre mieux. Or, s’il ne faut pas viser la perfection,
inaccessible, une amélioration est possible.
Albert Einstein a dit « Trois bombes menacent le
monde : la bombe atomique, qui vient d’exploser, la
bombe de l’information, qui explosera vers la fin du
siècle, la bombe démographique, qui explosera au
siècle prochain, et qui sera la plus terrible. » De fait, en
trois siècles, la Terre aura vu le nombre de ses habi-
tants augmenter par dix. Pour stopper cet accroisse-
ment, il faut que la fécondité soit exactement de deux
enfants par femme, ce qui stabilisera la population
mondiale à 9 milliards de personnes en 2050, ainsi que
nous l’avons déjà dit. Dans moins de quarante ans, les
êtres humains sauront maîtriser la hausse de la démo-
graphie. Mais faire vivre neuf milliards d’êtres humains
ne sera pas chose aisée. Nous devrons apprendre à
mieux gérer les ressources de la planète et à les parta-
ger de façon plus équitable. La survie de notre espèce
dépend plus de la façon dont les hommes vivront que
de leur nombre. Nous espérons juste que la vision
pessimiste de Malthus ne réalisera pas. Pour cet éco-
nomiste, la production de nourriture à tendance à aug-
menter moins vite que la population, car sa croissance
est linéaire, tandis que celle de la population est expo-
nentielle. Pour garantir une nourriture suffisante pour
tous, éviter les famines, il faut donc limiter le nombre
de personnes.
Tian Tian
ouvrant les portes.

3736 UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’AVENIR LES TÉMOINS
Paul Bradbury,
Stacked Cargo
Containers
Né en 1980 à
Livry-Gargan,
dans le
département
de Seine-
Saint-Denis,
de parents
marocains
arrivés en
France en
1975, Youness
Bourimech
a grandi à
Bondy au sein
d’une famille
d’entrepreneurs.
Très tôt – dès
l’âge de vingt
et un ans –, il a
créé sa première
entreprise dans
le garage de son
père. Depuis, ses
challenges se
sont diversifiés
et succédé,
portant à son
actif plusieurs
créations
d’entreprises
dans différents
secteurs
d’activité,
mais toujours
en banlieue
parisienne.
On peut, bien sûr, craindre que des systèmes lob-
byistes déjà en place, hostiles au nouveau modèle
économique qu’il porte, ne freinent le développement
de ce concept constructif. Et son essor peut aussi être
entravé, s’il ne bénéficie de l’aide déterminante d’une
politique volontariste de l’État.
Mais comment ne pas être convaincu par les atouts
si nombreux qu’offre ce mode de construction ?
Les avantages de la construction modulaire
L’un des intérêts de cette technique est sa rapidité
d’exécution. La mise en œuvre d’une construction
modulaire est trop fois moins longue que celle d’une
construction traditionnelle. Elle repose, en effet, sur la
préfabrication en usine de modules en bois ou en acier,
suivie de leur assemblage sur le chantier. De plus, un
processus de construction réalisé à près de 80 % en
usine autorise une bien meilleure gestion des déchets.
Totalement flexibles et adaptables à leur environne-
ment, les constructions modulaires peuvent aisément
être complétées par des extensions, et même dépla-
cées ou encore recyclées.
Non content d’être rapide et modulable, le procédé
présente aussi des avantages économiques. La standar-
disation du processus de fabrication en usine fait consi-
dérablement baisser les coûts : le prix se voit réduit de
moitié par rapport à une construction traditionnelle. Il
pourrait également être créateur d’emploi. Permettant
une plus grande rationalisation des techniques d’as-
semblage et de construction, il pourrait faire apparaître
des centres de préparation où serait employée une
main-d’œuvre pour partie différente de celle que mobi-
lisent habituellement les chantiers classiques.
Enfin, rappelons-le encore, car ce n’est pas la
moindre de ses qualités, la construction modulaire est
respectueuse de l’environnement. Elle édifie des bâti-
ments démontables en fin de vie (procédé construc-
tif d’assemblage) ; favorise les matériaux recyclables
(structure acier, bois…), l’autosuffisance énergétique,
les filières de valorisation (collecte et gestion des
déchets en usine) ; évite, grâce à l’industrialisation, les
nuisances de chantier (bruits, poussière, déchets, etc.).
Vivement 2050 !
Avec l’espoir de contribuer à de tels projets, par la
réflexion dans un premier temps, par l’action dans un
second temps, afin de laisser un monde meilleur à nos
enfants…
tion des traditionnels pays de départ et pays d’arrivée :
depuis l’Afrique, l’Amérique latine ou l’Asie du Sud-Est
vers l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord ou le
Moyen-Orient.
L’histoire nous met face à la fatalité des guerres et
des conflits religieux, ethniques ou politiques.
Des raisons d’espérer
Bien que dominantes, les énergies fossiles (pétrole,
charbon, gaz) perdent progressivement de leur supré-
matie en faveur des énergies renouvelables (hydrau-
lique, solaire, éolienne, etc.). Ces énergies nouvelles,
plus respectueuses de l’environnement, peuvent ali-
menter n’importe quel territoire aménageable. De
modes de production et de consommation plus res-
ponsables sont apparus, qui promeuvent les matériaux
recyclables, la gestion des déchets, le contrôle de la
pollution, la modularité des réalisations. Enfin, le fait
que les progrès technologiques, et en particulier la
domotique, soient de plus en plus accessibles permet
d’espérer les voir se démocratiser totalement et contri-
buer au bien-être de l’Homme.
Au service d’un grand idéal, une solution simple
et concrète : la construction modulaire
La construction modulaire à base d’acier ou de bois
est aujourd’hui une alternative évidente à la construc-
tion traditionnelle. Grâce à elle pourraient être bâties
les villes de demain, des villes éphémères. Ces villes
d’un nouveau genre seraient à même d’apporter une
réponse aussi bien aux états d’urgence provoqués par
une catastrophe naturelle qu’à la problématique du
logement. Formidable moyen de préserver la dignité
de l’Homme, ce type de construction ouvre donc des
perspectives d’avenir pleines d’espérances.
Diplômé de HEC,
Jean-Claude Boulet
débute comme
journaliste à l’AFP,
puis au département
marketing de
Procter & Gamble.
Il est ensuite
consultant en
communication
et en stratégie,
notamment dans
le groupe américain
Young & Rubicam.
En 1984, il crée
avec trois associés
l’agence de
publicité BDDP
(Boulet Dru Dupuy
Petit), devenue en
quelques années
le troisième groupe
français, avant
sa fusion avec
TBWA en 2001.
Jean-Claude Boulet
est un acteur
de la mondialisation
des entreprises,
des marques,
des concepts,
du numérique,
domaine dans lequel
il est toujours actif
en tant
que conseiller
en stratégie
et investisseur.
Mark Lewis, extrait
du film Downton :
Tilt, Zoom, & Pan,
2005, Paris, Centre
Pompidou, Musée
national d’art
moderne – Centre de
création industrielle
velles technologies de communication. De plus en plus
d’individus se sentiront citoyens du monde au moins
autant que citoyens de leur pays. La médecine,
l’infor-
matique, les biotechnologies, la robotique… auront
bien sûr encore progressé.
Je suis un fervent partisan de la mondialisation.
Je suis convaincu de ses bienfaits, de
l’intérêt de voir
apparaître ces citoyens du monde conscients des
enjeux à l’échelle de la planète. Mais, à mon avis, l’hu-
manité sera encore complètement dominée en 2050
par la religion matérialiste du « toujours plus », « tou-
jours plus vite », « toujours plus riche ». Donc le monde
va évoluer par à-coups. Quand les tensions seront trop
fortes, il faudra bien trouver des solutions. Ce sera
vraisemblablement possible pour des sujets
comme la
gouvernance de l’Europe, mais je crains, par exemple,
qu’en matière d’écologie
des dommages irréversibles
ne soient commis.
Face à cette course en avant, cette idéologie du
« toujours plus », il manquera
de la spiritualité, de la
solidarité, de la bienveillance, à l’échelle individuelle
mais aussi à l’échelle mondiale, pour réussir à vivre
ensemble en 2050 et au-delà. Je ne suis pas croyant,
néanmoins je pense que c’est en se souvenant des
enseignements du christianisme ou du bouddhisme,
notamment, qu’on peut espérer trouver les moyens de
faire coexister dix milliards d’hommes et de femmes
sur une planète qui est
extraordinaire.
Youness BOURIMECH
Quelle est ma vision pour 2050 ?
À partir de mon vécu et de mon environnement, je porte
un regard grave sur le monde et sur son évolution. Je
rejette les inégalités, condamne l’injustice et valorise
l’Homme. Si je dois imaginer 2050, cette vision se sou-
ciera nécessairement préserver la dignité humaine, qui
n’est pas aujourd’hui un acquis pour tous !
Un monde confronté à des dangers et à des défis
Les catastrophes naturelles, comme les plus récents
tsunamis en Asie ou le séisme de Port-au-Prince en
Haïti, devraient poursuivre leurs ravages, auxquels
il faudra ajouter les conséquences du réchauffement
climatique : montée des océans pour les décennies à
venir, avancée des déserts, assèchement des lacs ou
même des mers intérieures.
Les crises économiques, qu’elles soient régionales
ou mondiales, se succèdent et n’épargnent sur leur
passage ni les puissances mondiales ni les économies
les plus faibles.
Les flux migratoires, actuellement évalués à 3 %
de la population mondiale par les Nations unies, sont
destinés à croître, amenant probablement une redéfini-
Oui, il y a eu des changements majeurs, mais, pen-
dant la même période, beaucoup de
choses n’ont pas
évolué : les conflits entre les religions, le racisme, la
course au « toujours plus » entretenue par l’idée de
croissance économique, le terrorisme, l’égoïsme, l’ab-
sence de spiritualité, le triomphe du matérialisme, la
prépondérance de la finance… En fait, le monde s’est
transformé, mais l’Homme n’a guère varié.
Comment vois-je 2050 ? Très humblement et en espé-
rant sincèrement me tromper – qui suis-je, en effet, pour
parler de 2050 ?
La planète terre sera fatiguée, car l’écologie, le
développement durable n’auront fait que de modestes
progrès. Il y aura moins de ressources naturelles, plus
de pollution ; le réchauffement climatique se poursui-
vra. Faute d’une vraie
mobilisation planétaire autour
de cet enjeu.
L’Europe n’aura plus de croissance. Elle devra trou-
ver le moyen d’exister, de vivre sans
croissance. Elle
aura amélioré son fonctionnement, sa gouvernance
au fil des crises. Mais elle devra gérer cette absence de
croissance, le vieillissement de sa population, sa
pau-
périsation relative, des taux de chômage élevés. Dans
le reste du monde, des
milliards d’individus (Chine,
Inde, Indonésie, Russie, Afrique…) refuseront, quant à
eux, de
renoncer à accéder à tous les biens, tous les
conforts dont l’Occident jouit déjà depuis au moins un
demi-siècle. Cela entraînera des tensions économiques
majeures. On se battra encore plus qu’aujourd’hui pour
le contrôle des ressources naturelles, pour la conquête
de parts de
marché, peut‐être même pour des territoires.
L’alimentation sera devenue davantage écorespon-
sable, parce qu’on ne pourra pas nourrir neuf
ou dix mil-
liards d’individus avec les gaspillages d’énergie, d’eau,
d’aliments actuels. L’enseignement, la propagation du
savoir auront formidablement évolué grâce aux nou-

3938 UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’AVENIR LES TÉMOINS
Découper un
papier, cela
veut-il dire qu’on
peut isoler des
fragments ?
Ou que c’est
impossible ?
Ou qu’on peut
les assembler
autrement ? Un
mot, une date :
coupures. On
peut couper en
1967. Appeler
ça Colombie
britannique,
Canada. Ou
nommer ça
Geoffrey Farmer.
Le papier
découpé, mis
debout, dit
quelque chose de
la photographie,
d’un objet, d’une
vie, du retour
à un lieu non
académique. Livre,
représentation
artistique,
processus de
transformation,
récit. Comment
faire des
sculptures avec
des photos.
fut, il y a toujours une autre fois. Avez-vous déjà essayé
de vous tenir entre deux miroirs ? Vous devriez. Vous
verrez une longue ligne de miroirs brillants, de plus
en plus petits, qui s’étendent à perte de vue, de moins
en moins distincts, si bien que vous ne pourrez jamais
voir le dernier. Mais, même si vous ne pouvez plus les
voir, vous, la série des miroirs se poursuit, ils ne s’ar-
rêtent pas là (Gombrich, 2008, p. 2).
3. Franchement, le temps des pendules m’ennuie. Je
ne suis pas horloger. Ce qui m’intéresse est d’appré-
hender le temps dans son être non structuré. Je veux
dire par là que je m’intéresse à la façon dont cet animal
sauvage vit dans la nature – pas au zoo. Ce qui m’inté-
resse est la façon dont le temps existe avant que nous
ne mettions notre patte sur lui – avant que nous ne lui
imposions la marque de notre esprit, de notre imagina-
tion (Feldman, 2000, p. 87).
4. Dans ce recueil secret, il y aurait tout. Tout, c’est-
à-dire : l’histoire détaillée du futur, Les Égyptiens
d’Eschyle, le nombre exact de fois où les eaux du
Gange ont reflété l’ombre d’un faucon, la secrète et
vraie nature de Rome, l’encyclopédie que Novalis aurait
réalisée, mes rêves endormis et mes rêves éveillés du
14 août 1934 à l’aube, la démonstration du théorème
de Fermat, les chapitres non écrits du Mystère d’Edwin
Drood de Dickens, ces mêmes chapitres traduits dans la
langue des Berbères Garamantes, les paradoxes sur le
temps que Berkeley a inventés mais n’a jamais publiés,
les livres de fer d’Urizen, les épiphanies prématurées
du Stephen Dedalus de Joyce, qui ne prendront sens
qu’après un cycle de mille ans, l’évangile gnostique de
Basilide, le chant que chantaient les sirènes, le catalogue
complet de la Bibliothèque totale, et la démonstration
de son incomplétude. Tout. Et pour une seule ligne
sensée et une seule mention d’un fait réel, il y aurait
des milliards de cacophonies sans le moindre sens, de
dérapages verbaux, de borborygmes. Tout. Mais toutes
les générations humaines pourraient passer devant ces
rayons qui donnent le vertige – ces rayons qui éclipsent
la lumière du jour, ces rayons couverts de chaos – avant
qu’ils ne veuillent bien leur offrir la récompense d’une
seule page acceptable (Borges, 2001).
5. Je serais bien le dernier à professer le lieu commun
stupide que le chagrin ne sert à rien, qu’il faut éliminer le
chagrin. J’aurais honte d’offrir ces mots-là à quelqu’un
dans le chagrin. Et même les gens qui dans leur vie font
tranquillement, paisiblement, opportunément, pareille
démarche n’en gardent pas moins un peu de mélanco-
lie. Le chagrin est lié à quelque chose de beaucoup plus
profond, au péché originel, et au fait que nul ne peut
devenir parfaitement transparent pour lui-même.
6. Coupe le baiser de douces plèvres (lèvres ?). Douceur
humide, humide, humide et sucrée. Baiser apolitique,
baiser de sonorités, trempé d’air. Smack. Baiser pres-
sant. Le Baiser de Klimt. Baiser de Judas. Les belles
François
Desroziers est
âgé de vingt-six
ans. Après un
master de finance
à l’université
de Paris IX –
Dauphine, il
cofonde Spear,
une coopérative
de crowdfunding
solidaire
permettant aux
épargnants
de choisir la
destination
exacte de leur
argent parmi
une sélection
de projets
responsables,
et dont l’objectif
est de faciliter le
financement de
projets de création
d’entreprises
solidaires. Il est
également associé
de CapSens, une
société de conseil
en crowdfunding
et finance
solidaire.
Martin-
Guinard Terrin,
installation
Sans titre,
réflexions
possibilité de reprendre le pouvoir avec son argent, et
de financer le projet de son choix. Par cet outil, nous
pouvons désormais sélectionner les projets que nous
souhaitons voir naître, et contribuer tous ensemble à la
construction de notre société future.
Toutes ces initiatives me font sincèrement espérer que
cette prise de conscience est irréversible, et que nous
allons tous être amenés naturellement à consommer
de façon plus intelligente, à nous impliquer dans la vie
locale, et à agir en fonction de nos moyens personnels
pour construire le monde de demain.
Sortir de la caverne
À mon sens, l’œuvre de Martin Guinard-Terrin sym-
bolise le tournant auquel nous faisons face. Sa sculp-
ture met en scène une plaque de Plexiglas, qui laisse
entrevoir un reflet statique du spectateur. Derrière cette
plaque transparente se trouve un miroir en perpétuel
mouvement. Nous sommes tous face à ce miroir, à
regarder le reflet changeant du monde. Allons-nous
continuer à regarder le monde bouger autour de nous
ou allons-nous accepter de prendre le risque de le
construire comme nous l’imaginons ?
Aujourd’hui, nous avons tous les moyens d’agir et
de sortir de cette caverne moderne, pour devenir acteur
de notre vie et affirmer enfin notre vision du monde.
C’est cette expression du monde dans sa diversité
qui constitue notre richesse, et il s’agit désormais de
construire le reflet du monde que nous souhaitons.
Geoffrey FARMER
Nous sommes les passagers !
1. Rassembler des photos, c’est rassembler le monde
sous nos yeux. Les films et les images de la télévision
s’allument sur nos murs, les illuminent un instant,
puis disparaissent ; tandis que les images des pho-
tographies immobiles sont aussi des objets – légers,
peu coûteux à produire, faciles à transporter avec soi,
à collectionner, à conserver. Dans Les Carabiniers de
Godard (1963), deux apathiques paysans misérables
se laissent entraîner à rejoindre l’Armée du Roi par la
promesse qu’ils pourront piller, violer, tuer, faire tout
ce qu’ils voudront à l’ennemi, et devenir riches. Mais
la valise de butin que Michel-Ange et Ulysse ramènent
triomphalement chez eux, des années plus tard, à leurs
femmes, s’avère contenir uniquement des images :
des cartes postales par centaines de monuments, de
grands magasins, de mammifères, de merveilles natu-
relles, de moyens de transport, d’œuvres d’art et autres
trésors bien classés par catégories, venant des quatre
coins du globe (Sontag, 1980, p. 3).
2. Il était une fois. Et cela continue, en remontant de
plus en plus loin dans le temps. Sous chaque fois qui
que l’activité humaine continue d’avoir sur la nature.
Quand bien même nous en sommes conscients, nous
ne modifions pas nos comportements, par fainéantise,
au mépris des générations futures. Cette crise éco-
logique est en cours, et sans changement rapide de
notre part, sera génératrice de tensions climatiques,
humaines et géopolitiques. On estime à plus d’un mil-
liard le nombre de réfugiés climatiques d’ici à 2050.
L’Homme risque également de se déconnecter de
son écosystème au sens large en se refermant sur
lui-même et sur ses propres intérêts. Le signe le plus
apparent de cette déconnexion est la diminution de
l’engagement politique dans de nombreux pays. Ce
phénomène est symptomatique du repli sur soi et du
désir de s’abstraire du reste de la société. Je redoute
de voir naître une société de résignés, dénués de toute
croyance en l’intérêt général.
Enfin, on parle souvent de la déconnexion entre
l’économie réelle et la sphère financière. Cette rupture
s’est déjà produite très brutalement il y a quelques
années, du fait d’un manque de transparence consi-
dérable. En l’absence de contrôle ou de pouvoir des
individus sur la finalité de leur argent, de nombreuses
institutions ont confisqué la capacité d’action offerte
par la finance. Ma crainte est que ce phénomène s’am-
plifie, et que des « hyper-agents » continuent de s’acca-
parer le pouvoir d’agir du plus grand nombre.
L’espoir d’une prise de conscience orientée vers l’action
Les nouvelles capacités d’action sont aussi le fruit d’une
information et d’un savoir devenus de plus en plus acces-
sibles et compréhensibles. Pour agir, il est nécessaire
d’être éclairé, et, à cet égard, le web concrétise le rêve
des Lumières. Il permet à tout un chacun de s’informer
et d’apprendre plus facilement, à l’image de Wikipédia
ou des MOOC (Massive Open Online Courses).
Ma principale espérance pour le futur est que cette
nouvelle forme de diffusion du savoir ouvre les yeux
de l’Homme sur la nécessité d’agir pour autrui. De
nombreuses initiatives prouvent que ce mouvement
est déjà en marche.
La consommation collaborative change radicalement
notre mode de fonctionnement, et transforme notre
économie de la propriété en une économie tournée vers
l’usage. Ainsi, nous avons un impact moindre sur l’envi-
ronnement et tissons une nouvelle forme de lien social.
De même, la démocratie participative ou d’autres
formes d’engagement citoyen qui apparaissent sur les
réseaux sociaux permettent cette prise de conscience
de l’autre. Proposer une idée pour améliorer la vie de
son quartier ou financer une initiative locale est désor-
mais possible, et change radicalement notre vision de
l’action citoyenne.
Le crowdfunding (financement participatif) est éga-
lement une innovation majeure, qui offre à chacun la
François DESROZIERS
Imaginer le futur est un exercice difficile, qui nécessite
de faire l’effort de se repenser au présent, tout en se
détachant de l’immédiat. L’enjeu est ici de réussir à
prendre du recul pour se resituer sur une échelle de
temps plus vaste.
En observant les évolutions du
xx
e siècle, nous pre-
nons conscience de deux phénomènes importants :
l’accélération du temps et l’augmentation des capaci-
tés individuelles. Grâce aux progrès technologiques,
l’Homme s’est émancipé de nombreuses contraintes
(naturelles, sociales, techniques...), et il a pu explorer
ou entreprendre, dans un nouveau champ des pos-
sibles. De même, le monde s’est ouvert, permettant
de voyager, d’échanger ou de travailler dans presque
tous les endroits de la terre. Ce monde est devenu
plus connecté, globalisé et s’est massifié. Cependant
l’Homme s’est petit à petit retrouvé tout seul au milieu
de ce gigantesque ensemble.
La perspective de ces différents éléments fait naître
en moi une crainte réelle, celle d’une déconnexion de
l’Homme avec son environnement. Face à cette massi-
fication, il développerait en réaction un individualisme
défensif, et s’isolerait dans sa conscience de lui-même.
Pour autant, cette appréhension est contrebalancée
par un espoir majeur, qui est que l’Homme se rende
compte de la nécessité de l’Autre, et qu’il utilise ces
nouveaux outils pour s’ouvrir rationnellement à lui.
Le risque d’une déconnexion
Ma principale crainte pour 2050 est donc un risque de
déconnexion entre l’Homme et son environnement,
que ce terme désigne la nature ou bien l’écosystème –
au sens large – des individus (vie sociale, travail...).
Ce danger s’est déjà matérialisé de façon évidente
par le changement climatique et les impacts négatifs

4140 UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’AVENIR LES TÉMOINS
Norman Foster
est le fondateur
et le président de
Foster + Partners,
groupe
international
d’architecture,
de design et
d’ingénierie, qui
depuis quatre
décennies mène
une action
pionnière pour une
approche durable
de l’architecture
et de l’écologie,
à travers un
large éventail
de réalisations
allant des plans
d’urbanisme à
la conception
de bureaux,
d’infrastructures
et de complexes
industriels. En
1999, 21e lauréat
du Pritzker
Architecture Prize,
Norman Foster a
été honoré de la
pairie à vie, avec
le titre de « Lord
Foster of Thames
Bank ».
Dans Une brève histoire de l’avenir, Jacques Attali
envisage une forme d’hypercapitalisme qui ne fera
qu’élargir la fracture entre une riche élite et des pauvres
marginalisés. On rencontre dans peu de villes au
monde une différence de niveaux de vie plus extrême
qu’à Mumbai, où, d’un quartier à l’autre, les salaires
peuvent varier du simple au centuple. Il y a sept ans,
nous avons mis en place un projet visant à améliorer
la qualité de vie des habitants de Dharavi, l’une des
plus grandes zones de logements précaires de la ville.
Avec un million de personnes entassées dans moins de
deux kilomètres carrés, Dharavi est dix fois plus den-
sément peuplé que les quartiers les plus populaires
de Londres, la majorité des résidants étant logés dans
des habitations à un seul étage. Les commodités sani-
taires de base sont réduites, avec une seule installation
de toilettes pour 1 400 personnes ; et le manque d’es-
pace est tel que les enfants font leurs terrains de jeu
au milieu des cimetières et des rails de chemin de fer.
Bien que Dharavi soit souvent étiqueté comme
« bidonville », nous nous sommes aperçus que ceux
qui y vivent utilisent rarement ce terme – la réalité est
bien plus complexe. C’est une zone industrielle, où ont
recyclés 80 % des déchets de Mumbai, et où les petites
entreprises de produits manufacturés sont florissantes.
Quand nous configurons à travers le monde, en tant
qu’architectes, des rues et des espaces publics, notre
but est toujours d’encourager la vie et l’activité. Or à
Dharavi, les rues sont utilisées de façon naturelle par
la communauté comme des lieux de socialisation et de
travail. Nous avons trouvé là une société d’une bonne
cohésion, très soucieuse d’une éducation qui fait sa fier-
té. Elle avait certes un besoin urgent d’infrastructures
de base, d’une amélioration de l’habitat et des condi-
tions sanitaires ; mais elle possédait aussi de nombreux
aspects positifs, que l’on ne veut pas toujours voir.
Notre projet fournit un cadre pour un processus
de régénération enrichissante, durable et humaine,
qui fasse de Dharavi une partie intégrante de la pros-
périté croissante de Mumbai, au lieu de considérer
ce quartier comme un barrage au progrès de la ville.
Cette approche, fondée sur le respect de la commu-
nauté existante, constitue une alternative radicale à
la méthode traditionnelle de tout raser au bulldozer,
de déraciner la structure sociale et de repartir à zéro –
protocole qui a toujours échoué jusqu’ici. Témoins de
ces échecs, les immeubles d’habitation de quatorze
étages, aujourd’hui vides et abritant les uniques toi-
lettes… Ils ont été construits par le gouvernement local
afin d’améliorer les conditions de vie, mais leur haute
verticalité n’a pas tenu compte de l’étalement horizon-
tal de la société, et ne correspond pas à sa structure
particulière : intrication des lieux de vie et de travail,
importance de la rue et liens communautaires étroits
développés à la faveur des lieux de rencontre publics.
commence. Un torse, une narine, du liquide dans un
œil, un ongle incarné au bout d’un doigt. Clic. Griffes,
coagulation, grincements, tintements, la stimulation
de l’eau qui coule, de la vaisselle entrechoquée. Clic,
clac. Rouge, noir, blanc, noir, pourpre, noir, noir, noir.
Disant au revoir de la main, créant des constellations
de lieux où nous demeurons en orbite, puis disparais-
sant un bref instant pour revenir et y rester. Puis res-
tant là tout en nous déplaçant. Sans oublier les lourds
présents des lieux où il est impossible de ne pas rester.
Et puis, finalement, les lieux que nous pouvons seu-
lement aller chercher à de grandes distances. Nous
projetant nous-mêmes au télescope loin de notre tête
prise de tournis. Notre tête ! Elle s’est retrouvée en haut
d’un escalier, a obliqué pour prendre un taxi. Nous a
ordonné de nous arrêter. Nous sommes les passagers.
Nous frissonnons en traversant la psychologie du vide,
la noirceur caustique, désespérée, de la douleur para-
lysante, écrasante. Nous supportons les intempéries,
les nuées et les échauffourées, les feux inconscients…
tels qu’ils sont définis par… les calculs servant à com-
bler l’espace entre le proche et le lointain. Donc, nous
voudrions voler, mais ne savons pas voler. Et pourtant,
nous volons. Oui, nous les passagers. Nous y allons
en traînant les pieds, mais nous y allons, poussant nos
charrettes, nos camions, nos liquides, nos chaussures,
nos boîtes, nos papiers. Nous sommes intenables.
Nous explosons, nous menaçons. Nous ouvrons des
portes, appuyons sur des leviers, nous nous sommes
réduits à rien et faisons sortir de nous des avions
énormes… nous détruisons des villages. La tête ! Le
bras, les jambes de l’avion. Et puis, quelque part, on
soulève quelqu’un de son lit, il se défait lentement, se
dessèche, se réduit en fumée, en puanteur, en mots
dégoulinants sur les lèvres des autres. Dernier soupir.
Bouche ouverte. Gasp !
Extraits du guide numéroté accompagnant l’installation Boneyard
(Ossuaire), qui rassemble 813 formes découpées dans du papier :
images de sculptures allant de 1100 avant J.-C. aux années 1970. Ces
images proviennent d’une collection de cartons à dessins d’acadé-
mies d’art, intitulés Capolavori della scultura (Chefs-d’œuvre de la
sculpture), qui servaient jadis à étudier la sculpture.
Lord FOSTER
À aucun autre moment de l’Histoire, les gens n’ont été
plus nombreux à vivre dans les villes qu’aujourd’hui ;
on estime que, en 2050, 70 % de la population mon-
diale sera urbaine. Si nous voulons prévoir le futur de
la société humaine, nous devons nous pencher sur la
nature de ces villes, pour la simple raison que l’espé-
rance de vie, la mortalité infantile, l’éducation, l’éman-
cipation sexuelle et politique dépendent des services
vitaux que représentent l’électricité, les égouts, l’ad-
duction d’eau potable.
d’ombre se déplace imperceptiblement au cours de
son trajet quotidien. Mais, si le son a pour nature d’être
presque la nature, observons notre cadran solaire au
moment où il n’y a plus de soleil, et où il y a cepen-
dant beaucoup de lumière. Paradoxalement, c’est à
ce moment-là que le temps nous échappe le moins.
Toutes les ombres ont disparu, nous laissant un objet
fané. En ces instants-là, le temps lui-même est moins
perçu comme un mouvement que comme une image.
Dans le premier cas (en plein soleil), notre temps-son,
scruté par une lumière mesurable, est voué à prendre
la forme fixe d’une mélodie. Dans le second cas (en
l’absence de soleil), le temps s’est transformé en son
pur. Il y a encore du mouvement, mais il est désormais
réduit à la respiration du son lui-même.
12. La Lecture de la tête de pierre, dite aussi
L’Explication de la tête de pierre. L’expert : « Cette tête,
cette tête de pierre… Cette tête, cette tête de pierre…,
etc. » Derrière, vous pouvez aussi voir les deux têtes de
métal. Cette sculpture bipartite pose un autre type de
problème. Un problème de relation, comme on parle
de relation entre deux personnes. Cela change complè-
tement une fois que vous l’avez divisée en trois.
13. Le sentiment subjectif que votre partenaire a violé
les règles ou les normes qui régissent une relation.
14. L’expression qui fait comme si : aujourd’hui.
15. Le livre dont émergent toutes les figures.
16. Petite Maternité debout, 1910-1914. Nous devons
entrer dans l’esprit du personnage : ici le défi est de
situer cette figure dans l’espace humain, de trouver ce
qu’il/elle représente par rapport à d’autres personnes,
d’autres personnalités humaines ; si vous y arrivez,
vous avez gagné. Le sujet est situé dans le royaume
des morts qui continuent à vivre.
17. Où, dans ce vaste monde, l’homme peut-il trouver
noblesse sans orgueil, amitié sans envie, ou beauté
sans vanité ? Ici. Là où la grâce est cousue de muscles
et la puissance tempérée par la gentillesse. Il sert sans
servilité ; il a combattu sans haine. Il n’existe rien d’aus-
si puissant, rien de moins violent, rien d’aussi rapide,
rien de plus patient. Il porte sur son dos tout le pas-
sé de l’Angleterre. Notre histoire est son œuvre ; nous
sommes ses héritiers, il est notre héritage. Le Cheval !
18. Le mémorial ne fera pas seulement mémoire des
victimes, il célébrera l’héroïsme qui a succédé aux
attaques, et la détermination de notre nation à vaincre.
19. Ces sculptures font entendre des craquements, qui
se poursuivent pendant toute la durée de l’exposition.
Un bon nombre de ses sculptures sont perdues ou
détruites.
20. Nous commençons notre journée en nous dépla-
çant de par notre propre volonté. Certains dans des
fauteuils roulants, d’autres à pas lents vers la cuisine,
traînant des vêtements un peu partout. Traînant des
vêtements, les agrippant, les tirant et les étirant. Ça
couleurs d’un baiser : Giotto. Un baiser dans la chapelle
des Scrovegni. Kataphilein (embrasser). Tendrement,
chaudement.
7. La Bureaucratie de l’inconscient (le début du surréa-
lisme).
8. Sans les rêves, les humains n’auraient pas eu l’oc-
casion de diviser le monde. L’extrême clarté de toutes
les idées-rêves, qui présuppose une foi incondition-
nelle en leur réalité, nous rappelle l’état antérieur de
l’humanité, dans lequel les hallucinations étaient très
fréquentes, et tenaient parfois sous leur emprise des
communautés, des nations entières en même temps.
Cette clarté peut illuminer, progressivement, pas à pas,
l’histoire de l’origine de ce monde en tant qu’idée – et
nous élever, du moins par moments, au-dessus de l’en-
semble du processus (Friedrich Nietzsche).
9. Il crée un récit combinant faits personnels et faits
historiques d’échelles et de contenus très différents,
présentant une histoire culturelle libre, c’est-à-dire
qui rassemble des objets sans les chapeauter par une
structure linguistique, par une « lecture ».
10. Quarante jours et quarante rêves
Sombres visions troublant la raison
La philosophie ne peut apaiser l’âme
Mais on saura la vérité dans le miroir
Je te montrerai tes terreurs
Regarde juste le miroir
11. Et, comme on dit, le temps passe et le jour suit son
cours. Et, comme on dit aussi, le temps dénoue les
situations complexes. Et, comme on dit encore, ce qui
nous reste est le visage de la pendule, et pas son méca-
nisme intime. Le temps, dans sa relation au son, n’est
pas sans rapport avec un cadran solaire dont l’aiguille
Geoffrey Farmer,
Boneyard
(détail : Germaine
Richier, Il Menhir,
1956-1959, bronze
polychrome),
2014.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%