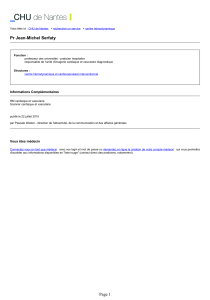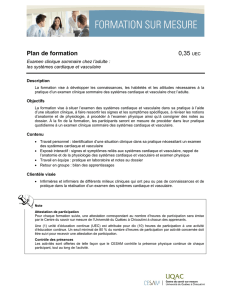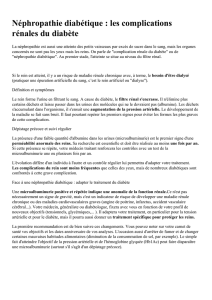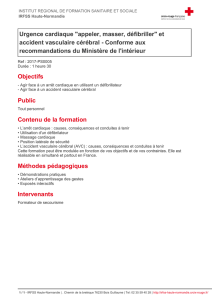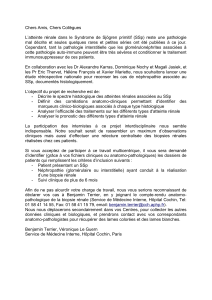Médecine vasculaire plus

97
Médecine vasculaire plus
La néphropathie ischémique correspond à une perte
progressive de la masse néphronique fonctionnelle,
secondaire à une sténose ou à une obstruction des
artères rénales tronculaires et/ou intrarénales préglo-
mérulaires (1-6). Le terme de néphropathie vasculaire
est un terme beaucoup plus général puisqu’il englobe
la néphropathie ischémique, les lésions de néphroan-
giosclérose, les lésions d’athérome intrarénal et les
lésions propres aux emboles de cholestérol (2, 7).
La néphropathie vasculaire athéromateuse (NVA) est
une cause croissante d’insuffisance rénale chronique
en raison du vieillissement de la population et de
l’amélioration de la prise en charge des maladies car-
diovasculaires (1, 2, 8-11). La NVA est un problème
de santé publique de plus en plus préoccupant puisque
si l'on se réfère à la base de données américaine
concernant la période 1991-1995 (8), cette pathologie
est retrouvée chez 12 à 14 % des nouveaux patients
entrant dans un programme de dialyse, soit 14 % des
insuffisances rénales chroniques (1). Ces chiffres sont
comparables à ceux publiés par Mailloux en 1988
(10). C’est la NVA qui va conditionner le pronostic de
la maladie et le succès d’une éventuelle angioplastie,
d’une sténose artérielle associée (3).
L'objectif pour les années à venir ne sera pas tant de
diagnostiquer les sténoses rénales, car les techniques
de dépistage se sont considérablement améliorées,
mais sera surtout d’identifier des marqueurs d’atteinte
rénale réversible qui permettront d’adapter la prise en
charge thérapeutique et d’éviter l’évolution vers l’in-
suffisance rénale terminale. Ces notions font ainsi réfé-
rence au concept de protection néphronique dont l’ob-
jectif principal est de protéger le capital néphronique
en prévenant la survenue de lésions rénales fixées.
Un certain nombre de marqueurs de la néphropathie
vasculaire sont actuellement à notre disposition mais
ils sont pour la plupart trop tardifs, témoignant de
lésions le plus souvent déjà évoluées.
Marqueurs cliniques
et biologiques
Ces marqueurs ne sont pas spécifiques de la
néphropathie vasculaire ni de la sténose rénale.
C’est leur présence dans des situations cliniques à
risque qui doit faire poursuivre les investigations
complémentaires à la recherche d’une pathologie
vasculorénale (11-17). Certaines situations cli-
niques comme l’insuffisance rénale rapidement
évolutive, les œdèmes pulmonaires répétés, l’HTA
réfractaire au traitement, l’HTA maligne et certains
paramètres biologiques, comme la protéinurie
supérieure à 3 g/24 heures, ou encore la créatinine
plasmatique supérieure à 30 mg/l sont ainsi des
marqueurs de néphropathie vasculaire évoluée (5,
11, 14, 16, 17). À l’inverse, une protéinurie non détec-
table, une micro-albuminurie inférieure à 200* g/ mn,
une créatinine plasmatique comprise entre 15 et 30
mg/l ou encore l’aggravation datée de la fonction
rénale sous traitement antihypertenseur sont de
meilleurs pronostiques et peuvent inciter à une revas-
cularisation en présence d’une sténose rénale signifi-
cative (5, 11,14, 16-18).
La microalbuminurie traduit l’existence de lésions
vasculaires fixées et sa présence est associée à un
moins bon résultat clinique de la revascularisation
(18). La microalbuminurie est donc plus un mar-
queur de sévérité de la néphropathie vasculaire
qu’un marqueur diagnostique précoce.
La créatininémie et sa clairance font partie des mar-
queurs biologiques les plus couramment utilisés
pour la prise en charge de la néphropathie vasculai-
re. Mais en étudiant la filtration glomérulaire glo-
bale des deux reins, la clairance de la créatinine
plasmatique sous-estime en réalité l’atteinte fonc-
tionnelle du rein sténosé, ce d’autant que le rein
controlatéral va présenter une hyperfiltration com-
pensatrice. Pour les mêmes raisons, elle n’évalue
pas non plus précisément la récupération fonction-
nelle du rein revascularisé (1, 15, 19, 20, 21).
Par conséquent, ces marqueurs cliniques et biolo-
giques ne sont pas appropriés pour le dépistage pré-
coce de la néphropathie vasculaire.
*Service de médecine
interne et HTA, hôpital
cardiologique, CHRU,
Lille.
** Service de chirurgie
vasculaire, hôpital car-
diologique, CHRU,
Lille.
*** Service de radiolo-
gie vasculaire diagnos-
tique et interventionnel-
le, hôpital cardiolo-
gique, CHRU, Lille.
Évaluation de la néphropathie vasculaire
athéromateuse chez le patient hypertendu
Claire Mounier-Vehier*, Olivier Jaboureck*, Stephan Haulon**, Valérie Boivin***, Alain Carre*, Jean-Paul Beregi***
I
l est nécessaire en préambule et pour la clarté de l’exposé de bien
définir les termes qui vont être utilisés par la suite. La pathologie
vasculorénale athéromateuse est en effet une entité complexe qui
associe : 1. les sténoses exo-rénales des artères rénales ; 2. leur reten-
tissement d’aval sur le rein ; 3. les lésions distales dues à la localisation
intrarénale de la maladie athéromateuse ; 4. les lésions dues aux
emboles de cholestérol (1-3)..
Médecine vasculaire plus
1
/
1
100%