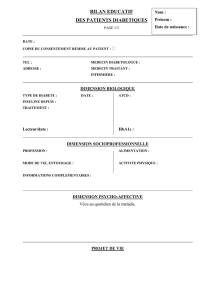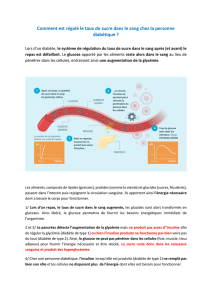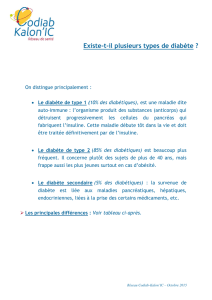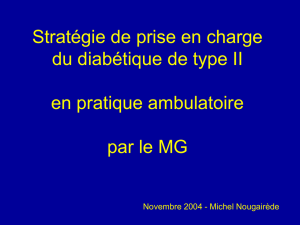U n e r é a l i...

© Alix/Phanie
© Lille/Phanie
L
e diabète sucré est un des
premiers responsables du
“risque cardiovasculaire”. C’est
un des fléaux de nos sociétés occi-
dentales, car il est cause de compli-
cations qui altèrent le quotidien des
sujets touchés et est responsable
d’un nombre considérable de
décès. Pour les points importants,
quatre aspects essentiels qui sans
être exclusifs peuvent être souli-
gnés : la fréquence croissante du
diabète sucré, son meilleur dépis-
tage, la sensibilisation aux nécessi-
tés de prise en charge et les progrès
thérapeutiques.
Un symptôme biologique
L’inflation glycémique n’est qu’un
symptôme biologique qui relève
de mécanismes physiopatholo-
giques variés. Deux entités domi-
nent la scène : le diabète de la
maturité, dit de type 2, qui relève
d’un mécanisme composite asso-
ciant la résistance tissulaire à l’ac-
tion de l’insuline et un défaut rela-
tif de l’insulinosécrétion, d’une
part, et le diabète de type 1, par
insulinopénie absolue liée à la
destruction des cellules ß des
îlots de Langerhans pancréatiques
responsables de la production
d’insuline, d’autre part. Si le dia-
bète de type 1 a une incidence
relativement constante, le type 2
voit sa fréquence s’accroître de
façon exponentielle dans les pays
industrialisés, dont le nôtre.
Modes de vie aberrants
Pourquoi ? Parce qu’à une prédis-
position polygénique s’associent
des phénomènes révélateurs,
parmi lesquels dominent les
aberrations diététiques et la
sédentarité. Ces deux facteurs
essentiels ont pour conséquence
une tendance au surpoids et,
consécutivement, à “l’insulinoré-
sistance”, élément géniteur clé de
l’inflation glycémique et de ses
redoutables complications. Par
ailleurs, l’abaissement du seuil de
glycémie défi
nissant le diabète
sucré (< 1,26 g/l
à jeun, soit 7
mmol/l, et/ou 2 g/l en postpran-
dial, soit 11 mmol/l) participe à
cette inflation de la fréquence du
diabète. Il ne s’agit pas là d’une
vue alarmiste mais bien d’une
reconnaissance plus précise du
rôle délétère de l’élévation glycé-
mique sur le risque de complica-
Diabète sucré
Une réalité galopante
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004
Sommaire
•Poids économique et social
•Diabète de type 2
•Insulines
•Insulinorésistance
•Diabète et grossesse
•HTA et hypercholestérolémie
•Artériopathie
•Affections oculaires
•Insuffisance rénale
•Activité physique et nutrition
•Obésité
>> DOSSIER
DIABÈTE
17
Dia = à travers, beten = passer. L’éthymologie du mot
diabète décrit bien la réalité pathologique. À l’instar du
diabète insipide, où le rein laisse échapper l’eau, ou du
diabète sodé de l’addisonien incapable d’empêcher la
fuite sodée, le diabète sucré est caractérisé par l’impos-
sibilité pour l’organisme de retenir le glucose. Ce dernier
suit un chemin de traverse sans être utilisé. Les consé-
quences directes ou non en sont multiples, infectieuses,
dégénératives et surtout vasculaires. Le diabète sucré
est une réalité galopante aux objectifs thérapeutiques
heureusement de mieux en mieux ciblés.
>>
Réalisé avec la participation de notre publication
Métabolismes Hormones
Diabètes et Nutrition
M
étabolismes
H
ormones
M
étabolismes
H
ormones
et
utrition
N
N
D
iabètes
D
iabètes

tions, notamment oculaires et
cardiovasculaires. Le diabète de
type 2 est aujourd’hui bien sou-
vent identifié lorsqu’il a déjà
engendré ses complications vas-
culaires. Le challenge est donc à
la fois de le dépister précoce-
ment, de prévenir ses complica-
tions et, de façon optimale, d’em-
pêcher son apparition chez des
sujets prédisposés.
Traitements
Le dépistage ne repose pas sur
la détection de la glycosurie,
mesure de l’âge des “goûteurs
d’urines” des siècles passés,
mais sur la détermination de la
glycémie à jeun, qui est heureu-
sement de plus en plus usuelle
dans les bilans biologiques
actuels.
Une fois identifié, le diabète
impose un traitement pour en
prévenir, à juste titre, le retentisse-
ment. Application de règles diété-
tiques (suffisamment adaptées
au patient pour être suivies),
réduction de la sédentarité et, si
besoin, action médicamenteuse
contre l’insulinorésistance repré-
sentent une première approche.
Dans cet objectif, la metformine
et les plus récemment dispo-
nibles thiazolidinediones repré-
sentent des armes thérapeu-
tiques de choix. Il s’agit là d’une
première mesure de prévention
des complications. Lorsqu’à l’insu-
linorésistance s’associe un déficit
relatif de la production d’insuline,
le recours à des médications sti-
mulant l’insulinosécrétion par les
cellules ß des îlots de Langerhans
devient légitime. C’est l’objectif
de la prescription de sulfamides
hypoglycémiants. À ces outils,
dont certains sont déjà anciens,
s’adjoindront dans un proche ave-
nir d’autres médications insulino-
sécrétrices comme les analogues
du GLP-1 (Glucagon-Like Pep-
tide), puissant stimulant physiolo-
gique de la sécrétion d’insuline.
La cellule ß langerhansienne n’est
cependant pas inépuisable, et le
recours à l’apport exogène d’insu-
line s’avère de plus en plus sou-
vent nécessaire pour l’obtention
d’un meilleur équilibre glycémi-
que. En attendant l’insuline orale
ou nasale, encore du domaine de
la recherche thérapeutique, l’insu-
linothérapie optimisée par pompe
externe ou implantable (couplée
à un capteur de détection du glu-
cose) se développe et a pour
objectif l’obtention d’un équilibre
glycémique le plus physiologique
possible, toujours dans le but de
prévenir les complications dégé-
nératives. Au demeurant, celles-ci
nécessitent une approche théra-
peutique spécifique incluant anti-
hypertenseurs, néphro-protecteurs
(comme les inhibiteurs de l’en-
zyme de conversion ou les anta-
gonistes de l’angiotensine II),
antiagrégants plaquettaires et hy-
polipémiants. Dans ce dernier do-
maine, les inhibiteurs de l’HMG-
COA réductase (les “statines”) ont
démontré, dans de nombreuses
études prospectives, leur effica-
cité dans la prévention des acci-
dents cardiovasculaires chez les
diabétiques. Les progrès obtenus
dans le domaine des greffes de
cellules ß pancréatiques sont in-
discutables, mais les possibilités
restent à ce jour limitées aux dia-
bètes de type 1 incontrôlables par
les autres méthodes thérapeu-
tiques. Le reconditionnement de
cellules souches en cellules insuli-
nosécrétrices est d’un avenir pro-
metteur, mais est encore du
domaine de la recherche.
Détection précoce
Dans l’immédiat, la meilleure
approche reste donc celle d’une
détection précoce du diabète,
d’une éducation du patient,
étape où le rôle de l’infirmière
est essentiel, et d’une optimisa-
tion de l’équilibre glycémique à
l’aide de la diététique, de la pro-
motion de l’exercice physique et
des médications stimulant ou
mimant la sécrétion d’insuline
et/ou luttant contre l’insulinoré-
sistance. Il s’agit là, en effet, d’un
facteur pathogène majeur dans
l’apparition des complications. Si
les progrès dans les thérapeu-
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004
tiques du diabète avéré sont
considérables, le meilleur traite-
ment en reste la prévention
(ainsi que celle de ses complica-
tions) associée aux efforts d’édu-
cation à la santé. L’éducation et la
responsabilisation des patients
sont dans ce domaine des fac-
teurs essentiels. Une telle poli-
tique devrait, à terme, porter ses
fruits.
Pr Jean-Marc Kuhn
rédacteur en chef de Métabolismes,
Hormones, Diabètes et Nutrition
Service d’endocrinologie, diabète et maladies
métaboliques, CHU Rouen.
Infos ...
Les îlots de
Langerhans
En 1869, Paul
Langerhans décrivit
les îlots qui portent
son nom et qui
sécrètent l’insuline.
À cette époque,
on n’avait pas
encore individualisé
l’insuline
et on disait :
“Le diabétique,
s’il ne se soigne pas,
sera emporté
par la tuberculose ;
s’il se soigne,
il succombera au
coma
acétonémique.”
Source Alfediam
DOSSIER
18
>>
>> DOSSIER
Un peu d’histoire
Susruta, dès l’Antiquité, évoquait
ce qu’il appelait : “l’urine de
miel, cette maladie qui frappe
les riches... le malade maigrit, se
fatigue, la soif est importante,
les mictions nombreuses. Les
fourmis s’attroupent autour de
l’urine, les infections sont fré-
quentes”.
Au cours des siècles, on comprit
que le pancréas était l’organe
nécessaire pour la régulation de
la glycémie.
En 1855, Eduard von Jaeger
décrivit une rétinopathie diabé-
tique et en fit le dessin ; on y
voit des exsudats et des hémor-
ragies. Le développement de
l’ophtalmoscope permit l’essor
de l’examen du fond d’œil du dia-
bétique.
Avec l’utilisation de l’insuline en
1923 par Banting et Best, qui
leur valut le prix Nobel, le traite-
ment du diabète s’améliora
nettement à compter de cette
date.
Le premier vrai traitement de la
rétinopathie diabétique (RD) fut
fait par Meyer-Schwickerath
dans les années soixante, par
photocoagulation. L’introduction
de l’angiographie fluorescéi-
nique permit de mieux définir
les stratégies thérapeutiques.
Source Alfediam

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004
Le diabète prélève une part
toujours plus importante
des budgets nationaux de
la santé alors que le nombre de
ceux qui en sont atteints aug-
mente partout dans le monde. Or,
en l’absence de prévention pri-
maire, l’épidémie de diabète va
continuer de s’étendre. En 1985,
on estimait à 30 millions le nom-
bre des diabétiques dans le mon-
de. En 1995, il était monté à
135 millions et, selon les der-
nières estimations de l’OMS, il
était de 177 millions en 2000 ; il
devrait atteindre au moins les
300 millions d’ici à 2025. Le
nombre de décès attribués au
diabète a été estimé à un peu
plus de 800 000, mais on sait
depuis longtemps que ce chiffre a
été largement sous-estimé. En
réalité, il est plus probable qu’il se
situe aux alentours de 4 millions
de morts par an, soit 9 % de la
mortalité totale. La plupart de ces
décès se produisent à un âge pré-
maturé où les personnes sont
encore économiquement actives
dans la société.
Les différents coûts
Les coûts du diabète ne sont pas
seulement d’ordre financier. Ils se
mesurent d’abord en souffrances,
inconfort, anxiété et autres désa-
gréments diminuant la qualité de
vie. Ainsi, le diabétique peut
devoir renoncer à certaines activi-
tés pour se faire soigner, faire
l’objet de mesures discrimina-
toires à son travail, avoir davan-
tage de difficultés à trouver un
emploi et voir sa vie profession-
nelle abrégée en raison des com-
plications entraînant des incapaci-
tés prématurées, voire la mort.
Les relations sociales, les loisirs, la
mobilité peuvent aussi être entra-
vés. Enfin, le traitement du dia-
bète, notamment l’injection d’in-
suline et les contrôles, peut
demander beaucoup de temps et
entraîner des désagréments et de
l’inconfort.
En ce qui concerne les coûts
matériels proprement dits, on
peut distinguer les coûts directs et
les coûts indirects. Les coûts
directs atteignent en premier les
malades et leurs familles. Ce sont,
entre autres, ceux des soins mé-
dicaux, des médicaments, de l’in-
suline et autres dispositifs. À cela
peut s’ajouter, par exemple, un
relèvement des cotisations d’as-
surance vie et d’assurance auto-
mobile.
En second lieu, pour l’Assurance
maladie, les coûts directs englo-
bent ceux des services hospita-
liers et des prestations médicales,
des examens de laboratoire et de
la prise en charge quotidienne
(insuline, seringues, agents hypo-
glycémiants administrés par voie
orale, analyses de sang, etc.). Ils
deviennent extrêmement élevés
quand il s’agit d’hospitalisations
de longue durée nécessaires au
traitement des complications.
Dans la plupart des pays, les hos-
pitalisations pour les complica-
tions à long terme (accidents vas-
culaires cardiaques ou cérébraux,
insuffisance rénale, pathologies
des membres inférieurs) repré-
sentent le poste le plus important
de dépenses relatives au diabète.
Certains coûts dits indirects sont
induits par la diminution de la
productivité. En effet, certains dia-
bétiques ne sont plus en mesure
de travailler ou, du moins, de tra-
vailler aussi efficacement qu’avant
leur maladie. D’où les congés
maladie, les incapacités, les mises
à la retraite anticipée et les décès
prématurés liés au diabète, etc.
Il n’est certes pas facile d’estimer
les coûts de cette perte de pro-
ductivité pour la société, mais ils
existent.
La prévention
Pourtant, en diagnostiquant rapi-
dement le diabète, en informant
efficacement les patients et les
professionnels et en assurant des
soins globaux sur le long terme,
les complications du diabète qui
en sont les causes pourraient
régresser.
Par ailleurs, une prévention effi-
cace passe par celle de l’appari-
tion du diabète lui-même (pré-
vention primaire) et, à défaut, par
celle de ses conséquences immé-
diates ou à plus longue échéance
(prévention secondaire).
La prévention primaire concerne
les modifications du mode de vie
(régime alimentaire approprié et
augmentation de l’activité phy-
sique, avec la baisse de poids qui
en résulte) et les programmes
éducatifs continus, qui, en outre,
ont des effets sur l’obésité, les
maladies cardiovasculaires et cer-
tains cancers.
La prévention secondaire repose,
entre autres, sur le dépistage, la
prévention et le traitement pré-
coces. Le traitement de l’hyper-
tension artérielle et de l’hyperlipé-
mie ainsi que le contrôle de la
glycémie peuvent réduire sensi-
blement le risque de complica-
>>
>> DOSSIER
Le diabète est une maladie redoutable par ses complications. Celles-ci comprennent
notamment la rétinopathie diabétique, l’insuffisance rénale, les cardiopathies, la neu-
ropathie diabétique, l’ulcération des pieds et l’amputation. La maladie, considérée
comme une épidémie mondiale, requiert à elle seule environ 8 % en moyenne du budget
total de la santé des pays développés.
Poids économique et social
Des coûts difficiles à chiffrer, mais réels
DIABÈTE
19

tions et ralentir leur évolution
dans toutes les formes de dia-
bète. Des soins appropriés des
pieds permettent d’obtenir une
diminution de la fréquence et de
la durée des hospitalisations, et
de réduire notablement l’inci-
dence des amputations.
Le dépistage et le traitement pré-
coces des rétinopathies permet-
tent d’éviter la cécité. Le traite-
ment de la protéinurie est une
autre mesure qui permet de pré-
venir ou de ralentir la progression
vers l’insuffisance rénale. Les
mesures visant à diminuer la
consommation de tabac contri-
buent également à la prise en
charge du diabète. Par exemple,
on a établi que le tabagisme
associé à un mauvais contrôle de
la glycémie a une forte relation de
cause à effet avec l’hypertension
et les cardiopathies chez les dia-
bétiques, comme chez les non-
diabétiques d’ailleurs.
Lorsqu’on parle de diabète, il s’agit
principalement du diabète sucré.
Le diabète de type 1
Avec 10 % des cas, le diabète de
type 1, ou insulinodépendant, est
beaucoup moins fréquent que le
diabète de type 2. Il touche essen-
tiellement le sujet jeune et reste
très contraignant. Seules des injec-
tions quotidiennes d’insuline faites
au bon moment en utilisant un
lecteur de glycémie pour évaluer le
taux de sucre dans le sang permet-
tent de contrôler la maladie, sans
toutefois la guérir. Le diabète de
type 1 est provoqué par l’autodes-
truction des cellules bêta situées
dans le pancréas. Ces cellules sont
en fait spécialisées dans la produc-
tion de l’insuline, seule hormone
capable de faire baisser le taux de
sucre dans le sang. En cas de dia-
bète, les cellules bêta, détruites, ne
remplissent plus leur fonction.
Le diabète de type 2
Diabète non insulinodépendant,
le diabète de type 2 est le plus
courant et le plus préoccupant
aujourd’hui. Il apparaît générale-
ment vers l’âge de quarante ans
et touche souvent les personnes
qui ont une histoire familiale de
diabète ou qui souffrent d’obé-
sité. Cependant, son apparition
est encore souvent fortuite, alors
qu’il a déjà commencé sournoise-
ment et lentement son œuvre de
détérioration. On estime que près
de la moitié des personnes qui
souffrent de ce type de diabète
ne sont pas diagnostiquées.
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004
Dans ce type de diabète, l’insu-
line produite par le pancréas est
insuffisante ou, si elle est suffi-
sante, l’organisme est incapable
de s’en servir pour métaboliser
le sucre. Si l’on ne connaît pas
les mécanismes en cause on
croit cependant que des antécé-
dents génétiques jouent un
rôle.
ALP
Infos ...
Contrôler
sa glycémie
Les diabétiques
de type 2 peuvent
habituellement
contrôler leur taux
de glycémie
en suivant
un régime
alimentaire
spécifique
et en adoptant
un programme
régulier d’activité
physique.
Lorsque ces mesures
s’avèrent
insuffisantes,
on aura recours
à des médicaments
oraux qui ont
pour effet
de stimuler
la production
d’insuline
ou d’augmenter
son absorption.
DOSSIER
20
>>
>> DOSSIER
Petit lexique
• Acido-cétose : carence en insuline provoquant un accroissement du cata-
bolisme lipidique aboutissant à la formation d’acides gras libres, favorisant la
synthèse des corps cétoniques. Terme ultime de la décompensation métabo-
lique du diabète sucré.
• ADO
– Sulfamides hypoglycémiants : stimulent la sécrétion d’insuline basale et
induite par le glucose. Potentialisent le transport de l’insuline et le stockage
du glucose.
– Biguanides : potentialisent l’action de l’insuline au niveau des cellules
cibles (foie et muscle). Réduisent la néoglucogénèse hépatique et l’absorp-
tion intestinale des glucides.
– Inhibiteurs de l’α-glucosidase : inhibent le dernier stade de la digestion des
sucres.
– Glinides : stimulent la sécrétion d’insuline induite par le glucose.
– Thiazolidinediones : potentialisent la sensibilité à l’insuline.
• Coma hyperosmolaire : survient le plus souvent chez un sujet âgé à l’oc-
casion d’une déshydratation.
• Microangiopathie : altération de la paroi des microvaisseaux et du conte-
nue vasculaire, les organes touchés sont la rétine et le rein.
• Macroangiopathie : athérosclérose qui peut atteindre tous les vaisseaux.
• Neuropathie : atteinte des systèmes nerveux périphériques, plus rarement
atteinte du système végétatif.
• Diététique : il est primordial quel que soit le type de diabète, de :
– contrôler son poids en assurant un apport nutritionnel équilibré et adapté ;
– éviter ou minimiser les fluctuations glycémiques ;
– participer au contrôle des facteurs de risques cardio-vasculaires ;
– aider à réduire l’évolution de certaines complications microvasculaires.
• Éducation : fondamentale car la prévention des complications aiguës et
chroniques dépend de la compréhension de la pathologie.
• HbA1c (Hémoglobine glycosylée) : pourcentage de fixation du glucose
sur l’hémoglobine, elle reflète la moyenne des glycémies sur les 2 à 3 der-
niers mois (N : 4-6 %).
• Hypoglycémie : complication aiguë la plus fréquente, glycémie < 0,60 g/l
(3,3 mmol) :
– Signes cliniques : modification du comportement, sueurs, troubles visuels,
tremblements, fringales...
• Syndrome X : Hypertension artérielle, Hyperglycémie, Hyperinsulinisme,
Insulino-résistance, Dyslipidémie.
• Syndrome cardinal : polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement.
• Insulinothérapie : de nombreuses techniques de traitement sont utilisées,
qui visent toutes à concilier confort et efficacité. Il n’existe pas de technique
idéale pour tous les diabétiques mais une certaine technique pour un diabé-
tique donné.
La répartition de l’insulinothérapie doit être étudiée pour respecter les
besoins théoriques totaux, en fonction de l’activité physique, de l’alimenta-
tion, et du rythme de vie.
Source Alfediam

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 59 • novembre 2004
L’ un des enjeux majeurs
des années à venir est
de répondre à la forte
augmentation de la prévalence
du diabète de type 2 et de com-
bler les insuffisances de la prise
en charge de cette pathologie :
retards diagnostiques, irrégularité
du suivi, fréquence des complica-
tions, sous-estimation du poten-
tiel évolutif de la maladie.
Surveiller l’équilibre
glycémique
Les bénéfices liés à une prise en
charge intensive de l’équilibre gly-
cémique et des autres facteurs de
risque cardiovasculaire (HTA, dys-
lipidémies, tabagisme) sont dé-
montrés. Comme le montrent
des grandes études d’intervention
dans le diabète, une baisse de
1 % de l’hémoglobine glyquée
permet une réduction de 25 %
des complications microvascu-
laires. Force est de constater que
le diabète apparaît comme une
défaillance insulinosécrétoire pro-
gressive et que cet épuisement
semble inexorable, quel que soit
le mode thérapeutique. Le pan-
créas est le coupable désigné.
Mais il faut savoir que les pre-
mières manifestations biologiques
remontent à bien avant l’appari-
tion du diabète. Elles sont asso-
ciées à l’insulinorésistance, laquel
-
le impose des besoins accrus en
insuline auxquels le pancréas
n’arrive pas à faire face. En re-
vanche, un sujet obèse sans ano-
malie du pancréas (on peut être
obèse sans être diabétique) ré-
pondra par une hyperinsulinémie
permettant de maintenir l’homéo-
stasie glycémique. Les causes de
cette insulinodéficience progres-
sive restent débattues (gènes can-
didats, sédentarité). Cette ano-
malie du pancréas est d’abord de
nature fonctionnelle, au moins
pendant un certain temps. L’hyper
-
glycémie chronique intervient par
un mécanisme de glucotoxicité
au niveau des cellules bêta des
îlots de Langerhans, et on s’est
aperçu plus récemment que ces
derniers peuvent aussi être la
cible des acides gras circulants
(lipotoxicité). D’où l’aggravation
de la défaillance des cellules bêta.
Il existe aussi une anomalie orga-
nique de la sécrétion d’insuline
dans le diabète de type 2, à savoir
une diminution de 20 à 40 % de
la masse des îlots de Langerhans.
Cependant, on ignore quand
celle-ci apparaît dans l’histoire
évolutive du diabète.
Régime et activité physique
Rappelons que le traitement du
diabète débute toujours par 4 à
6 mois d’un régime visant à amé-
liorer l’équilibre alimentaire et par
l’augmentation de l’activité phy-
sique. La contraction musculaire
augmente l’utilisation du glucose
et, à plus long terme, améliore la
sensibilité à l’insuline. Si ces me-
sures sont insuffisantes, l’Anaes
propose le schéma d’empilement
des médicaments, en commen-
çant par un seul médicament,
avec comme objectif idéal une
hémoglobine glyquée (HbA1c) à
6,5 %, et à 7 % chez les plus de
60 ans. Les chiffres supérieurs à
ces valeurs justifient le passage à
une bithérapie, qui s’impose si
l’HbA1c est supérieure ou égale à
8 % ; la décision est laissée au au
prescripteur sur la base du rap-
port bénéfice/risque lorsque
l’HbA1c se situe entre 6,5 et 8 %.
À noter que l’HbA1c doit être
dosée tous les 3 à 4 mois afin de
vérifier si le diabète est suffisam-
ment contrôlé par le traitement et
si le patient bénéficie d’une pré-
vention des complications de
micro- et de macroangiopathie.
En cas d’échec de la bithérapie à
doses maximales (association gli-
benclamide 15 mg + metformine
2 550 mg), l’insulinothérapie doit
être discutée. Selon le Dr S. Jac-
queminet, le niveau d’HbA1c dé-
finissant l’échec thérapeutique
des hypoglycémiants oraux a été
fixé arbitrairement à 8 %. Toute-
fois, il semble plus cohérent de le
fixer à 7 %, ce qui correspond à
une glycémie moyenne de 1,50 à
1,60 g/l. Concernant les deux
études portant sur la trithérapie
(metformine + sulfamide glitazo-
ne),
le bénéfice est apparu
variable en fonction de la capacité
insulino-sécrétoire résiduelle : si
cette dernière est trop faible, il ne
faut pas retarder l’heure de l’insu-
linothérapie.
De même, aux yeux du Dr S. Jac-
queminet, les recommandations
de l’Anaes sont dépassées quant
au choix de la metformine à partir
d’un index de masse corporelle
supérieur à 28, car ce médica-
ment devrait être conseillé dès
qu’il existe une surcharge pondé-
rale (soit un index de masse cor-
porelle supérieur ou égal à 25).
En outre, il a été démontré que le
bénéfice par l’augmentation des
sulfamides aux doses maximales
est très inférieur à celui noté
avec l’association à la metfor
mine.
>>
>> DOSSIER
Actuellement, en France, on compte environ 2 millions de diabétiques de type 2 connus,
avec une augmentation annuelle de 3 %. On attend que la nouvelle stratégie thérapeu-
tique basée sur la physiopathologie fasse ses preuves, tant au niveau de la défaillance
insulinosécrétoire progressive qu’en ce qui concerne le bénéfice cardiovasculaire de
l’insuline et des glitazones.
Diabète de type 2
De nouvelles stratégies thérapeutiques
DIABÈTE
21
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%