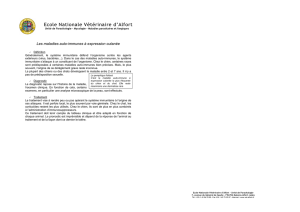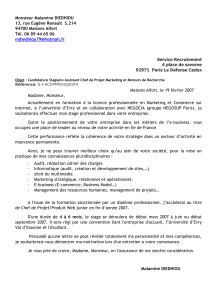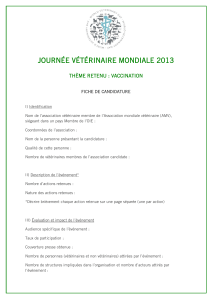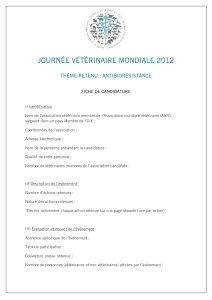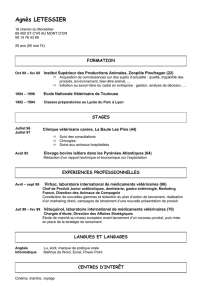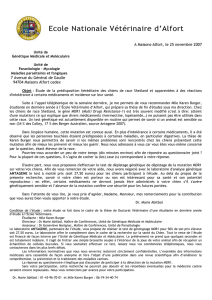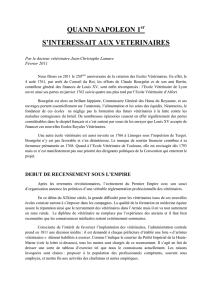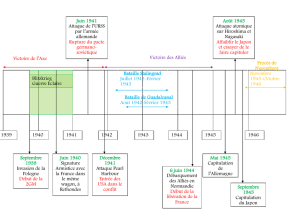Télécharger le texte intégral - Thèses

ÉCOLE NATIONALE VETERINAIRE D’ALFORT
Année 2009
LA VIE A L’ECOLE NATIONALE
VETERINAIRE D’ALFORT PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
THESE
Pour le
DOCTORAT VETERINAIRE
Présentée et soutenue publiquement devant
LA FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL
le……………
par
Angélique, Paulette, Eugénie ENTE
Née le 3 janvier 1982 à Compiègne (Oise)
JURY
Président : M.
Professeur à la Faculté de Médecine de CRETEIL
Membres
Directeur : M. Christophe DEGUEURCE
Professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
Assesseur : M. André Laurent PARODI
Professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort

LISTE DES MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT
Directeur : M. le Professeur MIALOT Jean-Paul
Directeurs honoraires : MM. les Professeurs MORAILLON Robert, PARODI André-Laurent, PILET Charles, TOMA Bernard
Professeurs honoraires: MM. BUSSIERAS Jean, CERF Olivier, LE BARS Henri, MILHAUD Guy, ROZIER Jacques, CLERC Bernard
DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES (DSBP)
Chef du département : Mme COMBRISSON Hélène, Professeur - Adjoint : Mme LE PODER Sophie, Maître de conférences
-UNITE D’ANATOMIE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Mme CREVIER-DENOIX Nathalie, Professeur
M. DEGUEURCE Christophe, Professeur*
Mme ROBERT Céline, Maître de conférences
M. CHATEAU Henri, Maître de conférences
-UNITE DE PATHOLOGIE GENERALE , MICROBIOLOGIE,
IMMUNOLOGIE
Mme QUINTIN-COLONNA Françoise, Professeur*
M. BOULOUIS Henri-Jean, Professeur
-UNITE DE PHYSIOLOGIE ET THERAPEUTIQUE
M. BRUGERE Henri, Professeur
Mme COMBRISSON Hélène, Professeur*
M. TIRET Laurent, Maître de conférences
-UNITE DE PHARMACIE ET TOXICOLOGIE
Mme ENRIQUEZ Brigitte, Professeur *
M. TISSIER Renaud, Maître de conférences
M. PERROT Sébastien, Maître de conférences
-UNITE : BIOCHIMIE
M. MICHAUX Jean-Michel, Maître de conférences
M. BELLIER Sylvain, Maître de conférences
- UNITE D’HISTOLOGIE , ANATOMIE PATHOLOGIQUE
M. CRESPEAU François, Professeur
M. FONTAINE Jean-Jacques, Professeur *
Mme BERNEX Florence, Maître de conférences
Mme CORDONNIER-LEFORT Nathalie, Maître de conférences
- UNITE DE VIROLOGIE
M. ELOIT Marc, Professeur *
Mme LE PODER Sophie, Maître de conférences
-DISCIPLINE : PHYSIQUE ET CHIMIE BIOLOGIQUES ET
MEDICALES
M. MOUTHON Gilbert, Professeur
-UNITE DE GENETIQUE MEDICALE ET MOLECULAIRE
M. PANTHIER Jean-Jacques, Professeur
Mlle ABITBOL Marie, Maître de conférences
-DISCIPLINE : ETHOLOGIE
M. DEPUTTE Bertrand, Professeur
-DISCIPLINE : ANGLAIS
Mme CONAN Muriel, Ingénieur Professeur agrégé certifié
DEPARTEMENT D’ELEVAGE ET DE PATHOLOGIE DES EQUIDES ET DES CARNIVORES (DEPEC)
Chef du département : M. POLACK Bruno, Maître de conférences - Adjoint : M. BLOT Stéphane, Maître de conférences
- UNITE DE MEDECINE
M. POUCHELON Jean-Louis, Professeur*
Mme CHETBOUL Valérie, Professeur
M. BLOT Stéphane, Maître de conférences
M. ROSENBERG Charles, Maître de conférences
Mme MAUREY Christelle, Maître de conférences
- UNITE DE CLINIQUE EQUINE
M. DENOIX Jean-Marie, Professeur
M. AUDIGIE Fabrice, Maître de conférences*
Mme MESPOULHES-RIVIERE Céline, Maître de conférences
contractuel
Melle PRADIER Sophie, Maître de conférences contractuel
-UNITE DE REPRODUCTION ANIMALE
Mme CHASTANT-MAILLARD Sylvie, Maître de conférences*
(rattachée au DPASP)
M. NUDELMANN Nicolas, Maître de conférences
M. FONTBONNE Alain, Maître de conférences
M. REMY Dominique, Maître de conférences (rattaché au DPASP)
M. DESBOIS Christophe, Maître de conférences
Mlle CONSTANT Fabienne, Maître de conférences (rattachée au
DPASP)
Melle DEGUILLAUME Laure, Maître de conférences contractuel
(rattachée au DPASP)
- UNITE DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE
M. FAYOLLE Pascal, Professeur *
M. MAILHAC Jean-Marie, Maître de conférences
M. MOISSONNIER Pierre, Professeur
Mme VIATEAU-DUVAL Véronique, Maître de conférences
Mme RAVARY Bérangère, Maître de conférences (rattachée au DPASP)
M. ZILBERSTEIN Luca, Maître de conférences contractuel
M. HIDALGO Antoine, Maître de conférences contractuel
- UNITE DE RADIOLOGIE
Mme BEGON Dominique, Professeur*
Mme STAMBOULI Fouzia, Maître de conférences contractuel
- DISCIPLINE : OPHTALMOLOGIE
Mlle CHAHORY Sabine, Maître de conférences contractuel
- UNITE DE PARASITOLOGIE ET MALADIES PARASITAIRES
M. CHERMETTE René, Professeur
M. POLACK Bruno, Maître de conférences*
M. GUILLOT Jacques, Professeur
Mme MARIGNAC Geneviève, Maître de conférences contractuel
Mlle HALOS Lénaïg, Maître de conférences
-UNITE DE NUTRITION-ALIMENTATION
M. PARAGON Bernard, Professeur *
M. GRANDJEAN Dominique, Professeur
DEPARTEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (DPASP)
Chef du département : M. MAILLARD Renaud, Maître de conférences - Adjoint : Mme DUFOUR Barbara, Maître de conférences
-UNITE DES MALADIES CONTAGIEUSES
M. BENET Jean-Jacques, Professeur*
Mme HADDAD/ HOANG-XUAN Nadia, Maître de conférences
Mme DUFOUR Barbara, Maître de conférences
-UNITE D’HYGIENE ET INDUSTRIE DES ALIMENTS
D’ORIGINE ANIMALE
M. BOLNOT François, Maître de conférences *
M. CARLIER Vincent, Professeur
Mme COLMIN Catherine, Maître de conférences
M. AUGUSTIN Jean-Christophe, Maître de conférences
- DISCIPLINE : BIOSTATISTIQUES
M. SANAA Moez, Maître de conférences
- UNITE DE ZOOTECHNIE, ECONOMIE RURALE
M. COURREAU Jean-François, Professeur
M. BOSSE Philippe, Professeur
Mme GRIMARD-BALLIF Bénédicte, Professeur
Mme LEROY Isabelle, Maître de conférences
M. ARNE Pascal, Maître de conférences
M. PONTER Andrew, Maître de conférences*
- UNITE DE PATHOLOGIE MEDICALE DU BETAIL ET DES
ANIMAUX DE BASSE-COUR
M. MILLEMANN Yves, Maître de conférences*
Mme BRUGERE-PICOUX Jeanne, Professeur (rattachée au DSBP)
M. MAILLARD Renaud, Maître de conférences
M. ADJOU Karim, Maître de conférences
Mme CALAGUE, Professeur d’Education Physique * Responsable de l’Unité Mme GIRAUDET Aude Clinique équine, Ingénieur de recherche

REMERCIEMENTS
A Monsieur le Professeur
de la Faculté de médecine de Créteil
qui nous a fait l’honneur d’accepter la présidence de jury de notre thèse.
Hommage respectueux.
A Monsieur le Professeur Christophe DEGUEURCE
de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
qui nous a fait l’honneur de diriger cette thèse, et qui a été le premier à croire en ce projet.
Hommage reconnaissant pour sa disponibilité et son implication de chaque instant.
A Monsieur le Professeur André Laurent PARODI
pour l’attention qu’il a apportée à l’examen de notre travail,
pour ses conseils avisés et sa disponibilité.
Hommage respectueux.

Au Dr Edouard FAVIER,
rien n’aurait été pareil sans toi. Je te dois tellement ! Cette thèse t’est dédiée, j’espère
que tu es fier de moi et de ce travail. Avec toute mon affection, ta petite-fille.
A tous ces témoins,
en témoignage de mon affection et de mon profond respect.
Sincères remerciements aux consœurs et confrères m’ayant aidé dans ce travail.
Ils en sont à ce titre les véritables auteurs.
Au Docteur Vétérinaire François-Henri BOLNOT,
Qui a accompli parfaitement sa mission d’enseignant tuteur. Pour cette main tendue
au moment où j’en avais le plus besoin. En témoignage de ma gratitude.
A la revue « Véto Vermeil » et à ses rédacteurs,
grâce à qui tout a commencé.

A mes parents, pour votre amour, vos encouragements, et tous vos sacrifices. Merci de m’avoir menée là
où je suis.
A Hervé et Marie-Paulette, Maud, Marie-Charlotte et Bastien, Joseph, Juliette, Ella, Lola et Noé. Que
votre vie soit belle.
A Mamie Samy (Bouzoute !) et à Didier. Vous êtes partis trop tôt. Je vous imaginais à mes côtés pour
cette journée si importante…Je vous ai parfois sacrifiés pour en arriver là. J’espère que vous ne m’en
voulez pas, et que, là haut, vous êtes fiers de moi.
A Danièle et Bernard, qui ont toujours cru en moi et m’ont toujours poussée vers le haut. A tout ce que
vous m’avez appris, à ces vacances merveilleuses à vos côtés. J’aimerais tous les jours avoir 7 ans…
A mon Zinzin Axel, pour son soutien inconditionnel. Pour son oreille toujours attentive et son épaule
toujours accueillante. A nos premières « teufs », à nos vacances et à celles qui viendront encore !
A Nadine et Patrick, Bernard et Claudette, Marie C (Vampirella !), Paulette R, Pierre B.
A ma belle-famille, merci de m’avoir accueillie aussi chaleureusement. Je suis fière d’être parmi vous.
A Jérémy et à ses parents. Pour tout ce que vous avez fait pour moi durant ces terribles années de prépa !
A ma Titine, mon premier « chef » et surtout mon amie. A nos étés de dur labeur, à nos soirées sur la
plage et à nos raclettes en plein mois d’août…hein Martine ????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A Julie (Marie-Chantâââââââââââââle !!!!!), Emi, Tite Flo, Juliette et Caro G. Mes amies, mes amours,
mes…A la vie, à la mort, et je rigole pas.
A Slimane. Tu es un mec bien, ne change rien. Euh si, parle un peu plus…
Aux Balochards (for ever !) mes potos qui déchirent tout, à Bazoches, à Etienne et Véro, à Dado et
Toutoune.
A ma Mite, et Glagla, merci merci merci merci merci merci…………………………Vive la Youri
Team, le Youri style et la Youri life. Je ne pensais pas mais en fait je suis fan. Vous me manquez !
Courage c’est bientôt votre tour pour cette P… de thèse !
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
1
/
184
100%