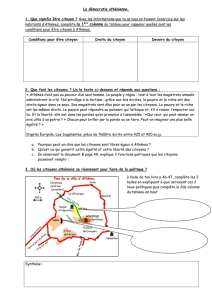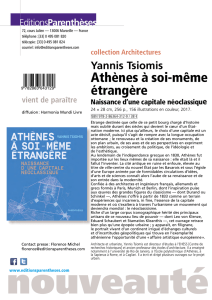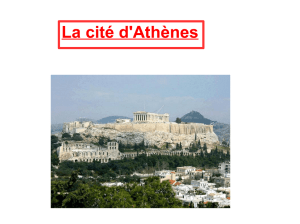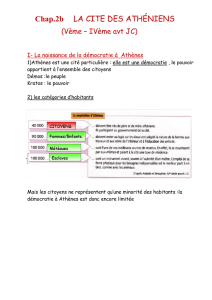Ce document fait partie des collections

Ce document fait partie des collections numériques des Archives Paul Perdrizet, le projet
de recherche et de valorisation des archives scientifiques de ce savant conservées
à l’Université de Lorraine. Il est diffusé sous la licence libre « Licence Ouverte / Open Licence ».
http://perdrizet.hiscant.univ-lorraine.fr
Henri Grégoire et Roger Goossens
« Sitalkès et Athènes dans le «!Rhèsos!» d’Euripide. Réponse à Mr. Sinko »
L’Antiquité Classique, 1934, Vol. III, N° 2, p. 431‑446.

H.GRÉGOIREetR.
GOOSSENS
SITALKÈS
ET
ATHÈNES
DANS
LE
<(
RHÈSOS
>>
D'EURIPIDE
Réponse à
M.
Sink.o
Extrait
de
L'Antiquité
Classique
Tome
III,
2.
BRUXELLES
1934

•
1
t
1

SITALKÈS
ET
ATHÈNES
DANS
LE
<(
RHÈSOS
))
D'EURIPIDE.
RÉPONSE
à
M.
SINKO
(1)
par
Henri
GRÉGOIRE
et
Roger
,
GoossENS.
I.
Trois
questions
:
allusions
historiques,
date
et
authenticité.
Nous avons prouvé
que
la
trame
du
Rhèsos
est
empruntée,
pour
une
part,
à l'histoire
du
ve siècle ;
que
le héros de
cette
allégo-
rie politique accomplit, sous le
nom
de Rhèsos,
toute
une
série
de démarches
qui
sont
précisément celles
que
les Athéniens
attri-
buaient,
entre
432
et
424,
au
roi Sitalkès (témoins Hérodote,
Aristophane, Thucydide).
M.
Thaddée
Sinko, dans le
savant
article
qu'on
vient
de lire, nie, prmo, que Rhèsos
soit
Sitalkès;
secundo,
que
le
Rhèsos puisse
être
d'Euripide. Les
deux
questions
sont
en
partie
connexes
et
en
partie
indépendantes. Nous
avons
assez mon-
tré
que, si le Rhèsos
est
une
pièce de circonstance inspirée
par
des
événements des années 432 à 425, les
arguments
les
plus
impres-
sionnants
des adversaires de
la
paternité
euripidéenne
tombent
d'eux-mêmes.
En
dernière analyse, il ne reste de leurs scrupules
qu'une
impression
sur
laquelle
la
philologie
ne
peut
rien
bâtir:
le
sentiment,
quand
on' passe des
autres
œuvres
d'Euripide
à celle-ci
d'une
différence
très
nette
de
ton,
et
très
légère de style
(2).
Mais en
(1) Cf. R.
GooSSENS,
La
date du Rhèsos,
dans
Antiq.
Glass.
t.
I,
1932,
p.
93-134;
Rhèsos et Sitalkès, dans
Bull.
de
l'assac.
G.
Budé,
octobre
1933,
p. 11-33. -
H.
GRÉGOIRE,
L'authenticité
du
Rhésus
d'Euripide,
dans
Antiq-
Class., t.
II,
1933,
p.
91-133. -
Th.
SINKo,
De
causae Rhesi novissima defen-
sione,
1,
dans
L'Antiq.
Glass.,
t.
III,
p. 1934, p.
224-229;
II,
supra, p. 411-429.
(2) G.
MURRAY,
The Rhesus of
E.,
éd. de 1924, p. VI:
«If
the
Rhesus is a
post-classical play,
it
can
hardly
be
honest
fourth-century
work:
it
must
be
deliberately archaistic ...
~.
M.
Sinko
s'est
donné beaucoup de
mal
(supra,
p.

432
H.
GRÉGOIRE
ET
R.
GOOSSENS
fin, s'il se trouve des critiques plus fins que nous, comme Mme Marie
Delcourt (1
),
qui
ont
encore de
la
répugnance à croire bonnement
que le Rhèsos est d'Euripide, voilà qui les regarde,
et
nous n'irons
pas leur demander leurs raisons.
La
seule chose que nous leur de-
mandions, c'est de ne pas nier l'évidence,
et
par
évidence nous
entendons,
par
exemple, l'identité Rhèsos-Sitalkès. Mme Delcourt,
d'ailleurs, ne la nie nullement,
et
tous les historiens de la tragédie,
comme tous les historiens du ve siècle athénien, seront d'accord
avec elle, avec
M.
Gustave Glotz, avec nous, pour conclure
qu'un
élément historique
Cf>mme
celui-là, qui est si évidemment une
allusion politique, porte en lui-même sa date,
et
que le Rhèsos est
par
conséquent contemporain de l'alliance d'Athènes avec la mo-
narchie odryse. A supposer même (et ce
n'est
nullement notre avis)
que cette dernière déduction ne soit ni sûre, ni la seule possible,
il
reste que cet élément historique du moins existe,
.que
sa présence
dans le Rhèsos est incontestable.
Si
incontestable que personne ne
l'a
sérieusement contestée (2
).
Et
quoique nous soyons fort loin
420 ss,)
pour
distinguer
<<
entre
la
manière
d'Euripide
et
celle de
l'auteur
du
Rhèsos,
Il
nous semble que
la
constatation
la
:plus
frappante
qu'il
ait
faite
reste encore celle-ci:
l'auteur
du Rhèsos emploie plusieurs fois le
mot
vava<a0f1a,
vocabulum a poetis alienum.
M.
Sinko
voit
dans le stratagème de Dolon, qui,
dans
Je
Rhèsos
(à
la
différence de
la
Dolonie), est effectivement
<<
déguisé » en
loup (au
point
qu'il
adoptera, dit-il,
la
démarche de ce
quadrupède:
vv.
208-
215) l'invention maladroite
d'un
plat
imitateur
de l'Hécube (1058 ss.).
Il
ignore
donc
qu'Euripide
reproduit ici
une
version populaire
de
la
légende de Dolon,
version
qui
nous·est connue
par
une
peinture
de vase d'Euphronios (cf. PoR-
TER,
The Rhesus, p. xi). Ajouterons-nous
qu'il
nous
paraît
moins heureux encore
d,ans l'exégèse de l'Hécube que dans celle
du
Rhèsos?
Il
risque, en effet, cette
ingénieuse conjecture : si Polymestor compare à des
<<
chiennes meurtrières »
les Troyennes
qui
l'ont
aveuglé,
c'est
pour
préparer le
spectateur
à
laméta-
morphose d'Hécube: en chienne, annoncée à
la
fin
du
drame I
(1) Cf. Antiq. Glass., t.
II,
1933, p. 274.
(2)
Pas
même le plus récent de nos critiques,
M.
Descroix, le
savant
auteur
d'une
dissertation
sur
le
Trimètre
iambique, médaillé
par
l'Association des
Études
grecques.
M.
Descroix nous consacre dans
la
REG
(t.
47, 1934,
p.
262)
un
compte rendu
qui
nous étonne.Nous y relevons une insinuation
qui
pourrait
égarer le lecteur. Le regretté Méridier
aurait
blâmé
notre
méthode.
Or
voici
une phrase
d'une
carte postale de
l'éminent
helléniste, envoyée le
26
février
1933 à
M.
R.
Goossens :
<<
Je
ne
vois guère que des félicitations à vous adres-
ser :
votre
thèse, si originale,
est
soutenue avec
une
fermeté,
et
un
luxe de
rap-
prochements
frappants
qui
me semblent bien emporter
la
conviction
»,
Le
maître
n'a
donc pas trouvé, comme
M.
Descroix, «
que
nous recherchions
l'al-
lusion à
tout
prix, avec une intempérance
systématique
».
Nous ayons
cit~
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%