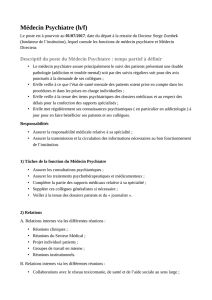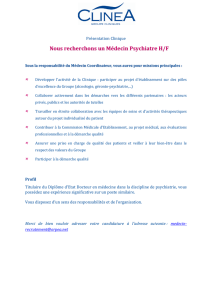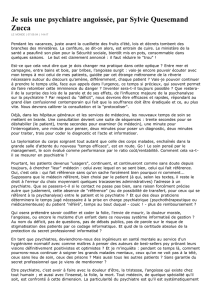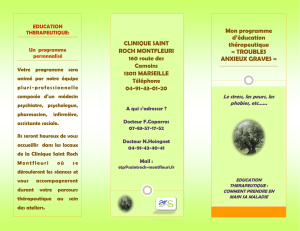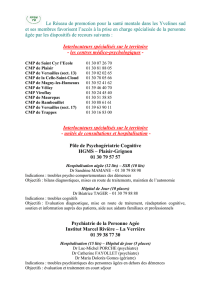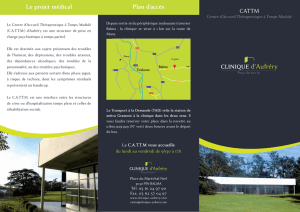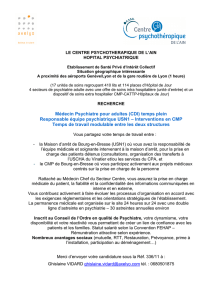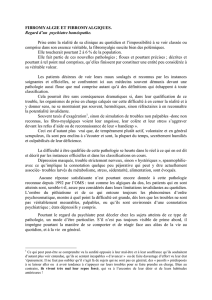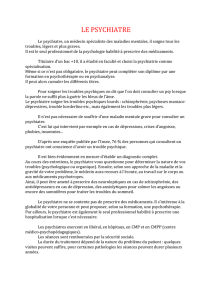Lire l'article complet

28
Le Courrier des addictions (4), n° 1, Janvier/Février/Mars 2002
Cet examen permet de mettre en évidence
ce qui va donner sa justification à l’exis-
tence de cette comorbidité, soit le déficit
psychique. Il faut, en effet, pour qu’une
telle comorbidité existe, que le Moi du
toxicomane soit faible ou affecté d’un
défaut. Cette thèse, héritage ancien de la
psychiatrie, tant de celle de la dégénéres-
cence que de l’organo-dynamisme, connaît
un retour en grâce par le biais de la toxico-
manie.
Un défaut du Moi bien nécessaire
Selon Didier Touzeau, le Moi du sujet est
au départ affecté d’un certain nombre de
déficits. Il tente de pallier ces déficits. Il
peut le faire par l’entremise de la drogue.
C’est quand cette dernière échoue qu’appa-
raissent des troubles psychiatriques : sous
l’angle psychopathologique, l’usage de
drogues constitue une tentative que fait le
sujet pour réparer les déficits du Moi, ten-
ter d’en réguler les dysfonctionnements.
Quand la drogue échoue émergent parfois
des troubles psychiatriques.
Déficit et réparation du Moi seraient ainsi les
deux mamelles qui nourrissent le rapport
entre psychiatrie et toxicomanie. Dans l’op-
tique de cette réparation, si les traitements de
substitution ont une raison d’être, c’est en tant
que “holding”, c’est-à-dire en rendant plus
tolérable le sevrage de l’héroïne. Les pharma-
cothérapies protègent, en effet, les patients les
plus vulnérables en leur évitant de faire l’ex-
périence de souffrances intolérables et désor-
ganisatrices de la personnalité. Ils permettent
de s’attaquer à la source du problème qui
est ce déficit de la personnalité, ou de l’iden-
tité qui réclamerait qu’on le comble par un tra-
vail approprié de réparation, voire ici de
reconstruction. En s’appuyant sur le traite-
ment, qui constitue un véritable “holding”, ils
peuvent alors construire leur identité.
Déficit du Moi, réparation manquée par la
drogue, reconstruction réussie par le biais du
“holding” rendu possible par le traitement de
substitution : voila les axes majeurs de l’ap-
proche de ce que Touzeau appelle “le double
lien” entre psychiatre et toxicomanie. Il prône,
ce faisant, une thérapie du Moi.
Bouchez et Carrière vont abonder dans le
même sens. Pour eux, il ne faut pas négliger
l’effet d’annonce de l’expression : “Je suis
toxicomane”. Elle risque d’induire en erreur
l’interlocuteur qui va croire qu’il a affaire à un
toxicomane, au lieu, écrivent-ils “de la vérité
de la personne souffrante qui a cru devoir
faire usage du produit pour vivre”.
Reprenant la même thématique du déficit du
Moi, ils nous indiquent les avantages du pro-
duit pour le patient qui lui permet de s’habiller
d’une identité de toxicomane. Le sujet masque
la carence qui l’affecte au niveau de sa person-
nalité par ce que Bouchez et Carrière appellent
le prêt-à-porter identitaire du produit.
Le propos de Jeammet est plus complexe. La
pathologie commence, selon lui, avec une
“perte de liberté radicale” pour le sujet. Son
idée consiste dans le fait que, faute d’une réa-
lité interne “suffisante” sur laquelle le sujet
aurait pu s’appuyer pour trouver, en cas de
conflit, “la sécurité interne nécessaire”, les
sujets vont se rabattre sur une réalité externe
dont ils vont devenir dépendants. Ce qui
caractérise à ses yeux les sujets dépendants est
ce défaut de ce qu’il nomme “une base suffi-
samment sécurisante au niveau de la réalité
interne”. Sans entrer ici dans le détail, il appa-
raît que, là aussi, nous avons affaire dans le
domaine de la pathologie à un déficit de la
réalité interne du sujet.
Bouchez et Charles-Nicolas sont sensibles à
la difficulté de la question. Ils font le tour des
études effectuées sur la comorbidité psychia-
trique. Avec des instruments diagnostiques
standardisés, et en s’appuyant sur les études
des antécédents psychiatriques qui ont pu être
faites sur la vie des patients, ils constatent que
ces études retrouvent une incidence élevée de
co-morbidités psychiatriques parmi les
patients dépendants de l’héroïne (54 à 83 %).
Parmi ces éléments, arrivent en tête les
troubles thymiques et anxieux, les personnali-
tés pathologiques suivent de très près (elles
sont essentiellement les personnalités consi-
dérées comme antisociales) ainsi que les
conduites d’alcoolisation.
Ils reconnaissent toutefois qu’il faut se mon-
trer prudent devant l’ampleur de tels résultats.
Ceux-ci parviennent très souvent de centres
de soins où les patients sont en demande de
soins, ce qui ne reflète pas la réalité de la
population de ceux qui ne demandent rien.
Il y a aussi des disparités géographiques
évidentes : quand on fait une étude, le pro-
blème de la personnalité anti-sociale se
pose de façon différente dans le Bronx et
dans un CHRU. Enfin, cet argument n’est pas
mince, ces études ne tiennent pas compte le
plus souvent des traitements entrepris qui
modifient souvent de façon sensible l’inci-
dence pathologique dans le sens de la
réduction des chiffres obtenus.
Bouchez et Carrière constatent de la même
manière que si les études de comorbidité
anglo-saxonnes soulignent des associations
pathologiques fréquentes soit au cours de la
vie entière, soit au cours d’épisodes de prises
de produits, et qu’elles mettent en évidence
l’importance des facteurs familiaux dans cette
comorbidité, elles ne sont guère concluantes
dès lors que ces troubles sont étudiés sur la
Éros peut-il être malade ?
Réflexion sur la comorbidité
psychiatrique en matière de toxicomanie
George-Henri Melenotte*
IDès son premier abord, une telle comorbidité trouvée dans le
champ des toxicomanies surprend. Le terme de toxicomanie dési-
gnant une entité psychiatrique, il peut paraître étonnant qu’elle
puisse être accompagnée d’une comorbidité du même ordre.
Cette redondance pose le problème de sa justification.
Elle demande un examen de l’effet produit sur le psychiatre par
la fréquentation des personnes qualifiées de “toxicomanes”.
Le jour
Est un vaste mot clair.
Le monde est réel.
Je vois,
J’habite une transparence.
OctavioPaz
*Le Dr George-Henri Melenotte est psychiatre
et psychanalyste, directeur médical du centre
espace dépendance de Strasbourg, 21, Bd de
Nancy 67000 Strasbourg. ESPACE.IND@
wanadoo.fr

29
durée lors de prises en charge longues des
addictions.
Les éléments ainsi collectés indiquent la
récurrence du déficit du Moi et la prudence à
adopter devant les résultats donnés par les
études de comorbidité. Ce déficit du Moi a
trouvé ses lettres de noblesse, il y a quelque
temps déjà, avec la théorie du stade du miroir
brisé de Claude Olievenstein. Son approche
à la fois psychologique, psychanalytique et
psychiatrique proposait une théorie d’un
développement psychique brisé caractéris-
tique de la personnalité du toxicomane. Elle
permettait d’en déduire l’existence d’un profil
psychologique, d’une clinique ainsi que des
orientations dans le domaine de la thérapeu-
tique spécifique. Cette idée du déficit n’est
pas neuve. La tradition du déficit de la
conscience ne remonte pas seulement à
Charles Blondel, avec sa conscience morbi-
de, mais aussi à la théorie des dégénéres-
cences de Morel et, plus près de nous, à celle
de l’organo-dynamisme d’Henri Ey. La
thèse, en matière de toxicomanie, reste la
même : le produit vient combler un déficit,
que ce soit un déficit de la conscience, un
déficit du Moi, ou, ce qu’un certain jargon
lacanien appellerait, dans un langage
impropre, un manque à être.
Le médecin et, dans le cas du suivi de ces co-
morbidités, le psychiatre auraient devant eux
une personne affectée d’un déficit de son
Moi : voilà posé le terrain où va s’effectuer la
rencontre, terrain marqué par une certaine dis-
symétrie, voire un déséquilibre dont il
convient d’interroger la fonction. Car ce défi-
cit est le résultat d’une opération qui, pour
être discrète, n’en est pas moins efficace.
La pathologisation – tel est le nom de cette
opération – produit un résultat qui ne situe pas
seulement côté patient par l’imputation faite à
son Moi d’un tel déficit, mais aussi côté
médecin, pour une raison plus obscure sur
laquelle il convient de s’arrêter un instant.
Pourquoi pathologiser ?
Qu’est-ce qui pousse certains psychiatres à
vouloir pathologiser une pratique qui n’a
somme toute que peu de rapport avec la mala-
die mentale, puisqu’il ne s’agit là de rien
d’autre que d’une pratique érotique ? La mul-
tiplicité des pratiques érotiques n’a pas lieu
d’être ici recensée, même s’il apparaît qu’elles
sont, la plupart du temps, relativement
pauvres. On les ramène bien souvent aux plai-
sirs de la chair que sont la boisson, la nourritu-
re et le sexe. Il en existe bien d’autres, parmi
lesquelles la pratique de la drogue tient toute sa
place. Cela suppose que l’on accorde au corps
le statut de “source de plaisirs” qui donne
accès à l’usage de drogue comme sollicitant ce
statut.
Les drogues font maintenant partie de la cul-
ture. De même qu’il y a de la bonne et mau-
vaise musique, il y a de bonnes et de mau-
vaises drogues. Et donc, pas plus que nous
sommes contre la musique, nous ne pouvons
dire que nous sommes contre les drogues.
Cette pratique du corps comme source de plai-
sirs permet de constituer ce corps comme lieu
où “s’inventent de nouvelles possibilités de
plaisir en utilisant des parties bizarres du
corps – en érotisant ce corps”. Henri
Michaux est le témoin vigilant de cette éroti-
sation du corps qui est rendue possible par la
mescaline. Il montre comment cette expérien-
ce du produit se révèle être une pratique éro-
tique particulière puisqu’elle n’a réellement
aucun partenaire.
Cette pathologisation d’une pratique érotique
est un vrai phénomène qui n’est pas nouveau.
Il ne faut pas remonter bien loin dans l’his-
toire de la psychiatrie pour rappeler comment
cette pathologisation des pratiques érotiques a
servi de substrat aux perversions. Il n’est pas
inutile pour l’illustrer de rappeler ce bref pas-
sage de la plume d’Henri Ey tiré de ses
Études psychiatriques : “Le goût du poison,
l’affirmation du vice, l’incorporation d’un
toxique, qui, en chavirant l’esprit, exalte enco-
re les passions bestiales, l’attitude de défi,
l’émulation des records de cabaret, le mépris
de la santé, sorte d’hypochondrie à l’envers, le
culte de l’artifice et des ‘fleurs du mal’ sont les
profondes racines perverses de l’appétence
pour les toxiques. C’est du vin qu’il faut au per-
vers ‘prolétaire’ révolté et revendicateur qui
traîne de ruisseau en ruisseau sa vie paresseu-
se et violente. C’est de l’alcool qu’exige ce
‘raté’ mythomane, maître chanteur, escroc ou
aigrefin, habitué des coulisses et des casinos.
C’est de la morphine que désiraient les
‘esthètes’‘fin du siècle’en mal de perversion et
d’attitude à la Thomas Quincey.
C’est encore sur la ‘came’ ou ‘coco’ que les
homosexuels et les prostituées des bars se
ruent, la ‘prise’ constituant dans ses milieux
un brevet d’impureté, un certificat de mau-
vaise conduite. Le poison consacre le vice, le
fortifie tout de même que le vice exige le poi-
son qui le prolonge. Tel est le fameux cercle
‘vicieux’qui résume les profondes relations de
l’appétence toxicomaniaque et de la perversi-
té. L’un et l’autre n’étant en fin de compte
que la manifestation d’une profonde angoisse
névrotique, d’une originelle insatisfaction,
d’une frustration libidinale, d’une ‘soif’ inex-
tinguible comme un effet vertigineux du vide de
l’existence. La dépravation, le dégradement
toxicomaniaque satisfont aux exigences déses-
pérées d’un frénétique sadomasochisme ; c’est
comme on l’a dit un ‘suicide permanent’.”
Au-delà du ton virulent adopté par Henri Ey,
il convient de retenir la réprobation morale
présente dans ce texte, dont on mesure qu’elle
est dans son fondement pudibonde. Car c’est
bien la dépravation et la frustration libidinale
qui indiquent que c’est le caractère érotique de
la pratique que stigmatise l’auteur.
Carrière et Bouchez ne s’attaquent pas direc-
tement à la question. Pourtant, ils en posent un
premier jalon. Ils s’interrogent pour savoir
pourquoi les toxicomanes s’adressent aux
médecins. Ils répondent que la toxicomanie ne
doit être considérée comme une maladie que
par métaphore, et que les médecins – c’est
démontré – ne doivent pas être les seuls à
intervenir. Il se trouve “que le médecin parta-
ge avec le toxicomane un certain savoir et une
certaine pratique de psychotropes”. Retenons
déjà cette notion de partage qui nous semble
précieuse. Il serait bon qu’ils nous précisent ce
qu’ils entendent par “savoir” et par “pratique”.
Est-ce à dire que médecin et le toxicomane
pratiquent les psychotropes et savent l’effet
qu’ils produisent ? Ne voyez là nulle malice :
l’ambiguïté est là.
Les auteurs poursuivent dans leur développe-
ment. Le psychiatre, disent-ils, a un rôle
important à jouer dans la prise en charge des
toxicomanes. Pourquoi ? Ils répondent que le
psychiatre, par son intervention, signifie
l’importance de la vie psychique là où le
contexte social, familial, judiciaire a ten-
dance à réduire la toxicomanie à ses mani-
festations somatiques.
En signifiant l’importance de la vie psy-
chique, le psychiatre joue ainsi un rôle
étrange. Il fait ce que devrait faire le patient
avec son symptôme, pour peu que l’on
accepte de voir dans le symptôme, ce qui
vient rappeler à tout bon entendeur son
salut inconscient. Autrement dit, il s’arroge
le rôle de son patient dans le rappel de ce
salut. C’est en cela que réside la pathologi-
sation d’une pratique érotique par le psy-
chiatre. En signifiant l’importance de ladite
vie psychique, il omet de le laisser faire par
le patient. Ce faisant, il transforme la pra-

30
Le Courrier des addictions (4), n° 1, Janvier/Février/Mars 2002
tique des produits en une conduite patholo-
gique et ne peut manquer, une fois l’opéra-
tion faite, de soutenir qu’il y a une comor-
bidité psychiatrique à la toxicomanie.
Pourquoi une telle pathologisation ? Nous
nous garderons de penser que le souhait du
psychiatre est de créer de nouvelles patho-
logies. Quand bien même cela serait, ce ne
serait au bout du compte qu’un phénomène
sans importance. Ce dont il s’agit est d’une
autre teneur, de la teneur de ce dont
Carrière et Bouchez ont eu l’intuition : il y
a une terre de partage entre médecin et toxi-
comane, pour reprendre leur expression.
Cette terre est le produit. Et ce partage ne
peut manquer de créer entre eux une étrange
et dangereuse proximité, cette proximité qui
fait que le médecin, le psychiatre en l’occur-
rence, se sent concerné par le toxicomane.
La question du concernement
Lacan, dans un petit discours qu’il fit aux
psychiatres à la clinique Sainte-Anne, a
abordé cette question du concernement. Il
le fait en traitant du problème posé par le
rapport que le psychiatre entretient avec le
fou. Mais, pour peu que l’on mette, dans le
passage, le mot “toxicomane” à la place de
“fou”, celui de “pratique érotique des pro-
duits” à la place de “folie”, on obtiendra un
résultat intéressant. D’abord la citation de
Lacan : [Le psychiatre] est irréductible-
ment concerné ! Par la folie, s’entend. Avec
notre petit tour de passe-passe, cela donne :
“Le psychiatre est irréductiblement concerné
par la pratique érotique des produits.”
Irréductible signifie incontournable. On
peut bien sûr avancer la thèse historique
pour dire que la psychose toxique est une
des pierres sur lesquelles s’est bâti l’édifi-
ce de la psychiatrie moderne.
Mais il y a plus dans cette irréductibilité. Il
y a que le psychiatre, à ses débuts, ce cher
Moreau de Tours le rappelle, était un
expérimentateur qui en savait beaucoup sur
les produits susceptibles d’être toxiques
parce qu’il ne manquait pas de les essayer
sur lui-même ou de partir en voyage avec
un ami fervent praticien du haschich.
Pourquoi le psychiatre serait-il irréducti-
blement lié à la pratique des produits ?
Parce que c’est en essayant les produits sur
eux-mêmes que certains d’entre eux ont
construit la psychiatrie au XIXesiècle.
Cette réponse pourrait suffire. Il n’est pas
dit que les choses aient tellement changé
aujourd’hui, bien qu’il soit évidemment
moins engageant d’essayer sur soi quelque
nouvelle molécule neuroleptique ou anti-
dépressive que de prendre du haschich.
Toutefois, il n’y a pas lieu de s’en conten-
ter. Comme devant tout ce qui le concerne
de trop près, le psychiatre, nous dit Lacan,
interpose entre lui et cette chose sa cli-
nique, son savoir, sa compétence médicale.
Le but de cette interposition est de lui per-
mettre de ne pas se sentir touché par le
concernement.
S’il ne se sent pas concerné – c’est là quelque
chose de tout à fait démontrable, tangible,
sans qu’on ait besoin pour autant de faire
intervenir l’expérience psychanalytique –,
c’est par certains procédés qui se manifestent
quand on y regarde de près, de façon non
contestable, cela que l’on soit psychanalyste
ou pas, par le fait qu’il se protège de ce
concernement, si vous permettez.
Le praticien d’Éros...
c’est le patient
C’est-à-dire qu’il interpose entre lui et le
fou un certain nombre de barrières protec-
trices qui sont à la portée des grands
patrons. Il met, par exemple, d’autres per-
sonnes que soi, n’est-ce pas, qui lui four-
nissent des rapports… Et puis, pour ceux
qui ne sont pas des grands patrons, il suffit
d’avoir une petite idée (un organo-dyna-
misme, par exemple) qui met à distance
cette “espèce” d’être qui se trouve en face
de vous et que l’on épingle comme on le
ferait d’un bizarre coléoptère à oberver,
comme ça, dans sa donnée naturelle.
Pourquoi de telles mesures de la part du
psychiatre ? On peut penser que le danger
doit être bien grand pour qu’il suscite de
telles mesures de protection. Quel est ce
bizarre coléoptère que nous devons décrire
“dans sa donnée naturelle” pour établir
qu’il vit bien loin de chacun d’entre nous ?
Un praticien d’Éros. Pour quelle raison
peut-on se trouver irréductiblement concer-
né par une telle pratique ? Parce qu’il est
bien difficile d’échapper aux mailles du
filet qu’Éros ne cesse de nous tendre à
chaque instant que nous vivons. Et il n’est
pas dit que cela soit réjouissant. Loin de là.
Peut-on penser que le psychiatre soit à ce
point effrayé par Éros, au point de s’en pré-
munir activement ? La réponse est “oui”
dès lors que se reconnaît dans cette pra-
tique la possibilité de sortir des sentiers
battus de l’érotisme quand il se réduit à une
norme. L’avantage de la pathologisation de
la pratique est qu’elle la désérotise en même
temps. Affectée d’une comorbidité psychia-
trique avérée, elle perd toute communauté ou
partage avec le médecin et devient, de ce fait,
érotiquement neutre pour lui. La pathologisa-
tion est une réduction réussie du concerne-
ment médical à un pur abord professionnel
du problème. Ce qui est laissé de côté dans
l’opération est Éros.
Ainsi, il est vrai que la pratique érotique
des produits pose ce problème général,
qu’elle nous concerne tous comme le fait
toute pratique de cet ordre. Il n’y a donc
pas lieu de s’étonner qu’elle suscite la levée
de barrières protectrices et soit perçue
comme dangereuse, surtout par ceux qui la
devinent comme telle. Cela arrive au psy-
chiatre pour peu qu’il ouvre ses oreilles.
Éros, en effet, n’est ni dans le sac de l’or-
gano-dynamisme, ni dans celui du DSM-IV,
mais il se trouve dans le texte de Michaux
quand il expérimente la mescaline.
La comorbidité psychiatrique de la toxico-
manie, qui va des troubles anxieux aux
troubles de l’humeur, en passant par les
troubles de la personnalité et les troubles
dits schizophréniques, constitue un savoir
qui se présente comme prometteur, mais il
est bien difficile de ne pas voir dans cette
clinique naissante le psychiatre construire
le mur séparatif contre son concernement,
pour reprendre ici ce terme qu’Henri
Grivois a su utiliser avec bonheur – concer-
nement auquel nous donnerons pour notre
part un autre nom : angoisse.
Dépathologiser cette pratique érotique
qu’est la pratique des produits érogènes est
donc une urgence où nous voilà requis.
Cette entreprise est une condition sine qua
non pour établir le contact depuis trop long-
temps perdu avec ces praticiens du plaisir
qu’il n’est plus question de continuer à
appeler “toxicomanes”.
Engelsman affirmait : “Les toxicomanes ne
doivent pas être vus ni comme des crimi-
nels, ni comme des gens dépendants, mais
comme des citoyens ‘normaux’ qui peuvent
faire des demandes ‘normales’ et auxquels
il faut offrir des opportunités ‘normales’.
Ils ne doivent pas être considérés comme
une catégorie à part.” Je crois que cette
position d’Engelsman est importante. Non
parce qu’elle dédramatise les données du

31
problème mais parce qu’elle positionne cor-
rectement la comorbidité psychiatrique
dans le domaine dit de la toxicomanie. Ce
ne serait plus, somme toute, qu’une comor-
bidité… normale.
Références bibliographiques
– C’est bien délibérément qu’il a été décidé
ici de ne pas parler d’addiction. Peut-être
pour préserver le caractère de débat interne
à la psychiatrie le travail qui suit. Nous pos-
tulerons que toute pratique psychiatrique – et
donc toute publication afférente à ce champ
– ne peut omettre les effets de l’étrange coha-
bitation auxquels il arrive à tout psychiatre
d’être soumis lors de ses rencontres avec
ceux que l’on appelle curieusement ses
“patients”.
– Touzeau D. Psychiatrie et toxicomanie.
In : Act. Méd. Int. Psychiatrie (14), n° 203,
octobre1997.
–Idem.
–Bouchez J, Carrière Ph. Place du psy-
chiatre dans les soins aux toxicomanes.
Pericoloso sporgersi ? In : Act. Méd. Int., op.
cit.
–Jeammet P. Psychanalyse et substitution –
un faux antagonisme. In : Les traitements de
substitution pour les usagers de drogue,
Arnette, 1997.
–Bouchez J, Charles-Nicolas A. Pathologies
psychiatriques et toxicomanies. In : Act.
Méd. Int., op. cit.
–Olievenstein C. L’enfance du toxicomane.
In : La vie du toxicomane, Paris, Puf,1991.
–Blondel C. La conscience morbide, Essai
de psychopathologie générale, 1914.
–Morel B.A. Traité des dégénérescences
physiques, intellectuelles et morales de l’es-
pèce humaine. Paris, Baillère, 1857.
–Ey H, Bernard P, Brisset C. Manuel de psy-
chiatrie, Première partie-Généralités, Paris,
Masson & Cie, 1974.
–Ce terme est emprunté à Michel Foucault,
les anormaux, cours au collège de France,
1974-1975, Paris, Hautes Études,
Gallimard-Le Seuil, 1999, p. 85, p. 227,
p. 288. Nous utiliserons ce terme ici pour lui
conférer le sens de la responsabilité que
prend le sujet de la pathologie qui est sensée
le frapper.
–Michaux H. Le problème d’Éros dans les
drogues hallucinogènes (1964). In : L’infini
turbulent, Paris, Gallimard, 1997. La pra-
tique de la mescaline est une “érotique élec-
trique” (p. 216), “un érotisme en dents de
scie”, un “érotisme comme un séisme”
(p. 216). L’orgasme qu’elle provoque est
“criblé, en marches d’escalier” (p. 218). Il
s’agit là d’une découverte majeure de
Michaux. Elle fait suite à une longue période
où il croyait que la mescaline provoquait un
état de schizophrénie artificielle (Misérable
miracle, Paris, Gallimard, 1997). Cette
remarque confirme que c’est dans la littéra-
ture et la poésie que ce sont réfugiés les véri-
tables témoignages sur la pratique des pro-
duits, après que la psychiatrie ait remisé
ladite toxicomanie dans les catégories de la
dégénérescence ou du déséquilibre psy-
chique (voir note 9).
– Lanteri-Laura G. Lecture des perversions,
Paris, Masson, 1979. Georges Lanteri-Laura
démontre dans ce livre souligne la fonction
idéologique que remplit le discours médial
dès lors qu’il s’attaque au recensement des
pratiques sexuelles déviantes.
– Foucault M. Michel Foucault, une inter-
view : sexe, pouvoir et politique de l’identité
(1984). In : Dits et écrits, Paris, Gallimard,
1994, p. 738.
–Ibidem.
–Ibidem.
–Michaux H. Expérience VI. In : L’infini tur-
bulent, op. cit., p.112.
–von Krafft-Ebing R., Psychopathia sexualis,
Paris, Garnier, 1990.
–Ey H. Études psychiatriques, 1948-1953,
3 volumes, Desclée de Brouwer : 256-7.
–Bouchez J, Carrière Ph. Place du psy-
chiatre…, op. cit.
–Moreau de Tours J. Du hachisch et de l’alié-
nation mentale, Études psychologiques,
Paris, Masson & Cie, 1845.
–Lacan J. Petit discours aux psychiatres,
10/11/67. In : Pas-tout Lacan.
–Grivois H. Naître à la folie. Les empê-
cheurs de penser en rond, 1991.
–Arnold-Richez F. Enjeux sociaux de la toxi-
comanie et des traitements de substitution-
Prévention. In : Act. Méd. Int., op. cit.
–Engelsman EL. Dutch Policy on the mana-
gement of drug related problems. In : Brit J
Addict 1989 ; 84 : 211-8 ? cité par A. Mino
et F. Arnold-Richez.
Aujourd'hui j'arrête !
Le tabagisme est un problème majeur de santé
publique avec un coût social annuel estimé entre 10
et 13 milliards d'euros pour la France. Soixante mille Français en meu-
rent chaque année, 47,8 % des jeunes de 18 à 25 ans fument, les cancers
liés au tabac touchent une population de plus en plus jeune et de plus en
plus féminine, et la moitié des fumeurs mourront de leur tabagisme.
Aujourd’hui la meilleure connaissance des fonctionnements cognitifs et
comportementaux des fumeurs a permis l’amélioration de la prise en
charge des deux périodes capitales dans l’arrêt du tabac que sont la
phase de motivation à l’arrêt et la prévention des rechutes.
En janvier 2001, la Ligue nationale contre le cancer et la mutuelle MCD,
en partenariat avec la Fédération nationale de la mutualité française, ont
lancé la campagne pilote “Aujourd’hui j’arrête !”, destinée aux 15-35 ans,
fondée sur une prise en charge partielle par la mutuelle MCD du coût
des produits validés pour l’aide à l’arrêt du tabac.
Un carnet de bord est également mis à la dispo-
sition du fumeur pour l’accompagner dans sa
démarche de sevrage ainsi qu’un site Internet
www.tabac-info.net.
L’évaluation menée auprès d’un échantillon des bénéficiaires de ce
programme montre que, pour les sujets concernés, cette campagne
est suffisamment incitative pour arrêter de fumer, et neuf sur dix
déclarent avoir utilisé les timbres à la nicotine.
Devant ce succès, la mutuelle MCD a décidé d’élargir ses prestations
en proposant désormais une prise en charge allant jusqu’à 70 % pour
les moins de 25 ans, 40 % pour les 25-34 ans et 20 % pour les 35-
49 ans. L’objectif est d’augmenter l’incitation financière à l’arrêt du
tabac en direction des plus jeunes, le facteur financier jouant un rôle
moins important chez les plus âgés plutôt préoccupés par leur santé.
M.P.
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
1
/
4
100%