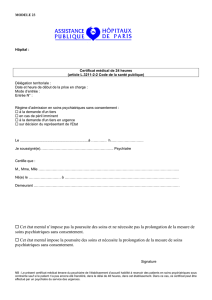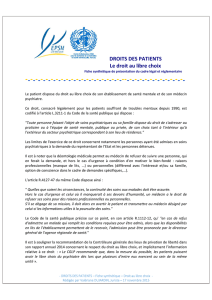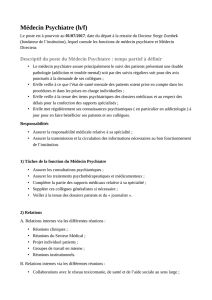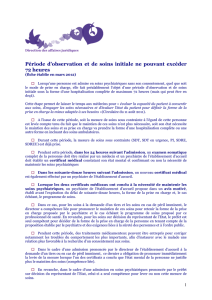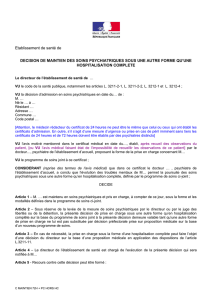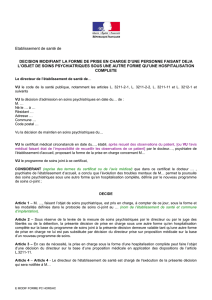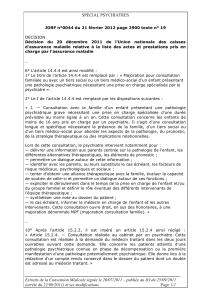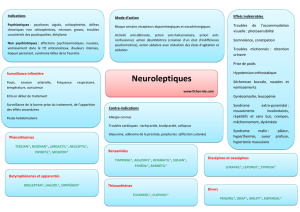Mise au point sur l’évaluation psychiatriques chez les patients adultes

152 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XI - n° 4 - juillet-août 2008
RECOMMANDATIONS
Messages
clés
Les recommandations, résumées sous la forme de messages clés, sont consultables
dans leur entier sur le site : www.afssaps.sante.fr
Mise au point sur l’évaluation
et la prise en charge des troubles
psychiatriques chez les patients adultes
infectés par le virus de l’hépatite C
traités par (PEG) interféron alfa et ribavirine
Une collaboration étroite entre les différents
acteurs impliqués dans le suivi du patient
infecté par le VHC (hépatologue, infec-
tiologue, psychiatre, médecin traitant, addicto-
logue,…) est indispensable avant même l’initiation
du traitement anti-hépatite C et doit se poursuivre
tout au long du traitement et dans les mois qui
suivent son arrêt.
Avant l’initiation
du traitement anti-hépatite C
L’instauration d’un traitement anti-hépatite C
➤
n’est généralement pas une urgence. Aussi, il est
important de prendre le temps nécessaire pour
établir un bilan psychiatrique du patient et identi-
fier les situations pour lesquelles un avis spécialisé
est nécessaire.
Il est recommandé de demander l’avis d’un
➤
psychiatre en cas :
d’antécédent de trouble psychiatrique ayant •
nécessité l’hospitalisation du patient ou une
consultation spécialisée ;
de traitement par thymorégulateur ou anti-
•
psychotique dans l’année écoulée ;
d’antécédent de troubles psychiatriques lors •
d’un traitement antérieur par interféron alfa ;
de mise en évidence d’un épisode dépressif
•
caractérisé, d’un risque suicidaire, d’un trouble
bipolaire et/ou d’un trouble du comportement
actuel(s).
Il est recommandé de demander l’avis d’un réfé-
➤
rent en addictologie pour les patients présentant un
usage de drogues actuel ou dans l’année écoulée.
L’état psychiatrique du patient doit être stabilisé
➤
avant la mise en route du traitement anti-hépatite C.
Le patient et son entourage doivent être informés
➤
des risques liés au traitement.
Pendant le traitement
anti-hépatite C
Il est recommandé de contacter rapidement un ➤
psychiatre en cas de :
verbalisation d’idées suicidaires ; •
manifestations d’agressivité envers l’entourage
•
ou troubles significatifs du comportement ;
présence de signes (hypo)maniaques (euphorie,
•
agitation excessive) ;
persistance et/ou aggravation de symptômes
•
dépressifs ;
en cas de demande spontanée du patient •
et de manière générale dès qu’il existe un
•
doute.
Il est recommandé de contacter rapidement un ➤
référent en addictologie en cas de prise de drogues
et/ou de déstabilisation du traitement substitutif
aux opiacés, voire une augmentation des besoins
en anxiolytiques.
En cas d’effets indésirables psychiatriques
➤
sévères, la poursuite du traitement anti-hépatite C
doit être réévaluée conjointement par l’hépatologue
et le psychiatre. Une diminution des posologies de
l’interféron alfa n’est pas recommandée.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XI - n° 4 - juillet-août 2008 | 153
RECOMMANDATIONS
La survenue de troubles du comportement
➤
(irri-
tabilité, impulsivité, agressivité, hyperémotivité)
doit faire rechercher la présence d’autres troubles
psychiatriques associés, notamment un épisode
maniaque ou hypomaniaque et/ou la consommation
concomitante de drogues qui pourraient justifier la
demande d’un avis spécialisé.
Dans le traitement des épisodes dépressifs
➤
modérés à sévères, il est préférable d‘utiliser en
première intention un inhibiteur sélectif de la recap-
ture de la sérotonine (ISRS) ou inhibiteur de la recap-
ture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNa).
Pour le traitement des épisodes (hypo)maniaques,
les sels de lithium sont à privilégier.
Après le traitement
anti-hépatite C
Des manifestations psychiatriques ont été
➤
rapportées plusieurs mois après l’arrêt du trai-
tement anti-hépatite C. La surveillance de l’état
psychiatrique du patient doit donc se poursuivre
après l’arrêt du traitement anti-hépatite C. Le
patient, son médecin traitant et son entourage
doivent être informés de la possibilité de survenue
ou d’aggravation de troubles psychiatriques même
après l’arrêt du traitement anti-hépatite C et de la
nécessité de consulter rapidement si de tels troubles
sont observés.
Actualités recherche rédigée par le Dr M. Chamaillard, inserm U801, CHRU Lille
Coup de projecteur sur les mécanismes
cancérigènes associés aux MICI
Chaque année dans le monde, environ un million de cas de cancer colorectal sont diagnos-
tiqués. Dans ce contexte, l’inflammation chronique de la muqueuse gastro-intestinale est
apparue comme l’un des facteurs de risque majeurs – près de 5 % des patients atteints de
rectocolite hémorragique développent un cancer du côlon. Une colectomie préventive est
désormais réalisée dans plus de 30 % des cas de rectocolite hémorragique. Une des problé-
matiques principales consiste donc en l’identification des patients susceptibles de développer
des cancers colorectaux associés à une maladie inflammatoire chronique. Une équipe de
chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology vient d’identifier un nouveau
suppresseur de tumeurs, l’alkyladenine ADN glycosylase (AAG). Surexprimé au niveau de
la muqueuse colique de patients atteints de rectocolite hémorragique, la molécule AAG
participe au système de réparation des dommages de l’ADN en excisant les bases altérées
en réponse à un stress cellulaire. En utilisant un modèle expérimental de cancer colorectal
chez la souris, les auteurs ont démontré que la progression, et non l’initiation, des adénomes
associés à des lésions inflammatoires est significativement augmentée chez les animaux
dépourvus d’AAG en comparaison avec des animaux contrôles. Dans un modèle expérimental
de colite, les auteurs ont précisé que l’absence d’AAG est corrélée au développement de
lésions épithéliales intestinales plus sévères et à l’accumulation de bases endommagées
responsables de mutations au niveau de l’ADN du côlon, tout particulièrement au niveau
de l’oncogène CTNNB1. L’infection chronique par Helicobacter pylori – agent infectieux
responsable de cancers gastriques chez l’homme – entraîne également des lésions gastriques
plus sévères chez les animaux déficients pour la molécule AAG que chez les souris contrôles.
En revanche, en l’absence d’inflammation intestinale, aucun rôle protecteur sur la formation
de lésions précancéreuses et d’adénomes du côlon n’a pu être mis en évidence. En conclu-
sion, ces données démontrent que la réparation des lésions de l’ADN causées par une
inflammation chronique est une étape clé de la protection contre la carcinogenèse du côlon
des patients atteints de MICI.
Commentaire
An de sensibiliser les cellules tumorales, la surex-
pression de la glycosylase AAG semble donc être
une approche thérapeutique prometteuse dans le
cancer du côlon associé aux MICI. De nouvelles
études chez l’animal sont désormais attendues
pour tester cette hypothèse avant d’envisager des
essais cliniques chez l’homme.
Référence bibliographique
Meira LB, Bugni JM, Green SL et al. DNA damage induced by
chronic inflammation contributes to colon carcinogenesis
in mice. J Clin Invest 2008;118(7):2516-25.
1
/
2
100%