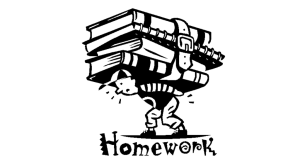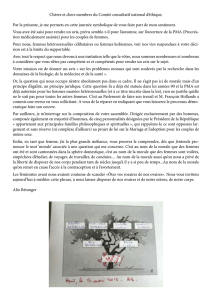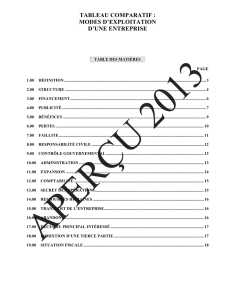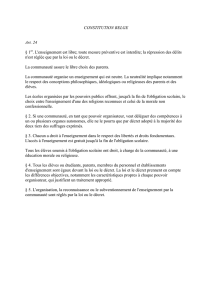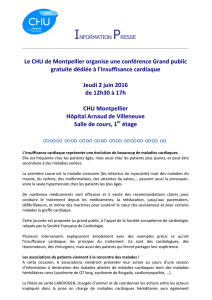C Et si l’on s’occupait de la douleur morale… ?

5
Le Courrier de l’algologie (5), n°1, janvier/février/mars 2006
C
omme l’écrit Canguilhem dans La connaissance de la vie : “L’acte
médico-chirurgical n’est pas qu’un acte scientifique, car l’homme malade
n’est pas seulement un problème physiologique à résoudre, il est sur-
tout une détresse à secourir”. C’est ce que les malades ont voulu rappeler, lors
de leurs États généraux, en réclamant une approche de la maladie plus humaine,
dans laquelle le médecin serait véritablement à l’écoute de la personne qui existe
derrière les symptômes de la maladie. Il y a cinq ans, lors de ces États généraux
des malades du cancer, une patiente nous interpellait, nous, soignants, de la
manière suivante : “Je suis un être physique, psychique, un être subtil et spi-
rituel. Comment m’avez-vous traitée ?”. À maintes reprises, les malades ont
demandé que s’instaure, dès l’annonce du diagnostic, un véritable dialogue qui
leur permette de “dire” ce qui les angoisse, de poser des questions, d’obtenir
des informations, de connaître (ou non) la vérité…
La loi du 4 mars 2002, la consultation budgétisée pour l’annonce du diagnostic
dans le cadre du Plan cancer, la référence 32 du manuel d’accréditation qui
pointe l’obligation de la prise en charge de la douleur aiguë et/ou chronique,
physique et/ou morale, ainsi que le code de déontologie médicale ont servi
de point d’appui à une évolution des mentalités. Le traditionnel rapport
paternaliste du médecin au malade tend progressivement à disparaître pour
laisser place – conformément à la doctrine des Droits de l’homme qui s’ap-
plique désormais au droit médical –, à une altérité, à une volonté de faire de
l’autre, malade, un partenaire du soin. Mais si l’information au malade est
un préalable nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance et à l’ob-
tention d’un “consentement éclairé”, en aucun cas l’information donnée,
aussi bien donnée soit-elle, ne peut résoudre la question de la douleur morale
inhérente à la maladie grave. Car donner une information claire et précise
sur la maladie, sur les symptômes et les traitements n’élimine pas forcément
le vécu subjectif, les peurs et les angoisses. Certaines résistent à toutes les
approches rationnelles.
Que l’on donne du crédit ou non à cette réalité, le malade a à faire avec la
mort, avec sa mort et non pas avec la maladie. Roland Gori rappelle à ce pro-
pos “qu’on oublie que, pour le patient cancéreux, il n’y a pas de ‘bons’ can-
cers établis par une probabilité de guérir, mais seulement une angoisse et une
souffrance en quête de certitude et de réassurance…” Il ajoute : “En fin de
compte, qui contestera qu’il vaut mieux faire partie des 10 % qui survivent
à un ‘mauvais’ cancer que des 10 % qui meurent d’un ‘bon’ cancer ?”
En créant une commission Douleur morale au CLUD du CHU de Nice, nous
souhaitions rappeler, à plusieurs, dans une authentique pluridisciplinarité
(incluant aussi les associations de malades), que la douleur morale des malades
atteints de maladies graves doit bénéficier d’une attention tout aussi grande
de la part de nos pouvoirs publics que celle qui a été accordée depuis plu-
sieurs années à leur douleur physique. En confiant la responsabilité de cette
commission à une psychologue clinicienne, il s’agissait aussi de rappeler que,
Et si l’on s’occupait de la douleur morale… ?
Hélène Brocq*
* Psychologue clinicienne, service
de médecine physique
et de réadaptation,
Centre de référence
pour les maladies neuromusculaires
et la SLA, hôpital Archet 1, Nice.
E-mail : [email protected]

par une prise en charge psychologique précoce du malade et de sa famille,
on peut, sans médicalisation excessive de la souffrance psychique, mieux iden-
tifier la demande des patients (qui se “camoufle” derrière de puissants méca-
nismes de défense) et ainsi réduire efficacement le décalage entre la per-
ception médicale et le vécu du malade, la progression de ce décalage pouvant
engendrer des demandes toujours plus médicalisées dans les méthodes d’ex-
ploration comme dans les traitements.
Depuis la création de cette commission, d’autres CHU nous ont rejoints dans
cette aventure. Le CHU de Montpellier, ceux de Bordeaux et de Bicêtre… Et
pourquoi pas aussi, prochainement, le vôtre…
Grâce à cette tribune, c’est en tout cas le vœu que je formule pour cette nou-
velle année 2006 !
■
MODE DE PAIEMENT
❐
Carte Visa, Eurocard Mastercard N°
Signature : Date d’expiration
❐
Chèque
(à établir à l'ordre de : Le Courrier de l’algologie)
❐
Virement bancaire à réception de facture
(réservé aux collectivités)
DaTeBe SAS - 2, rue Sainte-Marie - 92418 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 46 67 62 00 - Fax : 01 46 67 63 09 - E-mail : [email protected]
ABONNEMENT : 1 an
+
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
❏Collectivité.............................................................................
à l’attention de..........................................................................
❏Particulier ou étudiant
M., Mme, Mlle ............................................................................
Prénom ......................................................................................
Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre .....................
Adresse e-mail...........................................................................
Adresse postale.........................................................................
..................................................................................................
Code postal ........................Ville …………………………………
Pays ...........................................................................................
Tél..............................................................................................
Votre abonnement prendra effet dans un délai de 3 à 6 semaines
à réception de votre ordre. Un justificatif de votre règlement
vous sera adressé quelques semaines après son enregistrement.
ÉTRANGER (AUTRE QU’EUROPE)FRANCE/DOM-TOM/EUROPE
❐100
€collectivités
❐84
€particuliers
❐ 60
ێtudiants*
*joindre la photocopie de la carte
❐80
€collectivités
❐64
€particuliers
❐ 40
ێtudiants*
*joindre la photocopie de la carte
OUI
, JE M’ABONNE AU TRIMESTRIEL Le Courrier de l’algologie
Total à régler .......... €
À remplir par le souscripteur
À découper ou à photocopier
✂
CAlgo 1-2006
ET POUR 10 €DE PLUS !
❐10
€
, accès illimité aux 24 revues de notre groupe de presse
disponibles sur notre site vivactis-media.com (adresse e-mail gratuite)
R
RELIURE
ELIURE
❐10
€
avec un abonnement ou un réabonnement
+
Abonnez-vous !
Dans le cadre de votre Formation Médicale Continue,
devenez un lecteur privilégié...
... et bénéficiez en exclusivité :
✓
d’archives sur 8 ans :
accès à nos revues sur notre site Internet
www.vivactis-media.com
✓
d’une possibilité d’abonnement en ligne
✓
d’une parution régulière
✓
de la rigueur scientifique
et de l’indépendance rédactionnelle
(articles indexés dans la base Pascal [INIST-CNRS]
et récompensés par le Grand Prix Éditorial de la Presse Médicale)
1
/
2
100%