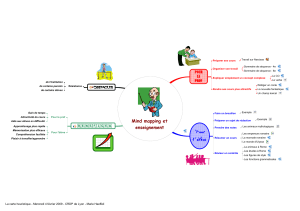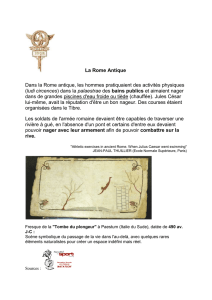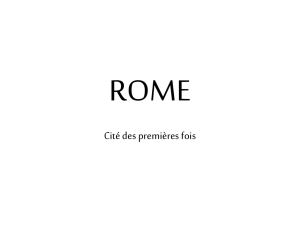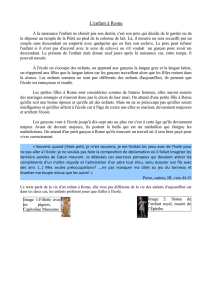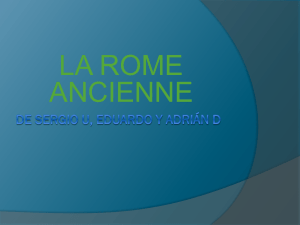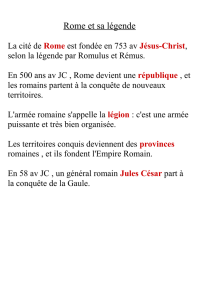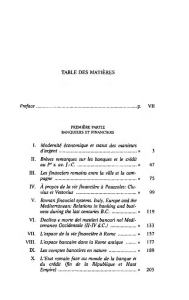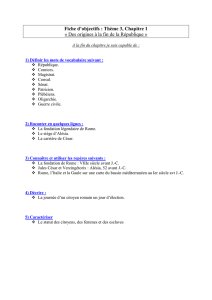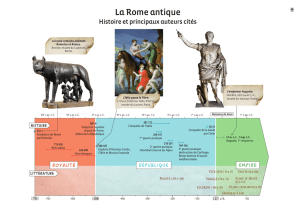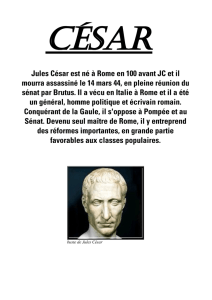LA 1 - Le blog de Jocelyne Vilmin

La ville, motif poétique
Texte 1 : Joachim DU BELLAY (1522-1560), Les Antiquités de Rome (1558),
sonnet III
Question : Comment du Bellay, en opposant la Rome antique et celle qui lui est
contemporaine, propose-t-il une réflexion sur le caractère éphémère des
civilisations ?
Introduction :
Au XVIe siècle, siècle de la Renaissance et de l’Humanisme, sept poètes : Ronsard,
Joachim du Bellay, Jacques Peletier du Mans,Rémy Belleau, Antoine de Baïf, Pontus de
Tyard et Étienne Jodelle fondent le groupe de la Pléiade, dont le nom est emprunté à un
groupe de poètes d’Alexandrie au IIIe siècle. Ils sont animés par les mêmes objectifs :
enrichir la langue française pour qu’elle égale le latin et le grec, imiter les auteurs antiques
pour les dépasser, imposer de nouvelles formes poétiques, objectifs que développe le
manifeste Défense et illustration de la langue française, écrit par Joachim du Bellay et
publié en 1549.
Joachim du Bellay est aussi l’auteur de recueils de sonnets : Les Regrets et Les
Antiquités de Rome notamment, qu’il a publiés en 1548, à son retour de Rome où il avait
séjourné de 1553 à 1557, comme secrétaire de son oncle, le cardinal Jean du Bellay. Parti
avec l’enthousiasme de découvrir la cité antique, il connaîtra la déception : Rome n’est plus
que ruines, la société qu’il côtoie s’illustre par un faste ostentatoire, l’hypocrisie et
l’ambition.
Le sonnet « Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome » est le troisième sonnet
des Antiquités de Rome dont le titre entier est : Les Antiquités de Rome, contenant une
générale description de la grandeur, et comme une déploration de sa ruine, plus un singe
ou vision sur le même sujet ; on voit ainsi se dégager les thèmes majeurs du recueil : la
gloire et le déclin de Rome. Ce sonnet évoque le passé glorieux de Rome en l’opposant à la
Rome contemporaine de l’auteur
Lecture
Reprise de la question et annonce du plan :
Dans ce sonnet régulier, du Bellay oppose donc la Rome antique à celle qui lui est
contemporaine et se dégage du poème une réflexion intemporelle sur le sort des
civilisations. Nous procèderons à une analyse linéaire du poème en montrant que du
Bellay, partant d’une lamentation sur le spectacle des ruines, évoque ensuite le passé
glorieux de la cité et conclut sur le constat de la vanité du monde.
I - La lamentation sur les ruines
On peut tout d’abord constater les répétitions du nom Rome, cinq fois dans le
premier quatrain et de l’expression « Rome en Rome » :« Rome (la Rome antique) en
Rome (la Rome contemporaine) »
a) un constat vérifiable par n’importe qui : l’apostrophe qui ouvre le poème
« Nouveau venu » est généralisante de même que le présent de l’indicatif « cherches »:
elle désigne tout visiteur de Rome et donc le poète lui-même. On peut ajouter que ce
premier vers s’adresse à tout humaniste curieux des valeurs antiques : le verbe
« cherches » renvoie à un des intérêts de l’humanisme : le retour aux sources antiques
dont Rome est un symbole.
b) la déchéance de Rome :
- le quatrain se poursuit par l’évocation des ruines : « ces vieux palais, ces vieux
arcs/ Ces vieux murs » : la répétition de l’adjectif « vieux » et de l’adjectif démonstratif
« ces » donnent évidemment un effet d’insistance sur la décadence des monuments

« palais », « arcs », « murs » dont la succession va en ordre décroissant : du bâtiment
grandiose « palais » à la ruine « murs ».
- on peut constater qu’à la quête active « cherches » au vers 1 succèdent deux
verbes de perception « aperçois » et « vois » à la rime des vers 2 et 3, indiquant le constat
déçu du « nouveau venu »
c) la ruine de Rome
- Le mot « Rien » est mis en relief à l’initiale du vers 2 : la Rome antique n’existe
plus.
- le dernier vers du quatrain reprend cette idée : Rome n’est plus que ruines « C’est
ce que Rome on nomme », constat mis en évidence par le gallicisme « c’est ce que » et par
l’homéotéleute en om
d) le jeu des sonorités : la répétition du nom « Rome », de l’expression « Rome en
Rome », les allitérations des nasales : « Nouveau venu », « Rome », « n’aperçois »,
« murs », « nomme » , les allitérations de la vibrante « r » : « cherches », « Rome »,
« rien », « n’aperçois », « arcs », « murs » donnent un effet de rythme incantatoire,
soulignant la mélancolie du poète, son regret d’une Rome disparue.
L'homéotéleute (substantif féminin), du grec homoios ("semblable") et teleutê
("fin") est une figure de style qui consiste en la répétition d'une ou de plusieurs syllabes
finales homophones soit de mots, de vers ou de phrase : « Rome on nomme »
INCANTATION, subst. fém.
1. Formule magique (récitée, psalmodiée ou chantée, accompagnée de gestes
rituels) qui, à condition qu'on en respecte la teneur, est censée agir sur les esprits
surnaturels ou, suivant les cas, enchanter un être vivant ou un objet (opérée par un
enchanteur ou un sorcier, et qui a un caractère soit bénéfique soit maléfique).
2. Par analogie : Tout ce qui, en vertu d'un caractère mélodique ou rythmique
accentué, évoque le pouvoir d'une incantation.
II - Une réflexion sur le passé glorieux de la cité et sa décadence
Dans ce quatrain, l’opposition entre le passé et le présent est mise en évidence dès
le premier vers grâce au parallélisme antithétique « quel orgueil »/ « quelle ruine » : de la
gloire passée au présent décadent.
a) le passé glorieux est caractérisé par l’expression de la toute puissance de la Rome
antique : La personnification du vers 6, l’utilisation du pronom démonstratif à l’initiale du
vers « Celle » et le verbe d’action « mit » mettent en relief la puissance de la cité. L’
expression « sous ses lois » désigne une domination absolue que vient encore souligner
l’hyperbole « le monde ». Les deux derniers vers du quatrain poursuivent l’expression des
mêmes caractéristiques : la force active par le complément circonstanciel de but « pour
dompter tout », la domination par le verbe « dompter », la puissance absolue par l’emploi
du pronom indéfini « tout »
b) le présent décadent est annoncé au vers 5 par le mot « ruine », placé avant la
coupe, et ainsi mis en valeur. Après l’évocation de la puissance de Rome, les deux derniers
vers du quatrain vont souligner sa destruction et même son autodestruction : l’opposition
est exprimée par la répétition du verbe dompter au vers 7 « pour dompter tout, se dompta
quelquefois ». Rome retourne ainsi contre elle-même son pouvoir comme l’indique la forme
pronominale pour arriver à un état de victime « devint proie ». La déchéance de la cité est
ainsi marquée par celle de son statut : de la Rome personnifiée « Celle qui mit », on en
arrive à l’animal « la proie » victime d’un prédateur. Enfin, la perte de pouvoir de Rome est
soulignée par le fait que, dans le dernier vers du quatrain, c’est le temps qui est sujet et
qui est caractérisé, comme auparavant Rome, par un pouvoir absolu destructeur: « qui
consomme tout »
c) le jeu des sonorités : dans ce quatrain, les occlusives : « quel », « quelle »,
« comme », « qui », « quelquefois », « consomme » et les dentales : « dompter »,
« tout », « dompta », « temps », « tout » dominent, faisant écho, par leurs sonorités
dures, à la force de la Rome d’autrefois et à celle de la douleur du poète qui médite sur sa
déchéance.

III - La vanité du monde
Les deux tercets expriment la conséquence des deux quatrains : le spectacle des
ruines de Rome amène à une méditation sur le caractère éphémère des constructions
humaines.
a) la destruction: Ainsi, les vers 9 et 10 insistent sur le pouvoir destructeur du
temps, en écho au 7 et 8 :
« Rome de Rome est le seul monument / Et Rome Rome a vaincu seulement »
Rome n’est plus que l’ombre d’elle-même : seul le nom Rome » subsiste, de la Rome
antique il ne reste rien. Ces vers font écho aux premiers du sonnet d’une part, par les
thèmes : « monument » fait écho » au champ lexical des constructions employé aux vers 3
et 4 comme le verbe «a vaincu » reprend le thème de l’autodestruction du vers 7 « se
dompta quelquefois » ; d’autre part par le jeu des répétitions : v1 et v. 2 : « Rome en
Rome » / vers 9 et 10 : « Rome Rome ».
b) la permanence de la nature en opposition au caractère éphémère de ce qui est
humain : les vers 11 et 12 indique que ce qui reste de Rome n’est pas du domaine humain
mais appartient à la nature éternelle : le Tibre. Cette opposition est marquée par l’emploi
du présent : le Tibre « s’enfuit », « reste ». L’enjambement des vers 11 et 12 produit un
effet de fluidité, propice à l’évocation du fleuve, comme le complément circonstanciel
« vers la mer » produit un effet d’infini.
c) la vanité du monde
- le vers 12 se termine par une exclamative : « Ô mondaine inconstance ! », traduisant
une constatation résignée du poète et son amertume. Le sonnet se conclut par une
sentence au parallélisme marqué : « Ce qui est ferme, est par le temps détruit / Et ce qui
fuit au temps fait résistance ». Ces deux vers généralisent le propos grâce au présent de
vérité générale et à l’emploi du pronom relatif « ce qui » : comme Rome qui a disparue, la
fermeté n’offre aucune résistance au temps alors que, comme le Tibre qui continue son
cours, ce qui s’écoule demeure.
d) le jeu des sonorités : dans les deux tercets, on peut constater la présence des
allitérations des sifflantes : « seul », « seulement », « seul », « s’enfuit », « reste »,
« inconstance », « ce », « ferme », « fuit », « fait », « résistance », soulignant d’une part
l’expression de la fluidité et d’autre part celle de la tristesse, de la nostalgie du poète.
Conclusion :
- Ce sonnet régulier oppose donc la gloire passée de Rome et sa décadence au
temps de du Bellay. De la Rome antique, il ne reste rien et l’humaniste curieux de
l’antiquité ne peut qu’être déçu par ce lieu. Cet exemple amène du Bellay à une réflexion
plus ample, plus universelle sur le rôle inexorablement destructeur du temps.
- Ce poème est caractéristique du recueil tout entier où du Bellay médite sur la gloire
et le déclin de Rome. Ici donc l’évocation de la ville, d’une ville sert un projet plus
ambitieux : réfléchir à la destinée d’une civilisation, à la destinée des constructions
humaines.
1
/
3
100%