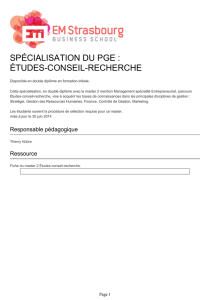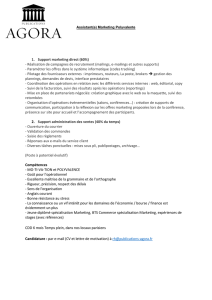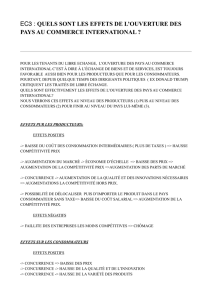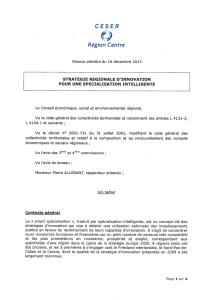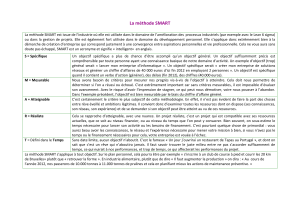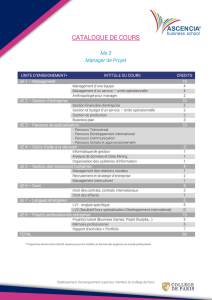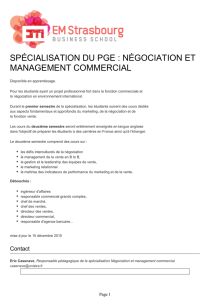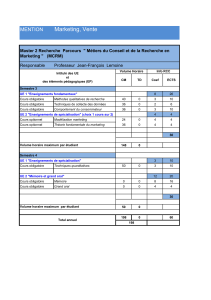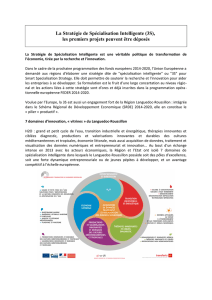CONFERENCES DE METHODE LOGIQUES D’INNOVATION

CONFERENCES DE
METHODE
Master 1 Economie Appliquée et Aménagement des Territoires
LOGIQUES D’INNOVATION
En quoi la « smart spécialisation »
amène-t-elle à reconsidérer les
logiques d’innovation ?
DELAPORTE Alice
ROUFAI Anissa
JUIN Valentin

1
UNIVERSITE DE BORDEAUX-MONTESQUIEU
MASTER 1 ECONOMIE APPLIQUEE « ECONOMIE ET AMENAGEMENT DES TERRITOIRES »
Comment la « smart spécialisation » amène-t-elle à reconsidérer
les logiques d’innovations
DELAPORTE Alice ; JUIN Valentin ; ROUFAI Anissa
Rapport d’étude dans le
cadre de la formation 2014-2015
Direction d’étude : Marilyne Peyrefitte

2
RESUME
Après l’échec de la stratégie de Lisbonne et les bilans mitigés, un nouveau programme
Europe 2020 dont l’objectif est d’entretenir « une croissance durable et inclusive » dans tous
les domaines en identifiant des secteurs clefs est reconduit. En effet, à partir des études d’un
groupe de chercheurs « Knowledge for Growth » et des apports de Dominique Foray la S3
voit le jour. Elle jouit non seulement d’une réflexion approfondie par rapport à la précédente
manœuvre « les SRI » mais prévoit aussi un plan d’action précis avec des moyens de
financements conséquents.
La smart spécialisation propose de réfléchir à de nouvelle manière d’innover et de valoriser
ces ressources. Elle s’inspire des modèles traditionnels anciens mais ajoute à cela une vision
commune européenne et met en place un nouveau plan d’action : la S3 plateforme. Cela peut
passer de l’économie résidentielle et organisationnelle ou bien de partir sur une ressource
spécifique et la repenser afin d’en faire un actif spécifique. La spécialisation intelligente
pourrait permettre une dynamique territoriale insufflée par des écosystèmes et apporter
croissance économique, emploi et richesse pour les régions.
After the failure of Lisbon policy and the weak objectives reached, a new program
Europe 2020 which issue is to maintain a sustainable and inclusive growth in every sectors,
focusing on key-subjects is fulfilled. Indeed, according to the research of expects “Knowledge
for Growth” and the papers of Dominique Foray, smart specialization is created. S3 not only
benefit of a reflection more precise when we look the precedent work on “SRI”, but highlight
to a brief action plan with huge amounts of financial means.
The smart specialization offers to think about new ways to innovate the possibility to add
value to these resources. Inspired by traditional and old models, it adds to this a new
European mutual vision and introduces a new action plan: platform S3. This may go through
residential and organizational economics or to bet on a specific resource and rethink it in
order to create a specific asset. Smart specialization could allow a local momentum though
ecosystems and provide economic growth, employment and wealth for the region.
MOTS-CLES
- Strategy for smart specialization (S3)
- Stratégie régional d’innovation (SRI)
- Logiques d’innovation
- Compétitivité
- Horizon 2020 / Europe 2020

3
SOMMAIRE
Résumé ................................................................................................................................... 2
Mots-clés ................................................................................................................................ 2
Introduction ................................................................................................................................ 4
I. Les logiques d’innovations dans l’horizon 2020 ................................................................ 6
A. Place et perception de l’innovation dans l’Europe 2020 ................................................. 6
B. Le Passage de la SRI à la S3 ......................................................................................... 11
C. Les répercussions sur les territoires .............................................................................. 18
II. La mise en place de la smart spécialisation ...................................................................... 21
A. L’émergence de nouvelles dynamiques organisationnelles .......................................... 21
B. Repenser les innovations en fonction des territoires ..................................................... 25
C. Quels impacts sur les territoires ?.................................................................................. 29
Conclusion ................................................................................................................................ 32
Table des Annexes ................................................................................................................... 33
Bibliographie ............................................................................................................................ 41

4
INTRODUCTION
L’échec de la stratégie de Lisbonne a amené la Commission Européenne à se
réinterroger sur les conditions nécessaires à la redynamisation des territoires européens et à
lancer un nouveau programme destiné à améliorer la compétitivité européenne, face à son
concurrent historique : les Etats-Unis. Pour cela, à partir du milieu des années 2000, des
travaux d’experts commencent à voir le jour, introduisant une nouvelle conception de
l’innovation. En se référant aux anciennes logiques d’innovation, ces travaux présentent de
nouvelles stratégies ainsi que de nouvelles applications de celles-ci. L’économie de la
connaissance à travers la déclinaison des stratégies d’innovation est devenue la clé de voûte
du programme européen Horizon 2020. En effet, afin de permettre une mise en compétitivité
efficace de l’espace régional et national, il apparaît nécessaire de repenser les enjeux actuels
et de trouver un mode de développement adapté à la structure spécifique de chaque territoire.
Ces perspectives sont clairement définies dans la mise en œuvre d’un Espace Européen de la
Recherche. En effet, cette manœuvre traduit l’approfondissement d’une cohésion territoriale
lisible et concertée fondée sur l’excellence scientifique, la compétitivité et la coopération
entre acteurs fondamentaux. C’est dans ce contexte qu’il est nécessaire de situer l’action
européenne visant à accroître la compétitivité internationale et infrarégionale via le
développement de nouvelles logiques d’innovation. Afin de stimuler les économies en crises
et reconvertir les secteurs en perdition, la communauté s’est tournée vers une approche
structurelle. Il s’agit d’inclure l’innovation dans la réflexion économique institutionnelle et
sociétale.
Dominique Foray, expert sur la question et fondateur du concept de smart spécialisation, la
défini comme « Un processus de sélection qui a pour finalité une priorisation et une
concentration des ressources sur un nombre limité de domaines d’activités et secteurs
technologiques où une région dispose d’un avantage comparatif, au niveau mondial, et donc
susceptibles de générer de nouvelles activités innovantes qui confèreront à moyen-terme un
avantage concurrentiel dans l’économie mondiale
1
». La S3 est directement inspirée des
stratégies régionales d’innovation, qui peuvent se caractériser par une action concrète dans
chacune des régions européennes, ayant pour but de définir les priorités stratégiques des
territoires et de permettre une bonne articulation des stratégies nationales et locales. Toutes
ces stratégies sont directement liées aux logiques d’innovation que l’on peut définir comme
étant un processus d’accélération de la dynamique économique et sociale. L’innovation admet
des formes diverses et variées, il peut s’agir d’innovations techniques, d’organisations du
travail ou d’éducation. Tout au long du XXème siècle, les acteurs économiques de différents
domaines (entreprises, recherches, universités, économie sociale, etc.) se sont regroupés avec
la volonté de créer des synergies entre les différents savoirs et savoir-faire dans le but
d’accroitre la compétitivité régionale et nationale. Cette dernière représente la capacité d’une
1
FORAY Dominique, Understanding smart specialization in PONTIKATIS, KYRIAKOU Y VAN BAVEL, The
question of R&D Specialisation, 2009
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%