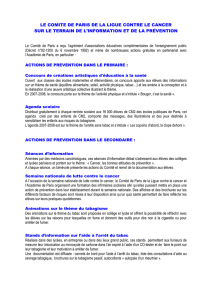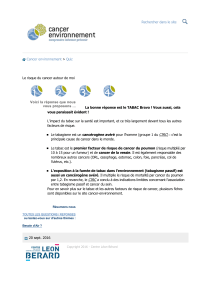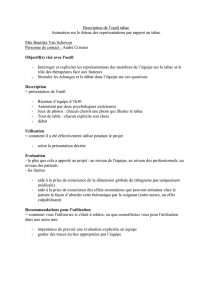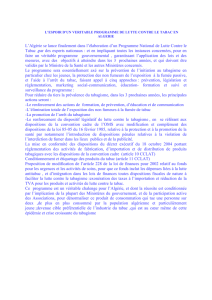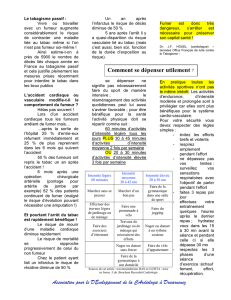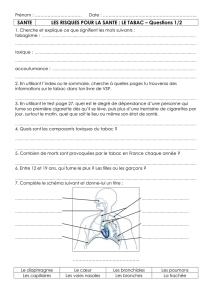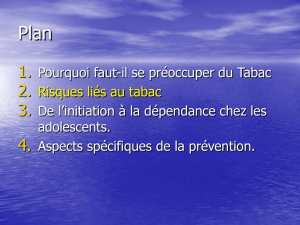L Renforcer la prévention du tabagisme dans les soins en cancérologie

102 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVII - n° 3 - mai-juin 2014
ONCO-PNEUMOLOGIE
Renforcer la prévention
du tabagisme dans les soins
en cancérologie
Investigate the tobacco prevention field in cancer care
J. Gaillot de Saintignon*, A. Deutsch*
* Département de prévention,
Institut national du cancer, Boulogne-
Billancourt.
L
e tabac est le premier facteur de risque de
cancer, responsable de plus de 30 % des décès
par cancer, soit 44 000 décès chaque année. La
consommation de tabac est également associée à
une moins bonne réponse aux traitements du cancer,
à un risque accru de second cancer primitif, à une
augmentation de la toxicité des traitements et à
une dégradation de la qualité de vie des patients.
La survenue d’un cancer est décrite, par ailleurs,
comme un moment propice aux changements de
comportements. Ainsi, une démarche de sensibilisa-
tion et d’accompagnement volontariste à l’arrêt du
tabac après un diagnostic de cancer est nécessaire.
Le Programme national de réduction du tabagisme,
annoncé dans le cadre du Plan cancer 2014-2019,
a notamment comme objectif de mieux impliquer
les professionnels de la santé dans l’accompagne-
ment à l’arrêt de leurs patients. Il propose, pour les
patients atteints de cancer, le triplement du forfait
de remboursement des substituts nicotiniques, soit
150 € par an. Cela marque le positionnement fort
que l’arrêt du tabac doit avoir dans les soins, et plus
particulièrement en cancérologie.
L’arrêt du tabac pour améliorer
le traitement des patients
atteints de cancer
Les progrès réalisés dans le diagnostic et les traite-
ments ont permis d’accroître, pour un grand nombre
de cancers, les chances de survie des patients. La
prise en charge des cancers n’est ainsi plus restreinte
à la phase aiguë du traitement. Elle considère désor-
mais les spécificités de la tumeur et du patient,
qui peuvent avoir un impact sur la réussite et les
complications des traitements. Dans ce sens, de plus
en plus d’études montrent que la poursuite de la
consommation de tabac est associée à la diminution
de l’efficacité de certains traitements, à l’augmen-
tation des effets indésirables et du risque de second
cancer primitif et à une dégradation de la qualité
de vie des patients. Ainsi, l’arrêt du tabac doit être
recherché après le diagnostic d’un cancer (1). Le
rapport Identifier et prévenir les risques de second
cancer primitif chez l’adulte, publié en décembre
2013 par l’Institut national du cancer (INCa), met
en évidence l’implication du tabac dans la survenue
d’une proportion importante de seconds cancers
primitifs, par son action cancérogène directe, mais
aussi indirecte, via son interaction avec certains
traitements anticancéreux (2). Une augmenta-
tion du risque de cancer du poumon radio-induit
est observée chez les patientes fumeuses traitées
pour un cancer du sein, ainsi que chez les patients
fumeurs traités pour un lymphome hodgkinien (3, 4).
Le risque de cancer du poumon chez les femmes
traitées par irradiation pour un cancer du sein est
trois fois plus élevé pour le poumon ipsilatéral que
pour l’autre poumon lorsque celles-ci sont fumeuses.
De plus, plusieurs études portant sur des patients
atteints de cancer du poumon et de la sphère ORL
montrent que le fait de continuer à fumer augmente
le risque de second cancer primitif tandis que l’arrêt
semble pouvoir le diminuer (5, 6). D’autres études
décrivent, chez les patients atteints de cancer, des
effets du tabagisme sur le risque de récidive et sur la
mortalité (7), l’augmentation des complications péri-
et postopératoires (8), et une plus grande susceptibi-
lité aux effets indésirables des traitements, telles les
cardiomyopathies après la prise d’anthracyclines (9)
ou les mucites après une radiothérapie (10). L’Ame-
rican Society of Clinical Oncology (ASCO
®
) a publié,
en 2012, un guide à l’intention des oncologues pour
faciliter leur implication dans l’arrêt du tabagisme
des patients (11). Ce guide présente les effets de
la consommation de tabac selon le type de traite-
ment utilisé (tableau I). La diversité des effets du
tabac observés chez les patients atteints de cancer
Le présent article est publié
parl’Institut national ducancer,
quiendétient les droits.
Saréutilisation est possible dèslors
qu’elle entre dans le champ
d’application de la loi n°78-753
du17juillet 1978 et qu’elle en
respecte les conditions (absence
d’altération, de dénaturation
desonsens etmention de lasource
etde la date desa dernière
miseàjour éventuelle).

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVII - n° 3 - mai-juin 2014 | 103
Points forts
»Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France, responsable de plus de 30 % des décès
par cancer.
»La consommation de tabac est associée, après un diagnostic de cancer, à une moins bonne réponse au
traitement, à un risque accru de second cancer primitif, à une aggravation des effets indésirables destrai-
tements et à une dégradation de la qualité de vie des patients.
»
Il est important de systématiser l'aide à l'arrêt du tabac dans le cadre de la prise en charge des patients
atteints de cancer.
»
L’implication des professionnels de la cancérologie dans la prévention du tabagisme ne s’arrête pas
aux interventions auprès de leurs patients. Ils ont la légitimité nécessaire, en raison du poids de ce facteur
dans la mortalité due au cancer, pour être de véritables porte-parole de la lutte contre le tabac.
Mots-clés
Tabac
Patients atteints
decancer
Arrêt du tabac
Professionnels
delasanté
Highlights
»
Tobacco is the leading
preventable cause of death
in France, responsible for over
30% of cancer deaths.
»
Tobacco use is associated,
after diagnosis of cancer, with
a poorer response to treatment,
an increased risk of second
primary cancers, a worsening
of side effects of therapy and
a degradation of the quality of
life of patients.
»
It is important to systema-
tize the support of cessation
included in the care of cancer
patients.
»
The involvement of profes-
sionals in cancer prevention
of smoking does not stop at
an intervention with their
patients. They are legitimate,
by the weight that this factor
represents in cancer mortality,
to be true spokespersons in the
tobacco control.
Keywords
Smoking
Cancer survivors
Tobacco cessation
Health providers
souligne que l’arrêt du tabac représente un enjeu
pour l’ensemble des patients et pas seulement pour
ceux qui sont atteints d’un cancer dont l’étiologie
tabagique forte est bien établie (poumon, ORL).
Les patients atteints de cancer
sont demandeurs d’aide pour
modifier leurs comportements
L’annonce du diagnostic d’un cancer apparaît, selon
la littérature anglo-saxonne, comme un élément
clef de la motivation pour l’arrêt du tabac chez un
grand nombre de patients. Près de 30 à 60 % des
patients arrêtent spontanément de fumer après le
diagnostic d’un cancer ou pendant les traitements.
Et, parmi ceux qui continuent à fumer, la plupart
semblent fréquemment désirer réduire ou arrêter
leur consommation et ressentent le besoin d’être
aidés pour y parvenir (12). Une synthèse bibliogra-
phique sur le sujet montre que certains facteurs
renforcent la motivation du patient atteint de
cancer, comme le fait d’être atteint d’un cancer
connu pour être principalement lié au tabagisme
(cancer du poumon ou ORL, versus cancer du sein),
la gravité de la maladie et la lourdeur des traite-
ments administrés (radiothérapie/chimiothérapie
versus chirurgie seule). Les périodes d’hospitalisa-
tion ainsi que l’annonce du diagnostic constituent
des moments propices au renforcement de la
motivation du patient. Pourtant, le sevrage taba-
gique est souvent perçu par les soignants comme
une privation inutile de l’un des seuls plaisirs qu’il
reste aux patients atteints de cancer. D’une façon
générale, on observe que l’importance que l’onco-
logue apporte aux messages de prévention est un
élément déterminant dans l’adhésion des patients
aux recommandations (11-13). Les patients atteints
de cancer peuvent être très différents vis-à-vis de
leur dépendance au tabac et de la représentation
qu’ils ont des effets du tabac sur leur santé. L’accom-
pagnement à l’arrêt peut ainsi aller de la délivrance
d’un simple message de sensibilisation à l’orientation
vers des spécialistes du sevrage. Ces derniers seront
à même d’adapter la prise en charge de l’arrêt du
tabac en fonction des spécificités de chaque patient,
en anticipant les possibles coaddictions, le risque de
dépression, les effets indésirables des traitements
L’Institut national du cancer (INCa) est l’agence sani-
taire et scientifique de l’État chargée de coordonner les
actions de lutte contre le cancer.
Créé par la loi de santé publique du 9 août 2004, il est placé
sous la tutelle conjointe du ministère des Affaires sociales
et de la Santé et du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
L’INCa a pour ambition de jouer un rôle d’accélérateur de
progrès au service des personnes malades, de leurs proches,
des usagers du système de santé, de la population générale,
des professionnels de la santé, des chercheurs, des experts et
des décideurs. Ses missions sont de :
➤coordonner les actions de lutte contre le cancer ;
➤
initier et soutenir des projets de recherche et l’innovation
médicale, technologique et organisationnelle ;
➤
agir sur l’organisation des dépistages, des soins et de
la recherche ;
➤
produire des expertises sous forme de recommandations
nationales, de référentiels, de rapports et d’avis ;
➤produire, analyser et évaluer des données dans tous les
domaines de la cancérologie ;
➤
favoriser l’appropriation des connaissances et des bonnes
pratiques par les différents publics.
Retrouvez les publications de l’INCa sur www.e-cancer.fr
Tableau I. Effets du tabagisme selon les traitements du cancer (11).
Chirurgie Radiothérapie Chimiothérapie
• Augmentation des complications
del’anesthésie générale
• Augmentation du risque
decomplications sévères pulmonaires
•Effets délétères sur la cicatrisation :
– compromet la circulation sanguine
capillaire
–augmente la vasoconstriction
–augmente le risque d’infection
•Réduit l’efcacité des traitements
• Augmente la toxicité et les effets
indésirables :
–xérostomie
–perte du goût
–pneumonie
–nécrose des tissus mous et osseux
–mauvaise qualité de la voix
• Potentielle exacerbation des effets
indésirables, incluant :
–immunosuppression
–perte de poids
–fatigue
–toxicités cardiaque et pulmonaire
• Augmentation de l’incidence
desinfections

104 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVII - n° 3 - mai-juin 2014
ONCO-PNEUMOLOGIE Renforcer la prévention dutabagisme dans les soins encancérologie
anticancéreux, etc. (14). Le Plan cancer 2003-2007
a permis l’ouverture de nombreuses consultations de
tabacologie sur le territoire. Tous les départements
disposent depuis 2004 d’au moins une consultation
hospitalière de tabacologie.
Systématiser le repérage
de l’addiction au tabac
et l’accompagnement
à l’arrêt pour tous les patients
atteints de cancer
La Haute Autorité de santé (HAS), dans ses nouvelles
recommandations de bonne pratique publiées en
2013, invite tous les professionnels de la santé, dont
les cancérologues, à interroger systématiquement
leurs patients sur leur consommation de tabac et à
conseiller l’arrêt à tous leurs patients fumeurs (15).
En effet, il existe toujours un bénéfice à l’arrêt du
tabac, quel que soit l’âge, et ce gain se révèle d’au-
tant plus important que le sevrage tabagique est
plus précoce. Arrêter de fumer à 40 ans augmente
l’espérance de vie de 7 ans ; arrêter à 50 ans, de
4 ans, et arrêter à 60 ans, de 3 ans. Dans ce sens,
la HAS préconise l’utilisation de la méthode des
5A, qui tient en 5 points qui peuvent être abordés
en 3 minutes : Ask (poser des questions), Advise
(conseiller), Assess (évaluer), Assist (aider, soutenir)
et Arrange (organiser) [tableau II]. Cette démarche
est préconisée dans de nombreux pays pour prendre
en charge le tabagisme, notamment dans les recom-
mandations américaines de 2008 (16). Les mesures
annoncées dans le Plan cancer 2014-2019 devront
également faciliter le repérage et la prise en charge
de la consommation de tabac des patients suivant un
parcours de prise en charge en cancérologie. Le statut
tabagique du patient devra être renseigné dans la
fiche des réunions de concertation pluridisciplinaire
(RCP), et son suivi devra figurer dans le dossier du
patient. Le montant du forfait d’aide à l’arrêt du
tabac pour l’ensemble des patients atteints de cancer
doit passer de 50 à 150 €. Afin d’accompagner cet
engagement partagé entre tous les acteurs de la
cancérologie, l’INCa mettra à disposition un argu-
mentaire scientifique rappelant les bénéfices de
l’arrêt du tabac pour les patients atteints de cancer
(diminution du risque de second cancer, amélioration
de l’efficacité des traitements du cancer et, plus
globalement, de la survie).
Les professionnels de la santé,
porte-parole de la lutte contre
le tabac
Les professionnels de la santé ont un rôle éminent
à jouer dans la lutte antitabac. Ils jouissent de la
confiance de la population, des médias et des leaders
d’opinion, et leurs voix se font entendre dans un
vaste ensemble de cercles sociaux, économiques et
politiques. Au niveau individuel, ils peuvent édifier la
population sur les dommages de la consommation
de tabac et du tabagisme passif (17). La France doit
faire face à une consommation tabagique qui reste
encore aujourd’hui trop élevée, 1 Français âgé de 15
à 75 ans sur 3 fumant quotidiennement, soit plus
13 millions de personnes (18). Il ne faut pas consi-
dérer cette forte prévalence comme une fatalité, car
d’autres pays, comme l’Australie, le Royaume-Uni ou
les États-Unis, ont vu récemment leur consomma-
tion de tabac passer en dessous de la barre symbo-
lique des 20 %, grâce à une politique de prévention
volontariste. Une des priorités du Plan cancer 2014-
2019 est le lancement d’un programme national
de réduction du tabagisme ayant pour objectif une
diminution de 1/3 de la prévalence tabagique d’ici
à la fin du plan. Il s’agit de déployer une politique
Tableau II. Méthode des 5A pour l’aide à l’arrêt du tabagisme.
Ask about tobacco use
Interroger sur la consommation de tabac Identifier et documenter le statut tabagique
detous les patients à chaque visite
Advise to quit
Conseiller l’arrêt du tabagisme D’une manière claire, ferme et personnalisée,
proposer à chaque fumeur d’arrêter de fumer
Assess willingness
to make a quit attempt
Évaluer la motivation pour l’arrêt
dutabagisme
Demander au patient s’il envisage d’arrêter
defumer
Assist in quit attempt
Aider la tentative d’arrêt du tabagisme Pour le patient disposé à faire une tentative d’arrêt,
proposer un accompagnement et une pharmacothérapie
pour l’aider à arrêter de fumer
Arrange follow-up
Organiser le suivi de l’aide au sevrage
tabagique
Proposer des temps de suivi commençant lapremière
semaine après la date de l’arrêt

Références bibliographiques
>>>
La Lettre du Pneumologue • Vol. XVII - n° 3 - mai-juin 2014 | 105
ONCO-PNEUMOLOGIE
ambitieuse, globale et cohérente s’attachant, d’une
part, à dissuader l’entrée dans le tabagisme pour les
jeunes, et, d’autre part, à rendre plus facile l’arrêt du
tabac pour les fumeurs. Mobiliser les professionnels
de la santé dans cet effort de prévention représente
un défi important. En effet, les mesures prises ces
dernières années en France ont fait de la lutte contre
le tabac une problématique plus sociétale (exemple :
interdiction de fumer dans les lieux publics) et fiscale
(exemple : augmentation du prix du tabac) que de
santé en impliquant trop peu le corps médical et
l’ensemble des professions de la santé. Ainsi, long-
temps cantonnée à des actions menées auprès de
la population générale, la prévention du tabagisme
doit être plus systématiquement intégrée à la prise
en charge des patients. L’objectif est double : faire en
sorte que les médecins participent de façon efficace
à l’effort collectif de prévention primaire et optimiser
la prise en charge médicale de leurs patients, en
réduisant les risques de comorbidités et de morta-
lité liés au tabagisme. L’enjeu est particulièrement
important dans l’accompagnement à long terme
des patients atteints de maladies chroniques et, en
particulier, des patients atteints de cancer (14). Des
études scientifiques ont montré que la consomma-
tion de tabac des patients est fortement influencée
par les conseils reçus par leur médecin. Il a égale-
ment été montré qu’un professionnel de la santé
fumeur est moins enclin à promouvoir le sevrage
tabagique de ses patients. Il serait donc important
que la prévalence tabagique des professionnels de
la santé français rejoigne celle de leurs homologues
américains et anglais, autour de 5 %, pour faire office
de modèle auprès de la population générale (19). Les
représentants de professionnels de la santé peuvent
également devenir des leaders d’opinion permettant
d’influer sur des sujets dépassant le strict cadre de
leur pratique, à l’instar de l’Association des méde-
cins britanniques (BMA), qui, dès 1986, a appelé
de ses vœux une législation interdisant de fumer
dans les lieux publics clos, et de l’American Society
of Clinical Oncology (ASCO), qui est engagée en
première ligne dans la lutte contre le tabac. Leur
rôle dans l’adhésion de l’opinion publique à un
programme national de réduction du tabagisme
présente un vaste potentiel, largement inexploité
pour l’instant par la plupart des professionnels de la
santé. Si chaque professionnel de la santé ne peut
pas faire de la lutte antitabac le centre de son activité
professionnelle, tous peuvent et doivent exprimer
clairement l’ampleur du problème posé par le tabac,
en termes de maladies, de souffrance et de décès
prématurés, ainsi que le fardeau économique qu’il
représente pour la société, et faire connaître leur
appui à des mesures antitabac.
Conclusion
S'appuyant sur des preuves scientifiques et médi-
cales incontestables concernant le lien entre cancer
et tabac et les graves conséquences du tabagisme
en termes de morbidité et de mortalité en France,
le Plan cancer 2014-2019 fait de l’implication des
professionnels de la santé dans la prévention et la
réduction du tabagisme un enjeu majeur. Les profes-
sionnels de la santé, référents sur des questions
sanitaires auprès de leurs patients, sont appelés à
prodiguer les meilleurs conseils et à proposer un
accompagnement personnalisé pour l’arrêt du tabac.
Sans oublier une exigence d’exemplarité dans leur
propre comportement. ■
Le tabac constitue la principale cause évitable de mortalité et de morbidité dans
les pays développés. Il est responsable en France de 73 000décès chaque année,
dont 44 000 par cancers. Les produits du tabac inhalés sont de puissants cancérogènes
incriminés dans le développement de cancers dans 17localisations différentes : cancer
du poumon et de la sphère ORL en premier lieu, mais également cancers des voies
urinaires, du rein, du col de l’utérus, de l’ovaire, du côlon, du rectum et de l’estomac,
certaines hémopathies et même le cancer du sein.
Les auteurs déclarent
ne pas avoir de liens d’intérêts.

Nombre
d’exemplaires
Total en
euros
L'annonce de la maladie : une parole qui engage (29 €)
Relation médecin-malade : enjeux, pièges et opportunités (29 €)
Frais de port 3,80 €
soit un total de €
Je souhaite recevoir
Frais de port
soit un total de
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
MODE DE PAIEMENT
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
Dr, M., Mme, Mlle ............................................................................................................................................ Prénom ..............................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal .......................................................... Ville .............................................................................................................................. Pays ..........................................................................................................
Tél. ............................................................................. Fax ............................................................................ E-mail ...........................................................................................................................................................
Carte bancaire VISA, EUROCARD/MASTERCARD
N°
I I I I I I I I I I I I I I I I I
Date d’expiration
I I I I I N° C V V I I I I
Date : Signature :
Chèque à l’ordre de "EDIMARK"
Virement bancaire à réception de facture (réservé aux collectivités)
EDIMARK SAS - Éditions - 2, rue Sainte-Marie - 92418 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 46 67 62 87 - Fax : 01 46 67 63 09 - E-mail : [email protected]
Un justificatif validant votre DPC sera joint à la facture
Nos éditions vous proposent :
(Trois derniers chiffres au dos de votre carte bancaire)
(obligatoire)
EUROCARD/MASTERCARD
I I I I I I I I I I I I I I I
I I
I
EUROCARD/MASTERCARD
I I I I I I I I I I I I I I I
I
Acheter
et régler
en ligne
NOS OUVRAGES
Bulletin à découper et à renvoyer complété et accompagné du règlement à :
EDIMARK SAS – Éditions – 2, rue Sainte-Marie – 92418 Courbevoie Cedex
DIFF/ABO/EDI
ONCO-PNEUMOLOGIE Renforcer la prévention dutabagisme dans les soins encancérologie
1. Hanna N, Mulshine J, Wollins DS et al. Tobacco cessa-
tion and control a decade later: American society of
clinical oncology policy statement update. J Clin Oncol
2013;31(25):3147-57.
2. Institut national du cancer. Identifier et prévenir les risques
de second cancer primitif chez l’adulte. 2013.
http://www.e-cancer.fr/publications/62-prevention/740
3. Travis LB, Gospodarowicz M, Curtis RE et al. Lung
cancer following chemotherapy and radiotherapy
for Hodgkin’s disease. J Natl Cancer Inst 2002;94(3):
182-92.
4. Prochazka M, Hall P, Gagliardi G et al. Ionizing radiation
and tobacco use increases the risk of a subsequent lung
carcinoma in women with breast cancer: case-only design.
J Clin Oncol 2005;23(30):7467-74.
5. Richardson GE, Tucker MA, Venzon DJ et al. Smoking
cessation after successful treatment of small-cell lung
cancer is associated with fewer smoking-related second
primary cancers. Ann Intern Med 1993;119(5):383-90.
6. Do KA, Johnson MM, Lee JJ et al. Longitudinal study
of smoking patterns in relation to the development of
smoking-related secondary primary tumors in patients
with upper aerodigestive tract malignancies. Cancer 2004;
101(12):2837-42.
7. Parsons A, Daley A, Begh R, Aveyard P. Influence of
smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer
on prognosis: systematic review of observational studies
with meta-analysis. BMJ 2010;340:b5569.
8. McCulloch TM, Jensen NF, Girod DA et al. Risk factors
for pulmonary complications in the postoperative
head and neck surgery patient. Head Neck 1997;19(5):
372-7.
9. Fujisawa T, Iizasa T, Saitoh Y et al. Smoking before surgery
predicts poor long-term survival in patients with stage I
non-small-cell lung carcinomas. J Clin Oncol 1999;17(7):
2086-91.
10. Rugg T, Saunders MI, Dische S. Smoking and mucosal
reactions to radiotherapy. Br J Radiol 1990;63(751):554-6.
11. American Society of Clinical Oncology. Tobacco cessa-
tion guide for oncology providers. 2012. http://www.asco.
org/sites/default/files/tobacco_cessation_guide.pdf
12. Demark-Wahnefried W, Aziz NM, Rowland JH, Pinto
BM. Riding the crest of the teachable moment: promoting
long-term health after the diagnosis of cancer. J Clin Oncol
2005;23(24):5814-30.
13. Jones LW, Courneya KS, Fairey AS, Mackey JR. Effects of
an oncologist’s recommendation to exercise on self-reported
exercise behavior in newly diagnosed breast cancer survivors:
a single-blind, randomized controlled trial. Ann Behav Med
2004;28(2):105-13.
14. Gritz ER, Vidrine DJ, Fingeret MC. Smoking cessation:
a critical component of medical management in chronic
disease populations. Am J Prev Med 2007;33(Suppl 6):
S414-22.
15. Haute Autorité de santé. Arrêt de la consommation de
tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence
en premier recours. 2013.
16. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB et al. Treating tobacco use
and dependence : 2008 update. U.S. Public Health Service
Clinical Practice Guideline executive summary. Respir Care
2008;53(9):1217-22.
17. Organisation mondiale de la santé. Le rôle des profes-
sionnels de la santé dans la lutte antitabac. Genève, 2005.
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/
wntd/2005/layoutfinalf.pdf
18. Guignard R, Beck F, Richard JB, Peretti-Watel P. Le taba-
gisme en France : analyse de l’enquête Baromètre santé
2010. Saint-Denis: Inpes, coll. Baromètre santé, 2013.
19. Joseran L, King G, Guilbert P et al. Smoking by French
practitioners : behaviour, attitudes and practice. Eur J Public
Health 2005;15(1):33-8.
Références bibliographiques
1
/
5
100%