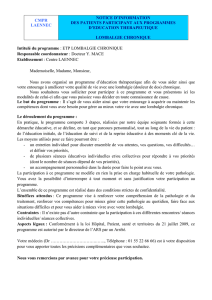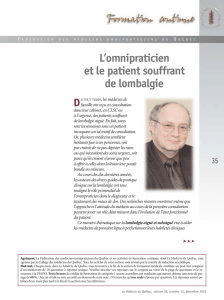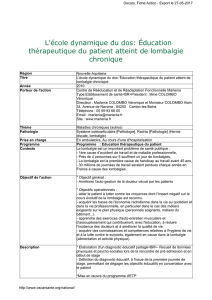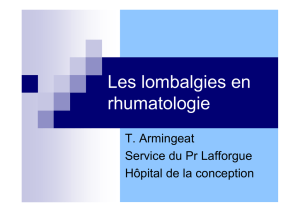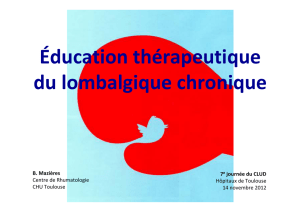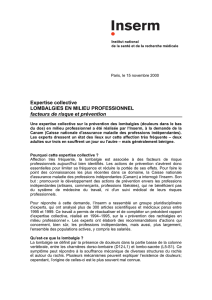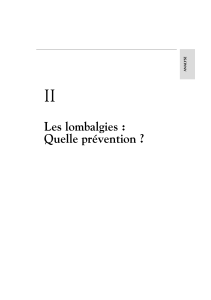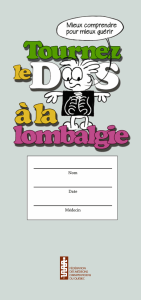Dossier « textes d’experts » Une base pour des recommandations. Introduction.

Dossier « textes d’experts »
médecine et armées, 2010, 38, 1, 17-21 17
Incidence et prévention des lombalgies en milieu militaire.
Une base pour des recommandations.
Introduction.
La lombalgie est un symptôme très fréquent puisque
l’on estime que 50 % à 85 % de la population française en
a souffert ou en souffrira. La lombalgie aiguë est la plus
fréquente, de pronostic généralement rapidement
favorable, représentant un banal accident de la vie. Moins
de 10 % des patients vont évoluer vers la chronicité mais
ils vont représenter 70 % à 80 % des coûts liés à l’affection.
La pratique quotidienne montre que la communauté
militaire est fortement concernée par ce problème de
santé publique, bien que les études épidémiologiques
manquent. La lombalgie chronique relève d’un modèle
biopsychosocial, dans lequel les facteurs psychologiques,
sociaux et professionnels sont plus importants que les
facteurs médicaux. Une partie de la prise en charge
préventive échappe donc au corps médical et est de la
compétence du commandement.
Définitions.
La lombalgie peut se définir comme une douleur
ressentie au niveau de la région lombaire, c’est-à-dire
entre les dernières côtes et les plis fessiers.
Selon l’ancienneté de la douleur, on distingue la
lombalgie aiguë qui évolue depuis moins de six semaines,
la lombalgie chronique qui évolue depuis plus de trois
mois et enfin la lombalgie subaiguë qui évolue entre six
semaines et 3 mois.
Selon l’étiologie, l’on distingue lombalgie spécifique
et non spécifique. Nous n’aborderons pas ici la lombalgie
spécifique, dite aussi secondaire ou symptomatique, qui
est en rapport avec une fracture, une tumeur, une infection
ou une maladie inflammatoire du rachis. Elle ne
représente que 1 % à 5 % des lombalgies, mais justifie la
nécessité d’une consultation médicale systématique. La
lombalgie non spécifique ou commune représente au
moins 95 % des cas. On suppose alors qu’elle est en
rapport avec une souffrance musculaire, ligamentaire,
discale ou articulaire postérieure, sans que la prise en
charge ou l’évolution soit modifiée par la détermination
de la structure en cause.
La lombalgie peut-être isolée ou associée à une
souffrance radiculaire qui est le plus souvent sciatique,
parfois crurale. La douleur dépasse alors le pli fessier et
irradie dans le membre inférieur.
L’invalidité lombalgique peut se définir comme une
lombalgie grave avec retentissement ou désinsertion
professionnelle.
Étiologie et physiopathologie de la
lombalgie commune.
L’origine de la lombalgie non spécifique est
multifactorielle. Des facteurs génétiques, anatomiques et
d’environnement, dont certains facteurs professionnels,
sont incriminés. Plusieurs modèles et concepts ont été
élaborés afin de comprendre la physiopathologie de la
lombalgie commune et le passage à la chronicité. La
connaissance de ces facteurs est indispensable pour la
prévention des lombalgies.
Le modèle biomédical.
Ce modèle tente d’expliquer la lombalgie par des
lésions anatomiques, discales ligamentaires ou
articulaires postérieures. Ces lésions anatomiques
existent, en particulier dans les formes chroniques de
l’affection, parfois dans le cadre d’une « dégénérescence
discale ». L’existence d’une néo-innervation discale
susceptible d’expliquer certaines douleurs est connue.
Par contre, la recherche de lésions anatomiques a
justifié et motive encore la réalisation d’examens
d’imagerie souvent excessifs et répétés à la recherche
d’une image expliquant la douleur. En fait, il n’y a aucun
parallélisme anatomo-radio-clinique au cours de la
lombalgie commune et les radiographies du rachis
lombaire, lues en aveugle, ne permettent pas de
discriminer une population lombalgique d’une
population non lombalgique. La fréquence des anomalies
mineures (pincements discaux, lyse isthmique,
spondylolisthésis, arthrose articulaire postérieure) est
identique dans les deux groupes. Il en est de même pour la
D. LECHEVALIER, médecin en chef, professeur agrégé du Val-de-Grâce.
Correspondance: D. LECHEVALIER, Service de rhumatologie, HIA Bégin, 69
avenue de Paris – 94163 Saint-Mandé Cedex.
D. Lechevalier a.
a
Service de rhumatologie, HIA Bégin, 69 avenue de Paris – 94163 Saint-Mandé Cedex.
D
O
S
S
I
E
R

tomodensitométrie et l’imagerie par résonnance
magnétique du rachis lombaire. Par contre, la description
des images par les radiologues, appuyée de nombreux
adjectifs, augmente l’anxiété des patients et il a été prouvé
qu’elle augmente la fréquence des gestes médico-
chirurgicaux agressifs sur le rachis, source potentielle de
handicap ultérieur. Il faut retenir que la lombalgie
non spécifique résulte le plus souvent d’anomalies
invisibles sur l’imagerie, d’origine musculaire,
ligamentaire ou ostéo-articulaires, et la connaissance
de la structure en cause ne modifie ni l’évolution ni la
prise en charge thérapeutique.
Les facteurs professionnels.
La responsabilité des expositions professionnelles
dans la genèse de la lombalgie est probable, bien que
discutée dans la littérature. Le travail sédentaire ne
semble pas représenter un facteur favorisant. Les facteurs
biomécaniques retenus comme favorisants sont les
manutentions de charges lourdes (bien que l’explosion de
l’invalidité lombalgique au XXesiècle puisse paraître
paradoxale dans un contexte de mécanisation), le
maintien de postures pénibles ou l’exposition aux
vibrations de basse fréquence. De nombreux militaires
sont donc potentiellement exposés à ces contraintes.
Le modèle biopsychosocial et les facteurs de
risque de chronicité.
Le modèle biopsychosocial attribue un rôle
déterminant aux facteurs cognitifs, sociaux et
professionnels dans le passage à la chronicité et la genèse
de l’invalidité lombalgique. De nombreux facteurs de
risque de passage à la chronicité ont été individualisés :
– facteurs individuels: âge élevé, faible musculature,
absence d’activité physique et sportive;
– facteurs cognitifs et psychologiques: un état dépressif,
une anxiété sont des facteurs favorisants.
Les peurs et croyances du lombalgique représentent un
des facteurs de risque essentiel. Dans le modèle dit de
« peurs – évitement » développé par Lethem, la peur de la
douleur et du handicap entraîne des conduites d’évitement
de l’activité physique, voir une véritable kinésiophobie,
entrainant un déconditionnement à l’effort avec perte de
force et d’endurance des muscles paravertébraux. L’arrêt
de travail prolongé, la perte d’emploi ou une dépression
peuvent en résulter. Au contraire, le patient qui affronte la
douleur conserve son capital musculaire et sa condition
physique. La stratégie développée par le patient en
réponse à la douleur est très variable et peut-être modifiée
positivement ou négativement par les thérapeutes.
Certains ont regroupé sous le terme « yellow flags » ou
« signes du drapeau jaune » des indicateurs de risque
accru de passage à la chronicité. Il s’agit : 1) des problèmes
émotionnels tels la dépression, l’anxiété et une conscience
augmentée des sensations corporelles, le stress, une
tendance à une humeur dépressive ou le retrait des
activités sociales, 2) des attitudes et des représentations
inappropriées par rapport au mal de dos, comme par
exemple l’idée que la douleur représenterait un danger ou
qu’elle pourrait entraîner un handicap grave, ou encore
des attentes de solutions placées dans des traitements
passifs plutôt que dans une implication personnelle, 3)
des comportements douloureux inappropriés, en
particulier un comportement d’évitement ou de réduction
d’activité liée à la peur.
Facteurs sociaux : bas niveau d’éducation, de
ressources.
Facteurs médicaux : mauvaise prise en charge initiale
d’une lombalgie aiguë.
Facteurs médico-légaux : prise en charge en accident
de travail, conflit médico-légal, problèmes de rente
d’invalidité.
Facteurs professionnels: contraintes biomécaniques
liées aux activités professionnelles (vibrations, gestes
répétitifs, port de charges), insatisfaction au travail,
environnement de travail ressenti comme hostile,
mauvais rapports hiérarchiques.
Épidémiologie.
En milieu civil.
Incidence.
Elle est définie par le pourcentage de nouveaux cas
d’une maladie par unité de temps. L’incidence annuelle de
la lombalgie en France est estimée entre 5 % et 10 %.
Prévalence.
C’est le pourcentage de cas dans la population étudiée.
La prévalence ponctuelle (au moment de l’enquête) de
la lombalgie est estimée à 30 %. La prévalence annuelle
(au cours de l’année précédant l’enquête) est de 50 %.
La prévalence cumulée (pourcentage d’individus
qui souffrent ou ont déjà souffert de lombalgie) est
de 60 % à 70 %. Selon une enquête du Centre de recherche
et d’étude et de documentation de la santé (CREDES),
la fréquence des lombalgies a triplé entre 1982 et 1992
en France.
En milieu militaire.
Les études consacrées aux lombalgies en milieu
militaire sont rares. Certaines données concernent des
militaires d’armées étrangères effectuant un service
national et ne sont plus utilisables dans le contexte des
armées françaises actuelles. À notre connaissance, il n’y a
jamais eu d’étude épidémiologique transversale dans les
armées françaises, ni d’études prospectives de cohortes.
Incidence.
L’incidence de la lombalgie est estimée entre 4,1% à
6,3% chez les hommes militaires aux USA, et entre 7,5 %
à 9,9 % chez les femmes. Ce chiffre est proche de celui des
populations civiles.
Prévalence.
Il n’existe pas de données concernant la prévalence de
la lombalgie dans l’armée française, tous emplois
confondus. Aux USA, la lombalgie affecte 150 000
militaires par an. Il existe probablement une grande
hétérogénéité épidémiologique selon les emplois.
Certains emplois sont non spécifiques aux armées et
18 d. lechevalier

l’épidémiologie des lombalgies devrait être identique à
celle observée en milieu professionnel civil. Par contre,
certains emplois plus spécifiques aux armées semblent
associés à risque fort de lombalgie. Ainsi, dans une étude
rétrospective, la prévalence des lombalgies est de 16 %
chez les non combattants, alors qu’elle est de 33 % chez
les combattants. Chez les pilotes d’hélicoptères, la
prévalence de la lombalgie est de 50 % dans la Royal
Norvegian Air Force, de 80 % dans la British Royal Navy
et de 73 % dans l’US Army. Cette prévalence ne semble
pas avoir diminué malgré les innovations ergonomiques
apportées aux machines les plus récentes, mais il est vrai
que les contraintes imposées aux pilotes ont progressé
dans le même temps. Dans une enquête française, 70 %
des pilotes d’avions militaires déclarent avoir présenté
des rachialgies. La prévalence dans les unités
parachutistes est probablement élevée, mais les études
manquent. Au niveau de la Brigade des sapeurs pompiers
de Paris (BSPP), la prévalence de la lombalgie a été
estimée à 19 %, ce qui peut être considéré comme un
chiffre faible, compte tenu des conditions d’emplois. Au
sein de l’US Navy, la prévalence cumulée est de 50 %.
Coût pour la collectivité.
Collectivité civile.
Le coût de la lombalgie est très élevé dans tous les pays
occidentaux. Les lombalgiques chroniques représentent
moins de 10 % des patients mais engagent 70 % à 80 % des
coûts liés à l’affection. Le coût est à la fois direct
(médicaments, examens complémentaires), et indirect
(journées de travail perdues). La lombalgie représente
9 % des consultations de médecine générale en France,
8 % des actes de radiologie, 30 % des actes de
kinésithérapie. Elle fait perdre 149 millions de jours de
travail par an aux États-Unis avec des pertes de
productivité dont le coût est estimé à 28 milliards de
dollars.
Collectivité militaire.
Il n’existe pas de données fiables pour l’armée
française. Le coût financier annuel de la lombalgie à la
BSPP a été estimé à 114 postes budgétaires, soit 2 millions
d’euros par an. Elle coûterait 1 billion de dollars par an à
l’armée américaine. Elle représente 15 % du temps de
consultation hebdomadaire des médecins militaires
allemands. En France, 75 militaires français ont été mis en
Congé de Longue Maladie (CLM) pour des lombalgies
ou lombo-radiculalgies au cours de l’année 2008, soit
environ 9 % des CLM.
Le coût opérationnel est lui aussi élevé : Lors de
l’opération « liberté immuable » en Irak, 53 % des blessés
présentaient une lombalgie ou une sciatique et seuls 2 %
ont pu rejoindre le théâtre d’opération.
En résumé, l’épidémiologie des lombalgies en milieu
militaire n’est pas connue avec précision. Il est probable
que sa fréquence se superpose à celle de la population
générale pour de nombreux emplois non spécifiques
et pour les militaires affectés dans des unités non-
combattantes, ce qui en fait un problème de santé
publique aussi fréquent et sérieux qu’en milieu
professionnel civil. De plus, incidence et prévalence
de la lombalgie semblent plus élevées dans certains
emplois spécifiques aux armées. Des études épidé-
miologiques, soit multicentriques, soit ciblées sur des
populations spécifiques mériteraient d’être menées.
Des études prospectives de cohortes seraient essentielles
pour déterminer l’incidence réelle et le coût opérationnel
des lombalgies.
Prévention des lombalgies non
spécifiques.
De très nombreux travaux scientifiques ont été menés,
essentiellement en milieu civil et plus particulièrement au
sein du personnel hospitalier, afin de valider des
méthodes de prévention de la lombalgie. Cette population
est soumise à des contraintes différentes de celles des
militaires. De plus, beaucoup de travaux sont de
méthodologie imparfaite. Les travaux effectués en milieu
militaire sont rares et ils sont absents en France. Des
recommandations européennes concernant la prise en
charge des lombalgies chroniques ont été formulées en
2006 et nous pensons qu’elles sont aisément applicables
au sein du ministère de la Défense.
Les moyens disponibles.
Sélection professionnelle.
Elle permet de ne retenir que les individus ayant la
probabilité la plus faible de lombalgie ultérieure.
L’instruction ministérielle 2100, et des instructions
spécifiques à différentes armes et emplois sont publiées et
doivent êtres appliquées par les médecins militaires des
centres de sélection. Une difficulté réelle d’application
est liée à la grande prévalence de la lombalgie à l’âge de
l’incorporation, estimée dans certaines études à 50 % à 20
ans. Une motivation suffisante, la pratique régulière
d’activités physiques, et sur le plan médical une bonne
musculature, l’absence de troubles statiques rachidiens
sont indispensables.
Mesures ergonomiques.
L’ergonomie de conception des véhicules militaires et
des aéronefs doit permettre de limiter au maximum les
contraintes biomécaniques appliquées au personnel, en
particulier par la diminution des vibrations corps entier.
L’adaptation des postes de travail et des rythmes de travail
pourrait être utile. Des études ergonomiques spécifiques
à certains postes sont indispensables.
Utilisation d’aides techniques.
Le port de ceintures lombaires ne semble pas diminuer
l’incidence des lombalgies ou leur récidive.
Le port d’orthèses plantaires, ou « semelles ortho-
pédiques » n’a pas démontré d’efficacité dans deux études
concernant l’armée danoise et l’infanterie israélienne.
Enfin, l’efficacité des aides techniques au levage n’a
jamais été démontrée dans les études contrôlées de bonne
qualité méthodologique réalisées essentiellement en
milieu hospitalier civil.
19
incidence et prévention des lombalgies en milieu militaire. une base pour des recommandations
D
O
S
S
I
E
R

Éducation et information des patients.
Des séances d’information en milieu professionnel ont
été proposées. Leur contenu est très variable, comportant
parfois des explications anatomiques, l’apprentissage
des gestes pour la manutention de charges, l’apprentissage
des postures et des stratégies d’adaptation à la lombalgie.
Leur efficacité n’a jamais pu être démontrée dans
les études réalisées en milieu civil et ne sont pas
recommandées au niveau européen.
Une information délivrée dans le cadre de protocoles
dit « d’éducation brève » ou par d’autres méthodes (livrets
d’information, échanges internet…) pourrait être utile.
La distribution de livrets d’information de type « Back
book » où « guide du dos » rédigés sur un modèle
biopsychosocial, semble susceptible de limiter la
fréquence des récidives et de limiter le passage à la
chronicité dans certaines études. Ces livrets ont pour
objet de délivrer une information rassurante aux patients,
d’encourager le maintien des activités professionnelles et
sportives et d’éviter un déconditionnement à l’effort. Ils
permettent de lutter contre les croyances négatives des
patients, mais aussi des médecins. Enfin leur coût est
relativement faible.
Les exercices physiques.
Plusieurs études randomisées, parfois contrôlées, de
bonne qualité méthodologique, sont en faveur de
l’efficacité des programmes de renforcement musculaire,
à la fois pour prévenir le premier épisode et pour limiter
les récidives. Le renforcement des haubans musculaires
rachidiens par une activité physique supervisée a été
préconisée par la conférence de consensus européenne
de 2006. Ces programmes ont pour but de renforcer la
force et l’endurance musculaire tout en améliorant la
souplesse rachidienne. Différentes techniques ont été
proposées dans la littérature: 1) rééducation en cyphose,
avec renforcement isométrique des muscles de la
paroi abdominale, paradoxale puisque la force des
abdominaux prédomine sur les extenseurs du rachis
au cours de la lombalgie chronique, 2) rééducation en
lordose de type Cyriax, programme de Mackenzie, 3)
apprentissage d’un verrouillage lombaire en position
intermédiaire. Aujourd’hui, aucune méthode ne peut être
privilégiée en raison d’une efficacité supérieure
scientifiquement démontrée.
Trois études menées en milieu militaire ont démontré
l’efficacité de ces procédures, qu’il s’agisse de séances
régulières d’extension rachidienne, de 20 minutes
d’étirement avant et après entraînement physique
quotidien. La pratique d’un « gainage lombo-abdominal »
à démontré son efficacité en terme d’incidence et
d’intensité des lombalgies. La pratique d’une gym-
nastique lombo-abdominale est parfaitement adaptée à la
culture sportive en milieu militaire. Elle peut se concevoir
comme une gymnastique individuelle ou collective,
quotidienne ou pluri-hebdomadaire, éventuellement
supervisée par un professionnel, dont les modalités
précises exactes restent à définir.
Une enquête a montré que seuls 28 % des pilotes de
chasse français pratiquent une musculation spéci-
fiquement rachidienne, alors même qu’ils disposent
d’équipements sur base. Il semble donc indispensable de
faire passer le message sur l’utilité du renforcement
lombo-abdominal en prévention des lombalgies dans
les armées. Des protocoles randomisés, mono ou
multicentriques, comparant différentes modalités
de gymnastique lombo-abdominale seraient simples
à mettre en place dans les unités françaises avec l’accord
et le soutien du commandement.
La prise en charge optimale des
lombalgies aigues.
C’est un élément essentiel pour éviter le passage à
la chronicité. La prise en charge d’une lombalgie aigue
doit comporter :
– un traitement symptomatique efficace prescrit
rapidement. Sont validés les antalgiques, les AINS,
et éventuellement les décontracturants;
– des informations précises et rassurantes délivrées
au patient;
– le maintien des activités professionnelles, qui seront
éventuellement adaptées, en cas d’épisode d’intensité
modérée. En cas de besoin, l’arrêt de travail doit être de
courte durée ;
– le repos au lit ne doit pas être prescrit de manière
systématique, mais doit être seulement autorisé pour une
courte durée, uniquement en cas de douleur très intense ;
– l’abstention de toute imagerie inutile.
Ces recommandations de bonnes pratiques devraient
être parfaitement connues et appliquées mais l’expérience
quotidienne montre que c’est encore trop rarement le cas.
Il est vrai que le libre choix du médecin par le patient lui
permet d’échapper fréquemment aux médecins des
armées et limite les possibilités d’intervention précoce.
La prise en charge spécifique des
lombalgies subaiguës.
Notre expérience quotidienne montre que le spécialiste
militaire hospitalier est trop souvent consulté tardivement
et uniquement pour une décision d’aptitude ou pour une
décision administrative de mise en Congés de longue
maladie (CLM), alors même que des interventions théra-
peutiques actives n’ont pas été proposées. Il est vrai que le
nombre limité de spécialistes militaires hospitaliers
traitant des pathologies de l’appareil locomoteur
contribue à allonger le délai de prise en charge des
patients. On connait maintenant le risque important de
passage à la chronicité lorsque la lombalgie dure plus de 6
à 8 semaines. Dans l’idéal, tout patient présentant une
lombalgie subaiguë non spécifique avec incapacité ou
arrêt de travail persistant plus de huit semaines, ou avec
« signe du drapeau jaune », doit pouvoir bénéficier d’une
prise en charge rapide dans une structure adaptée, en
particulier un service de Médecine physique et
rééducation. Seuls ces services disposent des moyens en
personnel et en matériel pour réaliser des programmes de
type « mini-intervention » limitant le déconditionnement.
Les deux services de rhumatologie référents dans les
armées pourraient consulter en priorité les patients
avec suspicion d’une lombalgie spécifique, dans le cadre
d’un partage de tâches.
20 d. lechevalier

La prise en charge des incapacités
chroniques et des invalidités.
Elle fait appel à la rééducation et de la réinsertion
professionnelle et sociale. Le but n’est plus de lutter contre
la lombalgie mais de traiter les incapacités permanentes,
en luttant contre le déconditionnement à l’effort et en
favorisant le retour au travail. Elle repose sur:
– les méthodes de reconditionnement à l’effort : ces
programmes hospitaliers multidisciplinaires s’adressent
à des patients motivés. Ils associent de manière variable
des traitements comportementaux, une école du dos, une
rééducation rachidienne active intensive avec étirements
et renforcement musculaire. Leur efficacité semble
actuellement démontrée. Notre opinion est que cette
thérapeutique pourrait être proposée plus précocement et
plus fréquemment aux patients ;
– les mesures de réinsertion professionnelle sont
susceptibles de limiter l’invalidité lombalgique en milieu
professionnel civil. L’absence de procédure de reprise à
temps partiel pour les militaires, les impératifs
opérationnels et les choix du commandement, sont des
éléments qui contrarient cette réinsertion. La mise en
CLM ne doit être considérée que comme une solution
palliative, lorsque toutes les méthodes de réinsertion ont
été essayées et ont échoué.
Conclusion.
L’analyse des données disponibles permet de formuler
des recommandations. Des études de prévalence et
d’incidence des lombalgies dans différents emplois des
armées françaises mériteraient d’être menées. Des
documents d’information sur la lombalgie de type « guide
du dos », basés sur le modèle biopsychosocial pourraient
être divulgués afin de limiter l’absentéisme et les
incapacités liées aux lombalgies. La pratique régulière
d’activités physiques doit être encouragée dans les
armées. Des programmes de gymnastique lombaire et de
renforcement musculaire supervisés, au profit de tous les
militaires, seraient susceptibles de diminuer l’incidence
et la prévalence de la lombalgie dans les armées.
L’application de bonnes pratiques médicales
(diagnostiques et thérapeutiques) devant une lombalgie
aiguë est indispensable. Des actions de Formation
médicale continue destinées aux médecins militaires
seraient souhaitables. La prise en charge rapide et active
des lombalgies subaiguës en arrêt de travail est
indispensable pour éviter le passage à la chronicité.
Enfin, il est souhaitable qu’un militaire lombalgique
chronique avec incapacité sévère soit évalué dans une
structure de Médecine physique et de réadaptation pour
un programme de reconditionnement à l’effort.
21
incidence et prévention des lombalgies en milieu militaire. une base pour des recommandations
D
O
S
S
I
E
R
MC D. Lechevalier. © F. Teste.
 6
6
1
/
6
100%