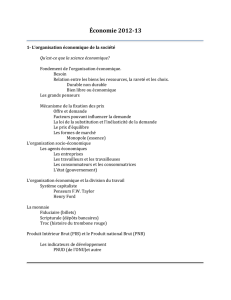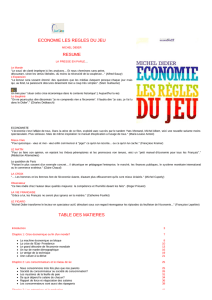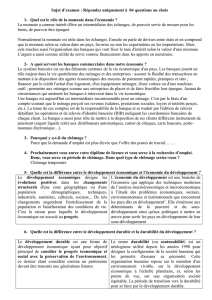Macro- économie Licence AES

Licence AES
Année 1
Semestre 2
Macro-
économie
Responsable de l’Unité d’Enseignement : Alain Paraponaris
alain.paraponaris@univ-amu.fr

-2-
Plan
Introduction
Qu’est-ce que l’analyse économique ?
Spécificités de l’analyse macroéconomique
Principaux thèmes abordés par la macroéconomie
1ère partie : les instruments de l’analyse macroéconomique
Chapitre 1 : la comptabilité nationale
Chapitre 2 : la demande agrégée et l’équilibre
Chapitre 3 : l’Etat et l’équilibre macroéconomique
Chapitre 4 : le modèle IS-LM comme approche des politiques économiques
2ème partie : l’analyse macroéconomique face aux problèmes contemporains
Chapitre 5 : Consommation, épargne et investissement
Chapitre 6 : Monnaie et Crédit
Chapitre 7 : Inflation et chômage
Conclusion
Ouvrages de référence
Macroéconomie de M. Burda et C. Wyplosz (de Boeck)
Macroéconomie de N. Mankiw (de Boeck)
Macroéconomie d’O. Blanchard et D. Cohen (Pearson)
Principes d’économie moderne de J. Stiglitz et C. Walsh (de Boeck)

-3-
1. Introduction
1. Qu’est-ce que l’analyse économique ?
La science économique étudie comment les individus, les entreprises, les pouvoirs publics et
organisations sociales font des choix et comment ces choix déterminent l’affectation de
ressources rares au sein de la société.
L’économie est donc une science du choix que l’on peut appréhender à l’aide de cinq
concepts principaux :
• l’arbitrage : il consiste à choisir entre des alternatives exclusives faute de ressources
suffisantes (arbitrage entre travail et loisir car le temps est une ressource rare,
dépenser plus pour un bien que pour un autre à cause d’un niveau de revenu
limité…). C’est la rareté qui oblige à faire des arbitrages ;
• Les incitations qui sont les avantages, y compris les réductions de coût, qui font
pencher un décideur en faveur d’une option particulière lors d’un choix entre options
concurrentes. Les prix sont le meilleur exemple d’incitations (par exemple, une
hausse de prix va inciter l’entreprise à accroître son niveau de production, le
consommateur à réduire sa demande…) ;
• L’échange : il accroît l’éventail des choix possibles pour chaque individu. Lorsque
l’échange est volontaire, les participants à l’échange voient leur bien-être
s’améliorer. Pour les économistes, à chaque échange correspond un marché où le
prix permet aux agents de faire des choix reflétant la rareté et conduisant dans
l’ensemble à une utilisation efficace des ressources. L’étude de l’échange marchand
permet de connaître quelles sont les ressources produites, qui gagne quoi et
comment sont allouées les ressources ;
• L’information : indispensable pour faire des choix éclairés (connaître tous les
avantages et coûts d’une décision), elle n’est pas un bien comme les autres car elle
peut être partagée gratuitement. Elle peut modifier la nature d’un marché (exemple
du marché des voitures d’occasion). L’imperfection de l’information peut aussi
modifier les incitations (comment rémunérer un professeur à la performance si on ne
peut la mesurer précisément ?)1
;
• La distribution : c’est la manière dont sont réparties les richesses produites entre les
individus. Les marchés déterminent la quantité totale de biens et services produits et
leur répartition plus ou moins équitable entre les individus. L’effort de l’état pour
redistribuer la richesse peut aller à l’encontre de l’efficacité économique en altérant
les incitations (à investir, à travailler…).
1 Voir l’histoire rapportée par S.D. Levitt et S.J. Dubner au sujet des résultats des écoles de Chicago dans le
chapitre « Tricher n’est pas jouer » de leur ouvrage Freakonomics (Folio, 2006).

-4-
Pour comprendre les problèmes, l’économiste a le loisir de recourir à des modèles qui
synthétisent mathématiquement les relations entre les variables économiques. Leur objectif
est de donner une représentation simplifiée mais intelligible de la réalité en se concentrant
sur les liaisons économiques essentielles.
Dans ces modèles, on distingue deux catégories de variables : des variables exogènes qui
sont extérieures au modèle (elles sont données au départ et introduites dans le modèle) et
des variables endogènes déterminées par le modèle lui-même (ce sont les variables que l’on
cherche à expliquer). Le modèle étudie comment les variables exogènes affectent les
variables endogènes.
Soit le modèle représentant un équilibre de marché, où l’offre de bien (qo) dépend du prix du
bien (p) et du prix des facteurs travail et capital (w et r), et la demande de bien (qd) dépend
du revenu (R) et du prix du bien (p), on a :
Exemple :
qo(p, w, r) et qd(R, p).
La quantité d’équilibre q* et le prix d’équilibre p* sont les variables endogènes et R, w et r
sont les variables exogènes.
NB : pour certaines variables, il est difficile de dire si elles sont endogènes ou exogènes. C’est
notamment le cas des variables de politiques économiques qui ne sont pas totalement
exogènes car elles interviennent en réaction à certains phénomènes économiques (hausse
du chômage…).
La simplification est le prix à payer pour que le modèle soit utilisable mais il faut faire
attention aux hypothèses qui sont faites : elles doivent être réalistes, pertinentes et tenir
compte des caractéristiques essentielles (en macroéconomie on parle de faits stylisés qui
sont des faits “typiques” qui semblent significatifs mais qu’on ne peut chiffrer avec
exactitude). Une hypothèse centrale en économie de marché consiste à supposer que les
prix sont flexibles. On peut alors revenir sur certaines des hypothèses pour déterminer
comme leur durcissement (la rigidité des prix à la baisse ou à la hausse par exemple) ou leur
relâchement (le taux de change est flexible et non fixe) peuvent modifier les résultats.
Les principales hypothèses qui sont faites en économie sont :
• La rationalité parfaite des agents : on parle d’homo oeconomicus. On supposera en
plus dans ce cours que les agents ont une information parfaite.
• Le raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » (ceteris paribus)
Modèle
économique
Variables exogènes
Variables endogènes
Source : Macroéconomie, M. Burda et C. Wyplosz, de Boeck

-5-
En économie, on fait la distinction entre une approche positive qui rassemble les
explications objectives ou scientifiques du fonctionnement de l'économie (le but est
d’expliquer pourquoi l’économie fonctionne comme elle le fait et de prévoir comment elle
réagira à certains changements) et une approche normative qui fournit des prescriptions ou
recommandations fondées sur des jugements de valeur personnels (on s'interroge sur les
valeurs que les individus associent à une décision économique). Pour résumer, on a coutume
de dire que l’économie positive décrit l’économie « telle qu’elle est » alors que l’économie
normative décrit l’économie « telle qu’elle devrait être ».
Quand ils étudient le fonctionnement d’une économie de marché, les économistes
s’intéressent surtout à trois grands types de marché où ménages et entreprises
interagissent :
• Le marché des biens (et services),
• Le marché du travail,
• Le marché des capitaux.
On distingue habituellement deux manières d’analyser l’économie :
• la microéconomie qui s’intéresse aux comportements des unités de base de
l’économie (individus, ménages, entreprises) et étudie à la fois comment les individus
prennent des décisions et quels sont les facteurs qui influencent les décisions en
question ;
• la macroéconomie qui s’intéresse au comportement de l’économie dans son
ensemble et étudie l’évolution des grands agrégats (taux de chômage, taux de
croissance économique, taux d’inflation…) qui informent sur ce qu’il se passe au total
ou en moyenne.
Microéconomie et macroéconomie sont deux manières d’appréhender une même réalité : la
microéconomie raisonne du “bas vers le haut” et la macroéconomie du “haut vers le bas”.
Entreprises
Vendent des biens
Engagent des
travailleurs
Investissent en
biens de capital
Ménages
Achètent des
biens
Vendent leur
travail
Empruntent et
investissent des
fonds
Marché des
biens
Marché du
travail
Marché des
capitau
x
Source : Principes d’économie moderne. J.E. Stiglitz & C.E. Walsh, de Boeck
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
1
/
204
100%