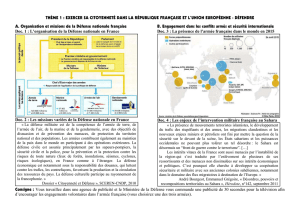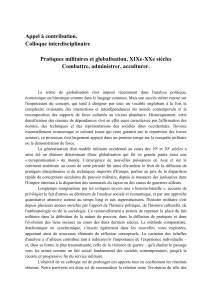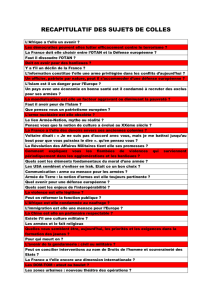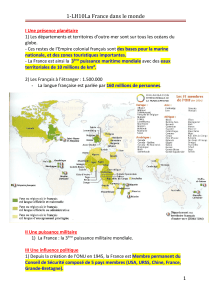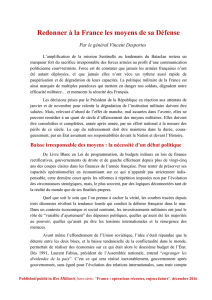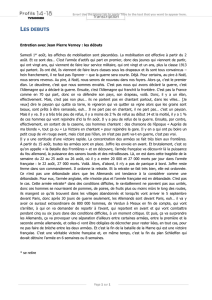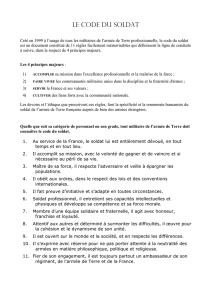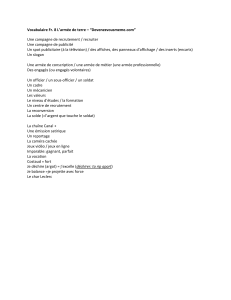Open access

1
Université Paul Cézanne Aix-Marseille
Institut Louis Favoreu
27
e
Cours international de Justice constitutionnelle : Constitution et sécurité extérieure
Mercredi 2 et jeudi 3 septembre 2015
Les pouvoirs du Chef de l’État
dans le recours aux opérations extérieures
Professeur à l’Université de Liège et au Collège de Défense de l’École Royale Militaire de Belgique
Assesseur au Conseil d’État de Belgique
Introduction
art
physiquement

2
attaque
au sein même
horizontales
vertical
Remarques liminaires
les pouvoirs du Chef de l’État dans le
recours aux opérations extérieures
Chef de l’État
Napoléon à la
bataille des pyramides
L’art de la guerre

3
Chef de gouvernement
Gouvernement, dans son ensemble »
Pouvoir exécutif » Chef de l’État
responsable
de facto
Introduction à la Théorie générale de l’État

4
Falklands WarGuerra de las Malvinas
.
dans sa globalité
Opex
The British Constitution
Politics in England : Change and Perspective
The Constitution of the United
Kingdom, A contextual Analysis
Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par
la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 11
décembre 2013 sur la mission "Engagement et diplomatie" n° 2777 déposé le 20 mai 2015 (mis en ligne le 4 juin
2015)

5
résoudre
Politique étrangère
Les relations internationales depuis 1945
War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age
op. cit.
Pyramides
Pouvoirs
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%