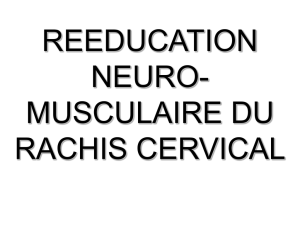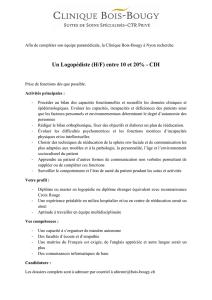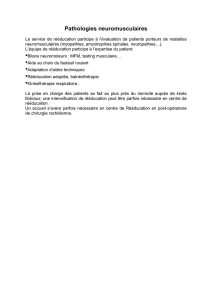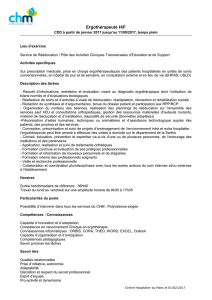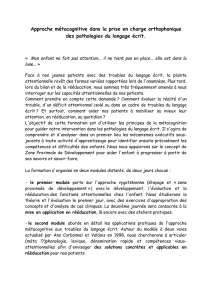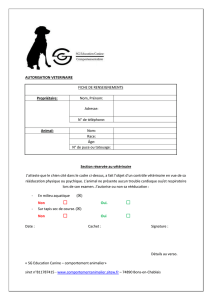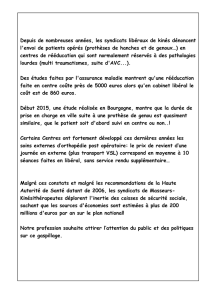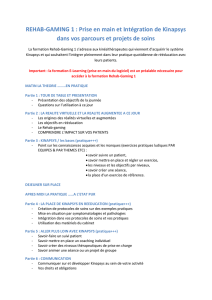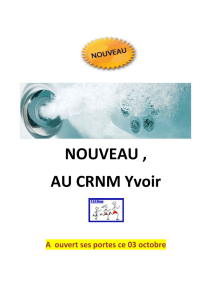AK1995_22_6_241-248

Ann. Kinésithér., 1995, t. 22, nO 6, pp. 241-248
©Masson, Paris, 1995
Évolution de la sensibilité kinesthésique cervicale
après un programme de rééducation oculo-cervicale
chez des patients cervicalgiques
Étude randomisée contrôlée
MÉMOIRE
J. VAILLANT (1), M. MINGUET (2), P. GERGOY (2), J.-L. MANUEL (3), M. REVEL (4)
(1) M G.MK, (2) Médecin de rééducation, (3) MK, (4) P.u.-P.H., Service de rhumatologie (Pr B. Amor), Hôpital Cochin, 27,
rue du Faubourg-Saint-Jacques, F75679 Paris Cedex 14.
La capacitéde repositionnement céphalique,
après un mouvement de rotation horizontale
active, a été évalué chez soixante patients
cervicalgiques. L'erreur angulaire moyenne
était de 7,7° +3,3 (valeur moyenne, écart
type) et 82 %étaient au-delà de la valeurseuil
des 4,5~Après une randomisation, 30 patients
ont suivi 15 séances de rééducation oculo-
cervicale et 30 patients ont servi de groupe
témoin. Après 10 semaines, le gain au test de
repositionnement céphalique a étésignificative-
ment plus important dans legroupe depatients
rééduqués (2° +2, 7) que dans le groupe
témoin (OO +2,6) (p <0,005). Les para-
mètres cliniques (douleur, prise médicamen-
teuse,amplitudes articulaireset auto-apprécia-
tion subjective de la fonction) sont également
plus améliorés dans le groupe de patients
rééduqués que dans le groupe témoin.
Cette étude confirme le rôle de la capacité
sensori-motrice cervicale dans le cas des
cervicalgies chroniques et suggère qu'un pro-
gramme de rééducation basé sur le couplage
oculo-cervicalpeut être inclus dans la prise en
charge médicale des patients cervicalgiques.
Bien que la cervicalgie soit une pathologie
fréquente (1, 2), les modalités de traitement par
la rééducation n'ont été que très peu étudiées.
Peut-être, est-ce dû au fait que les incapacités
de travail occasionnées par ces désordres cervi-
caux sont limitées en nombre. Hult (3) a étudié
Tirés àpart: J. VAILLANT, à l'adresse ci-dessus.
1 193 travailleurs masculins. Parmi eux, 51 %
avaient souffert de cervicalgie ou de névralgie
cervico-brachiale mais seul 5,4 %avaient eu une
incapacité àtravailler.
Les deux volets habituellement préconisés de
la kinésithérapie sont le renforcement mus-
culaire des muscles cervicaux et la rééducation
sensori-motrice (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Il, 12, 13).
La composante rééducative visant au renfor-
cement des muscles cervicaux n'a pu être
formellement validée par des études successives.
Highland et al. (14) dans une étude prospective
non contrôlée ont observé une augmentation
significative de la capacité des muscles cervicaux
en force et en endurance ainsi qu'une diminution
de la sensation douloureuse après 8 semaines de
renforcement musculaire. Par contre, Kam-
wendo et Linton (15), dans une étude randomi-
sée contrôlée n'ont pas trouvé d'effets positifs
àun programme d'école «du cou ».
Pourtant la bonne corrélation entre la surface
de section des muscles de la nuque et la force
développée en extension isométrique (16) permet
d'envisager, parmi les causes de cervicalgie, le
rôle de la charge excessive de travail imposée
àune musculature cervicale gracile au cours des
postures prolongées avec maintien de la tête
penchée en avant (17). Mais, la difficulté àétablir
une «normalité »au niveau de la force des
muscles cervicaux (du fait de la complexité de
la physiologie propre àchaque muscle [18, 19]
et du problème pour établir des modélisations
mécaniquement satisfaisantes [20, 21]) ne per-
met pas d'envisager une étude prospective visant
à établir une corrélation entre force musculaire
et risque de cervicalgie.

242 Ann. Kinésithér., 1995, t. 22, n° 6
Le volet réhabilitation de la capacité sensori-
motrice cervicale constitue pour beaucoup d'au-
teurs le temps essentiel de la kinésithérapie.
Paradoxalement, ce déficit sensori-moteur n'a
été objectivé que très récemment. Revel et al.
(22) ont montré chez le patient atteint de
pathologie cervicale chronique une diminution
significative de la capacité à repositionner la tête
sur le tronc. Les performances des cervicalgiques
(m =6,1°) sont significativement moins bonnes
(p <0,01) que chez les sujets sains (m =3,5°).
Parallèlement, le couplage fonctionnel entre
les déplacements oculaires horizontaux et les
muscles cervicaux a fait l'objet d'études chez
l'animal et chez l'homme (23, 24, 25, 26, 27,
28, 29). Il a été démontré que l'œil et la tête
se déplacent de façon conjuguée. Dès que la
position finale de l'œil se trouve déviée de plus
de 10 à 15° par rapport à la position initiale,
on assiste à un mouvement de recentrage
céphalique sur la nouvelle position du regard
(30°). Subjectivement, pour beaucoup de cervi-
calgiques, cette harmonie est perturbée. L'exa-
men clinique décrit une surutilisation de la
mobilité oculaire au détriment de la mobilité
cervicale.
Tout ceci plaide en faveur d'une reprogram-
mation sensori-motrice systématique de la ré-
gion cervicale.
Les deux objectifs de cette étude étaient de :
1) déterminer si un programme d'exercices
basés sur la coordination oculo-cervicale pouvait
influer sur la capacité sensori-motrice cervicale
et en même temps diminuer le syndrome
douloureux chez des patients cervicalgiques.
2) confirmer la validité du test clinique basé
sur l'habileté à replacer la tête sur le tronc après
un mouvement actif de la tête pour quantifier
l'altération de la sensibilité kinesthésique cervi-
cale chez les patients cervicalgiques.
Matériel et méthode
PoPULAnON
Soixante-cinq patients présentant une cervicalgie chro-
nique persistant depuis plus de trois mois et proposés à
un traitement médical incluant un traitement rééducatif,
recrutés àl'issue d'une consultation hospitalière dans le
service de rhumatologie.
Critères d'inclusion :
Patients de plus de 16 ans, n'ayant pas pratiqué
auparavant de traitement rééducatif et pouvant suivre le
programme de rééducation pendant 10 semaines
consécutives.
Critères de non-inclusion :
Patients ayant des cervicalgies dues àun syndrome
inflammatoire (polyarthrite rhumatoide, pelvispondylite
rhumatismale ...), tumorale ou infectieux.
Patients témoignant de signes de myélopathie cervicale
ou de névralgie cervico-brachiale.
Patients ayant un traitement rééducatif concomitant.
Critères d'exclusion:
Non-assiduité àla rééducation.
MATÉRIEL
Pour le test : Casque avec flèche lumineuse, cible de
40 cm de diamètre, échelle visuelle analogique de la
douleur de 100 mm (EVA).
Pour la rééducation : Lunettes fovéales, cible.
MÉTHODE
Définition de l'étude
Étude randomisée, contrôlée comparant un groupe de
patients ayant un programme de rééducation cervicale
(GR) en complément d'un traitement médicamenteux
symptomatique (anti-inflammatoire non stéroidien
(AINS), analgésiques) àun groupe témoin (GT) recevant
simplement un traitement médicamenteux symptomati-
que.
Déroulement de l'étude
Après détermination de la réponse aux critères d'exclu-
sion et aux critères de non-inclusion, les patients étaient
randomisés et répartis de manière aléatoire dans le groupe
GR ou GT.
Les patients du groupe GT pouvaient commencer leur
rééducation après 10 semaines d'abstinence rééducative.
Déroulement des tests
Les tests cliniques étaient réalisés àl'entrée dans l'étude
et après 10 semaines. Les tests étaient réalisés par
différents évaluateurs. Les dates de suivi étaient notées.
1) Test àl'entrée (SO) .
Étaient notés :
- l'âge et le sexe,
- l'histoire et les caractéristiques de la cervicalgie
(ancienneté des symptômes, éventuelle présence de signes
dégénératifs àl'examen du rachis cervical),

- l'intensité de la douleur évaluée par le patient sur
une échelle visuelle analogique de 100 mm (EVA),
- la mobilité cervicale mesurée avec un mètre ruban,
en flexion, en extension (distance menton sternum) et en
rotations (distances menton acromion),
- le traitement médicamenteux symptomatique réelle-
ment pris à cette date. Les doses d'AINS étaient
comparées en utilisant une table d'équivalence (30). Les
doses d'antalgiques étaient calculées en totalisant le
nombre de comprimés absorbés,
- la mesure de la sensibilité kinesthésique cervicale.
L'habileté à replacer la tête sur le tronc après un
mouvement actif dans un plan horizontal était mesurée
par un test clinique (TRC) décrit dans une précédente
étude (22).
Description : Le patient était assis face à une cible, la
tête droite, la vision occultée par des lunettes opaques et
portant sur la tête un casque muni d'un pointeur
lumineux. La distance entre le pointeur lumineux du
casque et les graduations de la cible était calculée de
manière à obtenir une conversion aisée en degrés
angulaires de l'écart en centimètres. L'écart mesurait la
distance entre le zéro (ou centre) de la cible et la projection
du faisceau lumineux sur la cible après réalisation de
l'exercice.
La position de la cible était choisie en plaçant le zéro
(ou centre) de la cible sur la projection du faisceau
lumineux dans la position céphalique de référence choisie
par le patient.
Après un effort de concentration cérébrale pour
mémoriser la position, le patient effectuait une rotation
horizontale d'amplitude maximum de la tête et essayait
de retrouver la position initiale avec le maximum de
précision. Ceci était réalisé sans indication de vitesse. La
distance entre la position du faisceau lumineux et le zéro
de la cible quantifiait l'erreur de repositionnement. Dix
essais étaient réalisés en rotation gauche et dix essais en
rotation droite. La valeur moyenne définissait la capacité
kinesthésique cervicale.
2) Test à10 semaines (S10)
Étaient notés :
- l'intensité de la douleur sur l'EVA de 100 mm,
- la consommation moyenne d'AINS et d'antalgiques
pendant la période d'étude,
- la mobilité cervicale en flexion-extension et en
rotations,
- la mesure de la sensibilité kinesthésique cervicale,
- l'auto-évaluation globale du patient sur l'améliora-
tion fonctionnelle (très amélioré, amélioré, un peu
amélioré, identique, aggravé).
Critères d'évaluation et échantillonnage
Le principal critère à évaluer était le changement dans
la sensibilité kinesthésique cervicale après 10 semaines de
rééducation oculo-cervicale chez des patients cervicalgi-
ques. Comme il n'y avait pas de précédent sur l'évolution
Ann. Kinésithér., 1995, t. 22, nO 6 243
spontanée de ce paramètre (valeur moyenne, variance),
nous n'avons pas pu calculer la taille de l'échantillon.
Nous avons donc opté arbitrairement pour un échantillon
de 30 patients par groupe.
En complément, la valeur moyenne de base de la
population pouvait nous permettre de confirmer les
valeurs trouvées dans une précédente étude.
Procédure de rééducation
L'objet du programme de rééducation était d'améliorer
la sensibilité kinesthésique et en même temps de diminuer
le syndrome douloureux et la gêne fonctionnelle. Nous
avions délibérément négligé les exercices de renforcement
musculaire ou à visée antalgique (même le massage était
réduit à 5 minutes) pour privilégier un programme de
rééducation sensori-motrice.
Ce programme était conduit par deux kinésithérapeutes
assurant 15 séances individuelles de rééducation, et ce à
raison de deux séances par semaine pendant 8 semaines.
Tous les exercices étaient basés sur le couplage
fonctionnel oculo-cervical.
TRAVAIL PRÉPARATOIRE AU DÉCOUPLA GE
OCULO-CERVICAL
Patient en décubitus, kinésithérapeute placé à la tête.
Exercice 1
Le kinésithérapeute effectuait un massage cervical de
5 minutes abordant les muscles paravertébraux, les
trapèzes et le plan musculaire antérieur.
Exercice 2
Le patient effectuait un travail des muscles cervicaux
à partir des muscles oculaires. Il portait, sans bouger la
tête, le regard au maximum de l'amplitude de mobilité
oculaire vers la droite, vers la gauche, vers le front, puis
enfin vers les pieds. Ceci, 3 fois de suite dans chaque
direction (fig. 1). Puis l'exercice était répété les paupières
fermées.
Exercice 3
Le kinésithérapeute mobilisait passivement le rachis
cervical en rotation et en flexion-extension. Le patient
maintenait pendant ce temps son regard dans la direction
d'une cible placée à la verticale du visage (fig. 2). Le même
exercice était répété les paupières fermées après mémorisa-
tion de la position de la cible.

244 Ann. Kinésithér., 1995, t. 22, n° 6
Fm. 1. - Travail des muscles cervicaux à partir des mouvements
oculaires.
TRAVAIL DU RACHIS CERVICAL EN
SITUATION D'EXCLUSION DE LA MOBILITÉ
OCULAIRE (découplage oculo-cervical)
Le patient était assis sur un tabouret tournant. La
mobilité oculaire était exclue par le port de lunettes
fovéales.
Exercice 4
Travail analytique de la mobilité cervicale.
Le patient effectuait une mobilisation du rachis cervical
en flexion-extension puis en rotations. L'objectif était
d'aller regarder le «plus loin possible » dans chacune
de ces directions. L'exercice était répété 3 fois.
Exercice 5
Travail global de la mobilité cervicale.
Le patient suivait du regard un parcours complexe
géométrique ou graphique tracé sur le mur (fig. 3).
Exercice 6
Travail de la mobilité cervicale par l'intermédiaire du
tronc.
Le patient était placé face à une cible accrochée au mur.
Il avait pour consigne de maintenir le regard sur la cible
pendant que le kinésithérapeute mobilisait le tronc dans
des amplitudes importantes de flexion-extension et de
rotations. Mobilisation effectuée de manière élective dans
un premier temps puis de manière combinée (fig. 4).
1 }
Fm. 2. - Le patient maintient son regard dans la direction d'une
cible suspendue, pendant que le kinésithérapeute mobilise le rachis
cervical.
Fm. 3. - Avec des lunettes fovéales, le patient suit du regard
un parcours complexe.
Exercice 7
Travail de placement céphalique (1er degré).
Le patient se plaçait dans une position subjectivement
estimée comme étant la «position de rectitude »du
rachis cervical. Après avoir mémorisé la position, le
patient effectuait un mouvement de rotation horizontale
du rachis cervical les yeux fermés. Puis, sanS ouvrir les
yeux, il essayait de revenir dans la position initiale. Il
vérifiait alors la précision du placement. Il replaçait alors
au besoin la tête dans la position initiale. Après avoir
mémorisé la position, il recommençait l'exercice. L'exer-
cice était répété 10 fois à droite puis la fois à gauche
(fig. 5).

FIG. 4. - Travail de la mobilité cervicaleautomatique. Le patient
doit maintenir le regard sur le zéro de la cible pendant que le
kinésithérapeute lui mobilise le tronc.
--
FIG. 5. - Exercice de repositionnement céphalique. Après avoir
mémorisé les sensations cervicalesobtenues pour êtreface au zéro
de la cible, le patient ferme les yeux et réalise une rotation
cervicale d'amplitude maximale, puis cherche, sans ouvrir les
yeux, à retrouver la position initiale.
Exercice 8
Travail de placement céphalique (2e degré).
Même principe, la mobilisation céphalique était cette
fois-ci réalisée passivement par le kinésithérapeute.
D'abord de manière analytique en flexion-extension et en
rotations, puis dans un second temps, après avoir mobilisé
la tête selon un mouvement complexe.
Ann. Kinésithér., 1995, t. 22, nO 6 245
FIG. 6. - Exercice de recouplage oculo-cervical. Le patient
poursuit du regard une cible mobilisée par le kinésithérapeute.
TRAVAIL DU COUPLAGE OCULO-CERVICAL
Le patient était assis sur un tabouret, mobilité oculaire
libre (sans les lunettes fovéales).
Exercice 9
Travail du couple oculo-cervical libre.
Le_'patient avait pour consigne de maintenir le regard
sur u'ne cible mobile à l'aide de la mobilité oculaire et
de la mobilité cervicale (fig. 6).
Exercice 10
Travail du couple oculo-cervical contre résistance
manuelle.
Même principe, mais cette fois-ci le kinésithérapeute
offrait une résistance au mouvement céphalique.
Exercice Il
Travail du couple oculo-cervical et stimulations ma-
nuelles multidirectionnelles.
Même principe, mais cette fois le kinésithérapeute
effectuait des stimulations multidirectionnelles par des
petites poussées manuelles au niveau céphalique.
Résultats
Soixante-cinq cervicalgiques ont été inclus
dans l'étude. Sur ces 65 cervicalgiques inclus,
3 sont sortis avant la fin de l'essai (groupe GR)
et 2 ont été perdus de vue dans le groupe GT.
Les trois patients sortis de l'essai répondaient
àun des critères d'exclusion (non-respect de
l'assiduité à la rééducation pour des raisons
indépendantes du traitement).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%