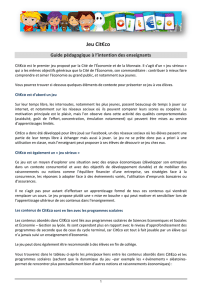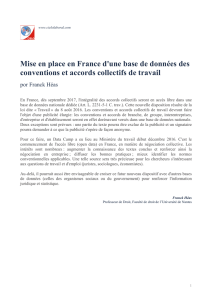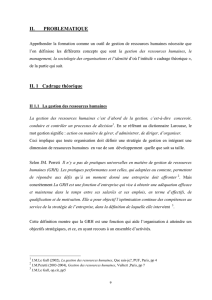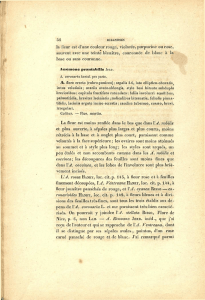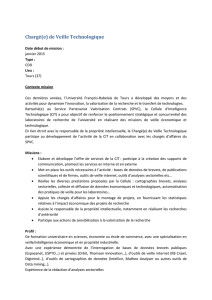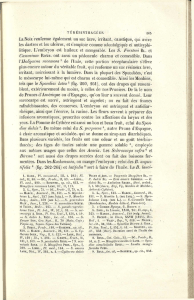Open access

PREMIERE PARTIE
LES COOPERATIONS INTERENTREPRISES,
ORIGINES ET FONDEMENTS D'UN
PHENOMENE

19
De toutes les caractéristiques associées aux formes de coopération interentreprises, leur
diversité est probablement une des plus frappantes :
- recherche et développement menés en commun, co-investissement dans un outil de
production, consortium de ventes, opérations de financement associant plusieurs
banques ou réunissant solidairement plusieurs entreprises, création par plusieurs
entreprises de centres de service employant à temps partagé des experts en
commercialisation ou en droit commercial, etc.
- Des coopérations se nouent tout au long des filières industrielles. Horizontalement,
elles réunissent des entreprises concurrentes ou de deux filières différentes.
Verticalement, elles associent dans une démarche partenariale fournisseurs et clients,
donneurs d'ordre et sous-traitants.
- Les opérations coopératives se déroulent sur de nombreux espaces géographiques. Au
plan local et régional, les coopérations incluent les "districts industriels" et les
"technopôles". Au plan international, elles se font transfrontalières en Europe, vecteurs
d'une intégration européenne, du succès commercial et technologique japonais ou d'un
renouveau de l'industrie américaine.
A des objets divers répondent des entreprises diversifiées. Les coopérations débouchent
sur des formes juridiques multiples. Simple accord implicite, elles peuvent aussi être
contractualisées ou donner lieu à la création de coentreprises. Elles consistent parfois à
prendre des participations minoritaires au capital des partenaires.
Dans le temps, les alliances se font et se défont à des rythmes différents. Simple
groupement momentané d'entreprises pour une opération ponctuelle, elle se stabilise
parfois sur des durées de vie dépassant la décennie. Elles peuvent également être
fondées sur des liens amicaux ou mettre en contacts des partenaires d'opportunité.
Cette diversité se retrouve au plan des terminologies et génère une vaste énumération de
vocables :
"Ces nouvelles structures sont le plus souvent désignées sous le vocable de réseaux [...]
bien que d'autres dénominations soient parfois proposées, comme partenariat à valeur
ajoutée, organisations à spécialisation flexible ou dans certains cas distretti
attrezzati, kyoryoku-kai, hollow corporations, voire virtual corporations"1
1FRERY F., (1993), "Et si l'entreprise n'était qu'un épisode de l'histoire ?", Annales de Colloque des IAE,
p.134

20
"Nous avons ainsi identifié près de quarante termes largement synonymes, parmi
lesquels on peut citer : réseau, partenariat à valeur ajoutée, alliance symbiotique,
quasi-firme, firmes solaires, constellation, fédérations d'hypofirmes, structure
hybride, virtual corporation, etc. Le terme "structure transactionnelle" a au moins
l'avantage de se référer explicitement aux coûts de transaction."2
En définitive, cette diversité peut faire penser qu'une entreprise peut tout faire en
coopérant avec d'autres sociétés et qu'il est impossible d'épuiser l'énoncé des catégories
de partenariat tant la capacité des dirigeants d'entreprise est grande à imaginer de
nouveaux types de coopération interentreprises.
Nature Auteurs Définitions
Relation
SCHERMER-
HORN La coopération peut être définie par la présence délibérée de
relations pour atteindre des buts individuels3
Stratégie
JAMES L'alliance est une combinaison de forces de concurrents actuels
ou potentiels pour dissuader d'autres concurrents potentiels
ou pour conduire une offensive4
Structur
e
JOFFRE,
KOENIG Selon le cas, la coopération sera de similitude ou de différence.
De similitude, elle conduira les entreprises connaissant des
problèmes identiques à grouper des moyens pour en économiser
l'usage.
La coopération de différence quant à elle, repose sur la
combinaison de complémentarités5
Contrat
CPA Une alliance est un échange dynamique de moyens financiers,
techniques et/ou humains entre différents partenaires.
Tout en préservant leur indépendance, les associés partagent les
profits comme les risques selon les termes d'un contrat
préalablement établi en commun6
Tableau I.1 : quatre orientations pour qualifier les relations coopératives (WACHEUX
7
)
La diversité des opérations coopératives étudiées ne doit pas non plus faire oublier leur
hétérogénéité. En partant de l'établissement d'une relation, l'alliance introduit une
2FRERY F., (1994), "La Réduction de l'Espace des Transactions et les Structures Néo-médiévales", Actes
du Colloque International de Management des Réseaux (CIRME 94) , Ajaccio, 24-26/06, p.351
3SCHERMERHORN J.R., (1975), "Determinants of Interorganizational Cooperation", Academy of
Management Review, Vol.18, n°4, pp.846-886
4JAMES B.G., (1985), "Alliances : The New Strategic Focus", Long Range Planning, Vol.18, n°3, pp.76-
81
5JOFFRE P., KEONIG G., (1985), "Stratégie d'Entreprise : Antimanuel", Economica
6CPA, (1988), "Euro-Entreprises, stratégies d'alliances", Colloque de Lyon, septembre
7WACHEUX F., (1994), "Coopérations et Alliances à travers les Recherches sur les Relations Inter-
Organisationnelles", Centre Lillois d'Analyse et de Recherche sur l'Evolution des Entreprises (UA-CNRS
936) : Cahiers de la Recherche, n°94/1, p.3

21
orientation stratégique alors que la définition de l'entreprise réseau est une définition
organisationnelle. Les coopérations sont aussi étudiées sous l'angle juridique en terme
de contrat.
Le management de tels ensembles implique aussi un support d'interface qui autorise
les échanges de données. Ainsi, la question des alliances rejoint régulièrement celle des
"autoroutes de l'information". Enfin, les pratiques coopératives ont des répercussions
nettes sur la conceptualisation même de la vie des affaires. Représenter le
fonctionnement économique en terme de maillage introduit une nouvelle métaphore de
l'entreprise comme un "noeud de contrats".
Si nous souhaitons conserver dans l'analyse la richesse émanant d'une telle diversité,
nous souhaitons, néanmoins, circonscrire le phénomène. Il s'agit de distinguer dans la
littérature ce qui concerne l'observation pratique d'une réflexion théorique. Il s'agit
également de réaliser une circonscription quantitative et qualitative du phénomène.
Dans un premier chapitre, nous limitons l'analyse du phénomène au débat pratique qu'il
suscite. La plupart des contributions se fondent sur la présentation de coopérations
interentreprises concrètes et sont situées au plan historique, au plan géographique dans
certains pays ou blocs de pays et au plan économique en termes de contenus et de
catégories d'entreprises impliquées dans la coopération interentreprises.
Dans un deuxième chapitre, nous entamons notre approche théorique avec les analyses
fondées sur les théories de l'environnement. Orientant principalement leur activité sur la
légitimation de ces pratiques, les contributions qui les utilisent contribuent à circonscrire
quantitativement et qualitativement le phénomène que représente la diversité des
coopérations interentreprises.

22
CHAPITRE I
L'IRRUPTION DES FORMES COOPERATIVES
INTERENTREPRISES DANS LE CHAMP DU MANAGEMENT
STRATEGIQUE
Au début du siècle et avec la fin de la deuxième guerre mondiale, on assiste à la montée
de la puissance économique des Etats-Unis. Cette domination économique
s'accompagne d'une domination culturelle évidente. Fleurissent alors aux Etats-Unis des
études nombreuses sur le thème des coopérations interentreprises qui témoignent
directement de l'évolution concrète des entreprises et des problèmes qui les concernent.
La recherche sur les coopérations interentreprises, "commanditée" par les dirigeants
d'entreprise, se trouve déterminée par les enjeux pratiques qui se posent à travers le
monde.
Les formes coopératives interentreprises s'ancrent, aux Etats-Unis, dans l'économie
internationale. Dans ce cadre, on observe un décallage évident entre les objectifs des
entreprises américaines associées dans des coentreprises à des partenaires japonais
engagés dans une stratégie d'apprentissage technologique à long terme à la poursuite
d'objectifs stratégiques. Les alliances entre entreprises américaines et européennes n'ont
pas suscité le même intérêt. De la simple coentreprise internationale souvent
commerciale, on passe à l'alliance stratégique globale et mondiale. Ce phénomène
va être fortement médiatisé et dramatisé au cours des années 1980.
Ce rééquilibrage des forces concurrentielles en faveur du Japon s'exprime dans le
management du développement technologique. La structure économique et sociale du
Japon s'adapte particulièrement bien à cet enjeu. Le mécanisme essentiel de l'économie
japonaise est le maillage, enchevêtrement de relations extérieures, entre recherche,
monde de la finance et entreprises industrielles autour de la figure centrale des
"keiretsu", groupements d'entreprises qui succèdent aux "zaibatsu", conglomérats
géants dissous après la deuxième guerre mondiale par l'occupant américain.
Face à cette contestation japonaise, les économies européennes et américaines
s'organisent en faisant émerger de nouveaux "champions technologiques". La question
coopérative devient "domestique" et "territorialisée" ce d'autant plus que les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
1
/
171
100%