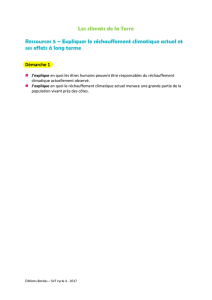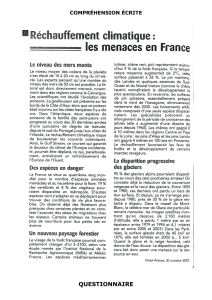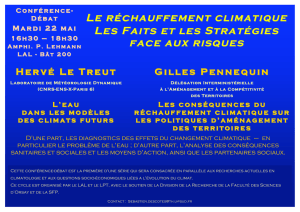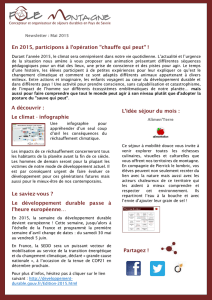Les collectivités territoriales et les risques naturels

Vous êtes ici :
Accueil> Soutenabilité> Les collectivités territoriales et les risques naturels
Les collectivités territoriales et les risques naturels
INTERVIEW DE BRUNO LEDOUX
<< Les collectivités territoriales devraient financer, avec d’autres partenaires, la recherche pour mieux cerner
comment pourrait se traduire le changement climatique sur leur territoire >>.
Bruno LEDOUX, est géographe, spécialisé en économie et droit de l’environnement. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
relatifs à la gestion des risques naturels, et plus particulièrement des inondations. Il était de 2003 à 2006 directeur adjoint
du Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle, en charge de la coordination et de l’animation du Plan
d’Actions de Prévention des Inondations.
Réalisée par : Sandra DECELLE
Tag(s) : Service urbain, Risque, Climat
Date : 05/05/2008
Le changement climatique est-il encore remis en cause par les experts ?
De rapport en rapport, le GIEC confirme la responsabilité humaine dans le réchauffement sans équivoque du système
climatique constaté au cours du 20e siècle, plus particulièrement de sa seconde moitié. Ce qui fait débat, c’est l’ampleur
de ce réchauffement à moyen terme et ses effets à des échelles régionales. Sur la question du changement climatique, il
existe quelque chose d’assez unique dans l’histoire des sciences : le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC). Créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement, il a vocation à évaluer de façon impartiale les informations scientifiques, techniques et
socio-économiques sur l’évolution du climat. Et ce groupe compte plusieurs centaines de spécialistes !
Depuis cette date, l’ensemble des rapports du GIEC tient lieu de référence pour les scientifiques et les décideurs du
monde entier. Jusqu’à aujourd’hui, la totalité des publications du GIEC a été approuvée, ou pour le moins leurs résumés,
à l’unanimité par les 192 pays représentés dans l’assemblée du GIEC.
A quels phénomènes naturels peut-on s'attendre dans nos régions tempérée ?
Au cours du 20ème siècle, la température moyenne en France a augmenté en moyenne de 0,1 °C par décennie, soit une
augmentation de 1 °C en un siècle, ce qui correspond à un déplacement moyen du climat de 200 kilomètres vers le
Nord. C’est une image un peu réductrice, car il existe de fortes disparités entre les périodes de la journée, les saisons ou
les régions. Mais globalement, les étés sont plus chauds et les jours de gel moins nombreux. La pluviométrie a
augmenté sur les deux tiers Nord du territoire métropolitain. Les événements pluvieux sont plus fréquents et durent plus
longtemps. Mais aucune conclusion ne s’impose sur l’évolution des précipitations intenses et il n’y a pas de preuves
tangibles de l’augmentation de l’intensité et du nombre global de tempêtes ou d’orages, ni de l’aggravation des épisodes
de crues.
Néanmoins, selon le GIEC, le changement climatique observé au cours du 20ème siècle est relativement faible en
regard de celui attendu pour le 21ème siècle. Selon les scénarios de croissance économique et démographique
envisagés, les modèles prévoient un réchauffement moyen à l’horizon 2100 dans une fourchette comprise entre 1,1 °C et
6,4 °C par rapport à la température moyenne de 1990. Les simulations faites par Météo-France montrent que le

réchauffement en France à ce même horizon sera compris entre 3 et 3,5 °C, tendance qui devrait être accompagnée
d’une augmentation de certains événements extrêmes. Par exemple, un été sur deux sera à la fin du siècle au moins
aussi chaud que l’été 2003. Les fortes précipitations deviendront encore plus fréquentes l’hiver et moins fréquentes l’été.
A l’échelle mondiale, la probabilité de la poursuite d’une augmentation de la fréquence des chaleurs extrêmes, des
vagues de chaleur et des événements de fortes précipitations est de 90 à 95%. Il est très vraisemblable que les
précipitations deviendront de plus en intenses et surtout de plus en plus variables, surtout dans les latitudes moyennes.
En Europe, les modèles prédisent une augmentation des inondations à l’intérieur des terres et des inondations côtières,
la réduction de la couverture neigeuse, la diminution des précipitations en été, des vagues de chaleur.
Comment les services responsables de la définition de l'aléa inondation, les Direction régionale de
l’environnement notamment, se saisissent-ils de la question du réchauffement climatique ?
Les atlas des zones inondables reposent sur des approches historiques : on cartographie les limites des plus hautes
eaux connues. Pour les démarches réglementaires (les plans de prévention des risques), on prend ces limites si la crue
historique la plus forte est au moins centennale, sinon, les services de l’Etat font réaliser des modélisations hydrauliques,
dont les hypothèses hydrologiques (les débits) reposent sur l’exploitation des données historiques…
Ni l’intensité ni la fréquence des crues ne présentent de tendance d’évolution significative, que ce soit en France ou en
Europe. L’augmentation des précipitations en hiver mise en évidence par les modèles devrait conduire à une
augmentation des crues hivernales, en termes d’intensité et de fréquence. Notamment lorsque le couvert neigeux joue
un rôle dans ces crues : la limite pluie-neige devant être plus élevée en altitude, l’effet tampon du couvert neigeux sera
plus faible. Mais il est encore impossible de traduire ces tendances probables en données quantifiées assimilables pour
la modélisation hydraulique locale et la réglementation.
Tout le monde est attentif aux connaissances produites par les scientifiques mais dans le cas de la gestion du risque
inondation, d’un point de vue réglementaire, les éventuels effets du changement climatique n’ont pas encore de
traduction concrète.
Quel rôle les collectivités territoriales peuvent-elle jouer dans la prise en compte des effets du changement
climatique en ce qui concerne les risques naturels ?
Changement climatique ou pas, les collectivités territoriales sont en première ligne lorsque surviennent des catastrophes
naturelles : non seulement leur territoire, leurs populations, leur économie sont touchées mais elles sont des acteurs
essentiels –notamment sur le plan financier – des phases de reconstruction post-sinistre. Il n’est donc pas étonnant
qu’elles soient toutes, peu ou prou, mais de plus en plus, mobilisées dans des actions de prévention.
Je crois que leur rôle principal, pour l’heure, doit être dans la production de connaissances à leur échelle territoriale de
compétence : elles doivent financer, avec d’autres partenaires, la recherche pour mieux cerner comment pourrait se
traduire le changement climatique sur leur territoire. Et ce changement concerne aussi bien les phénomènes extrêmes
(ce que l’on met généralement sous la notion de risques naturels) que les modifications des conditions moyennes du
climat (qui influe par exemple sur la question de la ressource en eau). La « régionalisation » du changement climatique
est un champ de recherche qui reste largement à défricher.
Mais cette recherche doit aussi traiter des politiques les plus pertinentes à envisager pour réduire la vulnérabilité des
territoires et des économies et être mieux à même de faire face. C’est la grande question de l’adaptation de nos sociétés
aux changements en cours.
Les collectivités doivent ensuite devenir le principal animateur d’une mobilisation de tous les acteurs concernés : les
agriculteurs, les industriels, les habitants, les gestionnaires de réseaux…).
La Région Rhône-Alpes est assez exemplaire dans ce domaine, avec par exemple sa participation au programme de
recherche sur les impacts des changements climatiques dans les alpes et les conséquences sur les risques naturels. Ou
encore la publication de l’ouvrage «
Changement climatique. Comment s’adapter en Rhône-Alpes ? ».
En tant qu'expert, estimez-vous que cette question est importante dans le cadre de la prévention des risques
naturels ?
En matière de risque, il ne faut pas raisonner seulement en termes d’aléa mais aussi en termes de vulnérabilité, et se
préoccuper de cette question à l’échelle des territoires. Quant bien même les aléas seraient profondément modifiés dans
un siècle, plus fréquents et plus violents, ils frapperont en France une société bien moins vulnérable que beaucoup
d’autres régions du monde. A l’échelle planétaire, nous n’avons pas encore mesuré et surtout pris conscience des
bouleversements que cela est susceptible de produire, notamment en terme de mouvements migratoires et d’impacts
sanitaires, et donc de déstabilisations socio-politiques.
Ce qui ne veut pas dire que les villes, l’économie agricole, l’économie du tourisme, notamment en montagne, ne doivent
pas se préparer à affronter des changements profonds que le réchauffement climatique va entraîner en France. Sur la
question plus particulière des risques naturels, le réchauffement climatique doit être une raison supplémentaire
d’accentuer nos efforts de prévention, mais je ne crois pas qu’il modifie radicalement la nature des risques.
Quelle place doit-on accorder au changement climatique ? Doit-on se saisir de cette question (au regard de la
prévention) ? Comment ?

Les « dérèglements » climatiques sont inéluctables pour plusieurs siècles, quelles que soient les politiques énergétiques
que nous adoptions demain, car l’effet des émissions anthropiques de dioxyde de carbone continueront à contribuer au
réchauffement
Au sein des experts, la question du changement climatique soulève souvent celle des aléas de référence : le
changement climatique doit-il induire un durcissement de cette référence ? La question n’est pas innocente : l’aléa de
référence, c’est ce que les documents réglementaires prennent en compte pour, par exemple, réglementer l’occupation
des sols, donc l’urbanisation, dans les zones inondables. Ou pour dimensionner des ouvrages de protection, comme les
barrages. Et la question est loin d’être purement technique : elle est largement politique, car elle renvoie à la notion de
risque acceptable. Hors du cénacle des experts, ces questions à l’interface de la technique et du politique étaient déjà,
avant que le changement climatique ne s’impose dans l’agenda politique, difficiles et souvent peu répandues, alors
maintenant que l’évolution du climat introduit de nouvelles incertitudes…
Mais il ne faudrait surtout pas prendre prétexte des incertitudes qu’introduiraient les évolutions climatiques dans la
connaissance actuelle des aléas pour ne rien faire ! L’hydrologie des cours d’eau (les crues, les étiages…) va
probablement être modifiée, mais l’on connait aujourd’hui suffisamment bien l’extension des zones inondables, qui ne
seront pas, elles, radicalement remises en cause pour agir dès aujourd’hui.
Sans minimiser l’impact du réchauffement climatique, nous savons déjà ce qu’il conviendrait de faire pour réduire les
risques actuels et ceux de demain. En effet, les profondes modifications qu’ont subies nos cours d’eau (extraction de
matériaux, recalibrage, endiguement…), ainsi que l’urbanisation dans les zones inondables, sont encore, selon moi, les
principales causes des inondations et de l’exposition excessive des hommes et des biens économiques.
1
/
3
100%