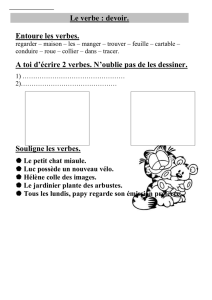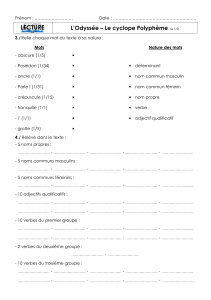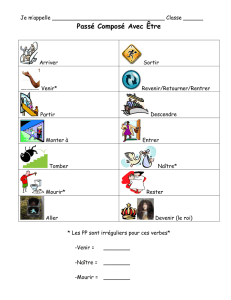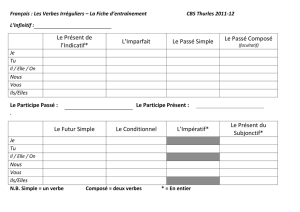« DES SCHEMES ET DES THEMES » Résumé :

1
« DES SCHEMES ET DES THEMES »
Lydia GUERCHOUH
Maitre assistante département de Langue et culture Amazighes
Université de TIZI-OUZOU.
Résumé :
Le verbe, en berbère, est la composante la plus importante du lexique de par son
statut syntaxique le plus souvent prédicatif et centre de rattachement dans un énoncé,
mais aussi en référence à son rôle dans l’enrichissement lexical étant en majorité base
de dérivation pouvant former jusqu’à 15 unités.
Ceci dit, cet élément, généralement, indispensable à tout acte verbal suscite
encore beaucoup d’interrogations. En effet, si les natifs de la langue arrivent plus ou
moins facilement à identifier les formes et la structure des différents thèmes verbaux de
manière spontanée, les non natifs, eux, ne peuvent s’exercer à la conjugaison à moins de
leurs fournir, dans chaque cas, un prototype qui formera d’ailleurs la référence d’un
système par analogie. La pratique de la langue, en dehors de ce cadre, sera obstruée par
l’absence de ces moules.
Si, en français, on pré-identifie les terminaisons des verbes en références à leur
classification (1er, 2ème et 3ème groupes en plus des verbes irréguliers), en berbère, cette
organisation reprise en partie par Mouloud Mammeri dans « tajerrumt n tmazi$t »
s’avère peu efficace pour cette langue notamment en raison de l’hétérogénéité des
formes verbales dites simples ainsi que les changements affectant le schème même des
verbes.
Si en terminologie et en sémantique, on identifie quatre thèmes verbaux (prétérit,
prétérit négatif, aoriste et aoriste intensif), au niveau formel, on constate assez vite que
certains thèmes affichent des structures similaires donnant ainsi des verbes à deux

2
thèmes et quatre thèmes constituant les deux extrémités d’une situation médiane à trois
thèmes.
Ces variations dans la conjugaison qui semblent, à priori, n’obéir à aucune
régularité, fonctionneraient, en fait, selon la construction des schèmes verbaux. Sur ce,
nous proposons d’établir une classification des verbes annonçant, dès le départ, certains
traits de leurs conjugaison. Nous nous interrogerons sur une éventuelle distribution
complémentaire entre les schèmes des formes simples et le nombre de thèmes verbaux
afin de fournir aux apprenants, natifs comme non natifs, des régularités dans la
conjugaison des verbes en berbère un peu à l’image de ce qu’elle est en français. Existe-
t-il, donc, une relation univoque et systématique entre les types de schèmes et le nombre
de thèmes verbaux leur correspondant ?
Pour étudier cette éventuelle régularité, nous nous référons à un corpus constitué
de 1000 verbes pour lesquels nous avons relevé toutes les réalisations aspectuelles y
compris les cas de variations et de diversité des réalisations des thèmes verbaux en
question.
Concernant cette thématique, les manuels scolaires ne fournissent qu’une seule
information indiquant de manière vague que l’aoriste intensif constitue toujours un
thème différent, opposant, ainsi, des verbes à deux, trois et quatre thèmes et excluant, de
ce fait, d’éventuels verbes à un seul thème. Les écrits à ce sujet, ne mentionnent, quant à
eux, que la diversité du nombre de thèmes verbaux de chaque groupe de verbes, avec
quelques illustrations de schèmes correspondant mais sans, toutefois, tenter d’établir
une répartition de ceux-ci en fonction du nombre de thèmes qu’ils peuvent prendre.
Dans ce qui suit, nous essayerons de relever les régularités dans la distribution des
nombres de thèmes verbaux. Nous dégagerons, dans un premier temps, tous les schèmes
pouvant former un, deux, trois ou quatre thèmes, puis nous établirons des connexions
entre les différents types dégagés afin d’étudier le type de distribution (complémentaire
ou aléatoire) qui régit cette diversité thématiques.

3
I. Les verbes d’état :
D’après une étude établie sur une quarantaine de verbes, il semblerait que les
verbes d’état sont tous des verbes affichant trois thèmes. Cependant, bien que les
oppositions de thèmes semblent être assez stables, certains schèmes comme ic1c2ic3
affichent des variations dans les types d’oppositions dont la raison nous semble
inexplicable, comme le démontre les exemples suivants :
I$zif (être grand) : $ezzif i$zif tti$zif
P/PN - A - AI1
Izyin (être beau) : zyen zyin ttizyin
P/A - PN - AI
Ishil (être facile) : shel shil ttishil
P - PN/A/ - AI
Les schèmes verbaux formant trois thèmes aspectuels sont représentés ci-après :
1. cvc : C1ac2
2. vcvc : ac1ac2, ic1ic2
3. vccv : ic1c2i
4. cvcvc : c1ic2ec3
5. vccvc : ic1c2ic3, ic1c2uc3.
Par ailleurs, certains verbes d’état, du fait que les locuteurs tendent à assimiler leur
conjugaison à celle des verbes d’action censé, normalement, être différente, affichent
deux ou quatre thèmes selon leurs schème et en référence aux corrélations existantes
entre les schèmes et les thèmes des verbes d’action que nous étudierons ci-après. Par
ailleurs, il semblerait que ce phénomène d’alignement des thèmes aspectuels de ces
verbes à ceux des verbes d’action ne concerne pas tous les verbes mais surtout ceux
présentant les schèmes suivants, notamment les verbes de forme active et les expressifs
1 P (Prétérit) ; PN (Prétérit Négatif) ; A (Aoriste) ; AI (Aoriste Intensif)

4
P PN A AI
c1vc2c3vc4 : zegzaw zegraw zegzaw ttzegziw
vc1c2vc3 : qseê qseê yeqseê ttiqsiê
II. Les verbes d’action :
Ils se manifestent sous deux, trois et quatre thèmes de la manière suivante :
II.1. Verbes à deux thèmes :
Il existe 27 schèmes verbaux (les plus nombreux) qui affichent deux thèmes en
passant d’un aspect à un autre. Les oppositions de thèmes sont régulières et
n’apparaissent que sous une seule forme puisque l’aoriste intensif constitue toujours un
thème appart entier :
P/PN/A - AI
Toutefois, certaines variantes, bien que rares, nous ont amenées à poser,
exceptionnellement, des verbes à un seul thème, dont celui de l’aoriste intensif ne
semble subir aucune modification. Ces cas ne concernent, toutefois, pas tous les verbes
mais uniquement quelques unités.
c1eC2ec3 : êemmel êemmel êemmel êemmel
P PN A AI
Les schèmes verbaux qui ne donnent que deux thèmes sont résumés dans ce qui
suit :
1. cv : C1i, c1a
2. ccv : c1c2i
3. cvc : c1ec2, c1uc2, c1ac2, C1ac2, c1ic2
4. vcc : ec1c2
5. ccvc : c1c2ec3
6. vcv(c) : uc1ec2, uc1ac2, iC1ic2, uc1u
7. cvcvc : c1uC2ec3, c1eC2ec3, c1uc2ec3, c1ac2ec3

5
8. cvccv : C1ec2c3i
9. cvccvc : c1ec2c3ec4, C1ec2c3ec4, C1ec2c3ac4
10. ccvcv(c) : c1c2ac3ec4, c1c2uc3ec4, c1c2ac3i
11. ccvccv(c) : c1c2ec3c4i, c1c2ec3c4ec5
Par ailleurs, les différentes variantes relevées nous ont révélé que certains verbes
de cette catégorie opposent trois thèmes. Cette variation apparait à travers les
alternances que subissent quelques verbes avec le thème du prétérit négatif dans lequel
il y a eu modification de la dernière voyelle : une alternance vers la voyelle « i »
qui est, généralement, la marque indiquant l’aspect de la négation.
Uc1ec2 : uqem uqem uqem ttuqam
Variante : uqem uqim uqem ttuqam
II.2. Verbes à trois thèmes :
Ce sont les plus nombreux en termes de nombre de verbes mais pas en termes de
schèmes formant trois thèmes. Contrairement aux premiers, ceux-ci ne sont pas
réguliers en termes de types d’opposition où l’on trouve les situations suivantes :
P/PN - A - AI
P/A - PN - AI
Ceci dit, si la majorité des schèmes de ce type de verbes diffère de ceux du
précédent favorisant ainsi la distribution complémentaire qui est le but recherché ici, il
existe trois schèmes : c1ac2ec3, c1c2ic3, c1ac2, partagés entre deux et trois thèmes.
Cette réalité est souvent générée par la variation puisqu’on retrouve très souvent les
deux types dans un même parler et où il est, quelques fois, assez difficile à cerner,
notamment, la voyelle finale du verbe qui est tantôt maintenue, tantôt alternée.
1. vc : ac1
2. cv : C1u
3. vccv : ac1c2u
4. cvc(v) : c1eC2i, C1ec2, C1ac2, c1ac2, c1ic2
5. vcv(c) : ac1, ac1u, uc1uc2, ac1ec2, ac1ac2
 6
6
 7
7
1
/
7
100%