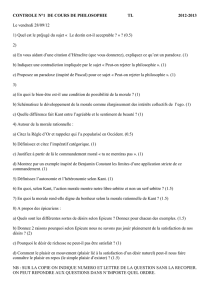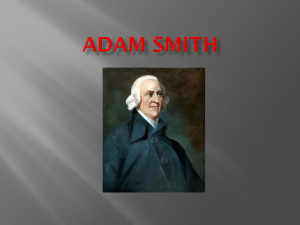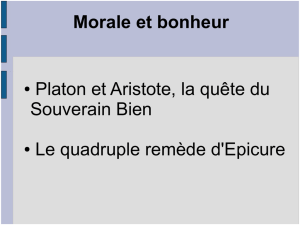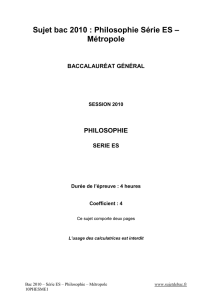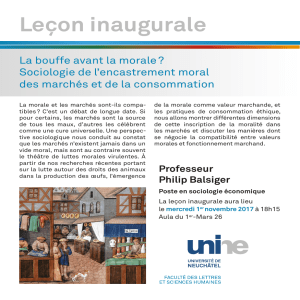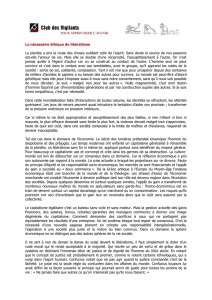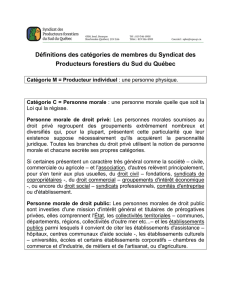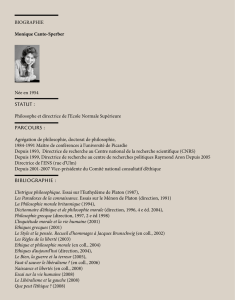I À NTRODUCTION

1
Département de sciences sociales et politiques
Faculté des sciences sociales, économiques et de gestion
Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix
INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE
Laurent de BRIEY
Année 2011-2012

2
Présentation
L’objectif du cours
Ce cours souhaite initier les étudiants à la démarche philosophique et à la réflexion abstraite.
L’étudiant devra être amené à comprendre en quoi consiste une démarche philosophique et à
témoigner lui-même d’une capacité de prise de distance critique par rapport à toute opinion et
conviction, en ce compris ses opinions et convictions personnelles. Il devra être à même de
veiller à la cohérence globale d’une argumentation, démontrer une aptitude de compréhension
et de confrontation de raisonnements complexes autres que les siens, ainsi que faire preuve
d’une relative aisance dans l’usage de concepts techniques. Via les notes de cours, il devra
également se confronter à la lecture d’un texte de style philosophique.
Le contenu du cours
Le cours comprend une introduction générale et deux parties principales. L’introduction
générale s’efforce de répondre à la question « Qu’est-ce que la philosophie ? ». Elle consiste
en une présentation méthodologique de la philosophie en la distinguant des autres formes de
discours comme l’art, la religion ou la science. Les deux parties principales sont
respectivement consacrées à la philosophie morale et à la philosophie politique. Outre un
évident souci de demeurer dans le champ de compétences de l’enseignant, le choix de
privilégier la philosophie pratique s’explique par l’espoir que des réflexions portant,
notamment, sur ce qu’un individu, soucieux d’agir moralement, a le droit de faire et sur la
manière dont une collectivité doit gérer les conflits en son sein, soient plus susceptible de
rencontrer l’intérêt d’étudiants dont la philosophie n’est pas la discipline, que des réflexions
davantage théoriques sur l’essence de l’être ou les conditions de possibilité de la
connaissance. Ce choix doit également permettre de mettre en évidence que la philosophie ne
constitue pas une réflexion abstraite désincarnée, mais fournit au contraire des cadres
conceptuels favorisant la compréhension de la société dans laquelle nous vivons et la
possibilité d’agir en son sein.
Dans la partie consacrée à la philosophie morale comme dans celle consacrée à la philosophie
politique, nous ne procéderons pas à une présentation de la succession historique des
principaux philosophes. Nous privilégierons une explication des principales traditions en
débat dans ces deux domaines de la philosophie. Pour la philosophie morale, chacune de ces
traditions sera illustrée par l’étude approfondie d’un auteur ou courant, à savoir Aristote,
l’utilitarisme, Kant et Jonas. Le fil conducteur de la partie « philosophie politique » sera
l’étude de la tradition aujourd’hui dominante, le libéralisme politique, et des critiques que lui
ont adressées les traditions socialistes, républicaines et communautariennes. Nous verrons
comment ces critiques ont forcé, et forcent toujours, le libéralisme politique à s’auto-
transformer.
Concernant cette deuxième partie, une remarque s’impose. Comme nous nous intéresserons
essentiellement aux débats contemporains, plutôt que de présenter la pensée de quelques
philosophes, nous essaierons de reconstruire des modèles-type du libéralisme, du
républicanisme, du socialisme et du communautarisme. Or, ces concepts sont des savonnettes.
Toutes les grandes traditions philosophiques réunissent sous un même vocable des théories
trop diverses et variées pour qu’il soit possible d’en donner des définitions claires et

3
incontestables. Dès que nous pensons être parvenus à le saisir en un ensemble cohérent de
thèses qui constituerait le noyau dur d’une tradition, celle-ci nous échappe et nous oppose
l’irréductibilité de sa complexité.
Il y a par conséquent une grande part d’interprétation, et parfois d’arbitraire, dans les
reconstructions idéales proposées. C’est non seulement inéluctable, mais aussi nécessaire.
Aussi insatisfaisantes soient-elles, ces idéalisations ont en effet le mérite de créer du sens.
Elles permettent de saisir la logique sous-jacente aux controverses philosophiques et
politiques et à la manière dont elles s’enchaînent historiquement.
En contrepartie cependant, une telle approche rend peu adéquate toute référence à une
philosophie précise et il ne sera fait qu’exceptionnellement référence à la pensée d’un
philosophe particulier. Les grands auteurs se situent tous quelque peu de biais par rapport à la
systématisation idéale proposée. Leurs pensées partageront certainement des éléments de
traditions ici opposées et leur originalité se manifestera dans la manière dont elle les
articulera. Il n’en reste pas moins que ces pensées peuvent être comprises en se référant aux
modèles idéaux dont elles seront les plus proches.
Le champ de la philosophie politique peut par conséquent être représenté comme un
continuum dont les points cardinaux (ou certains d’entre eux) seraient les modèles idéaux
proposés. Telle pensée sera, par exemple, plus libérale que communautarienne et plus
socialiste que républicaine, tandis que telle autre sera essentiellement communautarienne,
partiellement républicaine et fort peu libérale ou socialiste. Une manière d’appréhender la
philosophie d’un auteur particulier est de comprendre en quoi il se distingue du modèle idéal
dont il est le plus proche et quelles difficultés il parvient éventuellement à résoudre en s’en
distanciant.
Le syllabus
Les présentes notes de cours sont conçues comme un complément de l’exposé oral. Si elles
reprennent l’ensemble de la matière, elles sont fort denses et synthétiques. Elles nécessitent
par conséquent d’être explicitées lors des séances orales.
Une liste de questions-types figure à la fin de chaque chapitre des deux parties principales.
L’étudiant pourra vérifier sa compréhension et sa connaissance de la matière en s’efforçant de
répondre par lui-même à ces questions.
L’étudiant trouvera en outre à la fin de chacune des deux parties quelques références
bibliographiques. Ces références constituent autant de suggestions de lectures pour l’étudiant
désireux d’approfondir ce cours.
Enfin, sont jointes également trois annexes. Premièrement, une synthèse schématique de la
morale kantienne qui constitue certainement l’un des chapitres les plus importants et les plus
difficiles du cours. Deuxièmement, un article, écrit avec John Pitseys, consacré à l’étude des
enjeux philosophiques du débat parlementaire sur l’homoparentalité qui a eu lieu sous la
précédente législature. Cet article s’efforce d’illustrer l’éclairage que l’étude des traditions
philosophiques peut apporter à la compréhension des débats sociaux-politiques actuels. La
troisième annexe consiste en un lexique reprenant la signification de quelques-uns uns des
termes techniques les plus importants parmi ceux utilisés dans ces notes.

4
L’enseignement
Le cours est dispensé sous la forme d’un enseignement magistral. Chaque séance débutera par
une séance de questions-réponses sur la séance précédente.
L’enseignement magistral est complété par des séances de travaux pratiques (TP). Ces
séances d’exercices garantissent un ancrage pratique aux théories vues lors des séances
magistrales. Elles seront essentiellement consacrées à un travail d’application des concepts
vus au cours à des questions morales et politiques actuellement présentes dans le débat social.
Une participation active des étudiants sera exigée.
Modalités d’examen
En raison de la taille de l’auditoire l’examen sera écrit et se déroulera sera à livre fermé. Il
durera 2H1/2 et comprendra quatre questions (une question de synthèse, deux sur des points
plus précis du cours et une sur des articles de presse), ainsi qu’une question bonus pouvant
rapporter jusqu’à deux points supplémentaires complémentaires. Les trois premières questions
seront reprises des questions-types figurant dans le syllabus.
L’examen évaluera de manière privilégiée la capacité des étudiants à comprendre des
raisonnements abstraits et à les reproduire de manière cohérente. La qualité formelle de la
réponse et la précision dans l’usage des concepts sont à cet égard déterminantes. La capacité
des étudiants à faire le lien entre les théories philosophiques et des débats sociaux actuels sera
également évaluée.
L’examen sera noté sur 15 en juin, s’y ajoutant les points des TP, et sur 20 en septembre, la
note des TP n’étant pas reportée.
La note des travaux pratiques sera donc intégrée dans le résultat final de l’examen de juin.
Cette note est donnée sur base d’une présentation de groupe ayant lieu au cours du semestre,
ainsi que par la participation active des étudiants lors des séances (jeu de -1 / 0 / +1). Ces
séances sont obligatoires ; en cas de non-présence à une séance, l’assistant est habilité à retirer
un point.
Evaluation formative
En coordination avec la faculté, une évaluation formative sera organisée au milieu du
quadrimestre.

5
Introduction générale
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
1
/
186
100%