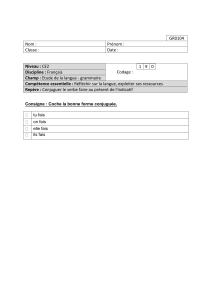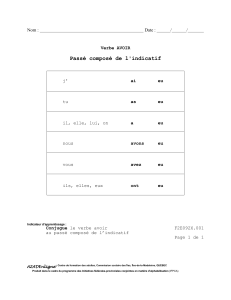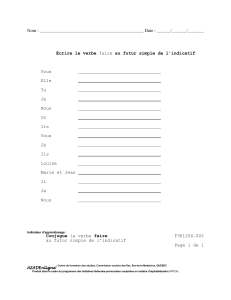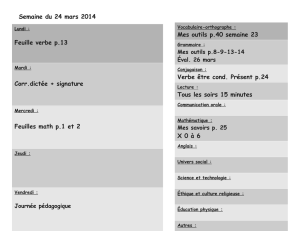UNIVERSITE DU QUEBEC THESE PRESENTE A
publicité

UNIVERSITE DU QUEBEC
THESE
PRESENTE
A
L'UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES
COMME EXIGENCE PARTIELLE DU DOCTORAT EN PHILOSOPHIE
PAR
ANDRE LECLERC
B.A., M.A
LE TRRITEHEHT DES
RSPECTS ILLOCUTOIRES DE LR SI6HIFICRTIOH DRHS
.
LR 6RRHHRIRE PHILOSOPHIQUE DE L'EPOQUE CLRSSIQUE
,
,
GENERALE DES MODES VERBAUX
AOUT 1989
:
(1660-1803)
LA THÉORIE
Université du Québec à Trois-Rivières
Service de la bibliothèque
Avertissement
L’auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l’Université du Québec
à Trois-Rivières à diffuser, à des fins non lucratives, une copie de son
mémoire ou de sa thèse.
Cette diffusion n’entraîne pas une renonciation de la part de l’auteur à ses
droits de propriété intellectuelle, incluant le droit d’auteur, sur ce mémoire
ou cette thèse. Notamment, la reproduction ou la publication de la totalité
ou d’une partie importante de ce mémoire ou de cette thèse requiert son
autorisation.
_:": -:".
*
'
.:
R esume
La premiere
La thèse se divise en t r o is part ie s .
la
Grammaire
rec herc~e
scientifisue,
Imre Lakat o s p our
-::>artie
en
a v1.s
notre
àes
SlX
de
la pensée;
o rien tée
1)
et
resp ecta nt
le
sa principale
2)
l an gage
f o ncti on
3)
(l a
la
la pens ée est
la
les langues se f o rment
repr oduis a nt
un
activité
une
certain
et
nombre
6)
le
évoluent
en
mo dè l es
de
etc. )
La ceinture
de protection comp rend les théories auxiliaires suivantes
théo rie des idées access o ires;
théorie des tropes;
et des inversions;
5)
4)
est
est
c ommunica t ion )
(pa ra d igmes de décl inaison et de conjugaison,
~a
le
il y a des universaux linguistiques
vers une fin
d'analogie
p r inc ip e
reconstruit
l'usage n o rmal de la par ole est
5)
prerr, iè r~
Le noyau dur s e compose à
principes suivants
me me p ar tout et pour tous; 4 )
rationnelle
Cette
la ceinture de protection du programme
communication des pensées dans le discours;
subst an tiels;
programme
le premier
de la Grammaire Générale.
l'expression
que
l'histo r iographie des sciences.
e-: le se con d,
rec~erche
tant
en s'inspirant de la méthode proposée par
se divise en deux chap it res;
n oyau èur,
de
classique
Géné r al e
presente
2)
1)
la théorie de la synonymie;
la
3)
la théorie de l'ordre naturel des mots
la théorie de la traduction;
6)
la théorie
d e l'origine de s langues.
La
seconde
QTë:rnmairiens
énoncés
~:uj
et
partie examine
philosophes
non déclaratifs.
dan s
..1..
es
*
théories
concernant les modes
des
principaux
verbaux
pour
géné ral es
Du Marsais,
Le résum é doit étre dactylographié à double Interligne
.J.
les
et
Nous distinguons deux approches
grammaires
représentée par Port - Royal,
les
à
ce
la
première,
Harris,
J . Burnet-:
I _~
• • .: ....... .
_ _
' ~'~. '
..
,
t _ _
.
•
( ~ o rd
Monb o èd c )
c omme
et
mara u eurs d'act e s de
ces
~
cié c laratifs
e st
ce
en
r é du c ti onn iste
~ _!e
~.
s e ns
des én o ncés
repré~ent é e
l'autre
p en s é e;
qu'elle
ré d u i t
d~ c -ara~ifs
pri n cipaleme n t
appr oche
én o ncés
les
e~primant
n on
des jugements,
Beauzé s .
N.
p ar C .
et
Co ndi!la c . . . . Beattie et De stutt de Tracy .
"T
La tr o isième partie est une é valuati o n critique de ces
approches
':: h é ori es
,=rr
ô~ mma
l'énonciation .
de
p h ilosophes
i rie n s
st ru c :ura l istes ,"
.+
FI () ur
l ' histoire
et de la place su'elles occupent dans
enSUl~e
avec
celles
th é ori es
des
comparatistes,
des
les
c ompar o ns
Nous
des
et des linguistes et philosophes c ontemp o rains,
les
nombre
confron t er à un certain
de
critères
d 'a d équation empirique .
No us cr oyons avoir montré que les modes verbaux constituent
le
principal
d 'une
espè c e
marqueur de force illocutoire,
assez
l'avaient jugé utile,
simple;
les
peuples
un
auraient
marqueur
pu,
verbales
caractérist iq ues.
les grammairiens philosophes sont restés prisonn iers
t raditi o n
ren o uveler
l o gico-grammaticale
séculaire
qu'ils
ont
d'une manière orig inale en anticipant quelquefois des
Signature du candidat
Date :
)
d'une
néanm o ins
résultats obtenus par nos cont empor ains.
r
s' il
distinguer et marquer toute la variété des
d ' illocut i on par des flexions
types
mais
Signature du co-auteur (s'il y a lieu)
Signature du co-directeur (s'il y a lieu)
Date :
Date :
mes parents,
qui n'ont
jamais eu la chance d'entreprendre des études supérieures,
et en particulier à ma
mère,
qui n'a cessé de m'encourager, même s'il lui arrivait de ne pas toujours bien
comprendre ce que je faisais.
À
REMERCIEMENTS
Une thèse de doctorat est,
"scolaire"
d'un
philosophe
en principe, le dernier travail
de formation.
philosophes qu'on devient philosophe.
la
Mais c'est parmi les
j'ai eu
A Trois-Rivières,
chance de découvrir un groupe de philosophes très
dynamiques
qui m'ont fait profiter de leur enseignement et de leur
exemple;
un lieu de recherche sans complaisance où la Philosophie exige et
donne beaucoup.
Ce qui a peut-être le plus
d'un
philosophe,
c'est
d'importance dans la
l'apprentissage des critères
satisfaire un travail philosophique "bien fait"
la
rigueur,
place.
Les
précision
professeurs
que
doit
où la clarté, la
et l'élégance doivent avoir
Claude Panaccio,
formation
Nicolas
leur
juste
Kaufmann
et
Daniel Vanderveken sont sans doute les trois personnes qui, à cet
égard, m'ont apporté le plus.
Et merci pour tous
la confiance témoignée au cours des années et
les avis précieux,
pris
à les remercier ici très
Merci de m'avoir fait suer!
chaleureusement.
l'intérêt
Je tiens
à mes travaux et
projets.
Je
n'essaierai
pas
d'évaluer ici ma "dette intellectuelle" envers eux, car ce serait
une longue histoire.
nous
choisissons
Dans la mesure où,
comme le dit A.
vraiment nos influences,
orgueil que j'invoquerai celles-là.
ce
n'est
pas
Koyré,
sans
Bon sang! Au cours de toutes
ces années, je n'ai pas cessé d'apprendre!
Aujourd'hui j'en suis
sûr: c'est ma bonne étoile qui m'a conduit à Trois-Rivières pour
y étudier la philosophie.
V01S
Quant à ma dette intellectuelle, je ne
pas d'autre façon de m'en acquitter que d'oeuvrer
longtemps
le
plus
possible dans les domaines qu'ils m'ont fait connaître
et approfondir.
J'aimerais avant tout remerc1er
a
M. Daniel Vanderveken, qui
dirigé mon travail de recherche pour cette thèse de
J'ai
doctorat.
eu le privilège d'être l'un de ses assistants de
recherche
depuis une douzaine d'années et d'être le témoin de sa formidable
contribution
philosophie
la
à
en
théorie
général.
des
(Car
actes
de
discours
on peut maintenant
et
dire
théorie des actes de discours ce que Ramsey disait de la
des descriptions définies de Russell
"une
méthode
description
penser
philosophie";
non
elle
fournit
seulement de la philosophie du
l'esprit et de la théorie de l'action).
de la
un
la
théorie
cadre
de
de
enrichissement
langage,
mais
philosophie
de
Daniel Vanderveken
sans doute le philosophe envers qui ma dette est la plus
consacré
de
nous enjoint
et permet un
de la philosophie transcendantale,
Puisse-t-il
la
elle est vraiment devenue
unifiée des phénomènes langagiers,
d'une manière systématique,
appréciable,
aUSS1
de
à
n'avoir jamais à regretter tout le temps
au cours de mes années de formationl
est
lourde.
qu'il
Encore une
m'a
fois
merci l
André Leclerc.
21 février 1990.
TABLE DES MATIERES
Introduction
...................................... ,
p.
1
PREMIERE PARTIE : La Grammaire Générale classique
en tant que programme de rechercha scientifique ... ,
p.41
Chapitre premier: La Grammaire GénérAle classique en
tant que programme de recherche scientifique :
Le Hoyau dur
.................................... . . ,
p. 42
ChApitre deuxième: La Grammaire Générale classique en
tant que programme de recherche scientifique :
La
Ceintur~
de protection
......................... ,
Conclusion de la première partie
.................. ,
p. 136
p. 222
DEUXIEME PARTIE: La sémAntique idéAtionnelle des
modas d'énoncé
Introducti on
.................................... ,
...................................... ,
p. 237
p.
238
SECTION 1 : La thjorie des modes verbAux comme
marqueurs d'actes de pensée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
p.253
..................... ,
....... , ........ , .... ,
p. 254
ChApitre premier
Chapitre second
Port-Royal
: Du MarsAis
p.
292
Chapitra troisième
James Harris
Chapitra qUAtrième
James Burnett (Lord Monboddo)
Chapitre cinquième
James Gregory
................. ,
................ ,
p. 315
p. 334
p.
349
SECTION II : Les th'ories r'ductionnistes des
modes verbaux
..................................... ,
Chapitre sixième: Buffier
p. 377
........................ ,
p. 380
....................... ,
p. 391
Chapitre septième
Beauz' •
ChApitra huitième
Condi 11 ac
..................... ,
p. 424
Chapitre neuvième
Beattie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
p. 461
Chapitre dixième: Destutt de Tracy
............... ,
p. 474
TROISIEME PARTIE : CONCLUSION GENERALE :
La s'mantique id'ationnalle des modes
place dans
l~histoire
des th'ories de
d~'nonc'
: sa
l~'nonciation
et son ad'quation empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
p. 492
BIBLIOGRAPHIE
p. 548
..................................... ,
***
INTRODUCTION
Le
principal
g'njr~l.
d..
objet de cette monographie
mod..
v.rbAuM
dans
la
Grammaire
d'6vAlu.r les diverses
grammairiens
philosophes
thé orique"
de la
aujourd'hui
les
encore,
pour
Philosophique
approches mises de l'avant
pour rendre compte,
Grammaire Générale,
compte
dans
par
le
lA
les
"caqre
de ce que nous
A.p.Ct. illocutoir •• d.
rendre
thjorie
la
Son but est de djcrir.
de l'époque classique (circ. 1660-1800),
et
est
appelons
.ignificAtion,
des différents
types
(ou
ou
modes)
d'énoncés dont certains,
selon l'enseignement des linguistes et
philosophes
(1)
langues,
aspects
se rencontrent dans tout..
les
Les aspects illocutoires de la signification sont
ces
contemporains
de
la signification qui
déterminent
littérale d'un énoncé doit compter comme
question,
prédict i on,
requête,
si
l'énonciation
assertion,
ordre,
témoignage,
promesse, exclamation,
etc,
Ce travail pourrait porter en sous-titre,
de
paraphraser
l'histoire
des
"Un chapitre
de Chomsky (1966)
des théories de l'énonciation",
théories
anné es
celui
de
constitue
l'énonciation au cours
sans
doute un fait
Page 1
si on me
Le formidable
des
sans
trente
permet
dans
essor
dernières
précédent(2)
dans
l'histoire
des
sciences
du
langage.
travaux du
second Wittgenstein et des
Mais
bien
"philosophes
ordinaire" --- en fait depuis l'Antiquité ---,
les poéticiens,
les
été
à
sensibles
d'utilisation
de
avant
du
les
langage
les rhétoriciens,
logiciens et les grammairiens ont toujours
ces
"innombrables
tout ce que
nous
et
diverses
sortes
nommons
, signes' ,
, mots' ,
'phrases'." (Wittgenstein, Inv.stig.tions philosophiqu.s, paragr.
23) .
Les
exclamations, les interrogations, les requ@tes, et les
impératifs sont parfois des moyens tout indiqués pour un
qui veut émouvoir,
Dans
étonner,
un
passage
bien
Aristote
renvoie
à
amuser,
connu
Tr.it'
du
la rhétorique et à
d'étudier les énoncés non déclaratifs,
qui
ne
sont ni vrais
ni
interrogations,
etc.
mentionnent
énoncés
les
ou motiver un
faux,
d.
la
orateur
auditoire.
l'Int.rpr,t.tion,
poétique
la
c'est-à-dire les
comme
les
prières,
Traditionnellement,
non déclaratifs
les
que
tâche
énoncés
ordres,
logiciens
pour
mieux
ne
les
distinguer des énoncés déclaratifs, seuls porteurs des valeurs -de
vérité.
Les
philosophes grecs,
avaient
toutefois
développé
péripatéticiens
des
classifications
et
stoïciens,
des
"genres de discours" (ou types d'illocution) ou des l.kt.
les stoiciens).
Les grammairiens grecs et latins
Moyen
de la
âge
et
l'existence,
phrases
dans
Renaissance) ,
ne
toutes les langues qu'ils
interrogatives,
optatives,
divers
(chez
(comme ceux du
pouvaient
ignorer
connaissaient,
jussives
de
(impératives) ,
exclamatives, etc. Les comparatistes du XIX· siècle (M. Bréal, A.
Meillet,
XX·
H.
Paul,
K.
Brugmann,
etc.)
et les linguistes du
(O. Jespersen, G. Guillaume, Jakobson, Benveniste, etc.) ont
Page 2
bien sar discuté des modes verbaux et
des
modes d'énoncé,
mais
on ne trouve cependant rien dans leurs travaux qui approche,
par
l'ampleur
des
des
publications,
dans
le
recherches,
ce
cadre
la
qualité
et
le
nombre
qu'on a produit depuis une trenteine
des théories de l'énonciation et
des
d'années
actes
de
parole.
Je voudrais montrer, dans ce travail, que la réflexion des
grammairiens
énoncés
philosophes
non déclaratifs,
l'histoire
des
philosophes
tradition
théories
sont,
pour
au
sujet des
constitue
de
modes
un
verbaux
moment
l'énonciation.
une large part,
pour
la
description
Les
restés
des
place
modèles
dans un
vénérés
difficultés
de
contexte
la
fidèles
langues;
au
déjà
cadre imposé par la
en
créant
la
concepts
mais
science
grecque
et
leur
et
elle
médiévale.
des
Les
Renaissance
y
les langues vivantes résistant souvent
grammaire latine.
Les Modistes
montré une certaine indépendance d'esprit à l'égard
tradition
à
qui n'est guère respectueux
éprouvées par les grammairiens de la
ont sans doute contribué,
dans
grammairiens
interprétation de la tradition a quelque chose de neuf,
prend
des
important
gréco-latine en lui empruntant bon nombre de
théoriques
et
une
nouvelle
batterie
de
avaient
de
la
concepts
descriptifs, mais leur influence sur les grammairiens philosophes
est nulle ou très indirecte.
Les grammairiens philosophes furent
les premiers à faire un examen théorique des modes verbaux et des
modes d'énoncé en confrontant leurs notions et conceptions à
Page 3
une
variété
toujours
toutefois,
la
croissante de
plupart
langues
Julien,
(cf. ,
d'entr'eux se sont limités
1979) ;
aux
langues
indo-européennes et ce sont les comparatistes du XIX· siècle
entreprendront
langues.
cette
De toute manière,
modes
d'énoncé
largement
le capital
philosophes concernant
grammairiens
les
description pour les autres
repris
générations
d'idées
les
familles
légué
modes
par
par
les
suivantes
grammairiens
qui
n'y
ont
et
et
et
toujours
des
ajouté
grand'chose. Mieux : la théorie générale des modes verbaux
Grammaire
des
Générale
résultats
l'énonciation,
de recherche
des
classique
obtenus
"anticipe"
par
les
d'une
Grammaire Générale.
et
1 es structural i st es
clairement
actuelles
En
de
programme
fait, avant l'essor
manière décisive les
et de
L. Hjelmslev
traditionnelle"
ou
envers
"dépassé Il
théories de l'énonciation
proposées
les
n' avai ent
La méfiance de F.
catégories
"normative" est
de
de Saussure
la
"grammaire
pour beaucoup dans
peut-~tre
peu d'intérêt montré par les structuralistes pour les
verbaux,
la
ces catégories leur paraissant trop liées au
grammaire latine et impropres à la
familles
cadre
de langue que
fourni
or.tionis)
Priscien
(mais
par Denys de
déjà
parties
Thrace,
du
d'autres
particulier,
discours
Apollonius
en gestation dans les
Page 4
En
modes
paradigme
description
l'indo-européenne.
par le système des
légué
les
pas
par les grammairiens philosophes.
de
théories
de la
théories de l'énonciation voilà une trentaine d'années,
comparatistes
le
parfois
en dépit des limites que lui impose le
de la
fut
linguistes
pas
de
les
verbaux
est remarquable à bien des égards,
qui
écrits
(p.rt.s
Dyscole
de
le
et
Platon,
d'Aristote
et
linguistes
des stotciens),
importants
générales,
bien
fut rejeté par la
préoccupés
qu'il
de
plupart
questions
ait constitué le coeur de
des
thé oriques
la
tradition
grammaticale en Occident pendant presque deux millénaires.
Il ne
sera
indo-
plus
évoqué
que
pour le
traitement
des
langues
europé ennes .
Plus près de nous,
développée
par
la sémantique des conditions de
les philosophes avait très
énoncés
non
concept
de fore. illoeutoir. (il utilisait Kr.ft
mais
les
quelques
ordres(3)
passant.
plus
déclaratifs.
peu à dire
Frege fut sans doute à
pages qu'il consacre aux
ne font,
pour ainsi dire,
que celle du
constamment et insensiblement,
et
sémantiques),
ses
ses multiples emplois
avant
l'étude
tout
scientifiques
positivisme
surtout
qui
des
les
fit
logiques,
Reichenbach,
langages
beaux
idé es
traitement des modes verbaux et des
philosophie
du
langage
ordinaire
ses
non littéraux,
construits
à
qui
aux
fort
chez
types
etc.
C'est
des
fins
et
du
Russell,
et
intéressantes
le
évolue
divers
modes syntaxiques.
et
en
(syntaxiques
jours de l'empirisme
même si nous trouvons
des
et
à cette époque,
ordinaire,
vagues,
du
allemand),
questions
avec ses ambiguïtés
syntaxiques,
les
qu'effleurer le sujet
langage
expressions
sur
l'origine
en
L'étude des langages formels semblait,
prometteuse
vérité
courant
pour
le
C'est la
de
la
grammaire générative et transformationnelle qui allaient
imposer
une conception plus large de la compétence du locuteur:
on doit
Page 5
maintenant
des
tenir compte de sa capacité à produire et
énoncés
non
déclaratifs,
et
des
m~me
comprendre
énonciations
non
littérales.
"Commander, interroger, raconter, bavarder, appartiennent à
notre
"histoire naturelle"
jouer " ,
paragr.
écrivait
25) .
autant que
ne
d'ordres,
manger, boire,
Wittgenstein (Inv.stig.tions philosophiqu.s,
Un peuple parlant une langue sans phrases jussives
(impératives) ou interrogatives, un
qui
marcher,
poseraient
composé
d'individus
jamais de questions et ne donneraient jamais
un tel peuple
anthropologique .
peuple
serait,
A son tour,
semble-t-il,
Benveniste écrit,
une
à
bizarrerie
propos
des
"modalités de phrase" :
on reconnatt partout qu'il y a des propositions
assertives, des propositions interrogatives, des
propositions impératives, distinguées par des
traits spécifiques de syntaxe et de grammaire,
tout en reposant identiquement sur la prédication. Or ces trois modalités ne font que refléter
les trois comportements fondamentaux de l'homme
parlant et agissant par le discours sur son interlocuteur : il veut lui transmettre un élément
de connaissance,
ou obtenir de lui une information, ou lui intimer un ordre. Ce sont les trois
fonctions interhumaines du discours qui s'expriment dans les trois modalités de l'unité de phràse, chacune correspondant à une attitude du locuteur. ( .... ,
La
déduction transcendantale des forces illocutoires
primitives
présentée dans Searle et Vanderveken (1985) constitue elle
un
argument de poids en faveur de l'universalité des
Page 6
aussi
catégories
de la logique illocutoire.
de
On peut, en apparence, faire beaucoup
choses par le discours,
illocutoires
primitifs,
illocutoires
primitives
mais il n'y a au fond que cinq
auxquels
correspondent
cinq
à partir desquelles tout..
permet
forces
les
forces peuvent être obtenues par certaines opérations.
autres
C'est
d'obtenir ces cinq buts illocutoires primitifs.
vouloir
buts
On
la
peut
1°) représenter comme actuel un état de choses dans le
monde
(les actes assertifs);
faire
quelque chose
tentative
(les
2°) s'engager vis-à-vis d'autrui à
actes
engageants);
faire
pour que l'allocutaire fasse quelque chose (les
direct ifs)
faire en
sorte qu'un
état
de
une
actes
choses
existe
simplement en affirmant qu'il existe (les actes déclaratifs);
exprimer simplement ses émotions et
enfin,
attitudes
et
(les
actes expressifs). Dans toutes les langues humaines "dignes de ce
nom",
il
doit
indirectement,
constituent,
kinds)
possible
actes
d'accomplir,
illocutoires
directement
de
déclaratif et expressif.
pour
Found.tions of
verrons
des
directif,
engageant,
(n.tu~.l
être
ainsi
dire,
d'emplois du langage.
1110cution.~y
Logic,
type
assertif,
Ces
catégories
"espèces
des
(Cf.
1985,
naturelles"
Searle-Vanderveken,
chap.
3 et 9).
selon
conventionnellement
partout
diverses
Nous
bientet que les grammairiens philosophes acceptaient
principe de l'universalité de la pensée et que les modes
servent,
ou
d'entre
certains
des
et pour tous,
Act..
d.
p.n.'.
eux,
qui
à
le
verbaux
exprimer
sont les
m~mes
et selon d'autres grammairiens, à marquer
id ••• Acc •••oir..
indiquant les
Page 7
attitudes du locuteur
tout en modifiant ou supprimant l'assertion d'un jugement.
La
Grammaire
Philosophique classique se
Q'n'rAl. et rAisonnf..
et
le
9~n'r.l • • t
"les raisons
Grammaire
de
grammairiens
r.isonn'.
est
(1660),
dans
manifestaient
leur
les
la
mesure
clairement
donner
où
leur
La
les
souci
(cf., Chomsky, 1966, et Padley, 1985)
les normes que l'on se doit de suivre pour
bien qu'à la Cour;
célèbre
langues".
ne voulaient pas seulement décrire des faits de
donner
fois
(Lancelot
qu'ils veulent
toutes
rAisonnf.,
philosophes
d'AdfquAtion explicAtive
ils
en sous-titre à
ce qui est commun à
Générale
à la
Les grammairiens de Port-Royal
grand Arnauld) affirment,
8r •••• ir.
veut
langues
parler
et
aussi
au contraire, bien parler n'est pas seulement
parler selon l'usage et la tradition, c'est aussi parler selon la
Raison,
d'une
manière pertinente,
et les
faits de
langue
ne
deviennent intelligibles que si on les rapporte aux opérations de
l'esprit qu'ils sont censés exprimer et aux fonctions qu'ils sont
destinés à remplir.
Les langues humaines ne sont
du hasard et du caprice;
"rendre
compte"
linguistiques.
dans
la
où
et
le
fruit
autrement, il ne serait pas possible de
faits
de
langues
et
des
universaux
Grammaire Philosophique est aussi
La
mesure
substantiels
des
pas
elle
affiche
affirme
l'existence
clairement
ses
QfnfrAl.,
d'universaux
pré t ent ions
à
l'universalité
la Grammaire Générale est la grammaire qui donne
les
des
fondements
grammaires
particulières
Page 8
de
tout..
l.s
IAngu ••.
sont
conceptuelle
La pensée
les
mêmes
partout
l'expression de la pensée;
et
et les opérations de
pour
tous
et
c'est à cette fin
communication des pensées) qu'il fut
le
raison pratique.
"inventé"
Pour la première fois,
à
grammaire se fait raisonnée et générale.
latins,
est
par les humains.
l'oeuvre
l'~ge
de
la
classique,
la
Les grammairiens gréco-
ou les grammairiens médiévaux et les grammairiens latins
de la Renaissance,
l'universalité,
faits
de
affichaient
langue,
en
latin
considération
parfois aussi leur
et ils cherchaient,
aristotélicienne (15 )
faites
langage
(l'expression et la
langage est donc un moyen .n vu. d·un. fin,
Le
l'esprit
•
dans
Mais
sur le
d'autres
eux aussi,
le
cadre
presque
latin,
prétention à
à expliquer les
de
la
science
toutes leurs
analyses
rarement
prennent-ils
et
langues pour mettre
l'épreuve
à
sont
en
leurs
conjectures. Mais à la Renaissance et au XVII- siècle, les choses
changent
rapidement
c. ) .
M@me
si les
grammairiens
philosophes
classiques font rarement référence à des langues autres
europé ennes,
avec
eux la grammaire devient
vraiment
qu'indogénérale,
universelle.
Si nos grammariens philosophes voulaient expliquer ce qu'il
y
a
de
"commun à toutes
rencontrer partout,
les
langues",
ne
devaient-ils
eux aussi, ces diverses modalités de phrases
et essayer d'en rendre compte?
dont nous parlions plus haut,
si oui, où? dans quelle partie de la Grammaire Générale?
approches
furent
pas
développées
pendant les
Page 9
cent
Et
Quelles
cinquante
ans
au
cours
desquels
le
mouvement
de
s'épanouit en France et en Angleterre?
que
la
Grammaire
Générale
Que faisons-nous de mieux
les grammairiens philosophes en cette
matière?
Nos
jeunes
théories de l'énon6iation ont-elles quelque chose à apprendre
de
cent cinquante ans de Grammaire Générale? J'avais ces questions à
l'esprit
lorsque
j'ai abordé l'étude des
grammaires
générales
classiques.
Bien sQ.r,
nuit
sous
la
des questions de ce genre viennent
forme d'un songe insolitej
rarement
elles
sont
le
la
plus
souvent suggérées par l'état actuel de la recherche. Ce n'est pas
là un défaut d'objectivité,
historique, sa condition,
t~che
mais plutôt le nerf de la
son point de départ et d'arrivée.
de l'épi stémol ogi e hi st orique" ,
déterminer
recherche
écrit M.
le sens que des connaissances passées
Auroux,
"est de
peuvent
"Ce que nous pouvons connattre d'une connaissance
est la plupart du temps le résultat d'une inférence,
de
départ
de
cette
connaissances." (Ibid.,
exactitude
nous
avoir
Et plus
pour nous".
loin
de
inférence
p.
c'est
12) .
l'état
passée
et le point
de
nos
Nous ne pouvons prévoir
avec
quelle direction prendra demain
pouvons
avenues
"La
la
actuel
recherche,
tout de m@me dresser une carte assez
recherche déjà parcourues.
Ce qui
précise
n'est
pas
mais
des
sans
intérêt pour les chercheurs actuels, tantôt parce qu'ils désirent
voir
leurs intuitions confirmées par les grandes autorités
Page 10
d'un
passé
plus
ou moins lointain (un peu à la manière
1966, ou Vendler, 1972),
passées
de
tant8t pour découvrir dans les
des énigmes oubliées ou des problèmes que
pour
y
découvrir
thé oriques,
d'exemples,
un
bric
oeuvres
théories
nos
doivent résoudre sous peine d'inadéquation empirique,
simplement
Chomsky,
brac
ou
encore
de
concepts
d'analyses et de procédures,
qui n'ont
à
peut-@tre pas dit leur dernier mot ...
Pour ma part, je fus d'abord frappé par certaines analogies
entre
le
programme de recherche de la Grammaire
celui de la Théorie des Actes de Discours.
acte.
p.n.'.
d.
illocutoires
d'énormes
accomplis
de
de
la
Grammaire
Générale
Bien sar,
Générale
et
la Théorie des Actes de Discours,
changements
(qu'on
songe
seulement
entre
les
actes
il Y
a
ont
l'universalité
un
fort
caractère
(contre la
particulièrement
les
Mais les deux programmes de recherche sont
•
priori,
et
les
"sens
prétendent
à
"relativité linguistique").
Les progrès accomplis par l'historiographie
et
eu
progrès
aux
"mentalistes", font une large place à la rationalité et au
commun l l ,
les
par la logique après Frege et Russell ... ) et nous
marquerons avec soin .
et
mises
en
garde
des
des
sciences,
historiens
conventionnalistes (Kuhn, Foucault, Feyerabend, etc.), ne peuvent
plus @tre ignorés,
comme le souligne aussi avec force M.
Page 11
Auroux
(ibid., p. 12). Un projet comme le mien éveillera sans doute
certaine
méfiance pour les historiens sensibles au
n'implique-t-il
entre
des
pas
fragments de théories élaborées
épi stémiques
("paradigmes Il ou
deux siècles?
"épi stèmè Sil)
problème
des
. dans
une
de
comparaisons
des
contextes
séparés par près
de
Mais comment évaluer autrement une théorie passée,
comment déterminer et indiquer ses lacunes, ses limites, sinon en
montrant qu'elle n'arrive pas à faire ce que font nos théories ou
qu'elle
échoue
empirique?
à satisfaire
Nous
méthodologiques.
certains
reviendrons
critères
bientôt
d'adéquation
aux
considérations
Je voudrais tout d'abord préciser l'objet et le
but de cette étude.
***
Les
modes verbaux sont familiers à
fréquenté la petite école.
six
quatre
conditionnel
et
Le français,
par exemple,
subjonctif),
et
deux
n'en
ont
impératif,
le chinois n'a
le grec ancien a
pas,
à
modes
Ainsi, le grec et le
un
a deux subjonctifs alors que l'hébreu et
pas,
en compte
Mais la nature et le nombre des
n'ont pas de conditionnel,
l'allemand
ayant
imp.rsonn.ls
modes
peuvent varier d'une langue à une autre<?').
latin
personne
(indica tif,
modes
(infinitif et participe).
toute
proprement
le
optatif,
suédois
parler,
de
flexions verbales pour les modes, et des grammairiens discutaient
encore
récemment
sur
la
reconnaissance
Page 12
d'un
prétendu
mode
"présomptif en roumain
CIiI
).
Presque toutes les grammaires philosophiques( 9
classique,
de
(la Sr •••• ir. g'n'r.l.
Port-Royal
[1660] inaugure le mouvement)
de l'époque
)
.t
r.isonn',
à Destutt de Tracy
est de 1803), contiennent une théorie gjnjral. des modes verbaux.
C'est
dans
le
philosophes
relat ives
cadre
de cette
classiques
ont
à la syntaxe
sémantique
que
les
grammairiens
abordé
la
plupart
des
questions
(thé ori e de
la
"e onstruct ion") ,
à la pragmatique des énoncés djclaratif.
et
djclaratif..
théorie
En effet,
n'hésitaient
pas
la plupart des grammairiens
parler
à
ou
de
modes
conc.ssif,
non
et
philosophes
int.rrog.tif,
verbaux
même si
à la
aucune
flexion
verbale ne leur correspond dans les langues qu'ils connaissaient.
Les linguistes contemporains qui s'intéressent à la question (par
exemple
doit
Zaefferer C10 »
mod..
de faire entre les
conditionnel,
et
insistent sur la distinction que l'on
promissif,
etc.),
optatif,
plusieurs
"optatif"
d'énoncé).
tandis
d·jnoncj
même
points
désignant
Les
modes
si
pris
impératif,
bien
un
mode
verbaux relèvent
de
exclamatif,
recoupent
verbal
la
(s,nt.nc • • oods,
en
qu'un
mode
morpho-syntaxe,
S.tz.odi)
en charge par l'une ou l'autre
Page 13
jussif,
jussif-impératif,
(indicatif-déclaratif,
aussi
ou
interrogatif,
les deux catégories se
que les modes d'énoncé
habituellement
impératif
(déclaratif,
déprécatif,
dubitatif,
(indicatif,
optatif, infinitif, participe, etc.),
subjonctif,
mod..
les
v.rbauM
se
des
sont
trois
disciplines de la célèbre tripartition de Morris (1938).
la distinction mode
maintenue,
de
ces
d'énoncé
comme le veut Zaefferer,
deux notions
premiers
Dyscole)
doit @tre strictement
le développement historique
montre à quel point elles sont
D'après Nuchelmans (1973),
1 ié es.
des
verbal/mode
Mais si
intimement
la théorie des modes
grammairiens grecs (Denys
s'inspirerait directement,
de
Thrace,
verbaux
Apollonius
du moins en ce qui a
trait
aux modes personnels,
des classifications des modes d'énoncé
(ou
"genres de discours")
avancées par les
et
les
entre
les
stoïciens
modes
(11
)
•
De plus,
de nombreuses
péripatéticiens
"confusions"
verbaux et les modes d'énoncé sont survenues au
cours
de
l'Antiquité et du Moyen âge, chez des auteurs aussi influents que
Martianus
Capella,
d'Espagne C1 : 2 )
,
Boèce,
Guillaume
de
Sherwood
et
Pierre
et les recoupements signalés plus haut entre
les
deux catégories sont probablement la source de ces confusions.
Je voudrais, dans cette monographie,
montrer l'originalité
du point de vue adopté par les grammairiens philosophes dans leur
théorie
générale des modes verbaux:
nécessité
de
tout en
recourir à des critères
formels
reconnaissant
la
(morphologiques)
pour identifier un mode particulier dans une langue particulière,
les
grammairiens
théorie,
marquer
d'fnonc'
le.
et
philosophes
soutiennent
peuple. auraient pu,
par
ailleurs
.'ils l'Avaient JUQ'
qu'en
utile,
distinguer formellement toute la v.ri.t.
d..
mode.
par des fl.xions verbal •• carAct'ristiqu•••
Les
modes
Page 14
verbaux et les modes d'énoncé ne sont, pour l'essentiel, que deux
m~me$
moyens, différents mais équivalents, d'atteindre les
exprimer
linguistiquement
op'rAtions
différentes
l'interrogation,
doute,
la
de
l'esprit),
le commandement,
concession,
Acte.
différents
la
de
tels
modes
d'énoncé
(ou
le désir (ou le souhait),
prière,
verbaux po •• ible. que de
C'est pourquoi,
pen.'e
l'affirmation,
etc. ,
etc.
grammairiens philosophes affirment qu'en théorie,
de
fins
modes
le
Plusieurs
il y a
autant
po •• ible •.
d'énoncés
dans la Grammaire Générale classique,
les modes
ou types d'illocution sont presque toujours traités
au
chapitre des modes verbaux.
Par ailleurs,
les
assimiler
(infini tif) ,
les grammairiens philosophes ont tendance
impersonnels
modes
soit aux adjectifs (participe).
modes d'énoncé aux modes verbaux,
substantifs et adjectifs,
avoir
soit
aux
à
substantifs
En assimilant
les
et les modes impersonnels
aux
les grammairiens philosophes
semblent
placé simplement sous la catégorie traditionnelle du
mode
verbal les questions relatives aux modes d'énoncé, déclaratifs et
non
déclaratifs.
d'énoncé dans la
modes
théories
à
celui
délimite
tendance
(inclure
un objet
qui
l'énonciation.
nous
de
La théorie
les
modes
en exclure les
modes verbaux et
de la théorie des actes
actuelles de
et la
double
catégorie des
impersonnels)
semblable
parole
Cette
paraît
parole
des
et
fort
des
actes de
théorie générale des modes verbaux de la Grammaire
Générale visent au fond la même cible : rendre compte des Aspects
Page 15
illocutoir •• d. lA siQnification,
littérale
compte comme une assertion,
M~me
etc.
une question,
un
d'act.
d. p.n.'.,
nous verrons
d'op'rations
et celui
l'e.prit développé tardivement par les co •• on s.ns.
écossais,
ou
la
grammairiens,
d'id'.
notion
acc •• soire
que
le
social.s
d.
philosoph.rs
pour
certains
remplissent à peu près les mêmes fonctions dans la
Grammaire Générale.
D'autre part,
dans la théorie des actes de
parole
de
(1988) ,
les actes illocutoires ne sont pas seulement des
Searle-Vanderveken (1985)
fondamentales
sont
aussi
Y
Il
en
a,
effet,
un
grand
Vanderveken
unités
senti
ils
la
pensée
nombre
.n p.ns'.
significatif que les grammairiens
finalement
d'actes
s.ul ••• nt.
philosophes
Il
aient
le besoin d'élargir la notion d'acte de pensée
(les soci.l op.r.tions .of th • • ind
compte
surtout
considérés comme des unités de base pour
illocutoires qui peuvent être accomplis
paratt
et
de communication dans les langues humaines
conceptuelle.
me
ordre,
si les grammairiens philosophes ne disposaient pas des
d'acte et de forc. illocutoir •• ,
concepts
concept
ce qui fait qu'une énonciation
également
des
accomplis par des
actes
êtres
Thomas Reid)
de
parole
de
solitaires,
qui
ne
pour tenir
peuvent
comme donner un
être
ordre
ou
adresser une requête; mais il n'est pas moins significatif que la
théorie des actes de
du
sociaux
langage,
discours,
aux
d'abord si attentive aux aspects
institutions
et
aux
qui
règles
déterminent si l'accomplissement d'un acte de discours est réussi
ou
non
dans tel ou tel contexte,
considérer
les
conceptuelle,
en soit
finalement
actes illocutoires comme des
car
nous
pouvons
Page 16
accomplir
unités
venue
à
de
pensée
certains
actes
illocutoires
.n
sans
intention
de
communication, comme des assertions, des questions, des promesses
(comme
les
pourrait
résolutions) ,
etc.
Mon
donc se formuler ainsi
hypothèse
1. mode du
de
verbe
constitue,
m~rqueur
la principal
force illocutoire.
travail
da
Plus précisément, le mode du verbe indique le
but illocutoira d'une énonciation,
car des énonciations marquées
par le m@me mode peuvent avoir des forces illocutoires distinctes
une
illocutoire
prédiction
et
et
un
le m@me mode
témoignage
verbal
ont
le
m@me
l'indicatif;
de
but
m~me,
l'impératif peut servir à exprimer un ordre, un commandement, une
prière,
une
concession,
etc.) .
Plusieurs raisons militent
faveur de cette hypothèse et nous
en
aurons maintes fois l'occasion
d'y revenir.
La
Grammaire Philosophique
"idéationnelle" du langage(13) ,
c'est-à-dire une théorie
classique
une
thé orie
selon l'expression de W. Alston,
"mentaliste"
langue en les rapportant à des
est
qui explique les faits de
opérations de l'esprit,
telle la
conception, qui produit les idées ou concepts, et le ju;ement
les autres actes de pensée ou "mouvemens de l'ame").
de cette conception est clairement
seconde
partie
de
la 8r •••• ir.
formulé
au
Le principe
tout début de la
de Port-Royal
Qu. la connoiss.nc. d. c. qui s. p.ss. dans
nostr• • sprit, .st n'c.ss.ir. pour co.pr.ndr.
l.s fond ••• ns d. la 8r •••• ir.' & qu. c'.st d.
Page 17
(et
l i qu.
d'p.nd 1. div.rsit' d.s .ots qui co.pos.nt 1. discours
(p. 26; en italiques dans
le texte) .
Et Condillac, un siècle plus tard
Puisque les mots sont les signes de nos idées,
il faut que le systême des langues soit formé
sur celui de nos connoissances.
Les langues,
par conséquent,
n'ont des mots de différentes
espèces, que parce que nos idées appartiennent
à des classes différentes;
et elles n'ont des
moyens pour lier les mots,
que parce que nous
ne pensons qu'autant que nous lions nos idées.
(8r •••• ir., 1775, p. 433 dans l'édition de G.
Le Roy) .
Mon but est de reconstruire l'idée d'une .6m.ntique id6.tionnelle
de.
mode.
d~6nonc6,
grammairiens
telle
philosophes,
qu'elle
fut
développée
et d'en évaluer les
par
limites.
les
Et
la
théorie générale des modes verbaux constitue, comme on l'a vu, le
coeur de cette
peut parattre
pour
la
comme
sémantique idéationnelle des modes d'énoncé.
étrange de parler d'un sémantique
thé ori e
juger,
des
vouloir,
"act es de pensé e"
cons idérant des
act es
des
représentations à la différence de ces actes qui ne semblent
pas
être;
etc. ,
"idéationnelle"
car les idées sont
en
dé sirer,
Il
mais cette assimilation des actes de pensée aux
est autorisée par Descartes lui-même :
ou craignons,
le
savons
lorsque que nous
le
volonté
ou
de
une idé e étant, pour Descart es, "tout ce qui est
conçu immédiatement par l'esprit" (cité par
36) ;
voulons
nous savons que nous voulons ou craignons, et nous
parce que nous avons l'idée de cette
cette crainte,
idées
Dominicy,
vouloir et la crainte sont donc mis par
Page 18
1984,
Descartes
p.
"au
nombre des idées"
(ibid.).
***
L'histoire
cours
des
des sciences du langage a changé de
vingt
dernières
années.
Depuis
la
visage
au
parution
de
jamais les
du
langage
et les linguistes n'ont manifesté
pour l'histoire de leur discipline.
la période couvrant les XVII- et
fort
riche
XVIII-
pour l'histoire des sciences du
un
très
lexicographes,
siècles,
langage,
vaste ensemble comprenant
philosophes, logiciens, grammairiens,
pédagogues, etc.
d'intér~t
autant
Cela est vrai en particulier
pour
représente
philosophes
des
rhétoriciens,
période
car
oeuvres
elle
de
poéticiens,
Cet ensemble, si vaste soit-il,
est maintenant beaucoup mieux connu(14), et les jugements sévères
(parfois
teintés de mépris)
portés à l'égard de
la
"grammaire
traditionnelle" ou de la "linguistique préscientifique"
par
les
comparatistes,
et
les
structuralistes,
ne
doit
les
sanskritistes,
les
philologues
demandent aujourd'hui à être nuancés, lorsqu'on
pas carrément les ranger parmi les préjugés
dénués
de
fondements C1S ) .
L'histoire des sciences du langage,
depuis le
milieu
des
années soixante, a grandement profité du renouvellement des idées
survenu
en historiographie des sciences au cours
Page 19
des
dernières
décennies.
On
distingue
historiographie
des
sciences<16>
L'histoire
l'inductivism.,
des sciences fut
selon la première de ces deux tendances,
comme
une
d'abord
un
données par
faite
science
ensemble
induction.
aux XVIII- et
historiens des sciences,
en
le
et
qui conçoit la
collection de données objectives et
théories solidement fondées sur ces
premiers
extr~es
quelquefois deux tendances
XIX-
de
Les
siècles,
étaient surtout sensibles aux progrt. des "lumières", aux progrès
accomplis
sur
le plan de la
vérité
objective.
Galilée,
Descartes, Huygens, Képler et
célébrés
pour
d'autre
part,
Ilcontes
de
bonne
conceptions
savoir
celles
des
et
ou
en
classique
volontiers
femme "
(et
plus
comparant
les conceptions et
les évaluaient et les
ressemblaient
alors
à
pr6jug6
(Bacon,
mythes,
façon
"progéni t ure" .
cumul
cesse
à
jugés
étant
passées
historiens
L'histoire
un
l'importance
savoir
en
d'inventions
voie
de
qui
totalisation,
leurs
leur
de
s'ajoutent
l es
des
savoir
du
La croissance du savoir y est représentée
de découvertes ou
avec
inductivistes
une
selon
du
significative.
théories
jugeaient.
les
l'évolution
admis par les membres de la communauté scientifique,
prédécesseurs
mais
"idé ologie") ,
retardé
d'une
savoir;
erreurs,
tard
théories passées ayant
au
du
comme
de leurs contemporains que les
sciences
un
philosophie
Copernic,
Newton étaient justement
durables
n'y ayant pas contribué
sciences
déjà
la
contributions
rej etait
Descartes)
C'est
leurs
Les
comme
sans
thé ori es
nouvelles, pourvues d'un excédent de contenu empirique corroboré,
absorbant ce qui, dans les théories plus anciennes, était vrai ou
Page 20
près de la
et
la
vérité.
science,
manifestent
en
L'histoire est,
une
balle
général peu
de
neige ...
d'intér~t
externes concernant, par exemple,
pour ainsi dire, une pente,
Les
pour
inductivistes
certaines
la vie des
questions
institutions ou la
sociologie de la recherche, et pour les conceptions métaphysiques
ou
religieuses
des chercheurs.
Grammaire Générale,
cette
de
comme Sahlin (1928) et Harnois (1929)
compter Thurot (1796)),
de
Les premiers historiens
tendance.
peuvent
~tre
la
(sans
vus comme des représentants
L'historiographie
inductiviste
permettre une meilleure appréciation des théories
devait
actuelles,
en
donnant la mesure du chemin parcouru.
Les travaux de Duhem, puis Koyré, Kuhn, Feyerabend, Foucault
et
plusieurs
cette
autres ont montré ce qu'il y avait
première
cohérence
approche.
interne
métaphysique
et
et
Les
inductivistes
l'arrière-fond
naif
dans
négligeaient
philosophique
religieux) des théories
(cf. Koyré, 1966/1973, p. 322);
de
scientifiques
(ou
passées
et pour évaluer les résultats de
ces mêmes théories, ils n'hésitaient pas, nous l'avons vu,
comparer
par
directement avec ceux obtenus dans les
leurs
contemporains,
signification
comparaisons
élaborées
des
naives
des
domaines
l'invariance
à travers
fragments
m~mes
le
isolés
à les
de
temps.
de
la
Ces
théories
des
contextes épistémiques différents et à
des
époques différentes,
sont aujourd'hui reçues avec méfiance.
Les
historiens
dans
en présupposant
termes théoriques
entre
la
"conventionnalistes"
des
Page 21
sciences,
depuis
une
trentaine d'années,
nous ont plus d'une fois mis en garde contre
comparaisons
ces
en
insistant
et
(holism.) les
"gl obal ement"
~ge
,
t~chant
en
éléments,
m8me
Dans
cette
n'est
pas
décrire
sur
la
nécessité
d'interpréter
théories scientifiques d'un
ceux qui nous semblent
la
de
problème
t~che
aujourd'hui
de l'historien
faire la généalogie du
savoir
autre
tous
"farfelus".
des
actuel,
sciences
de
ou reconstruire le contexte épistémique ("paradigme"
ou
le sol limoneux dont se nourissent les théories
les traditions de recherche d'une époque
aujourd'hui
quelque chose de beaucoup plus vaste
En
théorie.
8tre
histoire des sciences du langage,
considéré
comme
un
représentant
et
L'uni té
particulière.
description fondamentale en historiographie des sciences
peut
les
mais
"épistémè") ,
de
le
d'y intégrer d'une manière cohérente
perspective,
de
sur
est
qu'une
simple
Foucault
(1966)
de
tendance
la
conventionnaliste.
Mais
conventionnaliste
ont aussi leur
l'historiographie
par
accomplis
progrès
ces
contrepartie.
Peut-on
encore
parler d'un
"progrès" scientifique réalisé au cours des siècles?
L'histoire
des
"révolutions
mesure?
sciences
scientifiques"
Sommes-nous
chaque
peuple
a
s.
ou
de
qu'une
époque ayant
culture,
s.
science,
originale
Page 22
succession
"paradigmes"
irrémédiablement condamnés
chaque
épistémologique,
n'est-elle
et
sans
au
de
commune
relativisme
un peu
comme
incomparable?
L'adoption
d'un
scientifique
nouveau
"paradigme"
n'est-elle
irrationnelle,
rien
par
d'autre
une acculturation,
une
qu'une
un saut dans
communauté
"conversion"
l'inconnu,
une
mode?
Certains critiques
D. Shapere [1966])
du conventionnalisme
(en
particulier
ont toutefois semé le doute quant à l'ampleur
des phénomènes liés à l'incommensurabilité, comme les changements
de significations des mots lors des révolutions scientifiques. Le
mot
"planète",
par
"signification"
exemple,
(comme
ne
change
le prétend
Kuhn
pas
forcément
[1962]),
parce que son extension a changé lors du passage du
simplement
géocentrisme
à l'héliocentrisme; le mot exprime toujours le m8me concept,
s'il
ne s'applique maintenant plus au Soleil et à
comprend la Terre dans son extension.
tout,
des
la
Lune,
fausseté
tendances
tout en
je
viens
de
évidemment des cas extr8mes.
rarement
reconnaissant
des
décrire
inductivistes ou des
brièvement
des
sciences du
Agassi).
langage
succès
il
me
semble,
les
défauts
la
(en
sont
"purs et
Récemment,
particulier
Auroux (1979) et Dominicy (1984)) ont cherché à éviter,
certain
vues
représentent
conventionnalistes
dirait
historiens
et
Ces deux
Les historiens des sciences
durs"
certains
catégoriquement
(ou l'inadéquation empirique) du géocentrisme?
que
m~me
Et puis, ne peut-on, après
admirer l'imagination théorique et la profondeur des
précoperniciens
de
avec
respectifs
un
de
l'inductivisme et du conventionnalisme. La nature de mon objet et
Page 23
les
buts
sens.
que je me suis fixé m'obligent à aller
Car, d'une part,
~tre
du verbe, de la proposition, du jugement,
conjonctif "que",
pratiquement
l'ensemble
m~me
le
la théorie générale des modes verbaux de
la Grammaire Générale classique ne peut
du
dans
reconstruire
du
"programme
et
de
etc. ,
exposer
à
théories
des idées accessoires,
de la construction,
à
isolée des
ce qui
oblige
systématiquement
recherche"
des
grammairiens
philosophes, selon le voeu des conventionnalistes.
D'autre part,
comment évaluer critiquement ce que
"sémantique
idéationnelle
j'ai
appelé
haut
la
jamais
la
avec des théories
de
des modes d'énoncé"
d'une manière ou d'une autre,
l'énonciation plus récentes et plus riches,
plus
sans
comme la théorie des
actes de discours, à la manière des inductivistes?
L'historien des sciences a de plus le
dans
son
métalangage
théoriques,
des
conceptuelles,
il
étudie
les
descriptif,
procédés
des
d'analyse
textes<17).
théories passées.
de
l'exploration
termes et des
ou
Si on
d'autres
prend bien
on peut alors
concepts
ressources
Par exemple,
logique
illocutoire
des
textes,
pour la
ou de fragments de théorie,
théories
passées.
Les
compter sur des
pour
comme
présentation
de
certaines
ou pour l'évaluation
catégories de la
Page 24
de ne pas
j'utilise à l'occasion les
la
théories
soin
reconstruire et présenter
outils parfois précieux pour explorer,
catégories
d'utiliser,
qu'ignoraient tout à fait les auteurs passés dont
confondre l'ancien et le nouveau,
les
loisir
théories des
des
actes de
discours peuvent en effet fournir des indications précieuses pour
notre travail
quoi être
elles disent,
attentif .
d'accomplissement,
Les
pour ainsi dire,
notions de
où regarder,
but illocutoire,
de condition préparatoire,
de
de
à
mode
condition sur
le contenu propositionnel, de condition de sincérité, de degré de
puissance
ou
désignent
des
d'un
acte
de
direction
d'une
d'ajustement
facteurs ou des dimensions
de discours auxquels
les
de
énonciation
l'accomplissement
grammairiens
philosophes
sont souvent sensibles dans leur théorie des modes verbaux et ils
en tiennent compte de différentes façons;
mais les propos qu'ils
tenaient en ces matières ne pouvaient guère sembler novateurs
intéressants
(1929) ...
un
<1.).
à des historiens comme
La
théorie des
Sahlin (1928) et
Harnois
actes de discours nous
fournira
arrière-fond pour l'évaluation des théories avancées par
grammairiens philosophes
De la même façon,
des
(1957),
Popper (1967),
(1971),
Harsanyi (1976),
pour
travaux
identifier et
contemporains sur
Watkins (1970),
Kasher (1976),
reconstruire
la
ration&litj
Rawls (1971),
Elster (1979),
une théorie de la
et du choix rationnel, commune aux rationalistes,
et aux
"philosophes du sens commun",
dans les théories classiques
langues,
et
sur
les
<1.).
je me suis largement inspiré à
moments
et
sur
(Simon
Richards
etc.),
rationalité
aux empiristes
et qu'on trouve à l'oeuvre
l'origine
l'utilisation du langage.
Page 25
certains
et l'évolution
Je rejoins
par
des
là
Aarsleff qui soutient
que
pour
être
grammairien
il suffit d'être
"rationaliste"
plus
ne le font généralement les
large
que
philosophie)
la
(en prenant le mot en
un
historiens
sens
de
la
En acceptant l'hypothèse d'une telle théorie de
(20)
rationalité,
nombre
philosophe,
on parvient facilement à reconstruire un
de stratégies d'explication des faits de langue
grand
dans
la
Grammaire Générale.
C'est une façon de faire qui comporte de nombreux risques,
j'en
conviens.
Mais
ce
(Rn •• ndung)
l'ApplicAtion"
que
Gadamer
(21)
ne
appelle
constitue
"le problème de
pas
seulement
un
obstacle à l'objectivité en histoire dont il faudrait à tout prix
limiter les effets.
L'application est une dimension
de l'herméneutique historique.
un sens
"ancien"
L'historien se doit
aux conditions de
un
essentielle
secteur
son
époque.
particulier
d'"adapter"
La
recherche
historique,
sur
de
l'activité
scientifique,
est forcément déterminée par l'état général de
la
recherche au moment où l'enquête historique est entreprise. Notre
appréhension première des documents historiques est déterminée
coup
sÜr
par l'état de notre savoir;
c'est de
ce
savoir
surgissent les questions qui orientent la lecture des
qui
nous
problème
examinées
fond
rendent
plut8t
davantage
qu'à tel
sensibles
autre,
plutôt qu'à tel autre,
à
au
tel
etc.,
Page 26
des
de
parfois
tel
théories
et c'est encore sur
de ce savoir que certaines analogies,
que
documents,
traitement
aspect
à
le
frappantes,
parfois trompeuses, entre nos entreprises théoriques et celles de
nos ancêtres,
deviennent sensibles,
gare
qui se croit capable de faire le
celui
à
étranger
simplement
prennent du
parce qu'il connait bien
relief.
guide
son
Mais
en
pays
patelin!
M.
nous fait voir
le
ridicule d'"un anthropologue qui,
d'une
peuplade
manipuler des figurines,
jouent à la poupé e" ...
bric
brac
à
considérer
voyant certains
de
vieilleries
théoriques
que
proposition
qu'ils
l'on
par
pourrait
proposition.
personne ne peut observer le cours de l'histoire
du point de vue de Sirius et l'interprète,
ne commence jamais à partir de zéro;
collège,
conclurait
On ne doit jamais céder à l'illusion d'un
concept par concept,
Chose certaine,
en
individus
à l'un ive r s i té,
comme dit
Heidegger,
ce qu'on lui a enseigné, au
correspond le plus souvent à ce
qu'il
estime être "la meilleure explication" de tel ou tel phénomène, à
moins
qu'il
Feyerabend,
parmi
ne
un
n'hésitant
d'autres
l'historien,
soit
et
(:2:2)
conventionnaliste
radicale
pas à faire de la science une
Mais
il y a
plus.
La
la
à
idéologie
méthodologie
tous les instruments conceptuels qu'il
de
utilise
dans son métalangage, lui sont également fournis par le savoir de
son époque.
Il suffit de lire et comparer,
(1928) et Harnois (1929),
pour
s'en
relativement
convaincre
par exemple,
Sahlin
avec Auroux (1979) et Dominicy (1984),
rapidement.
de
Gadamer,
à l'interprétation de documents scientifiques
d'un
passé plus ou moins lointain, n'est pas un défaut d'objectivité
c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'histoire des sciences comme
discipline, c'est ce qui fait qu'elle peut être autre chose qu'un
Page 27
simple
divertissement
pour
des érudits en
savantes et d'exotisme intellectuel.
l'étude des théories passées comme
mal
de
Ce n'est pas en considérant
l'autopsie de
peut le mieux apprécier ces théories;
cadavres qu'on
c'est en les
int.rpr.tAtion. chAritAbl...
et en pratiquant des
curiosités
questionnant
Je rejoins M.
Auroux lorsqu'il écrit
Actuellement, la stratégie la plus efficace
parait la concentration sur quelques questions bien localisées.
Je veux dire qu'il
faut pratiquer une histoire "hypothéticoconfirmative",
aborder les documents avec
des questions précises à résoudre. C'est au
reste la seule façon d'avoir une histoire
dont le progrès ne soit pas réduit à l'accroissement (indispensable) de la documentation".
('IL' histoire de la linguistique",
dans L.nga. fr.nç.is., déc. 1980, p. 15).
Comment
reconstruire et présenter cent
Grammaire Générale?
dans
la
Le corpus dont j'entreprends la
première partie de cette
plus importantes
cinquànte
au XVII- et surtout au XVIII- siècles (de
Destutt
de
autant
que
pour fixer les bornes).
possible aux ouvrages
Géné raI e" ;
mais
grammairiens
Grammaire Générale,
philosophes
d'autres
pertinents
pour
notre
ouvrages,
les
et
seront
de
à
limité
comme
comme
principes
dictionnaires,
enquête
Page 28
suis
par exemple) écrites
selon
des
Port-Royal
identifiés
ou des ouvrages de rhétorique,
les articles de l'Encyclop'di.,
aussi
Je me
clairement
grammaires particuli.r •• (du français,
des
description
écrites en français et en
anglais
"Grammaire
de
étude comprend la plupart des
grammaires générales
Tracy,
ans
de
les
par
la
logique,
etc. ,
utilisés
sont
à
l'occasion.
le
Le choix des dates (1660-1803) , correspond, comme on
sait,
aux
,..iso",,',
de
tradition
dates
de parution de la
Lancelot et du grand
recherche
de
de
de la
Destutt
8,. ••••
Arnauld,
Grammaire
de Tracy,
i,..
g,,,,,..l.
.t
qui
inaugure
la
Générale,
la dernière
et
du
de
genre
la
dont
l'envergure et l'originalité soient incontestables.
La
qu'on
reconstruction
du mouvement de la
Grammaire Générale
lira dans cette première partie s'inspire largement de
m6thodoloQie
de.
Lakatos( 2 3 ) .
Les notions d'heuri.tiqu. n6Qativ. et d'h.uristiqu.
positiv.,
et
protection,
proQramme. de
surtout
celles
recherche
.ci.ntifiqu.
la
de noyau dur et
d'Imre
c.intur.
de
me semblent particulièrement bien adaptées aux
de l'enquête que je poursuis,
garanties
contre
les
progressif
ou
le
dans
philosophes
de
P,.og,..ssiv.
la
programme
n'est pas le fait d'une conversion
désidérata
l'ordre
théorie de
rejet d'un nouveau
d'un entêtement de vieux bouc),
des
une
les
Elle fournit de plus une
croissance du savoir en termes de
p,.obl •• shift,
(l'adoption
respectifs
défauts
l'inductivisme et du conventionnalisme.
explication de la
fins
et la méthodologie de Lakatos pour
l'historiographie des sciences est peut-être celle qui offre
meilleures
d.
rationalité
de
recherche
irrationnelle
ou
tout en respectant un bon nombre
conventionnalistes.
l'énorme production
Elle permet
littéraire
des
et d'expliquer la diversité de leurs
Page 29
de
mettre
de
grammairiens
préoccupations
pour
des faits de langue qui dépassent quelquefois largement
cadre
de la Grammaire Générale
l'analyse
des
Olé léments
grammaticalement") ,
l'ordre
naturel
comme
des
mots
"proprement dite"
de
la
la
synonynie,
(ellipse,
traduction, l'origine des langues ...
donc
la
(limitée
proposition
la
scientifique.
à
considérée
non-littéralité,
inversion,
etc.) ,
la
La première partie présente
Grammaire Générale classique en tant que
recherche
le
programme
Cette brève présentation du
de
mouvement
de la Grammaire Générale est avant tout une analyse interne : les
questions externes (considérations sociologiques,
les
querelles de priorité,
les influences et filiations,
n'occuperont pas une bien grande place.
seront
peut-être
biographiques,
déçus,
etc .)
Les amateurs d'anecdotes
mais je crois
qu'en
accordant
plus
d'attention au noyau dur de la Grammaire Générale et à
certaines
de
parvenons
ses
hypothèses
ou
théories
auxiliaires,
nous
rapidement à l'essentiel et préparons suffisamment le terrain
et
l'arrière-fond
ce
pour
la seconde et la troisième
travail.
Dans ma présentation,
"statique"
des
notions
(qu'on
protection"
au
déc larati f)
de
peut
j'ai plutôt favorisé
"noyau
exposer
détriment
de
parties
dur"
dans
l'aspect
et
un
de
de
l'aspect
"ceinture
discours
"dynamique"
de
de
type
des
deux
"heuristiques" correspondantes (négative et positive), qu'il vaut
mieux,
forme
je pense,
exposer dans un langage de type directif (sous
d'instructions).
Je
n'ai pas
cherché
à
découvrir
des
documents jusqu'ici ignorés par l'historiographie de la Grammaire
Générale,
et
en
d'interprétation
ce
sens,
mon travail en est
un
avant
et il repose sur bon nombre de travaux dont
Page 30
tout
il
est redevable, en particulier ceux mentionnés dans la note
La seconde partie
portera
exclusivement sur
générale des modes verbaux et des énoncés non
la
(14)
théorie
déclaratifs.
Elle
se divise en deux sections de cinq chapitres chacune,
parce
je
des
distingue
deux
approches concurrentes au
verbaux dans la Grammaire Générale classique,
sujet
modes
deux approches que
j'ai baptisées en m'inspirant de Shalom Lappin (1982)
la première (exposée dans la section I),
Selon
(24).
les modes du verbe sont
des
différents servent à exprimer littéralement différents
pensée (jugement,
autres
doute,
etc.) ;
j'appelle
modes
actes
les actes de
que le jugement et le discours non déclaratif
une certaine autonomie.
que
souhait,
que
pensée
ont
alors
Selon la seconde approche (section
r'ductionnist_,
de
les énoncés marqués par un
II),
mode
autre que l'indicatif sont tous analysés comme servant à exprimer
des
jugements
(le
plus
souvent des
locuteur à propos de lui-même :
etc.).
La
représentée
première
d'autres grammairiens
Gregory);
.odas,
français
que
porte
le
"Je souhaite ... ", "Je doute ... " ,
de ces deux
(et ici illustrée)
jugements
approches
est
par Port-Royal,
et
anglais
principalement
Dumarsais,
(Harris,
et
Monboddo,
elle distingue nettement, dans un énoncé, le dicta. du
comme le feront Wittgen.tein,
Austin,
Stenius, Searle,
Vanderveken, etc. La seconde approche est défendue principalement
(et ici illustrée) par Buffier,
Beauzée,
Page 31
Condillac,
Beattie et
Destutt de Tracy; elle rappelle davantage les travaux de ceux (D.
D.
Lewis,
Davidson)
qui
croient
possible
de
limiter
sémantique à un traitement des conditions de vérité. Je
dans cette seconde partie,
d'crir.
de
ces
deux
la
t~cherai ;
approches
en
restant le plus près possible des textes classiques se rapportant
à
la théorie générale des modes verbaux;
sorte
de
catalogue d'auteurs,
(1979)
Le
présentées
même;
choix
des
j'ose
du
un peu à la
grammairiens
me parait assez
moins
ce sera en
"naturel"
espérer
que
somme
manière
dont
les
de
par
exemple,
sont
pour se justifier de luile
lecteur
Il y a certaines Ilomissions"
familier
des
(14)
en
le Ilcatalogue",
ne contient pas d'article sur Court
Urbain Domergue ou Gabriel Girard;
Julien
théories
grammaires générales et des ouvrages mentionnés à la note
jugera comme moi.
une
et de plus,
de
Gébelin,
il contient plus
d'articles sur les grammairiens français que sur les grammairiens
anglais,
et
allemands.
néglige
tout à fait les travaux
des
Les omissions s'expliquent par diverses raisons:
particulier
les limites fixées à ce travail et
répétitions
déjà nombreuses.
paraissait
suffisant
pour
que
en
des
me
illustrer les deux types de théories
l'~ge
des
historiographes
de
classique.
Je
Grammaire
la
à dire que les grammairiens
que
nous
retenus comptent parmi les plus "importants" et
les
plus
"représentatifs"
l'ajout
plupart
s'entendraient
Générale
avons
la
l'inutilité
L'échantillonnage présenté ici
idéationnelles des modes d'énoncé présents à
pense
grammairiens
du mouvement.
d'articles
Domergue ou
de
sur
Sacy,
Au reste,
Restaut,
Girard,
je ne crois
Court
de
pas
que
Gébelin,
eut beaucoup fait augmenter notre capital
Page 32
À'idées sur la
sémantique idéationnelle des modes d'énoncé ;
léger surnombre des français
se
justifie
Grammaire
que
simplement
(six des dix grammairiens présentés)
par
le fait que
le
mouvement
Générale fut plus vivant et plus prolifique en
partout ailleurs;
"grammaire" ,
par
op.
les
cit . ,
de
la
France
ce qui faisait dire à de Saussure que
par
"inauguré e
principalement
Le
les
(fut)
Grecs,
13).
continuée
lingu.istiqu..
Français ... "
p.
la
On peut déplorer l'absence
des
grammairiens allemands dans notre "catalogue", mais les allemands
se sont surtout fait valoir, il me semble,
par leurs
travaux en
Grammaire Historique et Comparée au XIX· siècle; pour tout ce qui
concerne la pensée des Lumières sur les
questions linguistiques,
cette boutade de l'historien Pierre Chaunu ne manque pas,
tout, de vérité
monde
gris.
Dans
générale
que
sémantique
théories
qui
ou
huron"
servira
nous tenterons
de
conclusion
d'fvAlu.r
nous avons distinguées et la place
les
deux
qu'occupe
idéationnelle des modes d'énoncé dans l'histoire
de
l'énonciation.
structuralistes
leurs
anglais,
troisième partie,
notre travail,
à
approches
"Il Y a la France, l'Angleterre et un reste du
On est français,
la
malgré
font-ils
prédécesseurs
déclaratifs?
La
dans
En
quoi les
preuve
leur
sémantique
comparatistes
d'originalité
traitement
des
idéationnelle
des
Page 33
par
des
et les
rapport
énoncés
la
à
non
grammairiens
philosophes
qui
satisfait-elle les critères
d'adéquation
empirique
devraient être raisonnablement respectés par une théorie
l'énonciation?
Nous
éléments de réponse à
essaierons à tout le moins
c~s
questions.
***
Page 34
d'avancer
de
des
NOTES
(1) Par exemple, Benveniste (1966),
Zaefferer (1984a et 1984b),
Wittgenstein (1953), Zuber (1983), Searle-Vanderveken (1985),
et
plusieurs autres.
Les
philosophes et
linguistes
s'entendent
généralement pour admettre que les
énoncés
déclaratifs,
interrogatifs et impératifs
(ou jussifs)
se
rencontrent dans toutes les langues. Les énoncés exclamatifs
s'ajoutent souvent à cette courte liste.
(2) Cf., S. Auroux, "Actes de pensée et actes linguistiques dans
la Grammaire Générale", dans H.E.L., VIII:2 (1986), qui parle
du développement des théories de l'énonciation au cours des
trente dernières anné es comme d' une véritable "révolution"
dans l'histoire des sciences du langage.
(3)
Cf., Frege, "Sens et dénotation", pp. 114-115, et " La
pensée", pp.
174-175, dans la trad. française de C. Imbert,
Ecrits logiqu.s .t phi1osophiqu.s, Paris, Seuil, 1971.
(4) Benveniste, E., "Les niveaux de l'analyse linguistique", dans
Prob1t •• s d. 1inguistiqu. g'n'r.1., Paris, Gallimard, 1966, p.
130.
(5) Cf. G.L. Bursill-Hall (1971), les premiers textes du
de Joly et Stefanini (1977), et 1. Rosier (1983).
recueil
(6) Cf.,
G. Gusdorf,
L.s sci.nc.s hu•• in.s .t 1. p.ns'.
occid.nt.1.,
III: L. R'vo1ution 9.1i1'.nn.,
Paris, Payot,
1969;
en particulier les chapitres l (l'La constitution de la
philologie classique" et II
("La linguistique préscientifique")
de la section V intitulée
"Philologie
et
Linguistique". Les connaissances concernant les langues orientales et la découverte des langues du Nouveau Monde s'ajoutèrent aux nombreux travaux sur les langues indo-européennes entrepris à cette époque (Renaissance et XVII- siècle).
(7) Quintillien, dans son Institution or.toir.
(Tome 1, Paris,
éd. Garnier Frères, 1954), écrivait déjà ceci: "Quant aux
verbes, maintenant,
est-il homme assez peu cultivé pour
Page 35
ignorer qu'ils ont des voix, des modes, des personnes et des
nombres?
C'est à peu près ce qu'on apprend dans les écoles
primaires: ce sont des connaissances élémentaires, mais il y
a des phénomènes qui étonneront, parce que la flexion en est
équivoque". (P. 63). Notez que Quintillien est réputé @tre le
premier grammairien à utiliser le mot .odus pour désigner les
modes verbaux.
(8) V. Flora:
"Existe-t-il un mode présomptif en roumain?",
dans L.ng.g • • t psycho.'c.niqu. du 1.ng.g.
(pour R. Val in) ,
éd. par A. Joly et W. Hirtle, Presses Universitaire de Lille,
1980.
(9)
Grammaires
"philosophiques " ,
ou "générales", ou encore
"universelles".
Les anglais
utilisent plus
volontiers
"universelles", et les français, "générales", pour qualifier
les oeuvres des grammairiens philosophes.
(10) Par exemple, D.
Zaefferer et G. Grewendorf, "Theorien der
Satzmodi", art. du manuel S ••• ntik, éd. par D. Wunderlich et
A. von Stechow, manuscrit,
juin 1984: "Von dem Satzmodi
streng unterscheiden sind die Modi des Verbs
(Indikativ,
Konjunktiv,
Imperativ,
etc.),
obwohl oder gerade weil zum
Teil,
z.B. beim
Imperativ (Verb- und Satzmodus)
enge
Zusammenhange bestehen"; l''Les modes verbaux
(indicatif,
subjonctif, impératif, etc.)
doivent @tre distingués strictement des modes d'énoncé, bien qu'il y ait en partie un
un rapport étroit entre les deux,
en ce qui concerne, par
exemple, l'impératif
(à la fois mode verbal et mode d'énoncé) "I .
(11) G. Nuchelmans,Th.ori.s of Propositions, Ancient and Medieval
Conceptions of the Bearers of Truth and Falsety, Amsterdam,
North-Holland, 1973, p. 101.
(12)
Ibid., p. 166 .t p.ssi •• Voir aussi Michael (1970), p. 115.
(13)
Alston,
Th. Phi1osophy of
W.
J'emprunte ce terme à
L.ngu..g., Englewood cliffs, Prentice-Hall, 1964, pp. 11 et
suiv.
(14)
Les ouvrages suivants y sont pour quelque chose
H.
Aarsleff,
Th. Stu.dy of L.ngu.g. in Eng1.nd, 1780-1860,
Princeton, Princeton U. Press, 1967; Fro. Lock. to S.ussuMinneapolis, U. of Minnesota Press, 1982;
S. Auroux,
L'Encyclop'di •• ~8r •••• ir.N .t NL.ngu.N.u X~III· sitc1.,
Paris,
Mame,
1973;
S.
Auroux,
L. S'.iotiqu. d.s
r.,
Page 36
Encyclop4dist.s, Paris, Payot,
1979;
J. C. Chevalier,
Histoir. d. 1. synt.x..
Naissance de la notion de complément dans la grammaire francaise (1530-1750) , Genève , Droz ,
1968; N. Chomsky, L. Linguistiqu. c.rt'si.nn.,
Paris,
Seuil, 1969; M. Dominicy, L. H.iss.nc. d. 1. gr •••• ir • •0d.rn., Bruxelles, Pierre Mardaga, 1984; R. Donzé, L. 8r •• •• ir. g4n4r.l • • t r.isonn', d. Port-Roy.l, Berne, Francke,
1967; D. Droixhe, L. linguistiqu • • t l'.pp.l d. l'histoire
(1600-1800), Genève-Paris, Librairie Droz, 1978; A. Joly At
J. Stefanini, L. 8r •••• ir. g4n4r.l •. Des Modistes aux Idéologues, Lille, P.U. de Lille, 1977; P. Juliard,
Phi10sophi.s of L.ngu.g. in Eight •• nth-C.ntury Fr.nc., La HayeParis, Mouton, 1970; 1. Michael, English 8r •••• tic.1 C.t.gori.s .nd th. Tr.dition to 1800, Cambridge, C.U.P., 1970;
G. Nuchelmans, Judg •• nt .nd Proposition.
From Descartes to
Kant, Amsterdam, North-Holland, 1983; G.A. Padley, 8r •••• tic.l Th.ory in N.st.rn Europ., 1500-1700, Cambridge, C.U.
P., 1985; H. Parret (dir.), History of Linguistic Thought
.nd Cont •• por.ry Linguistics, Berlin-New York, de Gruyter,
1976; J.C. Pariente, L'Rn.lys. du l.ng.g • • Port-Roy.l. Six
études logico-grammaticales, Paris, Ed. de Minuit, 1985; U.
Ricken, 8r •••• ir • • t philosophi • • u sitcl. d.s Lu.itr.s
Controverse sur l'ordre naturel et la clarté du francais,
Villeneuve-d'Ascq, Université de Lille III, 1978; G. Sahlin, C4s.r Ch.sn •• u Du N.rs.is .t son r6l. d.ns l'4volution d. 1. gr •••• ir. g4n4r.l., Paris, P.U.F., 1928; J.
Sgard (éd.) Condill.c .t l.s problt •• s du l.ng.g., Genève
et Paris, Slatkine, 1982.
(15)
Voir, par exemple,
le jugement porté sur la "grammaire
traditionnelle" par de Saussure à la première page de son
Cours d. linguistiqu. g4n4r.l.
(première édition
1915;
Paris, Payot,
1922, p. 13), où il résume cavalièrement en
un paragraphe, toute l'histoire de la linguistique avant
les comparatistes
"On a commencé par faire ce qu'on
appelait la Iigrammaire". Cette étude,
inaugurée par les
Grecs, continuée principalement par les Francais,
est
fondée
sur la
logique et dépourvue de
toute
vue
désintéressée sur la langue elle-même; elle vise uniquement
à
donner des règles pour distinguer les formes correctes
des formes incorrectes; c'est une discipline normative,
fort éloignée de la pure observation et dont le point de
vue
est forcément étroit".
De Saussure exagère sur
plusieurs points et manifeste une réelle incompréhension de
la Grammaire Générale. Mais il semble vouloir se racheter
et nuancer son premier jugement
(plut8t sévère)
lorsqu'il
écrit ailleurs (chap.
III, p. 118)
"Il est curieux de
constater que leur point de vue
(celui des "grammairiens"
--- A.L.) sur la question qui nous occupe
(la "synchronie"
--- A.L.) est absolument irréprochable. Leurs travaux nous
montrent clairement qu'ils veulent décrire des états;
leur
programme est strictement synchronique". Et plus bas, à la
même page:
"On a reproché à la grammaire classique de
Page 37
n'@tre pas scientifique;
pourtant sa base est moins
critiquable et son objet mieux défini que ce n'est le cas
pour la linguistique inaugurée par Bopp."
Par contre, Husserl, à la toute fin de la Quatrième
R.ch.rch. logiqu., déclarait prendre "fait et cause pour la
vieille doctrine d'une "gr •••• ir. g'n'r.l • • t r.isonn'," ,
d'une grammàire 'philosophique' Il; Husserl attribue Ilau
rationalisme du XVII- et du XVIII- siècle l l l'idée d'une
telle gr •••• ir. univ.rsell •• Cf. R.ch.rch.s logiqu.s, Tome
second, Paris, P.U.F.,
1962, pp. 132-133. Voir aussi la
discussion critique du projet de la Quatrième R.ch.rch.
logiqu. par Merleau-Ponty,
IIS ur la phénoménologie du
langage ll , dans Elog. d. 1. philosophi • • t .utr.s .ss.is,
Paris, Gallimard, 1953 et 1960; pp. 83-84 : IIDans la 4- des
Logisch. Unt.rsuchung.n, Husserl propose l'idée d'une eidétique du langage et d'une
grammaire universelle qui
fixeraient les formes de signification indispensables à
tout langage, s'il doit être langage,
et permettraient de
penser en pleine clarté les langues empiriques comme des
réalisations Ilbrouillées i i du langage essentiel li .
Pour
Merleau-Ponty (ce philosophe de l'ambiguïté), il est dans
la nature m@me des langues de tout exprimer avec une certaine Ilambiguï té" . . .
(p. 86); et l'uni versaI i té ne
peut
s'atteindre
par "une langue universelle qui, revenant en
deça de la diversité des langues, nous fournirait les
fondements de toute langue possible ll
(p. 90);
elle s'atteint plutôt II par un passage oblique de telle langue que je
parle et qui m'initie au phénomène de l'expression à telle
autre que j'apprends à parler ' et qui pratique l'acte d'expression selon un tout autre style,
les deux langues, et
finalement toutes les langues données, n'étant éventuellement comparables qu'à l'arrivée et comme totalités, sans
qu'on puisse y reconnaitre les éléments communs d'une
structure catégoriale unique. 1I (Ibid.). Merleau-Ponty prend
ainsi le contrepied du Husserl de 1900-1901, non seulement
en admettant la relativité linguistique, mais encore en
adoptant "une voie longue ll (comme dirait Ricoeur), une approche plus empiriste semblable à celle des linguistes contemporains,
tandis que Husserl privilégiait nettement la
Ilvoie courte l l (transcendantale) d'une recherche de l ' . priori.
(16) Cette distinction est faite par J. Agassi, dans Tow.rds •
Historiogr.phy of Sci.nc., La Haye, Mouton, 1963, et Sci.nc.
in flux,
Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol.
28, Dordrecht, Reidel, 1975. La distinction est reprise et
discutée par Dominicy (1984), pp. 8-9.
(17) Cf. Dominicy (1984), p.
10: liNon seulement l' hi st ori en
d'une discipline scientifique a le droit d'utiliser, si la
rigueur le demande, un langage que n'auraient su comprendre
Page 38
les auteurs examinés ... , mais sa démarche perd tout intérêt
s'il ne compare pas la théorie ainsi reconstruite aux
développements postérieurs de la science. Il
(18) Par exemple, Harnois (1929) était convaincu que ce qui manquait aux grammairiens philosophes pour avoir un point de
vue plus juste, c'est la notion de "fait social" présente
chez de Saussure; notez qu'à l'époque,
la sociologie, avec
Durkheim, Mauss,
etc., commençait à se tailler une place
importante
dans les
sciences humaines...
Comme quoi
l'interprétation des textes d'un passé plus ou moins lointain est bien fonction du savoir admis par les contemporains
de l'interprète
elle est "historique";
"un texte n'est
compris que s'il est à chaque fois compris différemment .11
(Gadamer, ~4rit4 .t .4thod., Paris, Seuil, 1976).
(19) Le choix de la théorie des actes de parole pour le rôle que
j'entends lui faire jouer me parait justifié dans la mesure
où cette
théorie
(dans la version donnée par SearleVanderveken (1985) et Vanderveken (1988))
représente, à mon
avis,
la théorie de l'énonciation la plus riche et la plus
achevée que nous ayons actuellement.
(20) H. Aarsleff,
"The History of
Chomsky", L.ngu..g., XLVI, 1970.
Linguistics
and
Professor
(21) Sur le problème de l'"application", cf. Gadamer, ~4rit4
.4thod., Paris, Ed. du Seuil, 1976, pp. 148 et suiv.
.t
(22) Par exemple, P. K. Feyerabend, "Philosophy of Science 2001",
dans ~.thodology, ~.t.physics .nd th. History of Sci.nc.,
éd. par R. Cohen et M. Wartofsky, Dordrecht, Reidel, 1984,
pp. 137-147: "Sci.nc. is ju.st on. of th• • • ny id.ologi.s
th.t prop.l soci.ty (or th.t r.t.rd it) .nd it shou.ld b.
tr•• t.d .s su.ch" (p. 143; en italiques dans le texte) .
(23) Cf.
I.
Lakatos,
"The Methodology of Scientific Research
Programmes Il , dans Philosophic.l P.p.rs,
Vol. 1, éd. par J.
Worrall et G. Currie, Cambridge, C.U.P., 1978, pp. 8-101.
(24) Shalom Lappin,
liOn the Pragmatics
of
Moods",
dans
Lingu.istics .nd Philosophy, Vol. 4, no. 4 (1982), pp. 559578; en particulier, pp. 559-560, à propos des modes d'énoncé : "The proposaIs for analysing mood which have been put
forward to date by linguists and philosophers tend to exemplifly two basic approaches to the problem. The first may be
described as reductionist, in that it attempts to charactePage 39
rize aIl moods in terms of the declarative
(or indicative).
l will refer to the second approach as the mood marker view.
It involves representing sentential mood by a distinct marker which appears in the sentence as one of its constituents". (Je souligne).
***
Page 40
PRENIERE
PRRTIE
1
LA GRAMMAIRE GENERALE CLASSIQUE EN TANT QUE
PROGRAMME DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Page 41
CHAPITRE PREMIER
1
LA GRAMMAIRE GENERALE CLASSIQUE EN TANT QUE
PROGRAMME DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
LE
1
HO'lRU DUR
Un progr•••• d. r.ch.rch. sci.ntifiqu.
r.Qle.
m6thodoloQique.
pre.crivant
6viter
(heuristique n6Qative)
est un en.emble
le. voie.
et celles qui
de
de
recherche
sont
•
•
parcourir
(heuri.tique positive). L'heuristique négative détermine le noyau
dur
(h.rd cor.)
d'un programme de
ensemble de lois,
sont
c'est-à-dire
un
de principes ou de conceptions théoriques
qui
déclarés inattaquables par une" décision méthodologique
des
chercheurs
qui
particulier.
la
s'engagent
dans
un
programme
L'heuristique positive,
construction d'une ceinture de
autour
d'hypothèses
falsifiées,
de
recherche
Le noyau dur est ainsi soustrait aux procédures
falsific~tion.
pour
recherche,
du
noyau
dur,
un
auxiliaires qui sont,
et qui peuvent être
elle,
fixe un programme
protection
ensemble
elles,
ajustées,
de
(prot.ctiv.
théories
susceptibles
modifiées,
abandonnées au profit d'autres théories ou hypothèses,
Page 42
de
ou
d'~tre
ou
sans
m~me
que
le noyau dur ait à en subir les contrecoups. Le rapport entre les
hypothèses
pas
auxiliaires et les éléments du noyau dur
déductif,
entrainerait,
recherche.
toujours
sans
par
quoi le rejet
.odas
d'une
toll.ns,
la
n'est
hypothèse
chute
du
donc
auxiliaire
programme
de
Lorsqu'un programme de recherche voit le jour, il est
"plongé
dans un
auxiliaires doivent
océan
"digérer"
d' anomalies " ;
les
anomalies,
les
hypothèses
contre-exemples,
etc., et prévenir les objections éventuelles pouvant atteindre le
noyau dur.
Un programme de recherche scientifique ne s'identifie
pas
à une théorie particulière (m@me si,
une
théorie particulière sert effectivement de
plutôt à une
.'ri.
la plupart
du
temps,
"modèle"),
mais
de théories ayant en commun le m@me noyau dur.
Le recours à cette méthode de"reconstruction rationnelle"
m'apparait
pleinement
pour
la
Grammaire
parce
théorique
de toutes les études se rapportant au langage à
disait
théories
"l'oeuvre
Du Marsais,
de la grammaire est
et
un
des
idées
la
diamant
que d'autres théories doivent
de l'origine des langues,
l'inversion
la
constitue le fondement
Générale
classique
classique
qu'elle
justifié
source
l'âge
brut",
"polir".
accessoires,
Les
de
et de l'ordre naturel des mots, de la traduction, de
synonymie,
des
tropes,
de
l'ellipse
et
autres
figures,
s'inspirent largement des enseignements de la Grammaire Générale.
En
retour,
ces théories proposent des réponses à des
questions
qui peuvent à première vue sembler embarrassantes pour
quiconque
Page 43
adopte les principes constituant le noyau dur du
hypothèses
auxiliaires
évidemment pas,
dont
par exemple,
il
sera
programme.
question
ne
les instruments de
concernent
mesure,
c'est souvent le cas dans les sciences de la nature;
remplissent sensiblement les mêmes fonctions dans
programme de recherche de la Grammaire Générale.
questions
Les
mais
comme
elles
l'économie
du
L'examen de ces
et réponses sera la matière du deuxième chapitre.
Les
grammairiens philosophes ne
s'occupaient
donc
pas
seulement de Grammaire proprement dite, dont le domaine se limite
à
l'analyse
de
la
"proposition
considérée
(selon l'expression de Du Marsais)
(Harri s) .
propositions"
rhétorique,
encore
figuraient
Du
des diverses
L'enseignement
des
"espèces de
langues,
la
la poétique, la lexicographie, et bien autres choses
à
leur
attention et leurs efforts.
comme
ou
grammaticalement"
Marsais
grammairien
programme,
requéraient
Certains grammairiens
et Condillac,
et rhétoricien;
et
furent
la
à
philosophes,
fois
Condillac écrivit de plus
et ses thèses concernant
des langues eurent une influence considérable.
La
leur
logicien,
un
gros
l'origine
méthodologie
des programmes de recherche scientifique permet, il me semble, de
mettre de l'ordre dans ce vaste ensemble de textes sur le langage
légué
par
les
d'articuler
diverses
philosophes
les rapports,
théories
et
grammairiens
parfois un peu
relevant de la
Page 44
classiques,
troubles,
entre
"Grammaire philosophique"
et
les
au
sens
le
plus large du terme.
peut
jeter
un
éclairage
au
Nous pensons que
nouveau sur
Grammaire
Générale
l'analyse
des diverses espèces de
gr amma tic al emen t ")
et
sens strict
les
grammairiens philosophes.
noyau dur de
la
les
cette
rapports
(c'est-à-dire
"propositions
autres
théories
entre
la
l'étude
et
considéré es
abordées
Les rapports entre ces
Grammaire
approche
par
les
théories et le
Générale seront examinés au chapitre
suivant.
La
première
reconstruction
partie de ce travail est
huma i n e s"
<1
essai
de
Lakatos fut rarement
bien
imparfaite.
appliquée
aux
j'ai peu insisté sur
"sériel"
méthodologie
de
"statique".
Mon
s'écarte
l'aspect
Lakatos,
"évolutif"
pour
en donner
interprétation,
donc
de
et
cette
une
"inspirée"
méthode
particulier,
version
de
plutat
de la méthode
au
moins
la
de
par
son
d'identifier
des
"statique".
C'est
"séries"
La
son application à la Grammaire Générale nécessite
)
En
caractère
à
"sciences
peut-@tre un certain nombre de "réajustements".
Lakatos,
de
Mais je suis pleinement conscient du fait
ne s'agit encore que d'une ébauche
méthodo.logie
un
rationnelle de la Grammaire Générale classique
la manière de Lakatos.
qu'il
donc
de
qu'il n'est pas
toujours
théories dans le
facile
développement
Page 45
de ce programme de
recherche. La Grammaire Générale ne représente pas une entreprise
totalement nouvelle ni
longue
tradition
poursuivie
par
"révolutionnaire";
inaugurée par les
les
médiévaux
elle se situe dans la
grammairiens
et
les
gréco-latins,
grammairiens
Renaissance.
Les grammairiens philosophes classiques
de
concepts théoriques puisés à même
nombreux
séculaire,
la
nouveauté
résidant
"psychologie rationnelle"
Descartes,
et
dans
la
principes
auxiliaires
fondamentaux
(ceinture
de
certains
(noyau
protection)
ont
toutefois
systématiquement
les
eu
le
plus
problèmes,
dur)
et
de
notre
recherche ont donc tous un air de déjà vu;
philosophes
nouvelle
proposé e par
exemple ceux liés à l'interprétation des propositions
Les
tradition
puis dans une pragmatique
dans le traitement de
la
hériteront
cette
(ou "thé ori e des idé es")
Port-Royal et Locke,
développée,
surtout
d.
par
relatives.
les
théories
programme
mais les grammairiens
mérite
de
les
développer
pour expliquer les universaux linguistiques
faits
de
langue
l'épreuve"
de
ces
en
tenant
principes et
compte,
théories,
dans
leur
d'une
"mise
plus
de
diversité
de
principes
dans l'histoire des sciences du langage les ont
être mis à l'abri de
révisions successives.
et
à
grande
L'ancienneté et la persistance
langues.
de
ces
peut-
Lakatos insiste sur
le fait qu'une théorie scientifique doit être évaluée (.ppr.is.d)
en
tenant
toujours
compte des théories précédentes;
des
isolées,
précédentes
"séries
chaque
de théories"
théorie
par l'ajout
dans
la
que
plutôt
série
que
se
nous
évaluons
des
théories
distinguant
(ou le rejet et le remplacement)
hypothèse auxiliaire (ou de plusieurs).
Page 46
Par là,
on peut
des
d'une
rendre
compte
de
l'idée
kuhnienne
expl iquant la "cont inui té"
des
connaissances
de
et la
"science
normale"
tout
en
Ilrat i onal i té" du développement
scientifiques.
Or,
les variantes
que
l'on
trouve dans notre programme de recherche tiennent davantage à
la
présentation ou à l'organisation de la matière traitée (ou encore
au vocabulaire technique utilisé) qu'à des hypothèses auxiliaires
rejetées et remplacées par les successeurs d'Arnauld et Lancelot.
Ceci dit,
l'apparente absence de "séries" successives
modèles théoriques et le consensus monolithique des
de
grammairiens
philosophes sur les principes et hypothèses du noyau dur et de la
ceinture
donner
cent
de
protection de leur programme de
l'illusion que ce programme a fait du sur
cinquante
période,
ans;
mais en fait,
bon nombre d'innovations
protection
(présentée
de la tête de Zeus,
de
nombreuses
développer.
C'est
cit.,
cette
notre ceinture de
n'est
pas
sortie
de Port-Royal
la
la
manière
en fait surtout au XVIII- siècle
développera graduellement,
pendant
pendant
même si la 8r •••• ir. et
indications sur
peuvent
à l'intérieur d'un
De plus,
Lo~iqu.
place
eu,
au chapitre deuxième)
toute armée de la 8r •••• ir. et de la
contiennent
il y a
"locales"
cadre théorique relativement stable.
Athéna
recherche
comme
Lo~iqu.
de
la
qu'elle
se
comme l'a montré M. Auroux (1979, op.
p. 20 et p.ssi.) , de telle sorte qu'une présentation moins
"statique"
que
séries
théories.
de
la mienne devrait pouvoir distinguer
Dans
la
8r •••• ir.
Page 47
et
la
de
telles
Lo~iqu.
des
Messieurs,
on trouve en effet la notion d'idée accessoire,
c'est surtout au
notion
XVIII- siècle
protéiforme
dont
la
qu'elle sera
théorie
développée
fournira
un
mais
en une
complément
indispensable à la théorie idéationnelle de la signification;
on
trouve
la
aussi
des · indications
concernant
la
théorie
de
synonymie, mais celle-ci sera encore développée au siècle suivant
par Girard,
m~me
celle
Du Marsais,
Beauzé e,
Condillac et quelques autres;
remarque encore en ce qui concerne la théorie des Tropes
de
l'ordre naturel,
qui seront
surtout
développées
et
au
siècle des Lumières, par Du Marsais, Beauzée, Condillac, Diderot,
etc.
sont
Les théories de la traduction et de l'origine des
langues
XVIII-
siècle,
encore,
développés
en
pour
l'essentiel,
accord
des ajouts du
avec les enseignements
de
la
Grammaire
Générale. Celle-ci constitue, nous l'avons dit, la base de toutes
les études consacrées au langage au cours de la période
que nous
considérons ici. L'oeuvre d'Arnauld, Lancelot et Nicole contenait
donc bon nombre d'indications et d'instructions (c'est-à-dire une
pour
"heuri st ique
protection dont les théories,
substantiellement
développer
une
ceinture
de
chacune à leur façon, augmenteront
-- et d'une manière non .d hoc --
le
pouvoir
explicatif de la Grammaire Générale. A partir de ces indications,
nous avons donc une
successivement
ou
"série"
de théories
simultanément,
demi.
Page 48
qui se
développeront,
pendant près d'un
siècle
et
Par ailleurs,
aucune
ce programme de recherche n'a
opposition,
ne souffre d'aucune
concurrence
contrairement à la situation souvent observée
"naturelles"
ou "humaine's".
distinguaient
volontiers
pratiquement
véritable,
dans les sciences,
Les
grammairiens
de
ceux
philosophes
qu'ils
se
appellaient
(cf., par exemple, Du Marsais,
péjorativement des "grammatistes"
art. "Enallage" de l'Encyclop'ditt), ou des "rudimentaires" (selon
l'expression de Beauzée, c'est-à-dire des auteurs de "rudiments")
plus attentifs à
"décrire"
"exceptions"
(ce qui
philosophes)
qu'à
le
"bon
exaspérait
"expliquer"
usage"
grandement
les
faits
grammairiens philosophes en appelaient
latins
de
la
Perizonius,
la
langu~
Renaissance
etc.)
volonté
de
les faits de langue;
leurs
d'expliquer
mais
particuliers,
substantiels
grammairiens
langue.
Sanctius,
Vossius,
"causes de
et
Renaissance
non
des
encore
seulement
faits
par
de
leur
langue
linguistiques
des
("ce qui est commun à toutes
pas
mais ils se distinguent
prédécesseurs de la
pas
Les
aux grammairiens
voulaient tout comme eux expliquer,
seulement décrire,
nettement
de
souvent
(Scaliger,
les
dans leurs traités sur les
qui,
latine",
en multipliant les
les
langues",
écrit
Lancelot) .
Quant à la
relai au début du
Grammaire Historique et Comparée qui prendra le
XIX· siècle,
si elle
déclasse
et
fait vite
oublier la Grammaire Générale, ce n'est pas, semble-t-il, suite à
Page 49
une
confrontation dont elle serait sortie victorieuse.
mesure où
plus
les
pour
la
genèse, l'étymologie et l'histoire des
langues (dont Leibniz fut l'un des précurseurs),
une continuité
davantage qu'une
Il) .
p.
Bien
les
tard par Rasmus Rask,
"lois
de
mutations
précédents
dans
philosophes
ont
engouement
pour
"rupture"
sar, les filiations
Jones entre le sanskrit et
plus
la
grammairiens philosophes manifestaient de plus en
d'intérêt
1978,
Dans
on peut voir là
D.
(cf.,
Droixhe,
observées par William
langues européennes
(confirmé es
Franz Bopp et Jakob Grimm),
consonnantiques"
la Grammaire Générale;
de
Grimm
mais
n'ont
les
terrain
la
leurs
Historique
par
les
pas
de
grammairiens
certes contribué à préparer le
Grammaire
et
à
cet
propres
recherches sur l'origine des langues et l'étymologie; d'ailleurs,
à ma connaissance,
recherches,
assez
ils ne se sont jamais opposés à ces nouvelles
même si les comparatistes,
de leur côté,
durement (et sommairement) l'entreprise
des
ont
jugé
grammairiens
philosophes.
Au demeurant,
comme le disait en substance Max Planck, les
programmes de recherche disparaissent parce qu'il faut bien,
ou
tard,
que
meurent leurs principaux
Auroux (Innov.tion.t systt ••
valoir
le
Grammaire
théories.
pas
pu
fait
1
représentants
"coïncide
S.
1. t •• ps v.rb.1, manuscrit) fait
qu'au début du XIX· siècle,
Générale
tôt
avec
une
le
déclin
multiplication
de
la
des
C'est en quelque sorte un éclatement. La grammaire n'a
résister
à la croissance de la
Page 50
masse
des
producteurs
scientifiques,
comme
si
un
système
scientifique
ne
pouvait
progresser sans la domination effective d'une théorie au sein
laquelle
les innovations viennent prendre place."
Générale
aurait
suscités,
théorie
La
croulé sous l'abondance des travaux
"chaque
globale
grammairien
s'institu[ant]
qui annule celle de
ses
de
Grammaire
qu'elle
l'auteur
confrères,
a
d'une
et
d'une
terminologie qu'il est pratiquement seul à maîtriser" (ibid.). Il
ne
s'agit
programme
pas,
selon
Auroux,
"d'une
' dégénérescence'
de recherche au sens où Lakatos emploi ce
suppose une recherche close sur elle-même,
inventant
des
hypothèses.d hoc pour justifier de nouveaux
n'a
pu
prédire. Il
théories,
des
grammairiens
grammaticale,
C'est
(Ibid.) .
terminologies,
sur
le
la
après-coup
faits
qu'elle
des
le manque de consensus parmi
les
les dénominations à utiliser dans
l'absence d'une
qui
foisonnement
la
science
base institutionnelle solide pour
l'enseignement
de
Générale
les universités),
dans
donc
terme,
d'un
Grammaire (pas de
chaires
de
Grammaire
la prédominance
de
l'intérêt
pédagogique sur l'intérêt théorique, l'absence de discussions des
théories antérieures
finalement contribué
c'est tout cela qui, selon Auroux, aurait
à la chute du programme de recherche de
la
Grammaire Générale.
L'approche méthodologique que j'adopte ici
outre
le
défaut de présenter cent cinquante
Générale comme si,
ans
tout au long de cette période,
Page 51
a
peut-~tre
de
en
Grammaire
le concept de
avait toujours été appréhendé de la m~me
Grammaire
qui n'est pas le cas,
manière ,
comme l'a montré S. Àuroux(2)
ce
Néanmoins,
au cours de toute cette période, l'essentiel du "cadre théorique "
fourni par la
la
et
8r •••• ir. 94n4r.l • • t r.isonn4.
est préservé,
constante référence à l'oeuvre des Messieurs assure
la continuité d'une tradition de recherche
corps
relativement
comporte
invariant de
quelques
principes.
"simplifications " ,
l'unité
(3)
fondée sur
Si
notre
elles
ne
et
un
travail
tiennent
pas
forcément à la méthode utilisée, mais plutôt aux limites que nous
nous
sommes fixées,
l'arrière-plan
théorique
idéationnelle des
première
notre
partie
but
étant
dans lequel
modes d'énoncé.
simplement
s'inscrit
de
la
fournir
sémantique
Je crois néanmoins
que cette
constitue une introduction fort utile
pour
la
description et l'évaluation de cette théorie.
Les sections 3 et
principes
autres;
(qui sont des
S
commentaires sur les
3 et S du noyau dur) sont un peu plus longues que
le
l'uniformité
postulat
de
l'universalité de
de la nature humaine)
la
pensée
est évidemment
(ou
les
de
central pour
toute l'entreprise, mais j'attache la plus grande importance à la
conception de la rationalit. pratiqu.
les
grammairiens
thématiser,
dans
philosophes mettent à
leur
théorie
l ' usage normal de la parole.
stratégies
et du choix rationn.l
des
Cette conception fournit
d'explication des faits de langue
Page S2
sans
la
langues
et
contribution,
sur l'origine
et des
que
plusieurs
universaux
linguistiques
en plus de contribuer à clarifier
l'idée
suivant
laquelle les langues sont l'oeuvre et l'instrument de la Raison.
L'objet de ce
l'examen
du noy.u
premier
dur
de
chapitre
la
est
l'identification
Grammaire
Générale
et
classique .
l'objet du suivant.
•••
La
Grammaire
Générale classique
se
présente
comme
une
sci.nc., que les grammairiens philosophes opposaient volontiers à
l'Art grammatical qui,
d'une
langue
grammaires
des
lui,
se limite à l'étude de la grammaire
particulière.
On
trouve
particulières (françaises,
grammairiens
philosophes
cependant
par exemple)
selon
les
aussi
des
écrites par
principes
de
la
Grammaire Générale
un pl.n nouv •• u (1709) de Claude Buffier,
des Princip.s g'n'r.ux
.t r.isonn's d. 1. gr •••• ir. fr.nçois. (1730) de Pierre
des
~r.is
Girard,
et
Condillac.
Princip.s d. 1. l.ngu. fr.nçois.
de
la
seconde partie de
la
(1747)
Sr •••• ir.
Restaut,
de
Gabriel
(1775)
de
Mais je ne crois pas que l'on puisse parler, comme le
1966,
p.
106),
d'une
grammaire générale du français, de l'anglais, de l'allemand, etc.
Page 53
Ces
grammaires
"générales",
Générale
français
particulières
sont
"raisonnées",
mais
non
même si elles s'inspirent largement de la Grammaire
leur but est de rendre compte des faits de langue
du
(ou de l'anglais, de l'allemand, etc.), et non de rendre
compte de ce qui est commun à toutes les langues.
L'un
des plus illustres représentants du mouvement
de
la
Grammaire Générale, l'encyclopédiste Nicolas Beauzée, définissait
en ces termes la Grammaire Générale :
La 8r •••• ir. g'n'r.l. est donc la science raisonnée
des principes immuables et généraux du Langage prononcé ou écrit, dans quelque langue que ce soit.
La 8r •••• ir. g'n'r.l. est une sci.nc., parce qu'elle n'a pour objet que la spéculation raisonnée des
principes immuables et généraux du Langage.
La sci.nc. gr•••• tic.l. est antérieure à toutes l~s
langues, parce que ses principes ne supposent que
la possibilité des langues, qu'ils sont les mêmes
que ceux qui dirigent la raison humaine dans ses opérations intellectuelles;
en un mot, qu'ils sont
d'une vérité éternelle. (8r •••• ir. g'n'r.l.,
1767,
pp. V-VI).
D'autres grammairiens,
Beauzée,
préfèrent
toutes les langues"
au tempérament moins
parler
d' "observations
(Du Marsais) .
"rationaliste"
qui
Buffier (1709),
conviennent
à
par exemple,
laisse clairement entendre que la tâche du grammairien
Page 54
que
n'est pas
de prescrire
"le bon usage",
mais plut8t d'expliquer les usages
effectifs d'une communauté de sujets parlantsj il va même jusqu'à
affirmer :
"La
raison n'a proprement rien à faire par rapport à
une langue, sinon l'étudier" (cité par Auroux;, 1979, p. 228).
ajoutait
cependant
que
l'usage étant
ce
qu'il
est,
"raisonnable" de le suivre et de "parler comme on parle"
il
Il
est
si l'on
tient à être entendu.
La Grammaire Générale classique cherche à déterminer quels
sont les types ou catégories d'expressions qui sont "n.c •••• ir •• "
•
l·.>cpr ••• ian
communic.tion
hum.in..
temps,
comp1.t.
.fficac.
po•• 1b1 •••
d. 1.
d..
Je
p.n.' • •t
p.n....
dis
dan.
".uffi.ant."
tout •• 1 ••
"nécessaires",
dans
parce que certaines parties d'oraison sont
conçues comme
"nécessaires"
à l'analyse
•
la
1.n;u••
un
premier
effectivement
(ou à l'expression, ou
encore à la représentation) complète de la pensée dans toutes les
langues,
tandis
que
d'autres parties du
nécessaires 1 sont jugé es simpl ement "ut i 1 es Il
discours,
("
sans
être
suffi sant es") pour
la communication des pensées.
Auroux défend,
de
grammairiens
en se basant
Condillac,
sensualistes,
la
thè se
aucune
Page 55
sur deux passages
voulant
partie
du
que
pour
discours
de
la
les
n'est
nécessaire;
il n'y aurait,
suffisantes
à l'expression de toutes les pensées l l
rationalisme
pour eux,
l'analyse
. et
d'4pist4.o109i. de l'UQAM,
que
"des classes de mots
linguistique"
no. 8710,
ilLe
(Auroux,
(1987) ,
p. 8).
Il en serait ainsi
parce que, pour les sensualistes, les parties du discours ont une
Dans sa 8r •••• ir.
genèse (ibid.).
456),
Condillac
espèces
de
affirme
mots
substantifs,
pour
en effet
exprimer
des adjectifs,
tel que le verbe
.tr.
1I
(éd.
G. Le Roy,
"qu'il ne
toutes
faut
nos
pp.
445 et
que
quatre
pensées
des
des prépositions, et un seul verbe,
(p. 445);
plus loin (p. 456), on retrouve
la même tournure
(Ilil ne faut que l l )
quatre éléments.
Dans l'interprétation de M. Auroux, lIil ne faut
que l l
la
est équivalent à
"il suffit l l
appliquée à chacun
Jean-Claude Parienta
•
théorie du verbe de Condillac l l ,
dans Sgard
(dir.) ,
Condi11.c .t 1.s prob1t •• du 1.n9.9., p. 258),
autrement le passage cité plus haut
une
condition
nécessaire
(p.
445)
nécessaire et suffisante
ne
équivalent
à
Ille
dans ce débat,
serait donc malgré tout,
lIil faut et il
suffit l l
de me ranger du côté de
(IISur
1982
lit
et y trouve plutôt
verbe
et suffisant pour permettre au langage
faut que l l
ces
semble-t-il,
fonction qui est d'exprimer toutes nos pensées l l ;
lIil
de
.tr.
d'assurer
est
sa
selon Pariente,
dans
ce
contexte,
Je crois préférable,
M. Pariente,
pour trois
raisons fort simples :
1°) Condillac distingue
philosophes),
(noms,
ce qu'il
adjectifs,
(comme la plupart des grammairiens
appelle
prépositions
1I1 es vrais élémens du discours l l
et le
Page 56
verbe
.tr.)
des autres
parties
du
discours
conjonctions)
d'abréger le
qui
(adverbes,
sont
composées
discours.
" suffisants"
certes
Les
pour
moyens conventionnels;
pronoms,
des
vrais
verbes adjectifs
premiers
éléments
exprimer
toutes
dans
le
du discours
et
but
sont
nos pensées par des
mais s.ns eux, on ne voit pas comment une
langue pourrait remplir cette fonction;
2°) Destutt de Tracy, sensualiste et principal continuateur
de Condillac, parle sans hésiter des livrais élémens dont elle (la
propos i t i on) est néces sairement composé e" (S,. •••• i,..,
souligne) ;
la
à
page précédente,
p.
faut
IIII
il écrit
67; je
donc
absolument, pour former une proposition, un sujet et un attribut,
et il ne faut que cela ll (ibid.,
un nom et un verbe,
faut absolument"
exprime sÜrement ici une
et "il ne faut que cela l l
L'argument de M.
pas en général pour tous les
faut que ... 11
peut bien,
suffisante chez
condition nécessaire,
IIC ela suffit
veut sans doute dire ici
à former une proposition".
Condillac,
Auroux ne vaut donc
L'expression
sensualistes.
à elle seule,
p. 66). IIII
exprimer une
lIil ne
condition
mais elle n'exclut pas forcément, il
me semble, l'idée d'une condition nécessaire, compte tenu du fait
que les
parties du discours
discours"
apparaissent
sont
composées
évidemment
alors
comme
fondées
des
sur
les fondements
livrais
ces
élémens
derniers
nécessaires
de
du
qui
tout
l'édifice du langage;
3°) Les règles qu'enseigne la
une
très
large
mesure
des
Grammaire Générale sont dans
règles
Page 57
que
Searle
appelle
"constitutives",
et M.
cit., p. 231, note 171);
et Foucault
("La grammaire générale de
7, 1967 i p. 7)
présente
ces règles comme
qu'une
langue
signes
qui
langue
humaine
c'est
empiriste
"les règles auxquelles il
un
bien
bien
système
de
@tre
une
"parler en dehors des règles revient à ne
pas
la "nécessité" des universaux dont nous
je pense,
le
lui qui
faut
ne satisferait pas ces règles ne pourrait
parler du tout" (ibid.);
si
l'avait bien vu,
s'ordonne pour pouvoir exister";
parlons ici est,
op.
Auroux le reconnaît lui-même (1979,
cas,
relative à ces règles constitutives;
cet te "née ess i té Il
nominaliste comme Condillac peut
en
est
bien
une
qu'un
accepter.
Les
universaux seraient alors des éléments nécessaires d'une certaine
activité définie par des règles, un peu comme on ne saurait jouer
au
football
sans
un ballon et deux filets
(ou
quelque
chose
d'équivalent qui en tienne lieu).
Quant à
l'argument
de
la genèse
avancé par
M. Auroux à
propos des sensualistes, il faudrait, me semble-t-il, l'appliquer
également à Destutt de Tracy;
reconnaissait
l'existence
nécessairement composée".
nous avons vu que ce
or,
d'éléments dont la
Bien sÜr,
dernier
proposition
" est
pour eondillac, les langues
(ces "méthodes analytiques"), dans les commencements, sont encore
bien
imparfaites,
qu'elles analysent"
possible,
et
elles
"ne
(8,. •••• 1,..,
se
l,
perfectionnent
iii,
p. 435);
qu'autant
il est donc
à l'origine, que les langues aient manqué de telles ou
Page 58
telles parties d'oraison,
mais elles ne pouvaient alors analyser
et adéquatement toutes nos pensées,
qu'en évoluant,
que les
,
"primitives"
I,
"pol icé es" .
ce
n'est
en progressant vers la réalisation de cette fin,
langues
(S,. •••• i,.,'
et
viii)
Dans
la
ont pu
comme
y
résoudre leurs
sont
arrivées
mesure où les langues
problèmes
les
sont
langues
faites
pour
analyser
et communiquer complètement et adéquatement toutes
pensées,
et
thèse
de
qu'il n'est pas possible (sauf si l'on
leur
origine
divine)
d'assumer
fonctions dès les premiers balbutiements,
ces
la
accepte
ces
c'est relativement
d'avoir des substantifs,
à
entendre
des quatre parties d'oraison chez Condillac.
peut alors dire qu'il est nécessaire,
la
parfaitement
fonctions d'analyse et de communication qu'il faut
"nécessité"
nos
On
pour toute langue poliej.,
des adjectifs,
des prépositions et
un
verbe substantif.
La
t~che
de la Grammaire Générale est donc de rendre compte
"de ce qui est commun à toutes les
est
"raisonnée"
et cherche à
les rapportant aux opérations
[1985])
(Port-Royal);
elle
.)(pliqu.r les faits de langues en
de
l'esprit
qu'ils
sont
censés
Les grammairiens philosophes manifestaient par là leur
exprimer.
souci
langues"
Chomsky [1966]
d'AdjquAtian .)(plicAtiv. (cf.,
et
entreprise
distinguaient jalousement,
théorique
des
travaux
Page 59
de
nous
l'avons
ceux
qu'ils
et
vu,
Padley
leur
appelaient
(pé j ora t i vement)
grammairiens
les
sans
"gramma t i st es" ,
ambitions
l'enseignement des langues,
bon usage",
la
de
"contenant
tourné s
très respecté
M.
de
la Grammaire Générale qu'elle
les
langues;
la
des
autres,
la
de
la
pensée
énoncés
dans
communicAtion de la
~tre
les
dans
M.
thé orie
La Grammaire Générale peut encore
(4)
repr6.entAtion
les
un peu à
une
comme l'étude de deux types de contraintes
concernent
vers
Vaugelas.
est
principes de la construction
toutes les langues"
des
et qui s'emploient à enregistrer "le
(malgré tout)
dit
décrite
thé oriques ,
celui des écrivains et des gens instruits,
façon du
Auroux
c'est-à-dire
unes
toutes
pensée
les
dans
le
discours. La Grammaire Générale est ainsi l'étude des contraintes
que
doit
satisfaire
compl.tement
la
tout système de
pensée
et pour
signes
la
pour
communiquer
c'est-à-dire clairement et sans trop d'embarras.
bien
étant
distingué
liées
à
communication.
qu'une
ces deux types de
la
logique,
Condillac
efficAcement,
Foucault
contraintes,
les
autres
expliquait au
langue serait bien "imparfaite,
(dans
cit., p. 14)
op.
"La grammaire générale de Port-Royal",
représenter
les
tenant
a très
premières
plus
à
jeune Prince de
si
elle se
la
Parme
servoit
de
signes aussi embarras sans que les chiffres romains"
1775,
p.
435).
après
avoir
Et Destutt de Tracy
examiné
les
nécessairement composé e",
parties
rendre
facile."
l'expression
(Je souligne).
dont
la
1803,
p. 67),
proposition
"est
se propose "d'examiner les différentes
sortes de mots dont on se sert
pour
(8~ •••• i~.,
dans nos
langues perfectionnées,
de la pensée plus
us)
complète
et
(Les idé es de repr6.entAti on de
Page 60
plus
la
pensée
dans
logique et de communicAtion des pensées se trouvent aussi
l'interprétation de la
Ducrot
dans le
1.ng.g.
Grammaire Générale présentée par O.
Dictionn.ir.
[1972,
pp,
.ncyc1op'diqu..
15 et suiv.J;
analogue dans la théorie de la
on trouve
une
distinction
J.
Searle dans
signification de
[1983, pp. 165 et suiv.J).
Int.ntion.1ity
Une grammaire générale comprend une partie portant sur "les
sons
et
les
langage.
des
lettres",
c'est-à-dire la
Cette partie,
"face
matérielle"
du
qui occupe habituellement moins du quart
grammaires générales,
correspond grosso .odo à ce que
nous
appelons aujourd'hui "phonétique" et/ou "phonologie". On y trouve
une description de l'appareil phonatoire,
des principaux organes
qui
contribuent à la production des voyelles et
des
consonnes,
des
rapports
les
idées,
diverses
entre
règles
les lettres,
touchant
la
examinent la
"face spirituelle"
syntaxe,
sémantique
niveau
la
la
de
conv.nAnc./syntaK.
choses
en
d'.KplicAtion
d.
Les
les
,.6gim.,
les
autres
La syntaxe
grammairiens
en
parties
distinction
ont néanmoins fait
rapports
de
qu'entretiennent
délimitant,
Page 61
comme le
est
philosophes,
syntAK.
le
qui
d.
évoluer
les
d6t.,.minAtion
et
(pour les propositions relatives),
et
et
du langage, que se partagent la
vieille
travaillant
"déterminant/déterminé"
l'énonciation,
prosodie.
et
et la pragmatique.
le moins développé;
héritaient
les sons
ou le
les
mots
fait
Du
rapport
dans
Marsais,
différents
niveaux de "construction"
"naturelle" ou "analytique",
Tracy
décrivait
en syntaxe
(construct ions
"figurée" et "usuelle"). Destutt de
la syntaxe en des termes
très
modernes
comme
"l'art de calculer les idées de tout genre par le moyen de signes
(8,. ••••
donnés"
jours,
que
i,.. ,
la
p. 157) ,
Grammaire
et estimait, comme Montague de nos
Générale devait
s'appliquer
à
tout
système de signes (comme l'algèbre), et pas seulement aux langues
naturelles
(ibid., p.
sémantique,
153) .
retiennent
philosophes.
davantage
D'ailleurs,
contenue dans la
La
pragmatique,
surtout
l'attention des
la syntaxe est déjà.
théorie des
et
grammairiens
pour ainsi dire.
parties du discours,
les possibilités combinatoires de chacune;
la
qui
examine
elle constitue. comme
disait Du Marsais. les "préliminaires de la syntaxe " .
La théorie
des
parties du discours forme le coeur des grammaires générales.
Les
noms
(propres
adjectifs.
et
appellatifs.
et
leurs
cas).
pronoms.
verbes. adverbes. participes. articles. prépositions.
conjonctions et interjections.
y sont traités séparément.
jamais
indépendamment de leur contribution à l'expression
pensée
complète.
Le point de vue de la Grammaire
mais
d'une
Générale
est
celui de la fonction; c'est le r81e ou la contribution sémantique
d'une expression qui détermine son appartenance à telle ou
telle
classe de mots. Chez la plupart des grammairiens philosophes. les
critères
purement syntaxiques ou morphologiques se
Quant à la pragmatique,
"Une
pragmatique
occupait
dans
grammairiens
M.
Dominicy a montré
générale")
les
la
conceptions
de Port-Royal.
place
font
(1984,
Page 62
chap.
3 :
qu'elle
considérable
logico-grammaticales
en prenant toutefois ici
rares .
le
des
terme
"pragmatique"
au sens très large que lui donnait Morris en
où il désigne
1938
l'étude des
rapports entre les signes et leurs utilisateurs, en tenant compte
de leurs intentions et du contexte d'énonciation.
la thèse de doctorat de Julien, 1979,
(Voir également
Pariente, 1985, p. 349, et
Auroux, "Actes de pensée et actes linguistiques dans la Grammaire
Générale", 1986).
Cette
pragmatique reconstruite par Dominicy à
partir de la Sr •••• ir. et de la Logiqa. des Messieurs (et surtout
des oeuvres d'Arnauld)
(effabilité,
maximes de
est fondée sur un
vraisemblance,
rationalité
etc.) ,
ensemble de
sur un
gouvernant les
nombre
de
échanges discursifs,
et
tient compte de l'historicité des langues,
et
des
phénomènes
liés à la d.terminAtion
discours (polysémie,
Condillac,
dans
son
équivocité,
etc.) .
Rrt d"crir. (1775),
certain
des idées accessoires
des
mots
dans
Un siècle plus
affiche
mêmes préoccupations :
Chaque pensée, considérée en elle-m~me, peut
avoir autant de caractères, qu'elle est susceptible de modifications différentes
il
n'en est pas de même, lorsqu'on la considère
comme faisant partie d'un discours. C'est à
ce qui précède, à ce qui suit, à l'objet qu'
on a en vue, à l'intérêt qu'on y prend,
et
en général aux circonstances
où l'on parle,
à indiquer les modifications auxquelles
on
doit la préférence; c'est au choix des termes, à des tours,
et m@me à l'arrangement
des mots, à exprimer ces modifications: car
il n'est rien qui n'y puisse contribuer.
(Ed. de G. Le Roy, p. 517).
Page 63
principes
encore
le
tard,
les
***
Le noyau dur de la Grammaire Générale se réduit à mon
avis
aux quelques principes suivants
1) L.
l~ng~ge
e.t l'expr ••• ion (au l'analy •• ) d.
l~
p.ns'.
(définition ou hypothèse?) ;
2) La
d ••
principal. fonction du
p.n •••• ;
lang~Qe
•• t la
3) La p.n •• e •• t la m*me partout .t pour tau.
communication
(postulat de
l'universalité de la pensée);
4) Il Y ad •• univ.r.aux lingui.tique. sub.tanti.l. 1 pour
repr •••nter (analyser) compl.tement la p.n... et la
communiqu.r .fficacement, tout •• 1.. langu•• humain ••
ont b ••oin •• nsiblem.nt d •• m*me. cat.gori •• d'.xpr ••.ion . t suivent ••n.ibl.ment 1 •• m*me. r.gl •• ;
~)
L'u.ag. normal d. la parole •• t une activit. rationn.ll.
ori.nt •• v.r. un. fin
(principe de rationalité appliqué
à l'usage normal de la parole);
6) L. princip. d'analogi. 1 1 •• lanQu.. s. forment .t
.volu.nt en r ••pectant certain. mod.l.. r.lativem.nt
bi.n .tablis (comm. 1 •• paradigm•• de conjuQai.on.t d.
d.clinai.on),
.ans
quai
ell..
devienn.nt
trop
irr.Quli.r • • •t difficil •• ~ appr.ndre.
Examinons maintenant ces principes un à un.
Page 64
La
définition du
langage comme
expression de la
pensée
est; pour l'essentiel, aristotélicienne. L•• mat • •ant 1 • • • i;n ••
d •• id ••• (des "états de l'âme",
d.
disait Aristote dans le
On retrouve le
l'int.rpr~t.tion).
m~me
Tr.it~
principe chez Augustin
(par exemple, L.s Conf.ssions, Livre 10, chap. XII), et l'on sait
à
quel point fut durable et profonde l'influence
d'Augustin en
expression
des
Occident
d'Aristote
Cette conception du
<.).
langage comme
de la pensée est à la base de la théorie
logiciens
et
grammairiens
de
et
des
Port-Royal,
et
signes
peu
de
philosophes l'ont autant développée et discutée que Locke dans le
troisième
(1690).
Livre
de
son Ess.,
Ce troisième Livre,
conc.rning
Hu •• n
Und.rst.nding
si important pour la philosophie du
langage des Lumières, définit ainsi la "signification première ou
immédiate
des
mots"
"words,
in their primary
or
immediate
signification, stand for nothing but th. id•• s in th• • ind of hi.
th.t us.s th•• ,
are
collected
how imperfectly soever or carelessly those ideas
from the things they are supposed
to
represent"
(chap. II, paragr. 1).
Grammaire
La
Générale
"idéationnelle" du langage;
est
classique
une
théorie
une théorie mentaliste qui obéit
au
"principe de la référence des faits de langage aux opérations
de
(Pariente, op. cit., p. 109).
la pensé e"
stratégie
C'est là sa principale
d'explication des faits de langue.
l'esprit sont la canc.ptian,
le ju;.m.nt,
Ces opérations
de
qui produit les concepts ou
idées,
d'~tre
vraies
qui produit des pensées susceptibles
Page 65
ou
fausses,
et tous les autres "mouvemens de l' ame l l
l'interrogation,
le
commandement,
la
prière,
que
,
le
sont
doute,
la
concession, etc.
Nous reviendrons plus loin sur la logique et la
psychologie
lesquelles la Grammaire Générale
Notons
sur
simplement
que
la sémiologie des
prend
Lumières
s'élève
général sur une structure ternaire chose-son-idée :
quelque
li.u
en
un signe est
chose (par exemple un mot écrit ou prononcé)
d'une idée dans l'esprit du locuteur,
une chose dans le monde.
qui
et
Du
Marsais
par
choses.
exemple)
structure
quaternaire
(Sur
structures ternaire et quaternaire
les
c 1 a s s i qu e ,
représente
Les mots sont les signes
sont des représentations des
(Arnauld
auteurs
laquelle
Le monde se divise en choses, la pensée
et le discours en mots.
en idées,
idées
appui.
Mais
de
certains
pré fèrent
chose-son-idée du son-idée de
la
la
des
une
chose.
sémiotique
cf.
chap. 1).
M. Auroux (ibid., p. 70, et p.ss1.) appelle
langage-traduction"
"hypothèse du
la conception classique de la sémiosis.
Une
interaction discursive peut être décrite comme suit: en parlant,
un locuteur construit une "image" de ses idées et de ses pensées;
formellement,
le locuteur applique une fonction F à une idée
produisant
le son
L'auditeur,
lui,
S~,
pour
signe de l'idée i,
comprendre
soit
l'énonciation
F (i)
du
=
S~.
locuteur,
c'est-à-dire pour déterminer l'idée associée par ce dernier à
Page 66
i,
S~"
F-1
appliquera la fonction inverse
Parler,
c'est
associer,
S~,
à
F-1
soit
selon certaines règles,
(S .. )
=
ses idées
i.
et
pensées à des sons (mots) conventionnellement choisis à cette fin
et adoptés par le plus grand nombre.
mot
est
presque
toujours
Mais la signification
complexe
et
structurée
d'un
pour
les
classiques, et nous aurons plus loin (chap. 2) à tenir compte des
Acc ••• oir •• qui souvent s'ajoutent à une idée
id •••
laquelle
terme
principAl.,
constitue la signification principale du mot.
n'exprime
jamais plus qu'un.
idée principale,
Mais
s'il
un
est
utilisé selon son sens propre (primitif) ou littéral dans un même
contexte; il peut cependant exprimer une idée autre que celle qui
lui fut attachée, comme cela se produit dans le cas des tropes.
2) La principal. fonction du lan;A; • • •t lA
communicAtion
d •• p.n •••••
Plusieurs philosophes classiques (Locke,
Condillac)
d'autres
outre,
admettent
fins
et il
Mais
de
support
à
la
le
langage
pensées;
mémoire
pour
peut
il
admettent,
sauf
aux facultés supérieures
Berkeley
(cf.,
servir
peut,
l es
ou à raisonner à part soi et en silence
"donne de l'exercice"
tous
que
que la communication des
servir
abstraites",
volontiers
Leibniz, Berkeley,
en
"pensé es
(Leibniz) ,
de l'âme.
Princip.s
d.
1.
conn.iss.nc. hu•• in., paragr. 20), que sa principale fonction est
Page 67
la communication des pensées,
et le point de vue exprimé ici par
Leibniz est bien représentatif de la période que nous examinons :
"sans le désir de nous faire entendre nous n'aurions jamais formé
de
langage "
(Houv •• ux
.11.11 ..• ,
Livre
III,
236).
p.
l'anthropologie classique (à l'exception de Hobbes),
l'homme pour la vie en société,
organes
de
la
caractérisaient
présentes
classique.
parole.
déjà
dans
La
La
l'Homme
et
la
Sociabilit.,
aristotélicien,
l'anthropologie
première
Dieu a créé
avec une âme rationnelle et
Raison
de
les
qui
sont
toujours
de
l'époque
philosophique
page du N.r •• s
Dans
James
Harris
est
également représentative de la période que nous considérons
Si la nature avoit destiné les hommes à vivre
isolés,
ils n'auroient jamais senti de penchant
qui les portât à communiquer entre eux.
Si elle
leur avoit refusé la raison comme aux animaux
d'une espèce inférieure,
ils n'auroient jamais
pu reconnottre les matériaux propres du discours.
Or, puisque la faculté de . parler est le résultat
de la double énergie de nos plus nobles et de nos
plus. excellentes qualités, de celles qui assurent
à l'homme la supériorité sur les autres espèces
d'animaux, qui forment son caractère distinctif
et sa principale prérogative (je veux dire la
raison et la sociabilité), on ne peut refuser une
sorte d'intérêt et d'estime à ces recherches,
dont le but est de résoudre le discours dans ses
éléments naturels, et de le recomposer en combinant ces mêmes éléments. (Dans la trad. de Thurot
aux pages 1-2).
Est-ce le langage qui rend la société possible ou
question
fut débattue au XVIII- siècle
Rousseau, etc.),
l'inverse?
(Mandeville,
La
Condillac,
mais à tous le langage apparatt comme le ciment
de la vie sociale.
Page 68
postul.t
Le
d.
l'univ.rs.1it4
l'unifor.it4 d. 1. n.tur. hu•• in.
programme
pourrait
de
d.
p.ns4.
1.
ou
est évidemment central pour le
recherche de la Grammaire
Générale.
Le
langage
être l'expression de la pensée sans que la pensée
la même partout et pour tous.
de
Si c'était le cas,
la
soit
Grammaire
Générale serait sans fondement. Comme l'écrit S. Auroux (1979, p.
193)
"l'uni versali té
univ.rs.11.
correspondance
il
faut
la
pensé e
entre les
entendre ici avant tout
opposition
Descartes
de
à
est
l' é talon
langues. 1I
p.n.'.
la
IIpenséell,
A
la
au
début
l'imagination
(1662),
de
H4dit.tion),
les premiers paragraphes de la 6·
leur Logiqu. ou l'.rt d. p.ns.r
par
suite
les Messieurs de Port-Royal distinguent soigneusement,
de
la
conc.ptu.ll.,
l'imagination et à la sensation.
(cf.,
Par
de
d'un
polygone à 1996 c8tés, qui ne donne qu'une image mentale confuse,
de
la conc.ption du même polygone qui,
claire et distincte,
la
penseurs
Ainsi conçue,
même partout et pour tous.
Proposition,
1983,
classiques
conc.ptus obi.ctiuus
de Descartes,
produit une
idée
une idée qui est bien la m'" pour tous les
géomètres de toutes les époques.
être
elle,
chap.
2)
voit
la pensée devait
Nuchelmans
chez Descartes et
une survivance des
et d'.ss. obi.ctiv.
notions
médiévales
dans le
de
vocabulaire
lIêtre objectivement dans l'entendement ll ,
Page 69
d'autres
c'est
y
~tre
"par représentation".
tant
que
signification
"concepts passifs",
Les concepts ou idées,
des
mots,
sont
considérés en
envisagés
comme
des
des représentations "de quelque chose".
Ces
concepts ou idées sont le produit de l'intellection pur.
(ou de
"l'entendement pur", comme dit Malebranche, Dit 1. rltch.rchlt dit 1.
v'rit' [1674],
Livre troisième),
par la "réflexion";
perceptions qui
car,
n'ont
ou
doivent avoir été élaborés
ainsi que l'écrivait
jamais
sont pas proprement des idées.
été l'objet de la
dans l'âme,
auxquelles il manque,
d'être
considérées
comme
l'ori~inlt
signification des
identifiées aux
Vorstlt11un~ltn
classiques parlent souvent
propos des idées.
(A
d'ordre étymologique).
nature
partout
réflexion,
images"
pour être des
humaine
mots,
ne
Les
doivent donc
de Frege,
même si
idées,
sur
idé es,
être
p~s
les
auteurs
d'"images peintes dans le cerveau"
cela,
il
Le
postulat
Y a
d'ailleurs
de
sera sans cesse réaffirmé
les hommes ont la même
dit Condillac,
ne
Ess.i
(Condillac,
dits connoiss.nclts hu•• inlts [1746], p. 47).
en tant que
"des
Elles ne sont que des impressions
faites
des
Condillac,
des
raisons
l'universalité
par
les
à
de
la
empiristes;
"conformation naturelle",
comme
les mêmes sens et les mêmes besoins fondamentaux,
et partout les idées se forment selon les mêmes principes :
Or la pensée, considérée en général,
est la même
dans tous les hommes. Dans tous elle vient également de la sensation; dans tous,
elle se compose et se décompose de la même manière.
Les besoins qui les engagent à faire l'analyse de
la pensée, sont encore communs à tous; et ils emploient tous à cette analyse des moyens semblables, parce qu'ils sont tous conformés de la même
manière. La méthode qu'ils suivent est donc assujettie aux mêmes règles dans toutes les langues.
Page 70
On
trouve
une conception fort semblable chez
(1748);
expriment
David
Hume
dans
les
mots
qui
en différentes langues des idées complexes doivent
se
correspondre assez étroitement :
Dans différentes langues, même dans celles entre
lesquelles nous ne pouvons soupçonner la moindre
connexion ou communication, on trouve que le.
mots significatifs des idées les plus complexes
se correspondent étroitement
preuve certaine
que les idées simples, comprises dans les idées
complexes, sont liées par un principe universel
d'influence égale sur tous les hommes. ( 7 )
A ma connaissance, le seul philosophe classique qui ait osé
mettre
en doute le postulat de l'universalité de la
Maupertuis,
est
dans ses Rffl.xions philosophiqu.s sur l'origin. d.s
même année que l'Enqu.t.
ce
pensée
de Hume. Cet opuscule contient en effet
qui peut passer pour la première formulation du
principe
... on trouve des Langues,
sur-tout chez les
peuples fort éloignés, qui semblent avoir été
formées sur des plans d'idées si différents
des netres, qu'on ne peut presque pas traduire dans nos Langues ce qui a été une fois exprimé dans celles-là.
(iiI)
Page 71
de
Les Ilpl Ans d· id ••• di~~.r.nts" de Maupertuis furent immédiatement
condamnés et rejetés par les philosophes français qui avaient
la
chance
de
lire
l'opuscule
d'exemplaires circulaient.
rejoint
dont
à
peine
une
eu
douzaine
La réaction de Turgot (un
empiriste)
les idées exprimées par Hume dans le passage
cité
plus
haut :
Les pl.ns d'idées diff'r.nts sont de l'invention
de Maupertuis. Tous les peuples ont les m~mes
sens,
et sur les sens se forment les idées
aussi nous voyons les fables m~me de tous les
peuples se ressembler beaucoup. ( 9 )
La
réaction
Maupertuis
de
ira
Condillac aux
dans le
m~me
"plans
sens.
d'idées
différents"
Dans une lettre
adressée
de
à
Maupertuis (datée du 25 juin 1752), il écrit :
Il y auroit de la différence entre la philosophie de deux peuples qui n'auroient eu aucun commerce ensemble,
et la différence des
langages pourroit y contribuer
je doute
cependant que cette différence füt aussi
considérable que vous paroissez le supposer,
les hommes ayant partout les m~mes sens et
des besoins semblables; je crois que sans se
communiquer,
ils seroient sÜrement conduits
à faire les m~mes abstractions et les m~mes
raisonnements. ( 1 0 )
Cette réaction aux "plans d'idées différents" de Maupertuis
se
fait encore sentir plus d'un demi-siècle plus tard,
"Note
sur
les Réflexions de Maupertuis et Turgot
Page 72
au
dans
la
sujet
de
l'origine des langues··
reproche
(1815)
de Maine de Biran,
où ce dernier
à Maupertuis de n'avoir donné aucun exemple
d' idé es··
irréductibles
aux netres,
et de n'avoir
de
··plans
point
cité
IId'idiomes
où
il n'y eat pas eu tels signes pour
exprimer
substances
et
leurs. modes,
effets;
les causes et
leurs
autres
pour exprimer l'union de l'attribut et du
etc ...
Alors
pas
sujet
les
tels
intime,
nous aurions eu la preuve que ces notions ne
primitives et essentielles à l'esprit humain.··
(11)
sont
Un
peu
plus loin, il ajoute :
Or, voilà ce qu'on doit trouver de tout à fait
pareil dans la comparaison des langues, m~me
les plus sauvages, s'il est vrai,
comme nous
n'en saurions douter, que la forme primitive
du jugement, ou de la perception d'une qualité
attribuée à un sujet et distinguée de lui,
soit l'apanage naturel et commun de l'esprit
humain,
le vrai caractère distinctif de tout
~tre pensant.
C'est sous ce rapport qu'on aurait pu défier,
je crois, Maupertuis de citer quelque langue
étrangère qui füt formée sur des plans d'idées
si différents des nôtres que la traduction füt
.bsolu•• nt i.possibl •. ( 1 2 )
De
toute évidence,
le postulat de l'universalité
de
pensée et de l'uniformité de la nature humaine n'est pas de
que
l'on remet facilement en question lorsqu'on est
philosophe ...
d'utilité
Il jouit
épistémique.
manifestement
L'heuristique
d'un
très
négative
la
ceux
grammairien
fort
enjoignait
degré
les
grammairiens philosophes de ne pas entreprendre de recherches sur
Page 73
une
hypothèse
contredisant l'un des principes
noyau dur de leur programme.
du programme
Plusieurs
fondamentaux
"hypothèses auxiliaires"
de recherche de la Grammaire Générale
la traduction,
accessoires,
de l'inversion et de l'ordre
et
du
(théories de
naturel,
des idé es
de l'origine des langues) servent en
partie
à
mettre ce postulat à l'abri de contre-exemples par trop évidents.
Il convient ici je crois de toucher quelques mots à
de
la
logique et la thé ori e de l ' esprit
"psychologie
classique.
Grammaire
rationnelle " ,
ou
encore
("thé ori e
propos
des idé es" ,
"Idéologie")
de
l'~ge
Car les deux disciplines sur lesquelles se fondent la
Générale sont très liées du fait
toutes les deux,
qu'elles
mais chacune à leur manière,
de la
s'occupent
"pensée " .
La logique s'intéresse avant tout à certaines opérations de
l'esprit (concevoir,
où ces opérations,
ju;er, raisonner, ordonner), dans la mesure
conduites sous la droite Raison, nous rendent
capables d'atteindre la vérité dans les sciences. La "pensée" qui
importe
aux
yeux
des grammairiens philosophes
produisent
les
deux
conception
et
le
significations
des
premières
jugement.
mots
opérations
Les
lorsque
les signifier.
idées
ceux-ci
convention,
pour
s'expriment
dans le discours par des
de
est
l'esprit
sont
propositions
utilisés,
quant
que
la
deviennent
Les jugements,
Page 74
celle
à
les
par
eux,
déclaratives
composées
d'un sujet,
souvent d'une copule
d'un prédicat (ou attribut),
chez les philosophes classiques,
ce
puisqu'on ne parle guère
pour ainsi dire,
pour
mais plutôt presque toujours pour dire
que l'on juge des objets conçus;
n'est,
plus
Il Y a une nette primauté du jugement
(13)
dire ce que l'on conçoit,
et le
de
plus,
qu'une extension du
le
raisonnement
jugement,
puisque
raisonner, c'est former un nouveau jugement à partir de jugements
dé j à
donné s
discours
par
des
grammatica1ement"
l'unité
Parce que les jugements s'expriment dans
(14).
propositions,
la
(selon l'expression de
considéré e
Du Marsais)
de
fragments
de discours plus étendus.
ses
(1751),
théories auxiliaires
peuvent
Ainsi,
distingue clairement
la
tâche
est
de
diviser
Harris,
tant
la rhétorique,
qu'il
les
diverses
l
proposition
(considérée
son
de
tandis que la logique
discours
en
(inférences,
propositions
argumentations), sont des disciplines "synthétiques".
lA
des
ana 1ytique"
Ilespèces
parce qu'elles s'intéressent au
est composé de suites de
dans
si
la Grammaire de la Logique
propositions" en leurs parties naturelles,
et
même
embrasser
et de la Rhétorique : la première est une discipline
dont
constitue
maximale d'analyse dans la Grammaire Générale,
certaines
H.r.ts
"proposition
le
grammaticalement)
L'unit. d.
est
lA
L'analyse de la proposition dans la
Grammaire Générale sera entièrement empruntée à la logique,
toutefois
modifications
des
grammaticale,
la
en
devenant
proposition n'est plus seulement porteuse
valeurs de vérité,
ou subardonn'.
importantes
(1~).
elle
se
fait
aussi
avec
des
principAl.,
Cette théorie des propositions ne reconnaît
Page 75
pas
l'existence
des relations et cherche à ramener
propositions
à
propositions
peuvent
négative),
ou
singulière) .
proposition
Tracy;
de
la
la
générale
varier
selon
quantité
les
Sujet-Copule-Prédicat.
Les
la
qualité
(affirmative,
(universelle,
particulière,
On trouve cependant des analyses bipartites de
chez
Buffier,
Du Marsais,
Beauzée et
Destutt
la copule (ou le verbe) est alors une partie
l'attribut.
l'~ge
forme
toutes
la syllogistique n'est pas
de
essentielle
La logique for . . l l . n'est pas très
classique;
la
cultivée
à
considérée comme un
véritable instrument de découverte, ni l'instrument privilégié de
la
Raison
dans
scolastiques
les
sciences.
Tout
ce
fatras
embrouille et alourdit la démarche de
lieu d'accélérer sa progression.
de
règles
l'esprit
au
Descartes et Locke opposent une
sorte d'intuitionnisme au formalisme de la logique médiévale;
ce
qui
la
importe,
nécessité
dans
le
Royal,
du
c'est
de saisir clairement
et
distinctement
lien qui unit chaque proposition à
cours d'une démonstration.
la
précédente
de
Dans la Logiqu.
la logique formelle occupe moins du sixième de
(Pariente, op. cit., p. 113).
Port-
l'ouvrage
La tendance s'accentue encore dans
les logiques de Du Marsais et Condillac. La logique classique est
d'abord une discipline destinée à "former le jugement"; le centre
d'intér@t
de la logique se déplace du raisonnement (théorie
inférences) vers le jugement (théorie des propositions).
est
l'un
des rares philosophes classiques qui aient
cette tendance,
p.
425).
Leibniz
résisté
à
lui qui persistait à voir la syllogistique comme
un "art d'infaillibilité" (Houv •• ux .ss.is ••• ,
XVII,
des
Ce
"calcul
des idées"
Page 76
Livre
qu'est
IV,
la
chap.
logique
classique
est pour une large part fondé sur la fameuse
Port-Royal"
"Loi
de
sur la variation inverse de la compr6hension et
de
l'6tendue des idées (ou concepts)
plus un concept est riche en
compréhension, moins il. a d'étendue, et plus il a d'étendue, plus
pauvre sera sa compréhension.
nous
donnons
"renfermé e"
notre
(ou
Le jugement est un acte par lequel
assentiment
au
"contenue") dans une
fait
qu'une
autre.
idée
Ainsi,
est
la phrase
"L'homme est un animal rationnel et sociable" exprime le jugement
que les idées d'animalité,
de rationalité et de sociabilité sont
contenues
dans celle d'humanité;
mais le jugement
"L'animal
est
recevable,
homme"
n'est pas
parce
exprimé
que
par
l'idée
d'animalité est "plus générale" que celle d'humanité. En général,
si • et b sont des idées,
moins générale que",
alors. + b = •.
Si
la
et si "(" repré sent e la rela t i on
"~tre
alors, dans la logique classique, si • ( b,
(cf., Auroux et Rosier, 1987, pp. 16-17).
logique
classique
est
essentiellement
aristotélicienne, la psychologie de l'époque a plutôt des allures
La
cartésiennes.
acceptent
plupart des auteurs que nous
considérons
ici
en effet la distinction cartésienne entre l'ame et
corps;
c'est le caB,
Marsais
(1.)
et
par exemple,
Condillac
(17)
le
d'empiristes avoués comme Du
qui suivent par ailleurs
Locke
dans son rejet des idées innées et l'importance qu'il attache aux
sens et à l'expérience.
C'est bien davantage la genèse des idées
et connaissances que la nature de l'esprit qui est en cause
Page 77
dans
la
querelle opposant les sensualistes aux
m~me
c ' est
là le seul critère valable permettant de démarquer les
groupes. Le "matérialisme vulgaire"
est foncièrement spiritualiste.
se
rationalistes;
donne
principalement pour
l'esprit,
genèse
diffère
mis à part, le XVIII- siècle
La théorie classique de l'esprit
t~che
de déterminer la
de ses facultés et de ses opérations,
de
nos
idées et
grandement
Descartes,
connaissances.
L'~me
d e celle d'Aristote.
Sous
se
l'~me
voit
retirer
toute
L'explication de ces fonctions vitales
circulation
sanguine,
physiologie
conçue
Nul
de
besoin
piné al e" ,
Cette
est
comme un
conception,
bien
l'animisme,
chap.
1).
classiques
l'influence
des
vitale.
digestion,
l'affaire
de
de
de
la
univ.r •• l.
la
" glande
"animaux-machines " .
jamais
l'unanimité;
par
avec G.H. Stahl, devait faire un retour en
force au XVIII- siècle (cf.,
La.itr.s,
et
ne fit
sllr,
des
mjcani.m.
chapitre du
de
et d'étudier la
(respiration,
maintenant
" esprits animaux"
nàture
fonction
rappeler ici le fameux épisode
des
exemple,
etc.)
deux
F.
Duchesneau,
L. Physiologi. d.s
Mais la distinction cartésienne des
deux
substances (étendue et pensante) étend son ombre sur pratiquement
toute
la
période
maintenant
l'idée.
Et
un
qui nous occupe.
ab~me
En
entre l'idée et la
dans le r.pr' •• ntatiannali.m.
il
conséquence,
chose
représentée
classique
y
a
par
(exception
faite des co ••on s.ns. philosoph.rs qui s'écartent de l'"idéisme"
lockien) ,
les
connaissances.
que
reçoit
matière)
idées
les seuls objets
immédiats
Dans la psychologie aristotélicienne,
l'~me
des
sont
perçus
eux-mêmes.
Page 78
Dans
la
nos
les formes
(sans
dans la sensation sont les formes
objets
de
leur
nouvelle
"psychologie rationnelle", les choses relèvent de la r.s .xt.ns.,
et les idées,
de la r.s cogit.ns
passer dans les secondes;
rien des premières ne peut
ou plutôt, l'esprit, ses facultés, ses
opérations
et
devant
monde des choses étendues.
le
s es
idées ont maint enant
subjectivité JJ
,
psychologie
retient
une
ré ell e
Cette
"découverte
la tradition l'attribue à Descartes.
cependant
de l'ancienne
la
des
auteurs
pensée
De plus,
ou entendement et volant..
classiques,
sont
demeurés
division
la
anciens
expression;
présentes
pensée
toutes
est
déjà
là,
que
faite,
les parties d'une pensée sont
à l'esprit du locuteur,
croy.nce
ou
langage
m~mes
toute
exemple,
la
les
avant
son
simultanément
alors que l'expression de
dans une phrase française
précède le substantif,
et
chez
pensée dans le discours doit forcément s'ordonner dans le
Par
des
pour la plupart
les rapports entre le
essentiellement les
de la
La nouvelle
facultés actives de l'âme en perception et volant.,
et d'.ir,
aut onomi e
déclarative,
la
temps.
l'article
celui-ci précède normalement le verbe, le
verbe son complément, etc.
Cependant, les penseurs des Lumières,
en
seront de plus en plus sensibles
particulier Condillac,
effets positifs de l'acquisition du langage sur le
de la pensée.
Mais
m~me
aux
développement
Condillac sera critique à l'égard de sa
première tentative de 1746; en effet, dans la lettre à Maupertuis
citée
plus haut,
JJtrop
donné aux
progrè s
le
il avoue finalement s'
signes"
en voulant
~tre
faire
"trompé JJ
"voir
de l' espri t dépendent du langage. JJ ( 1 . )
besoin
de
communiquer aux autres
nos
Nous
pensées;
et
comment
avoir
les
ressentons
mais
pour
arriver à les communiquer clairement et efficacement, nous devons
Page 79
d'abord
les analyser,
les diviser en parties et
parties successivement et dans le bon ordre.
Condillac,
pensée;
427) .
Les
présenter
ces
langues,
pour
sont les instruments nécessaires de l'analyse de
la
"m6thod •• &n&lytiqu•• "
p.
elles
sont des
(Sr •••• ir",
Cette mise en valeur du langage comme analyse de la pensée
et de l'expérience, et la notion de
1
9 6ni." que nous verrons plus
loin (chap. 2), atténuent quelque peu, il me semble, la portée du
reproche
adressé
langage,
celui
"sac à mots",
Condillac
"Une
régulièrement
avec la
douées
phonique ... Il
d'un
l&ngu.
de la
est un instrument de
comme
classique
"nomenclature",
selon
communication
Martinet
selon
lequel
différemment dans chaque communauté,
contenu
du
(Comparez la conception de
< 1.)
définition
l'expérience s'analyse,
unités
conception
de concevoir le langage
ou "répertoire"
langue
à la
sémantique
et
d'une
en
expression
(20»).
La psychologie des Lumières fait aussi une
l'& •• ociationni.m.; les
large
place à
"associations d'idées" sont d'une grande
variété et ces associations, tant naturelles que linon naturelles"
(le cas des superstitions et des oeuvres d'imagination), sont des
trouble-fête
linguistique
qui
manifestent
leur
présence
sur
le
plan
et dont l'analyse classique du langage cherchera
rendre compte, en partie, à l'aide du concept d'idée accessoire.
Page 80
à
(Le lecteur
trouvera chez S.
chap. 1) deux
intéressé
par la théorie classique des
Auroux (1979,
excellentes
chap.
études
3) et M.
formelles
idées
Dominicy (1984,
et
détaillées
de
cette théorie)
4) Il Y
de. univer.Aux linguistiqu•• substAntiel ••
A
m~me
La pensée est la
est
l ' analyse
produire
une
complète,
ou l'expression de la
"image",
claire
et
grammaticalement
est
langage
Le
langage
une repr6.entAtion de
la
pensée
du moins
doit
aussi
dans
les
et "policées". La proposition considérée
la représentation d'un jugement
"action de notre esprit".
l ' esprit (désirer,
le
pensée.
précise que possible,
langues "perfectionnées"
autre
partout et pour tous et
interroger,
mêmes partout et pour tous,
ou
d'une
Le jugement et ces actions
de
commander, prier, etc.) sont les
et les êtres humains, pour analyser,
représenter et communiquer la pensée, ont eu recours sensiblement
à
la
même
méthode,
pourrait dire,
aux
mêmes
catégories
d'expressions.
reprenant la distinction de Quine
Lagie, 1970, pp. 19-20),
On
(Phi losophy of
que la Grammaire Générale cherche avant
tout à rendre compte des catégories trAn.cendAnte., l'explication
des catégories
immAnente.
étant
particulières.
Page 81
l'affaire
des
grammaires
Partant d'une analyse de la proposition
Prédicat
(ou
Sujet-Prédicat),
les
en
Sujet-Copule-
grammairiens
philosophes
estimaient, suivant en cela une très longue tradition remontant à
Platon et Aristote,
que toutes les langues devaient disposer
moyens pour "marquer",
ce que nous
ensuite,
d'abord,
voulons dire
l'action de notre esprit qui
commande,
de
les objets que nous
de
affirme,
ces
nie,
concevons;
objets;
et
enfin,
désire,
interroge,
prie, conjoint, etc. Une langue qui ne disposerait pas
moyens
pour remplir ces fonctions serait,
incomplétude expressive,
cause
à
un bien piètre outil de
de
développement
doivent
donc
disposer
son
communication.
Les langues policées ou ayant atteint une certaine maturité
leur
de
de
noms
dans
communs
(appellatifs) et des déterminants
(articles,
que
pour désigner les
objets
que
concevons et les relations possibles entre ces
objets
(ou
Toutes
les
nous
des prépositions ou des cas,
certaines
circonstances
pouvant
les
langues doivent pareillement avoir,
la pensée,
nous
"@tre",
affecter).
pour
analyser
des adjectifs ou des participes,
affirmons
ou nions des
objets
le verbe "substantif",
adjectifs),
conçus.
ainsi
complètement
pour marquer ce que
Enfin,
le
leur paraissait nécessaire
verbe
dans
toutes les langues pour marquer l'action de notre esprit qui unit
les deux termes
des
(Sujet-Prédicat)
grammairiens
"primitives",
de la pensé e,
philosophes
d'une proposition.
La plupart
distinguent
catégories
les
qui sont nécessaires à la représentation complète
des catégories
"dérivées" (comme les adverbes, ou
Page 82
les conjonctions chez Condillac et Destutt
utiles mais non nécessaires
à
et qui s'obtiennent à partir
abréviation; ce sont des
de
Tracy),
la représentation
des primitives
de Destutt de Tracy. Ce dernier distingue
de la
par
"mots elliptiques",
qui sont
pensée,
contraction ou
selon l'expression
soigneusement ce qu'il
appelle les 6l6m.nts d. lA proposition, c'est-à-dire les éléments
nécessaires
à
la
représentation complète
de
la
pensée,
des
6l6m.nts du discours,
qui sont dérivés ou composés des premiers.
Les catégories jugées
Ilnécessaires"
pensée
le sont
à la
représentation de
parce qu'elles reflètent la structure de
la
notre
esprit, et principalement la structure du jugement.
La primauté du jugement,
le fait que nous parlons
presque
nions, voulons,
toujours pour dire ce que nous affirmons,
etc. ,
et très rarement pour dire seulement ce que nous concevons,
nous
oblige
nous
à
utilisons
lier
les unes aux autres
pour
former
"toutes
l'allocutaire;
une
seule
les
les
expressions
pensée
dans
écrit
langues,
l'esprit
Du
conviennent en ce qu'elles ne forment de sens que par le
ou
la relation que les mots ont entre eux dans la
(Fr.g •• nts sur 1.s c.us.s d. 1. p.ro1.,
228;
voir
aussi l'art.
in
"Construction" de
~.ri.
que
de
Marsais,
rapport
proposition."
1ing~istic.,
l'Enc,/c1op'di.).
p.
La
syntaxe est ainsi l'étude des signes établis dans une langue pour
marquer le nombre,
les cas, etc.,
le genre,
la personne, les temps, les modes,
et des règles d'après lesquelles les mots doivent
Page 83
être ordonnés et accordés pour former un seul sens dans
de
l'auditeur.
d'autres
ne
Certaines
concernent
Condillac,
chap. IV:
est
que les
6r •••• ir.,
règles
langues
1775,
p.
"Une syntaxe sémantique")
pratiquement
grammairiens
soutenait
signes
ces
la
universelles;
mots
Du
(cf.,
particulières
pp.
153-
443; et S. Auroux, 1979,
La "syntaxe de convenance "
même dans toutes
de Port-Royal.
que les
sont
9r •••• ir. g4n4r.l • • t r.isonn4.,
Arnauld et Lancelot,
154;
de
l'esprit
les
Marsais
langues
(art.
sont à la fois les
selon
les
"Construction " )
instruments et
de la division ou de l'analyse de nos
pensées;
les
nous
ne
pouvons parler à quelqu'un sans analyser nos pensées au moyen
de
signes;
or,
il n'y a, dans toutes les langues du monde, "qu'une
même manière nécessaire pour former un sens avec les mots
c'est
l'ordre
mots,
dont
successif des relations qui se trouvent entre les
les
uns
sont
énoncés
comme
devant
être
& les autres comme modifians ou déterminans"
dé terminé s ,
comparez avec J. H. Greenberg,
"Construction";
(art.
of
Meaningful
in J. H. Greenberg (éd.), Univ.rs.ls of L.ngu.g.,
1966,
p.
76).
modification,
et
le rapport d'identité
édit. ,
ou
"Sorne Universals
of Grammar with Particular Reference to the Order
Elements",
modifiés
Ces
rapports
de
détermination
(sur lequel se
ou
de
fondent
partout, par exemple, les règles pour l'accord de l'adjectif avec
son substantif en genre et en nombre),
construction
analytiqu.
"simple") ,
"naturelle",
usu.ll.
règles
et figur6.
de
la
(ou
laquelle
sont les fondements de la
construction
s'oppose
qui varient d'une langue à
construction analytique ou
Page 84
"nécessaire",
aux
constructions
une
nécessaire
autre.
(la
Les
même
partout)
engendrent,
profondes",
et
si
reflètent
l'on
peut
dire,
les
les conditions nécessaires
"structures
de
toute
compréhension linguistique. Les idiotismes et les énoncés figurés
ne
la
seront compris par un auditeur que s'il parvient à
construction
analytique
sous
constructions usuelle et figurée.
les
déguisements
méthode
d'analyser la pensée,
d'analyse
de
des
Condillac, qui considérait les
langues comme autant de "méthodes analytiques",
manières
retrouver
ou
prétendait lui aussi
la pensée qu'est
le
langage
différentes
que
cette
avait
des
aspects universels. Il définissait ainsi l'objet de la Grammaire:
On appelle gr •••• ir. la science qui enseigne
les principes et les règles de cette méthode
analytique.
Si elle enseigne les règles que
cette méthode prescrit à toutes les langues,
on la nomme gr •••• ir. g'n'r.l.;
et on la
nomme gr •••• ir. p.rtieulitr.,
lorsqu'elle
enseigne les règles que cette méthode suit
dans telle ou telle langue:
(8r •••• ir., p.
443) .
Quel est le statut de ces règles "universelles" enseignées par la
Grammaire
Générale?
Il semble que nous ayons là affaire
règles nommées par Searle eonstitutiv.s.
générale
les
de Port-Royal", op. eit.,
règles
universelles
de
p. 7)
la
distingue
Grammaire
"règles auxquelles
qu'une langue
pouvoir exister".
règl es,
clairement
Générale
il s'agit plut8t,
faut bien
des
Foucault ("La grammaire
"prescriptions d'un législateur";
il
à
dit-il,
s'ordonne
des
de
pour
M. Auroux (1979, p. 231, note 171) dit que ces
"dans une large mesure", sont des règles "constitutives"
en référant à Searle (Sp •• eh Rets, 1969). Les règles universelles
Page 85
du
langage
comme méthode d'analyse de la
être conçues comme des
(Rsp.cts
pensée
"universaux de forme"
peuvent-elles
au sens de Chomsky
d. l. th4ori. SVnt.xiqu., 1971 pour la trad. fr.),
des
universaux qui "mettent plutôt en jeu le caractère des règles qui
apparaissent dans les grammaires et la façon dont
être corrélées" (p. 48)?
elles
Chomsky lui-même (ibid.,
la Iigrammaire universelle traditionnelle"
peuvent
p. 47) décrit
uniquement comme
Ilune
théorie des universaux de substance ll et Àuroux fait de même
(ilLe
rationalisme et l'analyse linguistique", op. cit., p. 11).
Chomsky,
l'étude
des
universaux
formels
(ces
conditions
abstraites que doivent satisfaire toutes les grammaires
possibles)
est
une entreprise récente en
Selon
théorie
humaines
générale
du
langage. Les règles universelles de la construction analytique et
de
l'analyse
linguistique
de la pensée ne
telles conditions abstraites affectant
sont-elles
pas
"le caractère des
qui apparaissent dans les grammaires"
de
règles
de toutes les langues?
Je
me contenterai ici de laisser cette question ouverte.
L'universalité
dont
il s'agit n'est
universalité qui ne laisse aucun choix,
langues sans exception ses catégories.
voit
les
grammairiens
philosophes
les
Générale
champ
des
sont
universelles
phénomènes
(cf. ,
forcément
une
qui impose à toutes
les
M. Àuroux (1979, p. 226),
évoluer
catégories
en ce
sens
Destutt de
Page 86
pas
vers
de
qu'elles
Tracy,
un
la
concept
Grammaire
épuisent
le
Sr •••• ir.,
p.
152). Toutes les langues doivent avoir recours à l'une ou l'autre
des
catégories
n'est
Nous
recensées dans la Grammaire
nullement
Générale;
nécessaire qu'une même langue les
mais
ait
toutes.
retrouvons le même type d'universalité dans la théorie
actes de discours;
n'importe
quelle
mais
il
des
n'importe quel acte illocutoire accompli dans
langue doit entrer dans l'une ou
l'autre
cinq catégoriss d'actes illocutoires primitifs reconnues dans
théorie;
il
n'est
nullement nécessaire
que
toutes
des
la
les
langues disposent de moyens syntaxiques pour exprimer directement
tous
ces
actes de discours (très peu de langues ont
syntaxe les moyens de former,
promissif) .
par exemple,
dans
leur
des phrases de
type
Il en va de même avec les "traits distinctifs" de la
phonologie.
Les grammairiens philosophes voulaient expliquer
est
commun à toutes les langues";
montrer
que
toutes les langues,
complètement la pensée,
ils
pour ce faire,
pour analyser
et
qui
devaient
représenter
doivent disposer de parties du
remplissant partout les mêmes fonctions
puisque le systême des idées a par-tout les
mêmes fondemens,
il faut que le systême des
langues soit, pour le fond, également le même
par-tout; par conséquent,
toutes les langues
ont des règles communes; toutes ont des mots de
différentes espèces; toutes ont des signes pour
marquer les rapports des mots.
(Condillac,
Sr •••• ir., p. 435).
Page 87
"ce
discours
Sans verbe, par exemple, nous ne pourrions "prononcer", comme dit
Condillac, aucun jugement.
Mais, encore une fois, l'universalité
dont il est ici question n'en est pas une qui impose
forcément à
toutes les langues les m@mes catégories, en particulier parce que
toutes
les
"perfection"
langues
n'ont
pas
atteint
le
dans l'analyse de la pensée,
peuples "primitifs" et isolés,
m@me
degré
de
comme les langues des
qui analysent peu la pensée parce
qu'ils ont peu de besoins qui les y poussent.
~)
L'USAg_ normAl d_ lA pAraI • •st un. Activit' rAtiann.ll.
orient'. v.rs un. fin.
Pour les
le
rationalistes
langage est
(Port-Royal,
(Descartes,
Arnauld,
l'''une des plus grandes preuves
1660,
p.
l'instrument de la Raison,
dessus des bêtes"
Les
27) .
langues
de
sont
Cordemoy) ,
la
raison"
l'oeuvre
une faculté qui nous place "fort
et
au-
et qui est de loin supérieure à leur instinct.
Tous les commentateurs s'entendent là-dessus. Mais aux empiristes
(ou sensualistes), on attribue souvent
Condillac
nature"
en
ces termes
(8,. •••• i,..,
p.
(21)
"les langues sont
432).
de
l'origine
philosophes (Beauzée,
des
l'ouvrage
Rationalistes et
seraient encore une fois opposés sur une
question
la thèse formulée par
langues;
question génétique,
certains
la
sensualistes
la
grammairiens
Beattie) préfèrent encore adopter,
Page 88
de
en
se
chap.
la thèse de l'origine divine.
lieu
entre
les
"rationnelle"
II, versets 20-22),
Mais la véritable lutte aurait
partisans
des langues,
(rationalistes)
de
eu
l'origine
et les partisans (sensualistes)
de
l'origine "naturelle".
Il me semble que cette façon de voir sous-estime grandement
le
caractère
profondément
sensualiste.
J'estime
"rationaliste"
de
la
philosophie
de plus que le slogan de Condillac
("les
langues sont l'ouvrage de la nature") doit âtre réinterprété à la
lumière de sa philosophie de la Raison et de sa notion de natur •.
Mes conclusions rejoignent en partie celles de Cassirer
(22),
qui
voyait les rationalistes et les empiristes,
à part égale,
comme
des
langues
libre
partisans
de
création de la
philosophe,
Bouveresse
thèse
faisant . des
"une
raison humaine"; elles rejoignent aussi celles de
(23)
Aarsleff
la
il
qui
suffit
(24)
proclame
d'âtre
que
pour
grammairien
être
"rationaliste";
celles
de
qui reproche à Chomsky d'avoir sous-estimé
le
caractère rationaliste de la pensée de Locke.
sens
étroit
des
"Rationaliste"
doit pas être pris
ici
philosophie,
qui ce terme désigne avant tout un groupe
pour
au
et
historiens
penseurs partisans de la thèse de l'innéité des notion.
(Descartes,
Wolff,
Arnauld,
etc.).
Cordemoy,
Malebranche,
ne
de la
de
commun ••
Spinoza, Leibniz,
L'interprétation de Chomsky (1966, en particulier
la section intitulée "L'acquisition et l'utilisation du langage")
a
le
défaut
d'associer
la
"linguistique
Page 89
cartésienne"
à
l'innéisme
provoquer
pouvait
des
la
~tre
rationalistes;
réaction des
la
à
historiens qui
grammairien philosophe
Locke et Condillac
alors
ce qui eut pour
voyaient
(A.
Joly) ,
ou
Stefanini)
aristotélicienne" (J.
fait fausse route
cartésienne"
de
bien qu'on
montrant partisan de
(comme l'avait vu Harnois, 1929).
"linguistique
condillacienne"
en se
conséquence
Iigrammaire
la
Chomsky,
opposa
III ingui st ique
la
mÊ!me
On
me semble-t-il,
a
les notions communes (ou idées innées) n'ont
rien à voir avec l'idée que l'usage normal de la parole est
"une
des plus grandes preuves de la raison".
voir
Elles n'ont rien à
non plus avec l'idée que les langues sont l'oeuvre de la
Chomsky
a
peut-~tre,
linguistique
des
dans
son
classiques,
enthousiasme
injecté dans
pour
son
Raison.
la
pensée
interprétation
quelques-unes de ses propres idées concernant l'apprentissage
langage ...
remarque
sans
Il insiste sur les passages de Descartes où
que
peine
m~me
les hommes les plus "hébétés"
à
comprendre en créant eux-mêmes des signes à cet effet,
les animaux,
celui-ci
peuvent
et que les sourds et muets parviennent
même les plus parfaits de leur espèce,
du
se
parler
faire
alors que
n'arrivent
pas à en faire autant. Mais cela montre seulement combien il faut
peu de raison pour être capable de faire usage de la
que la Raison est le propre de l'homme;
seul animal capable de parler.
y a,
of
L.ngu.g.)
démontrer
et
voilà pourquoi il est le
On ne peut conclure de cela qu'il
pour Descartes et les classiques,
"faculté de langage"
parole,
une telle chose
qu'une
innée. Monboddo (Of th. Origin .nd Progr.ss
consacrera
une
bonne partie
de
son
la fausseté de cette idée qui fait de la
Page 90
ouvrage
"faculté
à
de
langage" une faculté "na t urell e l l aux humains.
Je voudrais,
dans cette section,
esquisser une
certaine
conception de la rAtionAlit6 prAtique; il s'agit d'une conception
de " sens commun",
jamais vraiment thématisée par les philosophes
classiques mais constamment utilisée par eux dans leur théorie de
l'origine
et
conception
aux
l'évolution
qui
langues;
et
est sous-jacente à
(principalement,
me
semble
c'est
cette
commune aux rationalistes
l'idée
de la parole est une activité rationnelle
fin
Agassi
des
de la raison pratique,
sensualistes,
normal
une
de
la communication
dans le vrai lorsqu'il
des
que
l'usage
orientée
pensées).
écrit,
propos
à
et
vers
J.
du
problème de la rationalité pratique
"In the Age of Reason, the
Enlightenment,
the question was known but
th. Rufklirung (sic),
not discussed." (Sci.nc • •nd Soci.ty,
classiques
ont
avancé
plusieurs
soulever
p.
idées
beaucoup
458).
sur
le
sujet,
ou
de
sans
polémiques.
Je crois que cette conception de la raison pratique
par certains traits,
ce
nous
sens
que
"maximiseurs";
sommes des
discussions
mais
apparemment
se rapproche,
de
Les philosophes
de celle de Simon (1957), en
s.tisfic.rs
avant
d'~tre
des
par d'autres traits, elle rappelle celle de Rawls
(1971) et Richards (1971) parce que les explications données
par
les grammairiens philosophes font souvent appel, implicitement ou
explicitement, à des mAxime. de chaix rAtionnel.
Page 91
Les
sensualistes,
pas
moins que
les
rationalistes
et
souvent davantage, ont préféré l'autorité de la Raison à celle de
la Tradition;
la méthode,
moins
que
les
rationalistes,
ils
Chouillet
cru
trop
aux
aux
nous rappelle fort
historiens doivent se méfier des
" a f fa ire
ont
ont fait la lutte aux préjugés,
Jacques
s'empresse
de
de l'éducation, de la tolérance politique, etc.; pas
"lumières",
etc.
eux aussi ont fait la promotion de la science,
progrès
superstitions,
justement
"étiquettes"
"D' une
manière
que
les
commodes que l'on
souvent d'accoler à un auteur avec
c las sé e Il
des
générale,
la
mention
ces
grandes
classifications philosophiques qu'on a coutume d'opposer les unes
aux autres,
sensualistes,
rationalistes, n'existent que dans la
conscience universitaire du siècle suivant,
des
contemporains."
philosophiques"
(~t5)
Ces
"grandes
mais elles n'ont rien de définitif.
vrai en particulier pour le XVIII- siècle;
être
considéré
pour lui-même.
On
doit
pas,
s'étonner de rencontrer des thèses rationalistes et
Paul
Hasard
l'ordre
Cela est
chaque auteur devrait
ne
chez les mêmes auteurs de l'Rafklirang.
celle
classifications
sont sans doute commodes pour mettre de
dans nos archives,
y
mais non dans
au
fond,
sensualistes
Comme le dit prudemment
"l' esprit du XVIII- siècle,
tel qu'il prend
ses
racines dans le XVIIe, est rationaliste par essence, et empiriste
par transaction."
(~.)
Pierre Chaunu semble du même avis
la démarche des Lumières
sens"
Il
découle ...
(~7)
Page 92
de la raison
toute
et
des
Un
examen
rationalistes
divergences,
et
le
comparatif des conceptions de
des
la
empiristes révèle au fond
Raison
assez
des
peu
principal objet de litige étant le statut
de
des
notions communes.
Pour les deux clans,
la Raison est une faculté donnée
Dieu aux hommes pour leur permettre de découvrir et de
par
justifier
la vérité dans les sciences, et pour choisir (ou reconnaître) les
actions
qui
peuvent
le mieux
assurer
leur
Salut.
Pour
les
philosophes classiques, c'est dans les sciences que la Raison est
à son mieux et se manifeste de la manière la plus éclatante. Mais
le rappelle Condillac (Dictionn.ir.
comme
"Bon sens",
p.
95) ,
n'est
pas
pleinement
Sinon bien
et bien démêler ce qu'il faut penser
tout à la fois la théorie et
seulement
dans
usage
sa Raison.
de
art.
la Raison concerne tout autant la pratique
voir ce qu'il faut faire
embrasse
synony•• s,
"Qu'est-ce en effet que la r.ison?
que la théorie
elle
d.s
les sciences
On la
que
la
pratique."
l'on
retrouve
partout
dans
des hommes.
rationnelles,
il Y a tout l'art quotidien de l' à-peu-près , de la
du "seulement probable",
tout exclue.
extrême
pour
des
faire
l'"industrie"
prudence,
A côté de la certitude
peut
Ce
et la Raison n'en est pas du
Descartes n'écrit-il pas :
"Et j'avais toujours un
désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec
voir clair en mes actions,
sciences
le
et marcher avec assurance
Page 93
faux,
dans
cette vie. 11
56;
je souligne).
chapitre XVI de la quatrième partie de la Logiqu.
justement
à
"nous
rendre
plus
espérances & nos craintes. Il (P. 429).
leur
Port-Royal
IIDu jugement qu'on doit faire des accidents futurs ll )
(inti tulé
vise
de
Le
ouvrage
en
rappelant
que la
raisonnables
dans
nos
Et les Messieurs finissent
pire
des
imprudences
est
d'employer son temps et sa vie à autre chose que la recherche
Salut éternel,
du
et que
Ceux qui tirent cette conclusion, & qui la
suivent dans la conduite de leur vie,
sont
prudents et sages,
fussent-ils peu justes
dans tous les raisonnements qu'ils font sur
les matières de science; & ceux qui ne la
tirent pas, fussent-ils justes dans tout le
reste, sont traités dans l'Ecriture de fous
et d'insensés, & font un mauvais usage de
la Logique, de la raison & et de la vie.
(P. 431).
Descartes,
néanmoins
le grand champion de la raison théorique,
souhaitait
que la Nouvelle Science servit à réduire les
l'humanité
et à la soulager des tâches les plus
maux
ingrates.
de
Dans
Garnier
Frères,
1963,
rechercher
seulement
p. 79),
il écrit,
sérieusement
à propos de
"celui qui veut
la vérité des choses ll
à développer la lumière naturelle de
pour résoudre telle ou telle difficulté d'école,
"qu'il
sa
songe
raison,
mais pour qu'en
chaque occasion de sa vie son entendement montre à sa volonté
choix qu'il faut faire l l
•
Et lorsqu'il écrivait que le
est la chose du monde la mieux partagé e ll ,
Page 94
non
le
Ilbon sens
il ne pensait sOrement
pas à la seule communauté des "sc;avants".
abord et le plus souvent pratique,
La Raison est de prime
c'est-à-dire:
recherche des
moyens les plus apprapri •• à la réalisation d'une fin,
du
meilleur
moyen à prendre en vue d'une fin.
La
chaiK
ou
faculté
par
laquelle nous distinguons le vrai du faux est un don du Ciel pour
la conduite de la vie en général, et pas seulement pour atteindre
le vrai dans les sciences.
que
les
Messieurs
C'est l'une des premières
s'empressent
de donner
au
précisions
tout
début
du
"Premier discours" de leur Logiqu..
Ce n'est pas seulement dans les sciences qu'il
est difficile de distinguer la vérité de l'erreur, mais aussi dans la plupart des sujets
dont les hommes parlent, & des affaires qu'ils
traitent.
Il y a presque par-tout des routes
différentes, les unes vraies, les autres fausses; & c'est à la raison d'en faire le choix.
Ceux qui choisissent bien, sont ceux qui ont
l'esprit juste; ceux qui prennent le mauvais
parti,
sont ceux qui ont l'esprit faux,
&
c'est la première & la plus importante différence qu'on peut mettre entre les qualités de
l' espri t des hommes." (P. 35; je soul igne) .
Les sciences,
sont
considérées
déclarées inutiles.
"en elles-m@mes & pour
C'est très bien
elles-m@mes",
d'utiliser sa
pour trouver (et prouver) les vérités dans les sciences,
devrait surtout se "servir au contraire,
Raison
mais on
des sciences comme d'un
instrument pour perfectionner sa raison." (Ibid.) Les Messieurs y
insistent encore à la page suivante :
Les hommes ne sont pas nés pour employer
temps à mesurer des lignes, à examiner les
ports des angles, à considérer les divers
Page 95
leur
rapmou-
vements de la matière. Leur esprit est trop
grand, leur vie est trop courte, leur temps trop
précieux pour l'occuper à de si petits objets
:
mais ils sont obligés d'~tre justes, équitables,
judicieux dans tous leurs discours, dans toutes
leurs actions, & dans toutes les affaires qu'ils
manient; & c'est à quoi ils doivent particulièrement s'exercer et se former.
Nous
reviendrons
sur la rationalité pratique et
la
notion
de
choix rationnel dans un moment.
Les succès retentissants de la Nouvelle
Science
mettaient
surtout en vedette la raison théorique. Locke (quatrième Livre de
l'Ess.y ••• , chap. XVII) et Leibniz (Houv •• ux .ss.is ••• , Livre IV,
chap.
XVII) distinguent divers usages du mot "raison". Il Y a un
usage où ce mot est opposé à "foi",
et
un usage que critique
qui ne nous intéresse guère ici (Ess.y ••• ,
XVII,
paragr.
24) .
XVII,
paragr.
1)
finale";
Livre
Locke
IV,
chap.
Locke distingue encore quatre usages (chap.
"raison" se prend quelquefois pour
ou pour un ensemble de principes d'une vérité
"cause
évidente
ou pour des déductions faites à partir de
principes.
Enfin, et c'est ce dernier usage qui nous intéressera
dans la suite,
se distingue des
facul té,
vérités
ces
nous
"raison" désigne une faculté par laquelle l'homme
b~tes
et les surpasse de beaucoup. Gr1ce à cette
percevons
les
rapports
nécessaires
entre
et pouvons étendre nos connaissances au-delà du
limité de nos intuitions et perceptions.
Page 96
les
domaine
Pour les classiques, la Raison est avant tout une faculté de
disc.rnement (analyse) et de liaison (synthèse).
distinguons le vrai du faux,
laid,
ou
distinguons,
caractères
liaison
ou
le bien du mal,
etc.
des
parties,
Elle est aussi une
générales
un
dans
propositions)
s.ul
dans
(l'abstraction);
jugement,
un
idées
jugements
raisonnement,
et
de
individus
plusieurs
plusieurs
des
faculté
nous rendant capables de considérer plusieurs
un. s.ul. idée générale
sous
et même le beau du
dans une même chose,
qualités,
Par elle, nous
(ou
plusieurs
raisonnements dans un. s.ul. démonstration ou théorie <3.'. C'est
en
ce
sens
que la Raison est
faculté de discernement,
pensée
une
Comme
la Raison rend possible l'analyse de la
qu'on trouve déjà toute faite dans les langues
Marsais, Beauzée et surtout Condillac.
elle
discursiv•.
faculté
selon
Du
Comme faculté de liaison,
permet d'unir en un discours suivi les signes
d'une
foule
d'idées et de jugements.
Rationalistes et empiristes ne divergent sérieusement qu'en
ce
qui
concerne
le
statut
notions
des
commun.s.
Pour
les
rationalistes, la Raison a un cont.nu, comme l'a bien vu Cassirer
un
48) ,
principes
comme
"le
généraux
tout
et abstraits
d'une
est plus que l'une de
Page 97
contenu
certitude
ses
fait
de
irrévisable,
parties",
"si
on
retranche
une m@me quantité à deux quantités
demeure", etc.
Parce que l'induction et
égales,
l'égalité
l'expérience ne peuvent
jamais nous donner de certitude qui égale celle de ces principes,
les
rationalistes
inné es.
ont
conclu
Les sensualistes,
possible
au contraire,
innés
des
rationalistes
"proverbes des philosophes",
s'en
Condillac
abstraits"
Spinoza,
Malebranche,
systèmes
étaient
croyaient malgré
Condillac
qu'ils
ne
disait
sont
prend
Leibniz) .
l'arbitraire
à
des
(nommément
Les
Descartes,
principes
abstraits
qu'une maison est plus que l'une de ses pièces, etc.
ces principes dans un système est
ne
peuvent
jamais
conduire
à
parce que
doigt,
De plus, le
arbitraire
des
des
premières;
je peux observer à tout moment qu'une main est plus qu'un
principes
les
"systèmes
rationalistes ne sont pas des connaissances
de
des
que
je sais que le tout est plus que l'une de ses parties,
choix
tout
parce qu'ils présupposent une foule
rationalistes
des
connaissances
déjà acquises.
connaissances
(1749),
ces
de les dériver de l'expérience.
principes
de
que
et
ces
connaissances
particulières et utiles. Les seuls systèmes valables, aux yeux de
Condillac,
obs ervé s" ,
"Raison "
conceptions
sont
ceux
qui
se
fondent
la manière du système
à
l'Encyclopldi,
de
de
la Raison.
de
départage
Pris
sur
M.
fort
absolument,
des
"faits
L'article
Newton.
bien
le
bien
les
mot
deux
"Raison"
désigne une "faculté naturelle dont Dieu a pourvu les hommes pour
connaitre la vérité,
quelque lumière qu'elle suive,
ordre de matières qu'elle s'applique".
Page 98
& à quelque
Puis l'auteur ajoute:
On peut entendre par r.ison cette même faculté
considérée, non absolument. mais uniquement en
tant qu'elle se conduit dans ses recherches
par certaines notions. que nous apportons en
naissant. & qui sont communes à tous les hommes du monde. D'autres n'admettent point ces
notions. entendent par lumière naturelle. l'évidence des objets qui frappent l'esprit, &
qui lui enlèvent son consentement.
Mais cette divergence.
si importante soit-elle.
ne
prend
tout son relief que sur le fond d'un ensemble de similitudes. Une
comparaison
plus serrée
entre
Descartes
et
Condillac
est
à
mon avis fort révélatrice.
Si l'usage normal de la parole constitue pour Descartes une
"preuve de la raison".
universel
qui
peut
c'est que
servir
en
"la raison est un
toutes
sortes
cinquième Partie);
est
"faculté illimitée
une
Raison
est
ainsi
la
de
rencontres"
dit autrement. elle
d'innovation
seule de nos
instrument
adaptée"
facultés
qui
La
puisse
nous
rendre capables de faire un usage créateur de la parole. c'est-àdire
d'adapter
et
tous nos discours à n'importe
quelle
de répondre avec pertinence au sens
quel discours prononcé en notre présence.
de
situation
n'importe
Une machine peut bien
être construite de façon à répondre d'une manière appropriée à un
nombre
relativement
restreint
de
stimuli
déterminés;
par
exemple. elle pourrait demander ce qu'on lui veut si on la touche
à
tel
endroit précis.
ou dire qu'elle a mal si
Page 99
on
la
frappe
violemment,
etc.
Mais
façon lié aux stimuli;
d'un
locuteur
l'usage
le langage humain n'est jamais de
la parole n'est pas une réponse mécanique
à son environnement.
normal
de
cette
la
parole
L'emploi
est
libéré
des
de
identifiable (cf., S. Auroux, 1979, p. 44).
signes
tout
dans
stimulus
Parler n'est pas une
transaction causale avec le monde: c'est une activité rationelle
orientée vers une fin. L'usage normal de la parole est une preuve
de la Raison parce qu'il est "moralement impossible"
de
comme
animaux-machines.
d'inventions
Sans
ou
la
Raison,
d'innovations
le
nous
(Descartes)
comportement
serions
intentionnelles
des
incapables
adaptées
aux
situations nouvelles. Ce n'est pas seulement la capacité à former
des phrases nouvelles qui est la marque de la Raison; c'est avant
tout
le
caractère
parlante"
une
chose
de ce
appropri6
qui
est
dit.
est plus qu'une simple chose étendue
pensante,
dans
la
mesure
où
elle
La
"chose
elle est aussi
peut
arranger
diversement ses paroles pour répondre d'une manière pertinente
une
infinité
de
situations nouvelles.
Ce
qui
est
routinier, "mécanique", dans le comportement humain,
la
Raison
en
cause
habitudes,
ou
une routine,
"efficaces"
ou
(m@me s'il est
rationnel
lorsque celles-ci se
"appropriées";
c'est
surtout
à
habituel,
ne met pas
de
suivre
sont
leur
des
avérées
adoption
première qui met en cause la Raison) .
De
m@me,
pour
Condillac,
Page 100
c'est
dans
les
situations
nouv.ll •• que la Raison se met en vedette.
(1755), la Raison est présentée en ces termes :
La mesure de réflexion que nous avons au-delà
de nos habitudes est ce qui constitue notre
raison. Les habitudes ne suffisent que lorsque
les circonstances sont telles qu'on a qu'à répéter ce qu'on a appris. Mais,
s'il faut se
conduire d'une manière nouvelle, la réflexion
devient nécessaire, comme elle l'a été dans
l'origine des habitudes lorsgue tout ce gue
nous faisions étoit nouveau pour nous. (30) (Je
souligne) .
Nous
avons plus d'habitudes que les b@tes parce que
plus de besoins;
ne
sont
pas,
nous
mais les habitudes ne sauraient suffire: elles
il
s'en faut de
beaucoup,
en
proportion
l'infinie variété des situations et problèmes nouveaux
sommes
L'instinct des
susceptibles de rencontrer.
très sar,
avons
avec
que
nous
animaux
est
mais très limité; les @tres humains, par contre,
faillibles, mais leur Raison est
sont
illimitée et permet de répondre
adéquatement à n'importe quelle situation nouvelle.
Un autre point de comparaison intéressant entre
et
Condillac tourne autour de la notion de choix
point
est
création
particulièrement
et
l'utilisation
exercice de la volonté
important
des langues
parler,
pour
Page 101
rAtionn.l.
puisque
présupposent
c'est agir;
vouloir, et par suite, choisir.
nous
Descartes
Ce
la
le
libre
c'est donc
aussi
Au
début de sa quatrième
f.cult.s
,lig,ndi
(faculté
N4dit.tion,
d'élire
ou
de
équivalent de "volonté" et "libre arbitre"
la
(c'est-à-dire
circonstances) ,
ou
De fait,
représente
"le
il
Descartes,
à
été,
elles
(31 )
A. Kenny, 1970,
"meilleur"
"approprié"
moyen à
dans
degré
zéro"
de
si
la liberté
la
l'on
les
en
vue
d'indifférence
liberté"
(quatrième
De
veut.
est clair que les expressions
plus,
pour
linguistiques
ont
volontaire;
dit
ont été choisi •• comme moyen en vue d'une
fin
instituées par
communication
Réponses
bas
"degré
l'origine,
autrement,
pour Descartes,
plus
le
comme
J
du meilleur plan d'action à adopter
d'une fin.
N4dit.tion) ,
utilise
Nous agissons librement lorsque
plus
le
choisir)
(c f .
Raison prescrit à la volonté le choix du
prendre
(la
chap. 2).
1983,
et Nuchelmans,
Descartes
imposition
des idées et pensées).
Descartes
affirme
"
pour
l'ordinaire imposés par des personnes
fait
qu'ils
ne conviennent pas toujours
Dans
ses
les
cinquièmes
noms ont
ignorantes,
assez
été
ce
qui
proprement
aux
choses qu'ils signifient"; et dans les Princip.s d. philosophi. :
liA
peine
saurions-nous
concevoir aucune chose si distinctement
que nous séparions entièrement ce que nous concevons
paroles qui avaient été choisies pour l'exprimer"
sera le choix des mots,
représente,
langue
bien
choisi. avec soin.
les
(3::2)
Meilleur
plus parfaite sera la langue.
L'algèbre
à l'âge classique,
faite,
d'avec
l'exemple le plus achevée
d'une langue dont tous les signes
Ce n'est
que par la Raison que les
Page 102
d'une
ont
été
langues
peuvent se perfectionner, parce que seule la Raison rend possible
un quelconque progrès dans les affaires humaines, par le choix de
moyens
peut
plus appropriés aux fins poursuivies.
parfois
@tre fondé sur de mauvaises raisons (ce
arriver avec des "personnes ignorantes "),
arbitraire,
Le choix des
il
mots
qui
mais il n'est
peut
jamais
n'est jamais le fruit d'un simple hasard
ou
du
caprice, et la plupart du temps, ce choix, sans être le meilleur,
n'en est pas moins satisfaisant dans les circonstances
le moyen
choisi n'est peut-@tre pas le meilleur, mais il suffit à se faire
entendre.
Raison,
Si
et
on peut dire que les langues sont l'oeuvre de
que l'usage normal de la parole en est
c'est avant tout parce que
rationn.l,
et
pertinente et
qu'il
utilise
parce
qu'un
"responsable"
et
une
la
preuve,
les mots ont fait l'objet d'un
choix
locuteur ne peut parler d'une façon
sans
"analyser" les
choisir ( 3 3 )
pensées
les
qu'il
expressions
exprime.
Les
notions communes ou idées innées n'ont pas grand'chose à voir làdedans.
Chez Condillac,
à celle de volonté.
la notion de choix est analytiquement liée
Dans son Tr.it4 d.s .ni •• ax, il explique que
la phrase "je veux" ne signifie pas seulement qu'une chose
agréable,
mais encore qu'elle est l'objet de mon choix
m'est
(34).
Et
lorsqu'il explique, dans sa Sr •••• ir. (1775), pourquoi il préfère
parler
de
signes "artificiels" (comme d'ailleurs
[1675] avant lui),
Bernard
plut8t que de signes "arbitraires",
ceci
Page 103
Lamy
il écrit
En effet, qu'est-ce au fond que des signes
arbitraires? Des signes choisis sans raison
et par caprice.
Ils ne sauroient donc pas
entendus. Au contraire, des signes artificiels sont des signes dont le choix est
fondé en raison : ils doivent ~tre imaginés
avec tel art, que l'intelligence en soit
préparée par les signes qui sont connus.(3~)
Et un peu plus loin, il ajoute
On se trompe donc,
lorsqu'on pense que dans
l'origine des langues,
les hommes ont pu
choisir indifféremment tel ou tel mot pour
être le signe d'une idée. En effet, comment
avec une telle conduite, se seroient-ils entendus? (3.)
L. L.»9u.
Dans sa dernière grande oeuvre (d'ailleurs inachevée),
(parue en 1798),
IIEntre
Condillac écrit encore
plusieurs (expressions---A.L.)
il Y en a toujours une qui mérite
d'être
nos
préférée;
bien faites,
"Lorsqu'un
et
toutes
langues
seroient
si on avoit toujours su choisir .11
peuple choisit mal les analogies,
(37)
également
Plus loin :
il fait sa
langue
sans précision et sans goût, parce qu'il défigure ses pensées par
des
(3.)
images qui ne leur ressemblent pas,
Cela se produit
ou qui les
avilissent"
"parce que nous nous contentons de savoir
à-peu-près ce que nous voulons dire, et que nous nous embarassons
moins
avec
encore de savoir ce que les autres
des
expressions
qui
sont
disent,
à-peu-près
Page 104
nous
celles
qui
parlons
nous
conviennent. Il
Et en parlant des peuples,
(39)
au moment
de
la
formation des langues: " ... lorsqu'ils choisissent mal, ce n'est
pas qu'ils choisissent sans raison,
devroit
déterminer
offrir. Il
(40)
connaissances
ne
c'est que la raison qui
s'offre pas à eux,
Ils ne choisissent pas sans
et
ne
les
peut
raison,
mais
(les informations dont ils disposent)
s'y
leurs
sont encore
trop grossières pour leur permettre d'envisager 1. moyen le
propre
à
servir
leurs
fins
(celui
attendue ll ). Il en va ainsi, à l'origine,
pour les individus;
de la parole,
il en va encore de
dans les langues
soit,
qu'il
Iimaximise
l' utili té
pour les peuples
comme
m~me
pour l'usage normal
" po licées ll .
Dans la rhétorique
qu'il écrivit pour le jeune Prince
(1775) ,
qui
plus
de
Parme,
».
l'Rrt
d'~crir.
il lui explique "pourquoi, dans un cas donné, quel qu'il
il
y a toujours une expression qui est la
faut
Ilarbitraire",
savoir
saisir."
(41)
Plus
meilleure,
une
langue
et
est
plus elle est imparfaite; c'est pourquoi l'algèbre
est la seule langue Ilbien faite ll
Ilrien n' y paroit arbitraire ll ,
dit-il.
Mais les langues ne sont point Ilarbitraires l l
parait
~tre
langue n'est,
,
et
ce
qui
un caprice d'un peuple dans le choix des mots de
sa
pour Condillac comme pour Descartes, qu'ignorance,
défaut de jugement et mauvais goüt. S'il y a une différence entre
entre
les deux sur ces matières,
Iidegré de liberté l l
elle réside
peut-~tre
dans
et de conscience de soi avec lequel le
Page 105
le
choix
des mots,
à l'origine,
a été fait;
plus ou moins "maîtres du choix",
pour Condillac, nous sommes
car la natur.,
"qui
commence
tout", et par la suite l'analogi., guident sans cesse nos
"Les hommes qui ont fait les langues,
la
nature,
choix.
ont de même été guidés par
c'est-à-dire par les besoins qui sont une
suite
de
notre conformation" (Condillac, Sr •••• ir., p. 442). Que le besoin
de communiquer nous soit naturel n'implique pas,
les langues soient
réfléchissons,
hommes
l'oeuvre de la
nature.
Souvent,
et plus mal nous choisissons.
sar,
bien
plus
Mais les
n'avaient pas le loisir de faire des choix
que
nous
premiers
sophistiqués;
ils avaient probablement intérêt à ne pas se tromper,
et à
bien
se faire entendre, car leur survie, sans doute, en dépendait; les
langues
n'ont pas
invention
été faites pour
potiner
et
bavarder;
répondait sÜrement à un besoin vital puisque tous
peuples qui ont survécu y ont répondu de la même façon,
dire,
leur
par un langage de sons articulés.
les
c'est-à-
Mais Descartes a
très
peu écrit au sujet de l'origine des langues et nous ne savons pas
qu'elles étaient, selon lui, les conditions dans lesquelles s'est
fait le choix des mots à l'origine.
une
"métaphysique
présidé,
dans
les
d'instinct
débuts,
et
Du Marsais,
de
lui,
sentiment"
à la formation des
invoquait
qui
aurait
langues,
classification des choses et à l'analyse de la pensée.
évoquera également une "métaphysique de sentiment"
à
la
Condillac
qui Iifait les
langues" (Condillac, D. l'Rrt d. r.isonn.r, p. 620).
La
rationalité qui est en cause dans
Page 106
la
formation
des
langues
et
l'usage normal de la parole est une
rationalité
de
Les notions communes et innées ne jouent aucun
r6le
particulier dans l'invention des langues et l'usage
parole.
Bien
communiquer
sar,
les
nos pensées
langues
sont
d'abord
de
faites
et la structure de notre esprit
la
pour
impose
des contraintes à l'ensemble des grammaires possibles;
mais pour
un
pour
un
miroir
de
sensualiste
rationaliste
l' espri t ".
comme
Condillac,
Leibniz,
Les
(42)
grammairiens
pas
"le
princ ipes
moins
langage
qui
que
est
s ont
le
invoqué s
philosophes pour expliquer l'invention
d'institution
principes
comme
et
l'usage normal de la parole ne
des
sont
généraux et abstraits qui ne peuvent être
par
les
signes
pas
dérivés
des
de
l'expérience, mais simplement des maxim •• d. cheix ratiennel, des
maximes du genre de celles discutées par Rawls (1971) et Richards
(1971),
puis
Dominicy
utilisées
en pragmatique par
(1984, chap. 3
chez Arnauld sept
comportement
(1976).
"Une pragmatique générale")
"maximes de rationalité"
sémiologique
Kasher
dans
la
qui
mesure
M.
découvre
régissent
tout
celui-ci
est
où
rationnel.
Les maximes que nous présentons ici valent pour toute
action
général,
en
et
pas
seulement
pour
le
comportement
sémiologique, où les mey.ns utilisés sont d'ordre linguistique et
la fin poursuivie est (principalement) la communication. Je crois
qu'à
l'aide
de ces principes,
nous
pouvons
reconstruire
bon
nombre d'explications données par les grammairiens philosophes et
mettre pleinement en évidence leur caractère "raisonné".
Page 107
EtAnt donné un. fin voulu. (d.sir •• , poursuivi.)
un ~Qent, si celui-ci est rationn.l, il choisira le moyen 1. plus "approprié"
(ou 1. plus
".~tisf~i.~nt"
étant donné. les moy.ns .t l.s
informations dont il dispos.)
lui p.rm.ttant
d'att.indr. cette fin au moindre coat,
c.t.ris
(P.1)
p~r
p.ribu.s.
ce
Souvent,
rationalité"
principe
(comme
[1970]);
Watkins
est
appelé
le font,
par
Rawls
et
exemple,
"principe
de
nous appellerons (P.1),
comme
Richards,
Le
moyen le plus approprié,
l'évaluation
de
l'agent,
c'est le
le
moyen
"meilleur"
qui
permet
et
plusieurs
"approprié" figurant dans ma formulation est da. à Popper
Le
de
[ 1967]
Popper
mais comme il sera ici question
principes de choix rationnel,
font
simplement
le
mot
(1967) .
moyen,
selon
d'atteindre
efficacement la fin visée d'une façon économique, compte tenu des
moyens
agent
et informations disponibles dans les
rationnel cherche donc à
actions,
ne
circonstances.
"maximiser" le résultat
pouvons
évaluer les choses du point de vue
de
ses
Sirius.
Les
classiques étaient trop conscients de la "finitude"
l'homme et des limites de nos capacités cognitives,
nous
avons le temps et les capacités
passer en revue toutes les
chacune
de
ou la solution aux problèmes qu'il rencontre. Mais nous
penseurs
que
Un
qu'il
solutions possibles,
un calcul coa.ts/bénéfices,
pour
de
croire
faudrait
effectuer
et choisir finalement
pour
sur
celle
qui, selon la règle bayésienne, "maximise l'utilité attendue". Le
plus souvent,
nous nous contentons d'une solution qui, sans
objectivement
la meilleure,
sommes
des
s.tisfic.rs
est néanmoins
avant
d'être
Page 108
des
satisfai.ant..
"maximiseurs".
~tre
Nous
Le
passage suivant,
Hume,
de
témoigne de la présence d'une conception assez semblable à
l'âge classique
Comme l'homme est un être raisonnable et qu'il
est continuellement à la recherche du bonheur,
qu'il espère atteindre par la satisfaction
d'une passion ou d'une affection, il agit,
parle ou pense rarement sans but ni intention.
Il a toujours quelque objet en vue; et, quelle
que soit parfois l'impropriété des moyens
qu'il choisit pour atteindre sa fin,
il ne
perd jamais celle-ci de vue et il ne laissera
même pas se perdre ses pensées et ses réflexions quand il n'espère pas en obtenir
quelque satisfaction. (Op. cit., pp. 60-61).
Une
telle
conception
de
courante à l'âge classique,
être
Il
la
rationalité
pratique
m'apparaît
et elle est assez fondamentale pour
attribuée aussi bien aux sensualistes qu'aux rationalistes.
s'agit
en
fait d'une
conception
de
"sens
commun";
nous
présumons toujours de la rationalité des agents dont nous voulons
comprendre le comportement.
Parmi les maximes de rationalité que
Dominicy
p.
(1984,
chap.
3,
119)
retrouve dans l'oeuvre
de
Arnauld, la "maxime d'intelligibilité" dit que toute personne est
censée parler de façon à se faire entendre,
sans raison ni jugement.
sans quoi elle parle
Mais les moyens choisis
peuvent ne pas
toujours être ceux qui produisent les meilleurs résultats pour un
observateur ou expérimentateur impartial,
concerné,
s'agit,
quoique pour
l'agent
ces moyens puissent être tout à fait satisfaisants. Il
pour reprendre l'expression de Watkins (1970) et
Page 109
Elster
(1979),
d'une
l'origine,
rationalité
ont
(Descartes) ,
à-peu-près
"imparfaite".
pu @tre choisis par des
Ainsi,
les
Ilpersonnes
mots,
ignorantes"
ou par des personnes qui se contentaient de
ce
qu'elles voulaient
dire
à
(Condillac);
savoir
mais
ils
suffisaient, en dépit de leur impropriété, pour se faire entendre
efficacement.
(P. 1) est un princ ipe
pour @tre considéré comme rationnel,
normatif
chercher
d'une
Tel que formulé plus haut,
à
fin
multiples
faire le choix du meilleur moyen à
à réaliser;
applications
par contre,
po.itiv ••
l'explication du comportement humain
prendre
ce principe peut
pour
la
doit
un agent
en
vue
avoir
description
de
et
(cf., J. Harsanyi, 1976, p.
90) .
Le second principe est une variante du précédent;
l'appelle
"principe d'inclusivité", '
et Richards,
Rawls
"principe
de
dominance"
(P.2)
Etant donn' d.UH plan. d·action A .t B qui
n. p.uv.nt .tra m.n' • • bi.n .imu1tan'm.nt,
un aQant, .·i1 ••t rationn.1, choi.ira 1.
plan d·action A d. pr.f'r.nc • • B .i A p.rm.t da r'ali ••r tau. 1.. obj.ctif. vi.'.
par B .t un autre (ou p1u.i.ur. autr •• > an
surplu., c.t.ris p.ribus.
Je ne puis être à Montréal et à Québec au m@me moment; mais aller
à
Montréal
me permettrait de réaliser tout ce que
je
pourrais
faire à Québec,
plus certaines autres choses que je ne
pourrais
faire à Québec;
rationnellement, je devrais donc choisir d'aller
Page 110
à
Montréal.
L'un
la
fois
auteurs
de
l'article
écrivait : "Les .,thod.s
l'Encyclop~di.
à
des
un
préférables aux
grand
nombre
.~thod.s
des questions isolées"
de
bornées,
liMé thode"
de
générales pour résoudre
questions,
sont
infiniment
& particulières pour résoudre
Nous verrons, au chapitre suivant,
(43).
que c'est un tel principe qui explique pourquoi les peuples, lors
de la formation des langues,
ont préféré un langage fait de sons
articulés au langage d'action,
le premier étant une méthode plus
efficace, plus facile d'usage et plus complète
pour l'analyse et
la communication de la pensée.
Le troisième principe,
est nommé par Rawls
par
Richards,
lui aussi une variante du premier,
" pr incipe de la plus forte probabilité"
" pr incipe de la loterie");
on
peut le
(et
formuler
comme suit
(p.3)
Nous
Etant donn. d •• but. ou obj.ctif • • imi1air ••
qui pourraiant *tr. accompli. par d.ux plan.
d'action bi.n di.tinct., un aQ.nt, .'il ••t
rationn.l, choi.ira toujours c.lui d•• d.ux
plan. qui a 1. plu. d. chanc •• d. succ •• , c.t.,.is p.,.ibu.s.
retrouvons sensiblement le m@me principe sous la
plume
de
Descartes: "Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souvent
aucun dé lai,
c'est une vérité très certaine que, lorsqu'il n'est
pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions,
Page 111
nous
devons
suivre
(Discours
les plus probables."
• ,thodtt,
1•
Le tout dernier chapitre de la Logiqutl
troisième Partie, p. 76).
de Port-Royal,
dtl
qui veut nous rendre plus "raisonnables dans
nos espérances",
et
matière.
Sur le plan linguistique, il peut arriver, par exemple,
l'usage
d'un
cependant
pour
d'un terme
usuel
et
en
bien connu soit
terme plus recherché,
plus
précis,
"moins de chances" d'être entendu
d'autres
rhétorique
est
raisons;
qu'il
la
par
première règle
vaut toujours mieux
de
la
préférable à
mais
qui
a
l'allocutaire,
abstrus ou
qui ce terme peut sembler obscur,
sortes
partie
m~e
craintes
que l'usage
discute
nos
de
savoir
pour
toutes
toute
à
saine
qui
l'on
s'adresse si l'on veut maximiser l'efficacité de la communication
et augmenter ses chances de succès.
Il ne s'agit, encore une fois,
esquisse
Elster
de
sacrifie
toujours à l'originalité
de
chaque
et une
auteur.
(1979) examine brièvement les théories du choix rationnel
Pascal
Ulysses
que d'une esquisse,
et Descartes (chap.
and the Sirens").
II
"Imperfect
L'examen de celle de
Rationality
Leibniz
sans doute aussi fort instructive (Houvtl.u.x tlss.is ••• ,
serait
Livre IV;
Ess.is dtl th'odic'tI, en particulier, le Discours dtl 1. confor.it,
dtl 1. foi .VtlC 1. r.ison).
De
plus,
ces
principes
devraient
recevoir différentes formulations pour le court et le long terme,
ou
lorsque
le choix implique plus d'une
collective et stratégique).
Par exemple,
Page 112
personne
(rationalité
il n'est pas rationnel
de changer constamment le sens des mots,
m@me si ces changements
représentent une réelle amélioration de la langue,
changements
constants
communication.
de
Nous
mettraient
en danger
supposons toujours une
parce que ces
l'efficacité de la
certaine
stabilité
la signification attachée aux mots que nous employons
n'est
pas
rationnel de la changer à l'insu des
donner un "langage privé".
sommes
et
il
de
se
nous
ne
autres,
Descartes l'avait bien vu:
pas libres de changer la signification des mots une
qu'elle a été reçue (cinquièmes
Dominicy
(1984,
stabilité"
toujours
chap.
3,
op.
Réponses,
pp.
114-115),
cit.,
appelle
un semblable principe chez Arnauld.
autorisés
attribuant
allocutaire
d'abord
interpréter les
à
le
sens
s'attendent
mots
courant,
p.
fois
231).
"maxime
de
Nous sommes donc
d'autrui
usuel.
en
leur
Locuteur
mutuellement à ce que l'un
et
et
l'autre
utilisent et comprennent les mots selon leur sens usuel.
Ces principes de choix rationnel sont très souvent utilisés
tacitement
formation
paradigmes
par
les
philosophes classiques
et l'évolution des langues,
de
flexions
raisons d'économie,
pour
expliquer
le choix des mots et
pouvant alors
@tre
justifié
par
la
des
des
d'efficacité, de simplicité, de commodité et
d'élégance.
Ils
jouent
formulation
des
règles
l'efficacité du discours;
également
un
rhétoriques
grand
rôle
visant
à
dans
maximiser
le mot "choix" revient pratiquement
(1775)
Page 113
de
la
Condillac.
à
Les
raisons d'ordre économique sont particulièrement importantes. Les
langues
humaines
permettent
de
perceptions,
pouvons
ne sont viables que dans la
faire
des
avoir
beaucoup
idées
avec
peu;
mesure
où
le
nombre
car
et pensées de toutes
sortes
ou
que nous pouvons apprendre et maîtriser
mots).
Il y a des noms communs
(quelques
de
langues,
parce que nous ne pouvons retenir une infinité de
propres,
tandis qu'avec quelques centaines de noms
un
illettré
n'importe
arrive,
quelle
(articles,
avec
un
situation.
peu
La
toutes
les
noms
communs,
et
un enfant ou
adjectifs) ,
d'imagination,
plupart
nous
moyens
milliers
une poignée de déterminants
dans
des
que
excède de beaucoup le nombre des mots
linguistiques
elles
des
décrire
à
grammairiens
philosophes insistent sur cette économie considérable que
permet
de réaliser l'usage de noms communs (appellatifs), et sur l'usage
qu'on
en fait pour classifier les choses
mettre de l'ordre dans nos pensées.
d'abreger le discours"
est constamment
(genres,
être
(Br •••• ir. 94n4r.l • • t r.isonn4.,
élégante,
elle
plus "naturelle",
avec
promptitude
laquelle
Toute
l'esprit".
l'efficacité
p.
invoqué par les grammairiens philosophes.
préférée;
la moins
est d'ailleurs
souvent
plus énergique;
les
et
"Le désir que les hommes ont
deux manières de parler également efficaces,
doit
espèc es)
pensées
Entre
coüteuse
jugée
plus
elle rend mieux la
"viennent
nous
économie discursive qui ne met pas en
de la communication est en accord
93)
avec
(P.
à
danger
1) •
Le
recours à l'ellipse est ainsi autorisée par la raison (Condillac,
D.
l'Rrt
d'étonnant
d'4crir.,
dans
le
p.
541).
Destutt de Tracy ne
fait qu'une bonne partie
Page 114
de
ce
voit
rien
que
nous
exprimons
plus
demeure sous-entendu,
souvent
que les mots qui reviennent
dans le discours
(les
indéclinables,
prépositions et les conjonctions) soient presque
le
comme
toujours,
les
dans
toutes les langues, des monosyllabes, et que les mots déclinables
aient la capacité d'exprimer plusieurs significations,
verbes,
qui peuvent exprimer l'attribut,
comme les
le temps, la personne,
le nombre,
la voix, l'existence, et l'action de l'esprit, et les
noms,
peuvent
qui
exprimer,
principale, le nombre,
de ses moyens;
d'informations,
donner
s'il est
signification
rationnel,
s'il dit peu de choses,
moins
à
Ainsi,
en
leur
le genre et le cas
qu'il refuse de
nous
présupposons
locuteurs donnent le maximum
leur
de
sera
s'il donne
peu
nous sommes autorisés à penser qu'il ne peut
davantage,
conversation.
qu'il
plus
Un locuteur,
43,
économe
en
coüte
coopérer
constamment
d'informations
assez
de les
dans
la
que
les
pertinentes,
donner et
en
parce
qu'ajouter
des
informations supplémentaires plus ou moins pertinentes serait une
dépense
inutile (cf.,
"maxime
de
quantité"
Grammaire Générale,
Dominicy,
1984,
chez Arnauld).
pp.
Il Y
quelque chose comme un
effort" dans l'usage de la parole,
119-120,
pour
la
a
dans
la
donc,
"principe du moindre
ou une instance de la fameuse
loi de Zipf en théorie de la communication;
O. Jespersen croyait
lui aussi que les langues évoluent suivant une tendance visant
à
obtenir un maximum d'efficacité par l'utilisation d'un minimum de
moyens.
Page 115
Ces
Grammaire
langues
principes
de
Générale,
connues
rationalité
à expliquer pourquoi,
des
grammairiens
des verbes "adjectifs ll ,
adverbes,
utiles,
aussi,
dans
dans la plupart
philosophes,
il
et des pronoms.
s'entendaient sur ce point
effet,
servent
y
a
des
des
Car tous, en
ces parties d'oraison
sont
mais non nécessaires à la représentation complète de
pensée dans la langue;
la
la
on peut les éliminer, sans perte de sens,
en les remplaçant par d'autres parties du discours. On peut ainsi
sans perte de sens, les adverbes en les remplaçant par
éliminer,
des syntagmes prépositionnels
=
"sagement"
"avec sagesse ll ;
on
peut faire de même avec les verbes adjectifs, que l'on décompose,
en copule + participe présent
suivant la tradition,
Ilest
aimant Il;
classiques
d'un
les
pronoms,
que
définissent d'abord
par leur
capacité à
Cà
nom
philosophes
enfin
partir
de
reconnaissent
Beauzée
les
cependant,
grammairiens
les
parole) .
grammairiens
au pronom la fonction de
marquer
le
l'acte
de
En conséquence, ces trois parties du discours ne sont
nécessaires à la représentation complète de la
toutes
tenir lieu
de l'idée qu'il représente Clconfusément ll ) à
rapport
pas
et
les langues
passer.
Mais
communication
les
a
théoriquement,
on pourrait
langues sont faites pour
ses
exigences.
permettent
une
économie
amoindrie
par une perte d'efficacité de la
dans
partout
s'en
communiquer
Les adverbes
adjectifs
pensée
discursive
et
qui
les
et
verbes
n'est
communication.
la
pas
Leur
invention et leur usage sont donc en accord avec les canons de la
raison
pratique.
Les
Messieurs de
Page 116
Port-Royal
nous
demandent
d'imaginer de quoi aurait l'air une conversation où les locuteurs
seraient
constamment
obligés
de
se nommer
au
lieu
de
dire
simplement "Je" et "tu" ...
Un
dernier
relativement à la
parole
point
Condillac
de la nature",
pas littéralement.
faites
en
la
rationalité
formation des langues et
lorsque
l'ouvrage
concernant
l'usage normal de la
affirme que
"les
langues
il me paraît clair qu'il ne
Cette phrase signifie :
prenant
pratique
pour modèle le
sont
s'exprime
les langues ont
langage
d'action
été
dont
les
éléments sont innés et donc "naturels". Dans son Dictionn.i,.. d.s
S'Inon'l •• s, aux articles "langues" et "langage", il explique qu'il
y a deux types de langage :
gestes,
d'abord le lanQAQ. d'action, fait de
de cris inarticulés, de mouvements des yeux, de la t@te,
etc., et ensuite, le lAnQAQ. d • • •on. articul' •. Le premier n'est
pas
le propre de l'espèce humaine;
espèce
animale
a
le
sienl
bien
au
contraire,
Mais c'est
le
langage
chaque
des
sons
articulés qui s'appelle proprement "langue", et les langues, il y
insiste,
sont
faites
de signes d'institution
attacher
certaines idées,
comme il le disait déjà dans
su,. l'0,.i9in. d.s connoiss.nc.s hu•• in.s
chap.
IV).
Dans
"l'impuissance
proprement
où
dite"
linguistique,
une
sont
(44)
•
lettre
les
à
J.H.S.
b@tes
de
Chez Condillac,
pour
l'Ess.i
il
Formey,
se
faire
ce qui
est
parle
une
de
langue
proprement
conventionnelle
dépend de la réflexion et du choix.
Page 117
y
(1746, première partie,
tout ce qui concerne l'expression
de nos idées et pensées,
choisis
Et
le mot Ilnature" veut d'abord dire,
chose",
pour lui, "premier état d'une
et par extension, tout ce qui s'explique par les lois de
la mécanique (cf., art. "Nature" et "Naturel" du Dictionn.i,.. d.s
Le premier langage d'action est naturel parce
qu'il
n'est qu'une suite de notre "conformation naturelle"; un seul cri
de douleur en dit souvent davantage que bien des jérémiades. Mais
il
en
va autrement des signes d'institution,
qui supposent une
convention et une raison qui fait adopter le mot ou
l'expression
419) .
(op. cit., p. 431), il dit que
si nous sommes conformés pour parler le langage
d'action, nous le sommes également pour le langage des sons articulés. Mais ici la nature nous
laisse presque tout faire.
Cependant, elle nous
guide encore. C'est d'après son impulsion que
nous choisissons les premiers sons articulés, et
c'est d'après l'analogie que nous en inventons
d'autres, à mesure que nous en avons besoin. (Je
souligne) .
La
nature
nous
montre la
voie,
Condillac,
et elle continue à
l'analogie,
qui
entendre.
Le
communication
doit
être
elle
"commence",
nous guider dans
respectée si
on
nos
désire
comme
dit
choix par
se
faire
premier langage d'action demeure au niveau
de
animale;
signes
mais
dès
qu'il
s'enrichit
de
la
d'institution, la Raison (ou la réflexion) et le choix deviennent
nécessaires.
Page 118
Par ailleurs,
d'une
imposition
l'idée que les mots résultent d'un choix
volontaire (vo1ont.ry
i.position)
se
ou
trouve
aussi chez Locke, le père du sensualisme moderne; on ne peut donc
la réserver aux seuls "rationalistes".
les cris inarticulés,
les grimaces,
A l'inverse,
l'idée
que
mouvements des membres, des
yeux, etc., constituent "la première des langues", se trouve dans
le Discours physiqu. d. 1. p.rol. (1666) du cartésien Gérauld
Cordemoy
semble-t-il,
naturels
mais ce n'est là encore qu'une façon de
(4~)
puisque
des
l'auteur
distingue
aussitôt
signes d'institution et affirme que
seraient impossibles sans l'intervention de la Raison.
"langue"
"langage"
et
rationalistes
et
sont
parfois
les sensualistes,
utilisés,
pour désigner
parler,
ces
ces
signes
derniers
Les
mots
par
les
toute
d'expression (naturelle ou conventionnelle) des pensées;
sens
les
strict,
conventionnelle
utilisé
lui
"nature
choisit
des
aussi
les
"langues"
ne
pensées.
concernent
Le mot
"choix"
dans un sens extensif
voies
choisissent par instinct " ,
les
etc.
plus
par
que
est
forme
mais au
l'expression
quelquefois
Condillac
simples",
les
la
"bêtes
Mais à l'article "Préférer"
Le mot de choisir marque plus particulièrement
la comparaison qu'on fait de tout ce qui se
présente, pour connoître ce qui vaut le plus
et le prendre. (P. 453).
Page 119
de
du
sens, la nature et les animaux ne préfèrent pas et ne choisissent
pas.
Quant à l'instinct,
définition
toutes
les
ré flexion (c f ., art.
pour Condillac, son concept exclut par
opérations
"Inst inct" •
auxquelles
participe
la
Dicti onn.i "tt dtts synony.tts. p.
340) .
La
Raison
thèse voulant que les lAnQues soient
peut
donc
sensualistes",
thèse
être attribuée
dans
également
l'ouvrage
aux
l'oeuvre
ont
fait
l'objet
d'un
choix
à
une clarté satisfaisante.
l'origine,
clairement
les
signes
rationnel,
n'était pas forcément le meilleur choix possible,
qui tout de même suffisait,
la
Les langues sont
de la Raison parce que les sons articulés,
d'institution,
avec
dépasser
distinguent
les signes naturelles des signes d'institution.
la
"grammairiens
la mesure où ils cherchent à
de l'origine divine du langage et
de
mais un
qui
choix
pour se faire entendre
L'usage normal de la parole
est
une activité rationnelle, non seulement parce qu'il faut anAlyser
ses pensées pour les communiquer et lier en un tout (proposition)
les
signes de ces pensées,
mais encore parce qu'il faut
savoir
choisir les signes Appropri's.
Mais
les principes de choix rationnels
d'une certaine façon innés?
Locke (Ess., ... ,
rej etait l' idé e qu' il y ait des
"principes de
Page 120
ne
sont-ils
pas
Livre I, chap. II)
prat ique "
inné s,
sauf
peut-être cette tendance mise en nous par la nature à
heureux
et
principe
(donc
notre aversion pour la misère.
n'est
inné e)
quelconque
Leibniz,
que l ' expression d'une
de
au contraire,
principe)
l'est
L'universalité
(Houv •• ux
Il se peut également que des
soient
la
(Du
de
cette
résultat
d'une
73) .
p.
pourrait
"dispositions"
vers
de
bien
le
de ce genre
d'instinct
Marsais) ou de la "métaphysique
Pour
la vérité (le
.ss.is ... ,
"métaphysique
ce
"naturelle "
"inclination (naturelle) de l'âme
bien".
sentiments"
lui,
entendement.
principes de choix rationnel
dépendre d'une telle
source
notre
le
"s i le penchant est inné,
aussi"
des
pour
inclination
l'âme vers le bien et non
vérité innée imprimée dans
Mais
être
et
de
sentiment"
(Condillac) qui guidait "les premiers hommes" (semble-t-il à leur
insu) pour la division des choses en genres et espèces et pour la
formation des langues.
***
Page 121
Le
et
principe
différents
à
d'analogie
niveaux
intervient de
dans
la
multiples
Grammaire
façons
Générale.
Chez
plusieurs sensualistes (Locke, Du Marsais,
etc.), il explique la
genèse des
c'est l'analogie qui,
selon
It
noms généraux lt
Condillac,
guide
(appellatifs)
le choix des mots tout au
formation et de l'évolution des langues.
qui contribue à
l'établissement
morphologiques
douteux,
et
dans une langue,
C'est aussi
système des
lan~ue,
qui règle l'usage dans les
qui lui donne de la consistance,
et la
trop grand nombre d'irrégularités.
fait
que nos langues européennes aient été faites à
au
hasard
occupations.
Toutes
décevantes
pour
linguistiques
pour
une
s'obscurcit
(modèles,
langue,
génie
préserve
Condillac déplorait
partir
le
des
parlées par des peuples qui se sont
des
guerres,
langues
les
invasions,
ont
de
ces
le sens commun et les enfants
faire l'apprentissage.
cas
autres
C'est encore l'analogie qui façonne le
débris de langues anciennes,
la
significations
d'un
imposés
de
l'analogie
qui explique le mécanisme des métaphores et
tropes apparentés.
d'une
du
long
conquêtes,
irrégularités
qui
doivent
en
Une trop grande multiplication des formes
paradigmes)
car dans ce cas
et se complique l t
,
peut de plus être
"le mécanisme
de la
comme le remarque de
propos des irrégularités causées par les changements
troisième
Page 122
partie,
néfaste
langue
Saussure
à
phonétiques
chap.
IV,
section 1).
L'analogie
établir
est une sorte de raisonnement qui
une proportion entre plusieurs termes en
terme manquant.
consiste
découvrant
à
le
De Saussure nous dit que
L'analogie suppose un modèle et son imitation
régulière. Un. fora • • n.logiqu• • st un.
fora.
f.it • • l'ia.g. d'un. ou plusi.urs .utr.s d'.prts un. rtgl. d,t.rain',. (Ibid.)
Ainsi,
le féminin de "directeur",
etc. ,
donne :
"directrice",
Il
inst i t ut eur l l,
Ilinstitutrice" et
Ilproduct eur ll ,
Ilproductrice",
respectivement; le féminin de "recteurll sera donc Ilrectrice ll .
si
même,
Ilréaction ll donne
Ilréactionnaire ll ,
Ilrépression ll
De
fera
"répressionnaire", etc. Ce mécanisme, les grammairiens classiques
l'ont connu et bien mis en valeur,
d'une
façon
un
peu
vague,
ressemblance" (Condillac,
même si on le définit souvent
comme
un
simple
L. L.ngu. d.s c.lculs,
"rapport
op.
de
cit.,
p.
~tre
des
419) .
Ainsi,
d'après Locke,
les premiers mots devaient
noms propres destinés à nommer un seul objet perçu
par
la suite,
objets
constatant les ressemblances entre
nommés et les objets de la même espèce,
les
par les sens;
les
premiers
hommes
tout naturellement étendu la signification des noms propres
qu'ils désignassent également tous les objets de la
Page 123
m~me
ont
afin
espèce,
les noms propres devenant ainsi,
de proche en proche,
communs, signes des idées générales.
des
noms
Ici, la première nomination
sert de modèle pour les autres : un objet ressemblant fortement à
celui de la première nomination sera nommé de la même
façon.
Ce
processus décrit par Locke, Du Marsais, etc., rappelle une figure
trope
que
utiliser
Du Marsais appelle "antonomase",
un
et qui
nom propre comme s'il s'agissait d'un
consiste
nom
à
commun;
c'est ainsi que nous disons d'un homme grand et fort que c'est un
"Hercule",
c'est
ou d'un autre qui se donne des airs triomphants,
un "Napolé on" ,
concevoir
la
contraire,
etc.
Leibniz s'opposait à cette façon
genèse des noms
appellatifs;
il
prétendait,
que
de
au
que beaucoup de noms propres, à l'origine, avaient un
contenu général descriptif (Houv •• ux .ss.1s ••• ,
Livre III, chap.
III) .
A l'origine,
le choix des premiers mots,
chez Condillac en particulier,
mais "fondé en raison",
ne devait pas
nous l'avons vu
"arbitraire",
~tre
et un choix fondé en raison est un choix
qui peut @tre "justifié", pour lequel on peut donner une "raison "
(cause finale),
en montrant,
par raisonnement pratique, le lien
qui unit la raison donnée au choix effectué.
sans doute,
Or,
l'analogie est
dans les commencements et par la suite,
moyen de se faire entendre,
telle
façon
toute
personne
car elle fait choisir les signes
que leur signification soit aisément
connaissant
le plus sar
les autres
signes
connaissant seulement certains traits saillants et
Page 124
entendue
déjà
admis
de
par
ou
pertinents du
contexte
d'énonciation.
langue,
les
Dans
de
l'origine
philosophes classiques font souvent
ressemblance son-chose:
plus
leur théorie
intervenir
le mot (son) nouvellement utilisé
de chances d'être entendu s'il évoque déjà la
nomme.
Les
enfants
utilisent
ignorent "le mot juste";
souvent
ce
le son caractéristique qu'elle produit.
ont
des mots formés de cette façon,
que
procédé
aura
qu'il
lorsqu'ils
Toutes les
même si leur
langues
nombre
n'est
en français, par exemple, nous disons que les
chats "ronronnent",
croyait
chose
la
ils remplacent alors le nom de la chose
par
jamais très élevé;
des
que les
crapauds "coassent",
c'est en procédant de cette manière
nommé les animaux dans le Paradis Terrestre.
etc.
Leibniz
qu'Adam
avait
Par ailleurs, si on
désire introduire un néologisme dans la langue, on essaiera de le
faire,
autant
aisément
ait
de façon à ce qu'il
que possible,
par les locuteurs compétents de la langue,
même
besoin
d'avoir recours à
une
permet ainsi de limiter les effets
absolu
profit
au
absolument
Les
modi fié e,
qui
l'arbitraire
arbitraire (Tisch
etc.) ,
moderne,
de
"tablette"
langues,
pour
relatif.
de
Si
"attabler"
l'arbitraire
"tabl e l l
en
exprimer la
le sont
même
idée
qu'on
explicite.
en allemand,
et
compris
sans
définition
L'analogie
moins.
soit
est
grec
relativement
diversement
choisissent presque toutes de faire usage de morphèmes
modifient,
légèrement mais distinctement,
le
m~e
mot
(le
même "radical"), plutôt que de créer à chaque fois un mot nouveau
et distinct.
Par exemple,
"amoureusement" ,
les mots lIamour",
lIaimera", lIaimât l l ,
principal. (disons,
l'idée d'amour),
Page 125
"aimer", "aimant".
etc., expriment la
mais chaque fois
m~e
id ••
modifiée
par
diverses id ••• Acc.ssoir •• ,
qu i s" 1 a j 0 u t en t" à
l ' i dé e
(ou
signification) principale d'un mot, pour déterminer s'il signifie
à
la manière d'un - substantif,
d'un
infinitif,
d'un
participe
présent, d'un adverbe, ou d'un verbe avec telles circonstances de
temps
et
de
signification
principale,
modes.
Pour
complète
les
des
classiques,
d'un mot se compose d'abord
d'un.
la
idée
quelquefois appelée significAtion obj.ctiv., et puis
de certaines idées accessoires,
par
grammairiens
morphèmes
(qui
qui peuvent
marquent
alors
exprimées
~tre
le
significAtion form.ll. ou .p'cifiqu. du mot,
plus
soit
souvent
la
s'il signifie à
la
manière d'un substantif, d'un adjectif, d'un verbe, etc., ou s'il
est de tel genre, tel nombre, tel cas, à telle personne, tel mode
et tel temps), soit par l'intonation ou l'expression du visage au
moment de l'énonciation.
joindre
(régulièrement
(Certaines idées accessoires peuvent se
ou
à
l'occasion)
dans
l'esprit
des
locuteurs à la signification principale des mots qu'ils utilisent
ou entendent et les faire paraître
"injurieux,
civils,
aigres,
honn~tes",
etc., comme disent les Messieurs; par exemple, pour un
puritain,
le
élevée
peut
mot
avoir quelque chose de dégradant
(Pour la théorie
d.
"bordel" dans la bouche d'une
p.ns.r (1662),
des idées accessoires,
chapitres XIV et XV;
cf.
ou
personne
bien
d'avilissant.
L. Logiqu. ou l'.rt
nous y
reviendrons
au
chapitre suivant).
Les
phénomènes
analogiques
Page 126
concernent
surtout
les
significations
étranger
"formelles"
nouvellement
linguistique
verbales,
prendra
morphologiques;
introduit dans l'usage
tout naturellement les
adjectivales,
par cette communauté
ou
adverbiales,
(comme "tripper ll ,
ainsi,
un
mot
d'une
communauté
formes
nominales,
etc., de la langue parlée
Iitrippant Il,
"trippatif",
etc.), et devra être décliné et conjugué selon les formes que lui
impose
ces
formes
(modèles ou paradigmes) qui donne de la consistance à une
langue
et
sa
langue
adoptive.
C'est le
respect
de
tend à réduire les irrégularités qui pourraient la rendre
plus
en
plus
difficile
et
compliquée.
Tel
déclinera ou se conjuguera comm. tel autre,
autre.
On
voit
système de formes
mode,
en
nouveau
se
sur le modèle de tel
tout de suite l'économie formidable
qu'un
tel
(pour le genre, le nombre, le cas, le temps, le
etc.) permet de réaliser,
discours
mot
de
et la clarté qu'il apporte
liant les éléments de la chaine parlée
comme
au
ils
doivent l'être, selon le nombre, le genre, la personne, le temps,
etc.
le
Si le féminin de "recteur"
futur du verbe "aimer"
sémant ique ll
faire
devait être "blitigri",
faisait
"broubaga",
(comme disent les cognitivistes)
les frais ...
notre
devrait
C'est pourquoi Turgot écrit
ou si
"mémoire
alors
ilL' ordre
objets qu'on a les premiers désignés dans les langues,
a été
en
des
le
même partout, ainsi que les premières métaphores et les premières
idées abstraites gui règlent les conjugaisons.
l'analogie
des
langues
les
plus
barbares",
les déclinaisons,
(Di scou.,-s
su.r
Porset,
1970,
p.
133;
je
souligne),
Ailleurs
Page 127
("S ur les
progrès de
l' esprit
humain" [1750]),
Turgot parle encore
de
c'est à dire l'art de former des conjugaisons,
d'exprimer
les rapports des objets,
l'''analogie,
les déclinaisons,
d'arranger les
expressions
dans le discours" (également dans 1.I.,.i. 1inguistic., p. 127).
C'est
encore
métaphores.
(1730),
Du
l'analogie qui
explique
le
mécanisme
des
Marsais,
montre qu'un locuteur qui fait une métaphore a
toujours
une "comparaison dans l'esprit"; •• t.pho,. • • st b,..vio,. si.i1itudo
disait
c'est
Quintillien;
dire
d'une personne qu'elle est
dire qu'elle est (ou se comporte) comm. un
ressemble
à un loup sous tel ou tel rapport,
d'analogie
était
déjà
invoqué
des
etc.
Le
qu'elle
principe
grammairiens
litigieux;
dans ses R••• ,.qu.s su,. 1. 1.ngu. ,,..nçois. (1647), il
exemple,
que nous devons dire
témoin" et non "je vous prends à témoins",
"je
etc.
vous prends à partie",
(46)
•
pour
et non
régler
comme
qui
par
constamment
loup,
loup,
Vaugelas,
conclut,
l'utilisait
par
un
des
Ilje vous prends
cas
à
parce que nous disons
"je vous prends
à parties",
Condillac attachait à ce principe une telle importance
qu'il allait jusqu'à dire que les principei de toutes les langues
se
réduisaient
au fond à deux
l'analogie (8,. •••• 1,..,
L'analogie
l'analyse (de
la
pensée)
et
p. 431).
s'oppose
à l'anomalie qui est
Page 128
un
écart
par
rapport
peine,
beau
à
la loi ou à la
règle.
pour terminer cette section,
passage
de
l'article
Et je pense
qu'il
vaut
la
de citer in .xt.nso ce très
"Encyclopédie"
de
Diderot
dans
l'Encyclopfdi., qui traite de l'analogie et des écarts (comme les
idiotismes)
par
rapport
à
l'analogie
dans
le
cadre
"grammaire générale raisonnée"
Elle (= l'Académie française) n'aura pas oublié
sans doute de désigner nos gallicismes,
ou les
différens cas dans lesquels il arrive à notre
langue de s'écarter des loix de la grammaire
générale raisonnée;
car un idiotisme ou un
écart de cette nature,
c'est la même chose.
D'où l'on voit encore qu'en tout il y a une masure (sic)
invariable & commune au défaut de
laquelle on ne cannait rien,
on ne peut rien
apprécier ni rien définir; que la grammaire générale raisonnée est ici la mesure;
& que sans
cette grammaire un dictionnaire de langue manque de fondement,
puisqu'il n'y a rien de fixe
à quoi on puisse rapporter les cas embarras sans
qui se présentent,
rien qui puisse indiquer
en quoi consiste la difficulté,
rien qui désigne le parti qu'il faut prendre, rien qui donne
la raison de préférence entre plusieurs solutions opposées,
rien qui interprète l'usage,
qui le combatte ou le justifie, comme cela se
peut souvent. Car ce seroit un préjugé que de
croire que la langue étant la base du commerce
parmi les hommes,
des défauts importans puissent y subsister long-temps sans être apperçus
& corrigés par ceux qui ont l'esprit juste & le
coeur droit.
Il est donc vraisemblable que les
exceptions à la loi générale qui resteront, seront plutôt des abréviations, des énergies, des
euphonies, & autres agréments légers, que des
vices considérables. On parle sans cesse, on écrit sans cesse;
on combine les idées & les
signes en une infinité de manieres différentes;
on rapporte toutes ces combinaisons au joug de
la syntaxe universelle; on les y assujettit tôt
ou tard,
pour peu qu'il y ait d'inconvénient à
les en affranchir; & lorsque cet asservissement
n'a pas lieu, c'est qu'on y trouve un avantage
qu'il est quelquefois difficile, mais qu'il seroit toujours impossible de développer sans la
grammaire raisonnée,
l'analogie et l'étymoloPage 129
de
la
gie,
que j'appellerois les ailes de l'art de
parler, comme on a dit de la chronologie & de
la géographie que ce sont les yeux de l'histoire.
***
Page 130
NOTES
(1)
Le seul exemple que j'aie rencontré d'une application de la
méthodologie de Lakatos à une science humaine se trouve dans un
article de Mark Blaug,
"Kuhn versus Lakatos, or Paradigms versus
Research Programmes in the History of Economics", dans P.r.dig.s
& R.vo1utions. Applications and Appraisals of Thomas Kuhn's
Philosophy of Science,
éd. par Gary Gutting,
Notre Dame,
University of Notre Dame Press,
1980. Blaug applique l'approche
de Lakatos, qu'il estime préférable à celle de Kuhn, aux théories
keynésiennes (cf.,
en particulier, pp.
147 et suiv.). Lakatos
lui-même estimait que le marxisme n'était qu'une pseudo-science,
à
cause de l'attitude de ses partisans devant les problèmes
suscités par certaines "anomalies" (les événements de Hongrie en
1956)
ou par l'échec de certaines prédictions
(la paupérisation
absolue
du prolétariat),
en invoquant des
théories
qui
n'ajoutaient aucun contenu empirique corroboré par les faits;
ainsi
la
contre-révolution hongroise ne serait
pas
une
"authentique" contre-révolution,
mais les marxistes ne
se
donnaient pas la peine de préciser ce qu'est une "authentique"
contre-révolution;
ils répondaient de même au problème de la
paupérisation absolue en créant une théorie .d hoc -- celle de
l'impérialisme-- dont le seul support empirique était justement
le
non-appauvrissement de la classe laborieuse
des
pays
occidentaux industrialisés. John Worrall, par contre, arrive,
lui, à
la conclusion que le marxisme est bien un programme de
recherche scientifique,
mais un
programme
"décadent"
ou
"dégénérescent"; à ce sujet J. Worra11,
"The Ways in which the
Methodology
of Scientific Research Programmes Improves
on
Popper's methodology", dans Progr.ss .nd R.tion.1ity in Sci.nc.,
éd. par G. Radnitzky et G. Andersson, Dordrecht, Reidel, 1978,
pp. 55 et suiv.; voir aussi la note 33.
(3) S. Auroux, L. S'.iotiqu. d.s Encyc1op'dist.s, p. 228, note
159; et M. Dominicy, L. N.iss.nc. d. 1. gr •••• ir • • od.rn., p. 14.
(4) S. Auroux, ilLe temps verbal dans la Grammaire Générale", dans
Innov.tion . t systt •• , chap. 1, manuscrit.
(5) Cf.,
Chomsky, L. Linguistiqu. c.rt'si.nn., p. 54 (pagination
de l'édition originale anglaise); et J.-C. Pariente, LI~n.1ys. du
1.ng.g • • Port-Roy.l, pp. 109-110.
(6) Sur l'influence d'Augustin à Port-Royal, cf. A. Robinet, L.
L.ng.g • • 11*g. c1.ssiqu., Paris, Klincksieck,
1978; d'après
Dominicy
(1984, p.
15), Robinet exagère la portée de cette
influence; sur l'influence d'Aristote, on peut lire, par exemple,
les premiers textes du recueil de Joly et Stefanini, L. Sr •••• ir.
Page 131
S'n'r.l •. Des Modistes aux Idéologues, 1977.
(7)
D. Hume, Enqu.t. sur l'ent.nd ••• nt hu•• in
Paris, Aubier Montaigne, 1947, p. 59.
(trad.
fran.) ,
(8)
P.L. Moreau de Maupertuis, R'fl.xions philosophiqu.s sur
l'origine des l.ngu.s.t 1. signific.tion d.s .ots, dans V.ri.
linguistic., éd. par C. Porset, Bordeaux, Editions Ducros, 1970,
p. 27.
(9)
A. -R.
Turgot,
"Remarques critiques sur l es Ré flexi ons
philosophiques de Maupertuis sur l'origine des Langues et la
signification des mots", dans V.ri. linguistic., p. 26.
(10)
Condillac, Corr.spond.nc.,
Condill.c, Vol. 2, p. 537.
dans O.uvr.s philosophiques
de
(11)
Maine de Biran,
"Note sur les Réflexions de Ilaupertuis et
Turgot au sujet de l'origine des langues", dans R. Grimsley (éd.)
Sur l'origine du l.ng.g., Genève, Droz, 1971, p. 87.
(12)
Ibid., p. 88.
(13)
A propos des analyses bipartites de la proposition à
classique, cf. Nuchelmans, 1983, chapitres 5 et 9.
l'âge
(15) S. Auroux, ilLe temps verbal dans la Grammaire Générale", op.
cit.
(16) Cf.
Du Marsais,
le premier
Logiqu• • t Princip.s d. Sr •••• ir •.
article de sa
Logiqu.,
dans
(17) Condillac, Ess.i sur l'origin. d.s connoiss.nc.s hu•• in.s,
dans O.uvr.s philosophiqu.s d. Condill.c, vol. 1, première
partie, section première, chapitre premier.
(18) Cf. la lettre à Maupertuis citée plus haut à la notei•.
(19) Cf.
G. Mounin, L.s Probl ••• s th'oriqu.s d. 1. tr.duction,
Paris, Gallimard, 1963, pp. 21-22.
(20)
A. Martinet, El' •• nts d.
Armand Colin, 1970, p. 20.
linguistiqu.
g'n'r.l.,
Paris,
(21) Par exemple,
selon J. T. Andresen, IIFranç ois Thurot and the
First History of Grammar
in Historiogr.phi. linguistic., V:1/2,
1978, p. 49; et Rüdiger Schreyer, IICondillac, Mandeville, and the
Origin of Language
in Historiogr.phi. linguistic.
(même
numéro) ,
p.
20,
Condi llac
est
censé
rej eter
l' idé e
cartésienne, adoptée par Port-Royal, d'une invention rationnelle
du langage. Mais nous verrons plus loin que cette affirmation
n'est vraie que du premier langage d'action; elle cesse de l'~tre
ll
ll
,
,
Page 132
pour un langage d'action plus développé, comme la danse ou la
pantomime,
et à plus forte raison pour le langage des sons
articulés et "choisis", comme le dit bien Condillac. Nous verrons
aussi que le premier langage d'action n'est pas le propre de
l'espèce humaine (chaque espèce animale a le sien), et que le mot
"langue"
ne s'applique proprement qu'au langage des
sons
articulés, c'est-à-dire un langage fait de "signes d'institution"
choisis pour la représentation et la communication des pensées.
L'affirmation de Condillac ("les langues sont l'ouvrage de la
nature") ne peut être interprétée littéralement; c'est la raison
humaine, dans s on usage "pratique", qui faç onne les signes
"artificiels",
et non pas la nature, quel que soit le sens que
l'on donne au mot "nature".
Par ailleurs, R. Grimsley, dans
l'''Introduction'' de son recueil Sur l'ori')in. d.s 1.n')u.s, p. 20,
prétend que Maine de Biran, parce qu'il "croit que le langage
garde toujours un rapport vital avec la raison",
montre par là
qu' "il se rapproche...
bien plus du rationalisme que
de
l'empirisme". Les rationalistes n'ont jamais eu le monopole de la
Raison;
les sensualistes avaient eux aussi une conception de la
Raison et j'estime que son rale dans leurs théories de l'origine
et de l'usage du langage est loin d'être négligeable. Aarsleff
défend la même idée; cf.
"The Tradition of Condillac
The
Problem of the Origin of Language in the Eighteenth Century and
the Debate in the Berlin Academy before Herder", dans Dell Hymes
(dir.)
Studi.s in th. History of Linguistics. Traditions and
Paradigms, Bloomington et Londres,
Indiana University Press,
1974, p.
118
"If by rationalism is meant the doctrine that
reason is the principal source of certain knowledge as weIl as of
aIl ordered knowledge even when not certain in that sense, then
Locke was surely nothing but a rationalist,
in spite of all that
we have been told to the contrary -- though chiefly by Victorian
conservatives";
on trouve le même texte dans Fro. Lock. to
S.ussur.,
pp.
146-210.
On
lira également
avec
profit
l'''Introduction'' à L' •• piris•• d. Lock. de François Duchesneau
(La Haye, Martinus Nijhoff,
1973), qui met en perspective les
relations de Locke à l'oeuvre de Descartes et des cartésiens.
(22) Cf.
Cassirer, L. Phi10sophi. d.s for •• s sy.bo1iqu.s (1923),
Tome 1, Paris, éd. de Minuit, 1972, p. 92.
(23) Aarsleff,
"The History of Linguistics
Chomsky", dans Fro. Lock. to S.ussur., p. 106.
and
Professor
(24)
Bouveresse, "La linguistique cartésienne
Grandeur et
décadence d'un mythe", dans Critiqutl, fasc. 384
"Comme beaucoup
d'autres " Chomsky sous-estime totalement l'aspect profondément
rationaliste de la pensée de Locke et se méprend sur la
signification exacte de sa polémique contre l'innéisme, qui est,
entre autres choses, un plaidoyer pour le libre examen, la
rationalité et la tolérance contre l'autorité et la tyrannie,
dont chacun sait qu'elles n'ont que trop tendance à se retrancher
derrière des vérités et des principes "innés", c'est-à-dire
supposés évidents et indiscutables pour tout homme normalement
constitué." (pp. 422-423). Plus loin, Bouveresse trouve étonnante
Page 133
(tout comme Aarsleff) l'absence de Condillac dans les références
historiques de Chomsky, et il ajoute: "Pour Condillac comme pour
Leibniz, le langage est bien le miroir de l'esprit humain:
son
origine et ses progrès sont le reflet direct des capacités
créatives et évolutives de la raison humaine et constituent une
voie d'accès privilégiée à la connaissance de l'être humain." (P.
424) .
(25)
J. Choui 11 et,
"Descart es et le problème de l'origine des
langues au XVIII- siècle", dans Dix-huitit •• sitc1., IV, p. 51.
(26) P. Hasard, L. Cris. d. 1. consci.nc • • urop'.nn., 1680-1715,
2, Gallimard,
1969 (première édition, Arthème Fayard, 1961), p.
10.
(27) P. Chaunu, L. Civi1is.tion d. l'Europ. d.s Lu.itr.s, Paris,
Flammarion, 1982, (première édition, 1971), p. 198.
(28) F. Thurot, dans ses Remarques à sa traduction du H.r.ts de
James Harris (1796) (éd. par A. Joly, Genève-Paris, Droz, 1972)
parle
d'une
"faculté connective et unifi.nt."
(qui
est
manifestement la Raison), qu'il décrit en ces termes
: "Au moyen
de cette faculté,
l'esprit considère une idée générale dans
plusieurs individus, une seule proposition dans plusieurs idées
générales,
un syllogisme dans plusieurs propositions; jusqu'à ce
qu'enfin,
à force de multiplier et d'unir les uns aux autres les
syllogismes, comme ils doivent être liés, il s'élève aux régions
brillantes et immuables de la science." (P.
378). Soit dit en
passant, Thurot est un sensualiste avoué,
grand admirateur de
Condillac, qu'il considérait comme l'égal des Képler et Newton;
et comme grammairien,
il le juge même supérieur à Du Marsais.
Cf., F. Thurot, T.b1 •• u d.s progrts d. 1. sci.nc. gr •••• tic.1.,
(Discours préliminaire à H.r.ts),
1796, éd. par A. Joly (1970),
p. 117.
(29) J'emprunte cette expression,
J.-C. Pariente, 1985, p. 54.
inspirée de Chomsky (1966),
à
(30) Condillac,Tr.it' d.s .ni •• ux, dans O.uvr.s phi1osophiqu.s d.
Condi11.c, Vol. 1, p. 363.
(31) Descartes,
1974, p. 231.
H'dit.tions .'t.physiqu.s,
(32)
Descartes, Princip.s d. Phi1osophi.,
Frères, 1973, première partie, # 74.
5- Réponses, P.U.F.,
Tome
III,
Garnier
(33) Martinet, E1' •• nts d. 1inguistiqu. g'n'r.1., Paris, Àrmand
Colin, 1970, p. 27 : "11 est clair que tous les choix que fait un
locuteur à chaque point de son discours ne sont pas des choix
gratuits." Voir aussi p. 32.
Page 134
(35) Condillac, 9r •••• ir., op. cit., p. 429.
(36) Ibid., p. 431.
(37) Condillac,L. 1.n9u. d.s c.1cu1s, dans O.uvr.s philosophiqu.s
d. Condill.c, Tome II, p. 419.
(38) Ibid., p. 419.
(39)
Ibid.
(40) Ibid., p. 420.
(41) Condillac, D. l'Rrt d"crir., dans O.uvr.s philosophiqu.s d.
Condill.c, Tome I, p. 517.
(42) Cf., Bouveresse, op. cit., p. 424.
(43)
Article
d'Alembert.
"Méthode "
de
l'Encvclop'di.
de
Diderot
et
(44)
Condillac, Lettre à J.H.S. Formey, 25 février 1756, dans
Corr.spond.nc., O.uvr.s philosophiqu.s d. Condill.c, Tome II , p.
540.
(45) Cordemoy,Discours phvsiqu. d. 1. p.ro1. (1666), dans O.uvr.s
philosophiqu.s, éd. par Clair et Girbal, Paris, 1968, p. 197.
(46) Vaugelas, R••• rqu.s sur 1. 1.n9u. fr.nçois. (1647), cité par
M. Arrivé et J.-C. Chevalier, L. 9r •••• ir., Paris, Klincksieck,
1970, p. 31.
***
Page 135
CHAPITRE DEUXIEME
LA GRAMMAIRE GENERALE CLASSIQUE EN TANT QUE
PROGRAMME DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
1
LA CEINTURE DE PROTECTION
Les six principes qui constituent,
dur
de la
Grammaire Générale
épistémique.
philosophes
les
Il
n'est
développé
donc pas étonnant que
et objections de toutes
plusieurs théories
inspirées des principes du noyau dur,
en
effet des réponses
à des
en
danger
du programme
signalé
l'ensemble
le noyau
ont un très haut degré
les
aient cherché à les protéger contre
contre-exemples
ainsi
à notre avis,
ou
d'utilité
grammairiens
les
anomalies,
sortes.
hypothèses
de
qui
proposent
pourraient
recherche.
ont
auxiliaires
et ces théories
questions
Ils
mettre
Nous
avons
au commencement du chapitre -premier que la 8r •••• ir.
la Logiqcul de Port-Royal contenaient une
Ilheuristique positive ll ,
un certain nombre d'indications ou de suggestions sur la
fa~on
développer des théories respectant les principes du noyau dur
les
mettant
à
l'abri de la falsification.
d'une Grammaire Générale,
créé
un.
et
En
de
en
l'idée
avan~ant
les Messieurs n'ont donc pas seulement
(comme
théorie,
Page 136
Einstein
en
1905
pourrait-on dire) ,
quoique la plupart de ces théories aient
été
surtout développées par les grammairiens du siècle suivant.
Si la pensée est la même partout et pour tous,
vient la difficulté de traduire?
alors
d'où
et d'où vient que l'ordre
mots n'est pas le même dans toutes les langues?
Si les
des
langues
se forment partout sur les mêmes principes, alors d'où vient leur
diversité?
Les
principes universels de la
sont-ils à l'oeuvre dès le
départ?
Et
Grammaire
comment
Générale
expliquer
que
certaines parties du discours jugées "nécessaires" à l'expression
de
la
pensée
ne se trouvent pas
dans
particulier les langues anciennes ou
est à
principes
d'économie
(l'efficacité au
"synonymes",
et
moindre
inutilement,
etc.)?
métonymies,
synecdoques,
de
et cette
d'idiotismes (latinismes,
synonymie,
de la
Raison
commune
pas multiplier les
entités
profusion de tropes
ironies,
hyperboles,
(métaphores,
etc.),
et
gallicismes, germanismes, anglicismes,
de
Les théories des idées accessoires, de la
l'inversion et de l'ordre naturel des
tropes et autres figures,
Grammaire Générale;
mots,
des
de la traduction, et de l'origine des
langues, s'inspirent toutes, à
la
qui parait contredire les
qui se moquent des règles de la langue et y introduisent
tant d'irrégularités?
de
ne
(en
comment expliquer cette
simplicité
coat,
langues
"primitives")? Si la Raison
l'oeuvre dans toutes les langues,
profusion de termes dits
etc.),
certaines
l'~ge
classique, des enseignements
en retour,
Page 137
elles
répondent
à
ces
questions et protègent les éléments les plus importants du
dur
(la
théorie
l'universalité
de
de
la
la
signification,
le
noyau
postulat
pensée et de l'uniformité
de
la
de
nature
humaine, le principe de rationalité, et le principe d'analogie).
Dans la Sr •••• ir. et la Logiq«. de Port-Royal,
des
indications
auxiliaires".
siècle
pour
de
ces
"théories
que reviendra la tâche de les construire,
plus ou
moins ordonnée,
autour
du
noyau
augmentant,
faits observés.
par ajouts
On trouvera,
successifs,
d'une
dur
Grammaire Générale, laquelle se développe ainsi en une
théories
trouve
Mais c'est surtout aux grammairiens philosophes du
suivant
manière
développer la plupart
on
de
la
.'ri.
de
l'adéquation
tout au long de ce
aux
chapitre,
indications historiques relatives aux principaux
des
moments qui ont
marqué les développements de notre ceinture de protection.
•
La
théorie
important
des
idées
accessoires
centrale
tropes
et
la
théorie de la
notions,
d'autres
(notion
typiquement
théorie
que
traduction.
nous présenterons,
la
et
par
sert
d..
donc
la
du
accessoire
théorie
;'ni.
C'est
"dix-hui tiémiste") .
fort
protection
Elle
comme celle de
Page 138
rôle
La notion d'idée
pour la théorie d. la synonymie,
définir
cette
un
dans la construction de la ceinture de
noyau dur de la Grammaire Générale.
est
joue
encore
des
à
langu ••
d'abord
suite
les
théories
qui en dépendent directement (théories de la
et des tropes).
Nous examinerons enfin
synonymie
les théories de
l'ordre
naturel des mots, de la traduction et de l'origine des langues.
***
1) LES IDEES ACCESSOIRES
M. Dominicy (L. N.iss.nc. d. 1. gr •••• ir• • od.rn., p. 132),
dont
l'érudition
est inconstestable,
signale
théorique" de la notion d'idée accessoire
Il
jus qu' ici . "
ajoute,
avec raison,
que
le
lin' a guère été
que
"la
notion
"statut
étudié
d'idée
accessoire survivra encore au XVIII- siècle" (ibid.). Je voudrais
montrer dans cette section que la notion d'idée accessoire a
seulement survécu au XVIII- siècle,
notion
protéiforme,
"signification
principale"
subsumant
ajoutée",
et
mais s'est développée en une
pratiquement toutes espèces
ajoutée
"objective"
tantôt
d'un
à
philosophes
anglais
apparentée,
celle de
aient
Français,
mot,
souvent
quoique
eu
"consignification".
Page 139
de
la "signification
tantôt
"signification spécifique". Il s'agit enfin d'une
surtout développée par les
non
sa
notion qui fut
les
recours
à
grammairiens
à
une
notion
Nous l'avons vu (chap. 1, section 1)
classiques,
le
le monde se divise en choses, la pensée en idées, et
discours en mots;
et les mots sont les signes des idées
sont des représentations des choses.
bien
: chez les grammairiens
existent par elles-mêmes,
(accidents,
qualité s,
existent par elles-mêmes (cf.,
Les choses représentées, ou
ou bien sont
attributs,
qui
modes,
des
modifications
etc.) des choses
par exemple,
qui
L. Logiqu. ou l'.rt
d. p.ns.r,
première partie, chap. II, p. 73; ou la Sr •••• ir.
Condillac,
p. 456). Les premières s'appellent substances, et les
secondes,
dont
l'existence
dépend
de
s'appellent attributs (ou propriétés,
celle
des
accidents,
de
substances,
etc.) .
Sur le
plan de la pensée et du discours, on retrouve la même dichotomie:
il y a des
idées
principales et
accessoires,
et de même,
des
mots "principaux·· et "accessoires". Les mots principaux sont ceux
qui
désignent
les
"objets
de
nos
pensées";
ce
sont
des
des mots possédant par eux-mêmes une signification,
et
dans
cette
signification
notre
modifier
id..
esprit indépendamment de
substantifs
nominatif)
est une
(utilisés
toute
référentiellement,
sont de cette espèce.
(c'est-à-dire
principal.
autre
qui
existe
idée.
Les
c'est-à-dire
au
Mais d'autres mots servent
d.t.rmin.r en étendue ou
axpliqu.r
à
[ou
d.v.lapp.r] en compréhension) les mots principaux, et souvent les
"accessoires··
des
mots
principaux ne sont
distincts,
mais des flexions
adjectifs,
selon Condillac (Sr •••• ir.,
des
idées accessoires,
pas
d'autres
mots
(nominales ou verbales). Ainsi, les
p. 454), n'expriment que
contrairement aux substantifs,
qui
eux
expriment des idées principales. Les premières n'existent que par
Page 140
les
secondes qu'elles modifient selon
exemple,
certains
dans
rapports.
"frère"
exprime
Par
l'idée
principale, tandis que "votre" et "illustre", expriment des idées
accessoires.
De ces trois idées,
celle de frtr. est la
principale;
et les deux autres, qui n'existent que par elle,
sont nommées .cc.ssoir.s, mot qui signifie qu'elles viennent
se joindre à la principale, pour exister
en elle et la modifier.
En conséquence, nous dirons que tout substantif exprime une idée principale, par
rapport aux adjectifs qui le modifient, et
que les adjectifs n'expriment jamais que
des idées accessoires. (Condillac,
Sr •• •• ir., p. 454)
Les
adjectifs
expriment toujours,
m~me
accessoires,
chez
Condillac,
lorsqu'on les retrouve dans les
des
idées
verbes
dits
"adjectifs", sous la forme de participes. Comme c'est déjà le cas
l'attribut exprimé
un verbe adjectif est une "signification jointe",
temps
et
de
la personne
(p.
comme le disait déjà Leibniz),
le premier cas,
comme celle du
Les
suiv.).
(ou
en
adjectifs
"intension"
ou en .t.ndu. (extension),
ils indiquent qu'une
qualité
existe
dans
Dans
un
comme la blancheur dans Socrate lorsque je dis : "Socrate
est blanc",
frère " ,
et
les substantifs en compr'h.nsion
modifient
sujet,
96
par
Dans la second cas,
l'adjectif détermine le
certains
conditions
cas,
de
les
idées
par exemple "votre" dans "votre
substantif en
accessoires
vérité d'un énoncé,
Page 141
extension.
semblent
lorsqu'elles
affecter
modifient
Dans
les
en
extension une idée principale,
restreignent
l'application;
c'est-à-dire en déterminent ou en
idée
est
modifiée en compréhension, les
conditions de vérité ne sont
pas
affectées.
"les hommes qui sont
Par exemple,
charitables",
restreint
la
dans
dans
proposition
l'extension
cas
où
une
incidente
sont
ne pourrait donc supprimer l'incidente sans changer la valeur
de
vainquit
Darius",
dans
aux
sont
on
mais
sujet
pieux
pieux;
vérité;
du
les
"Alexandre,
l'incidente
changer la valeur de vérité
seuls
hommes
qui était fils
pourrait
être
de
Philippe,
supprimée
sans
(cf. Pariente, L'Rn.1vs. da 1.ng.g• •
Po,.t-RoV.1,
p. 61 et suiv.; aussi Auroux et Rosier, "Les sources
historiques
de
L.ng.g.s,
déc.
la
conception
1987) .
de
deux
Toutefois,
types
dans
de
relatives",
certains
cas,
suppression d'une relative explicative (ou non restrictive)
affecter la valeur de vérité,
en particulier lorsque le
la
peut
contenu
de la relative entretient un rapport intime avec l'attribut de la
comme dans "Alexandre, qui était fils de
proposition principale,
Philippe,
p.ns.,.,
était
seconde
petit-fils d'Amintas" (L. Logiqa. oa
l'.,.t
Partie,
ailleurs,
chap.
VII,
p.
171).
Par
lorsqu'un substantif figure en position d'attribut
un philosophe") ,
il modifie le sujet en étendue,
appartenance
à
éléments
discours
du
une
classe.
Le
sujet
substantifs
qui peuvent
individus dans le discours;
qu'obliquement,
Les
introduire
("Socrate est
indiquant
sont
les
comme "Socrate" dans "la blancheur de
être plus ou moins complexes.
Le
sujet
Page 142
son
seuls
directement
mais il arrive qu'ils ne le
et l'attribut d'une proposition
d.
des
fassent
Socrate".
grammaticale
(un substantif),
peuvent
selon
Condillac,
des
peut @tre
propositions
modifié soit par des adjectifs,
incidentes,
précédée d'une préposition
soit
par
un
("de Socrate")
autre
Les
soit
par
substantif
prépositions à
cet égard jouent un rôle des plus importants, en particulier chez
Condillac
modifier
et Destutt de Tracy;
un
substantif
toutes les façons
(qu'il
soit
sujet
ou
différents rapports marqués par les
ainsi,
Il
l'incidente
P oè t e gé nia 1" ,
l'adjectif
"qui a du génie",
équivaut
à
laquelle équivaut à son tour
à
: Ilpoète de génie".
Et lorsque l'attribut est un adjectif transformé en participe
marchant] Il,
exprimant
suj et,
le
comme
idées
les
l'attribut
dans
accessoires
peuvent
se
prépositions;
Igénia1"
un simple rapport marqué par une préposition
modifiant
de
attribut)
réduisent aux
dans
possibles
encore
"Aristote
associées
~tre
marche
à
et
[est
l'adjectif
modifiées
par
des
substantifs précédés d'une préposition, c'est-à-dire des adverbes
("Aristote marche [est marchant] lentement [avec lenteur] ").
circonstances de temps et de lieu sont les accessoires
le verbe
qui ne signifie proprement que la
"~tre",
Les
modifiant
co-existence
de l'attribut dans le sujet.
Les substantifs, les adjectifs, les
prépositions et le seul verbe
"~tre"
pour
exprimer
complètement
p. 456).
toutes
suffisent donc,
nos
pensées
en théorie,
(Condillac,
Ce sont là les vrais "é1émens du discours",
tandis que les verbes adjectifs, les pronoms, les adverbes et les
conjonctions
sont
des
expressions
composées
équivalentes à plusieurs éléments du discours.
nous
l'avons
propo.i t ion,
et
"dérivées",
Destutt de Tracy,
d.
1.
qui sont n.c ..... ir •• à l'expression complète de
la
vu,
distinguait
de
Page 143
m~me
les
'l'm.nt.
pensé e,
(ou de l'oraison),
commodes,
utiles,
mais non nécessaires,
qui
car ils sont
sont
toujours
équivalents à plusieurs éléments de la proposition.
La notion d'idée accessoire, au XVIII- siècle,
est de
plus
fondamentale pour la morphologie verbale :
Chaque forme qu'on fait prendre au verbe,
ajoute quelque idée accessoire à l'idée
principale dont il est le signe. Avoir de
l'amitié ou de l'amour est, par exemple,
l'idée principale que le verbe . i •• r
signifie dans toutes ses variations,
et
chaque variation exprime ce sentiment
avec différens accessoires.
Le présent
est l'idée accessoire de la forme j'.i •• ;
le passé l'est de la forme j'.i •• i, et le
futur, de la forme J'.i •• r.i. (Condillac,
Sr •••• ir., p. 469).
Cette conception des flexions verbales temporelles n'est pas sans
rappeler
la
définition
chap.
aristotélicienne du
verbe
2)
dans la traduction de
consignific.r•.
Boèce,
De m@me, chez Priscien, le temps et le mode sont
des significations lIajoutées l i
Les modes sont
: le verbe signifie cu. t •• poribus
également considérés
Condillac comme des lIaccessoires du verbe
ll
,
par
Beauzée
et Beauzée assure que
les modes définis ou personnels se distinguent entre eux par
idées
accessoires
destinés
à
qu'ils
servent
à
exprimer.
marquer le nombre et le genre dans
Page 144
et
Les
les
les
morphèmes
substantifs
sont encore appelés, par Destutt de Tracy, des "accessoires" (cf.
sa 8r •••• ir., p. 73).
Un siècle plus tôt, dans la Logiqu. de Port-Royal, les idées
accessoires
avaient
compte
tenir
de
ce
ces
"connotations",
d'abord été introduites
que
nous
(en
appelons
valeurs Ilaffectives"
partie)
aujourd'hui
logique
Mais le mot
courant au Moyen âge dans la
terministe) n'est plus guère utilisé à l'âge
classique.
31-32-33) ,
Ilconnotationii
apparatt,
Iisignification confuse ll
adjectifs ll
vaguement
dits
IIconcrets",
comme
directement les obj ets
et
et
(ou
obliquement
blancheurs
les
Ils
montrent
significations";
obliquo) ,
et
signification
que
mot
désigner
une
de
ces
aussi
l'une
(p.
34)
Cet usage
rappelle
logic •• , pour les termes
Ilblanc ll ,
blancs,
qui
et
obj et s .
que
est distincte
C 1)
fait
Les
signifie
ou
enfin
Messieurs
l'adj ect i fil
l'adjectif
mais
signifie
qui
Il cons igni fi e ll ,
expl iquent que c'est la "connotat i on (qui)
32) .
le
qui distingue la signification des . II noms
d'Occam dans la Su •••
celui
s.cund.rio
IIC onnot e")
pour
de celle des Il noms substantifs ll .
connotatifs
pri ••rio
c'est
mais
les
Iladdi t i onnell es ll
et
des mots qui donnent tant de soucis aux traducteurs.
Ilconnotationii (du latin connot.tio,
pour
(p.
Iideux
a
indirecte
l'autre est confuse mais directe (in
r.cto).
(in
La
distincte est une Iiforme accidentelle ll ,
signifiée in obliquo
par l'adjectif Ilblanc ll ,
Page 145
et
la
signification confuse et directe est
le sujet de cette blancheur.
admis
de
"forme
"ce qui a de la blancheur",
Le nominaliste Occam
accidentelle"
dans
sa
n'aurait
sémantique,
signification secondaire (la connotation), chez lui,
et
pas
la
est oblique
(et non directe) et n'est jamais "confuse", ou indéterminé e. Mais
nous retrouvons à Port-Royal l'idée d'une
l'une directe,
l'autre oblique.
double
signification,
"Blanc" ne peut subsister
dans le discours sans un nom substantif exprimé ou
ce
que ce nom substantif signifie directement et
c'est
le
sujet d. la blancheur,
(aussi)
directement
tandis
mais confusément le
distinctement,
"blanc"
mâme
sujet,
blancheur
ou
signifie
à son sujet pourrait ainsi âtre marqué par des cas
ou
La signification distincte,
"connotation qui fait
signification
Le rapport
obliquement.
oblique et accessoire (comme plus tard chez
la
"Blanc"
blancheur",
"quelque chose"
en
la
et
des prépositions.
c'est
tout
de
directement,
"blancheur",
signifie
blancheur.
serait donc équivalent à "quelque chose ayant la
"quelque chose qui a la blancheur", où
sous-entendu;
que
signifiant distinctement mais obliquement la
seul
confuse),
en tout cas,
Condillac),
l'adj ectif"
puisque
(c'est-à-dire
et non la signification
est "
distincte.
la
Du
Marsais (Tr.it, d.s Trop.s, p. 226) reprendra aussi cette analyse
adjectifs
ne
dans le sens concret, les
"en effet,
des "adjectifs concrets"
on
forment qu'un tout avec leurs sujets;
ne
les
sépare point l'un de l'autre par la pensée"; "Le concret renferme
donc
toujours
propriété".
Le
deux
terme
(pp.
idées,
celle du
"connotatif"
74 et 97);
sujet,
celle
revient dans la
mais
Page 146
et
de
la
Logiqa. ou.
"connotatif" ne
renvoie
pas
ici
non
contemporains,
Dans
plus
aux
"connotations"
des
linguistes
à des valeurs affectives ajoutées aux mots.
Logiq«. . (première
leur
partie,
chap.
XIV et
les Messieurs introduisent les idées accessoires avant tout
tenir
compte
cadre de
de
leur
ces
"valeurs affectives . ajoutées",
théorie
de
XV)
pour
dans
le
accessoires,
ou
la définition :
les hommes ne considerent pas souvent toute
la signification des mots, c'est-à-dire que
les mots signifient souvent plus qu'il ne
semble,
& que lorsqu'on en veut expliquer
la signification, on ne représente pas toute l'impression qu'il font dans l'esprit.
Car signifier,
dans un son prononcé
ou
écrit,
n'est autre chose qu'exciter une idée liée à ce son dans notre esprit en
frappant nos oreilles ou nos yeux.
Or il
arrive souvent qu'un mot, · outre l'idée
principale que l'on regarde comme la signification propre de ce mot, excite plusieurs
autres idées qu'on peut appeller accessoires,
auxquelles on ne prend pas garde,
quoique l'esprit en re~oive l'impression.
(L. Logiq«. 0« l'.rt d. p.ns.r, p. 130)
Les
Messieurs
distinguent deux types
fa~ons
plutôt deux
de
joindre
commun
et
relativement
le
idées
accessoire~
aux
ou bien elles sont jointes par un
significations principales
usage
les
d'idées
locuteur au
stable,
de
le
l'énonciation.
sont
uniquement
par
premières,
dans la mesure où il est possible de les lexicaliser,
relèvent de la sémantique,
moment
ou bien elles
tandis que les secondes
Page 147
Les
relèveraient
plutôt de la pragmatique.
espèce
(qui
peuvent
Les idées accessoires de la
@tre
lexicalisées)
qu' ell es affect ent di ffé rent s
mentez! Il,
dites",
ont
synonymes);
et
la
"Vous savez le
même
signification
mais la première,
Par exemple,
les
contraire de
ce
principale
et non la seconde,
ell e "une idé e de mépri s et d'outrage,
celui
aux
130) .
p.
De
même,
signification principale,
l'idée
que
d'une
certaine
"père"
l'Eglise,
n'avaient
sont
emporte
avec
et elle (fait) croire que
et
"papa"
mais le second terme
injure"
ont
la
l'usage devait,
"honteux" en
par la suite,
disposition d'esprit,
de l'impudence" (ibid.,
associées
de
du
leur
premier.
mais
& qui tient quelque chose du libertinage &
p. 135). Ces idées accessoires sont donc
l'omniprésence
humaines,
de
y joindre "l'image d'une mauvaise
mais toujours relativement à un "état de langue".
langues
Pères
temps,
aux mots avec régularité dans l'esprit des
donnée
m~me
emporte avec lui
familiarité qui est exclue
rien
vous
(elles
utilisés par les
étant
phrases
qui nous (la) dit ne se soucie pas de nous faire
(ibid.,
mots
Ilcaractè res" qui peuvent 1 es faire
prendre en bonne ou en mauvaise part.
II VOUS
confèrent
première
des
recommandent
locuteurs,
Les Messieurs,
dans
idées accessoires
aux
lexicographes
d'en
compte :
Ces idées accessoires étant si considérables,
et diversifiant si fort les significations
principales, il seroit utile que ceux qui font
des dictionnaires les marquassent,
et qu'ils
avertissent, par exemple, des mots qui sont
injurieux,
civils,
aigres,
honn@tes,
déshonn@tes;
ou plutôt qu'ils retranchassent
entièrement ces derniers, étant toujours plus
Page 148
les
tenir
(L.
utile de les ignorer que de les savoir.
Logiqu. ou l'.rt d. p.ns.r, p. 135)
Les
la
idées accessoires de l'autre
type
(celles qui relèvent
de
pragmatique) sont excitées dans l'esprit du locuteur " par
le
ton de la voix,
autres
signes naturels qui attachent à nos paroles une
d'idées,
jugements,
Y
a
en
y
joignant
l'image
des
des opinions de celui qui parle.
&
voix pour instruire,
reprendre" (ibid.).
ton,
tantôt
sur
l'allocutaire.
Les
un
Dans
m~mes
autre,
voix
pour
paroles,
mouvements,
Il
flatter,
les
ne feront pas le
idées
même
exprimables
" par les symptômes universels de nos
par
signification
effet
M.
etc. ,
sur
Dominicy
, mouvements'
les "signes naturels" que sont le
l'air du visage,
pour
accessoires seraient toujours
p.
c'est-à-dire
voix
prononcées tantôt sur un
l'interprétation proposée par
135)
des
p. 130).
(Ibid.,
(op. cit.,
voix,
infinité
qui en diversifient, changent, diminuent, augmentent la
signification,
"Il
par les gestes, & par les
par l'air du visage,
de
la
et lorsqu'elles se joignent à
la
principale par le fait
d'~tre
ton
associées à
un
son
(ou à l'idée du son chez Port-Royal et Du Marsais) prononcé ou
des caractères
écrits
(ou à la perception
de
mots
se
conformant au
chargent
alors
de
valeurs
accessoires
très
fines,
(ibid.) ;
supplémentaires,
"désir que les hommes ont d'abreger
p.
à
ces caractères),
"c'est qu'un processus d'économie sémiologique a opéré"
les
Il,
93) .
expriment des nuances très diversifiées
le
se
discours"
Les
et
idées
souvent
et les rapports idées principales/idées accessoires
Page 149
vont de la simple "détermination"
"c opi er"
(ex.
"contrefaire" ,
c'est
sophistiquées
(dire
en exagé rant --Condi llac ,
jusqu'aux
allusions
littéraires les
plus
"Harpagon" pour "avare"; cf. Auroux, 1979, pp. 271-272).
Les Messieurs distinguent encore d'autres idées accessoires
qu'ils utilisent pour rendre compte de l'usage des démonstratifs.
Un
démonstratif comme "ceci"
a une signification très
et très confuse ("cette chose") ,
générale
"n'y ayant que le néant à
quoi
on ne puisse appliquer le mot de chose" (L. Logiqu.•. .. ,
p. 136).
L'usage
présente
de "ceci" fait concevoir une chose comme étant
au moment de l'énonciation; mais
seul
attribut de chose;
"l'esl?rit n'en demeure pas à ce
il y joint d'ordinaire quelques
attributs distincts" (ibid.).
autres
"Ceci" utilisé en pointant vers un
diamant le fait concevoir comme une chose présente, mais l'esprit
"y
ajoute
forme " .
les
idées de corps dur & éclatant qui
a
une
Appliqué à différentes choses, le mot "ceci"
telle
suscitera
à chaque fois différentes idées accessoires. L'interprétation que
donnent
Arnauld
Christ,
"Ceci est mon corps", est particulièrement intéressante,
car on peut y
l'idée
et Lancelot de la phrase prononcée
voir
assez
aisément la nature du
par
rapport
principale si;nifi'. par "ceci" et les idées
Jésus-
entre
accessoires
.xcit ••s lors de son utilisation. Certains ministres du culte
sont
trompés en pensant que "ceci",
devait si;nifi.r le pain.
dans "ceci est mon
se
corps",
En fait, "ceci" ne signifie jamais que
Page 150
l'idée
de chose présente,
devient
de
phrase,
pleinement
analysée,
IICeci, que vous savez éltre du pain, est mon corpsll. La
proposition
l'idée
et la
incidente
C1que vous savez éltre du
pain ll )
accessoire qui est Ajout •• à la signification
IIcec i
(à
Il
savoir,
l' idé e de
par Ilcecill.
chose
principale
pré sent e),
Les rapports entre idée
mai s
principale
idées accessoires ne semblent pas toujours aussi clairs
idées
accessoires
du
premier
type,
ces
précise
valeurs
non
et
pour les
affectives
ajoutées à certains mots par un usage relativement constant
dans
une communauté de locuteurs. Il n'est pas toujours facile de voir
comment on pourrait les analyser,
à la manière de Condillac, par
des propositions incidentes ou des syntagmes prépositionnels.
La
chose se complique encore lorsqu'on envisage la r81e tenu par les
idées
accessoires
signification,
131-132),
dans la théorie des ,tropes,
les
figures
rôle déjà signalé par les Messieurs (Logiqu., pp.
et sur lequel insistera Du Marsais dans son Tr.it, d.s
Ildépendance ll
Trop.s. Mais les rapports de
entre idée accessoire
et signification principale sont clairement caractérisés par
grammairiens
contiguïté,
etc.),
de
dans
la
théorie
tout-partie,
le
des
tropes
plus pour le
moins,
(ressemblance,
contrariété,
ce qui est loin d'@tre le cas lorsqu'ils font jouer
idées accessoires le r81e de
Le plus souvent donc,
les
aux
IIconnotationsll.
la signification d'un terme
tout composé d'un. idée principale (11111),
Page 151
et d'une ou
est
un
plusieurs
idées
accessoires ("i1,
... , in"). Beauzée, dans l'article
"Grammaire" de l'Encyclopfditl,
distingue le .an. fondam.ntal, le
•• n. ap6cifiqu.,
et le •• n. accidant.l d'un m@me mot,
distinction sera encore reprise par
et
Fontanier au siècle
(Ltls Figurtls du discours, pp. 59-60)
(2).
cette
suivant
Le premier est constitué
par l'idée "principale" ou "fondamentale" qui peut @tre commune à
des mots de différentes espèces,
, ,a i ma nt" ,
"ami t ié" ,
constitué
mot,
"amoureusement",
etc. ;
le
second
le
sens
au verbe en tant que verbe,
accidentel est celui
accidens des mots,
tels que les cas,
qui
"résulte
etc. ;
divers
les genres, les personnes,
60) .
Le sens accidentel est bien un sens accessoire,
sens
fondamental; le caractère
moins
de
de
les temps, les modes." (L.s Figur.s du discours, p.
les nombres,
est
est
par l'idée "fondamentale" associée à chaque espèce
au nom en tant que nom,
enfin
comme "amour", "aimer", "aimé",
évident
après
"accessoire"
tout,
ajouté
au
du sens spécifique
n'est-il
pas,
lui
aussi,
constitué d'une idée "fondamentale", représentant la fonction (ou
grammaticale
propriété)
différentes
espèces
d'un
peuvent
mot?
avoir
l'idée fondamentale?
à
des
m@me
la
N'a-t-elle
un caractère "secondaire" et accessoire?
affaire
si
mots
de
signification
la signification spécifique ne mofifie-t-elle pas,
fondamentale,
elle aussi,
Mais
une idée fondamentale,
elle
pas,
N'a-t-on pas
mais signifiée
aussi,
toujours
tant~t
à
la
manière d'un verbe, tantôt d'un adjectif, d'un adverbe, etc.? Par
ailleurs,
m@me
synonymes
tous
expriment
la
si
les
grammairiens
les termes (catégorèmes) d'une m@me
m@me idée fondamentale,
Page 152
appellent
philosophes
ils ne vont
langue
pas
qui
jusqu'à
qualifier
"aimer" ,
de
synonymes les
"aimant",
différentes
qui
série
etc.
portent
comme
Ce
"amour",
sont des mots de
l'indice
d'une
fonction
d'une contribution spécifique à l'analyse et à la
communication
avoir
"amoureusement",
espèces,
grammaticale,
mots d'une
d'une pensée complète.
En outre,
il
une hiérarchie dans la modification des idées
par les idées accessoires
signification
semble
y
principales
les idées spécifiques modifient
principale (objective ou fondamentale)
d'un
la
mot,
tandis que les sens accidentels modifient le plus souvent le sens
spécifique (comme le mode et le temps) .
Si
nous
principales
dénotons
et
la
signification
accessoires)
d'un
mot
totale
(1 es
idé es
quelconque
(un
catégorème) de la langue L1 par " . . (Mt.L1)", alors on peut écrire:
les
crochets
("[",
"]") indiquant le
accessoire des valeurs ajoutées i1,
grand nombre de cas,
i:z ,
caractère
...,
•
~n
et
et
Dans
un
(3)
il semble possible 'd'analyser
entre les idées accessoires
dépendant
•
les rapports
l'idée principale en les rendant
par des propositions incidentes,
ou par des prépositions suivies
d'un substantif, lequel signifie
secondairement
une
et
idée
modifiant
directement
une
autre
idée
par un autre substantif.
Page 153
signifiée
C'est
et
obliquement
premièrement
ainsi
que
les
choses se présentent chez Destutt de Tracy dans sa théorie de
la
pr6posttion,
un élément du discours qui est extr~mement
remarquable; non-seulement il joue un rôle
très-important qui lui est propre, mais il
entre comme élément dans la formation et
la signification de presque tous les autres
avec lesquels il s'incorpore et dont il
devient partie intégrante.
Il est donc
sinon absolument nécessaire, du moins bien
essentiel" (S,. •••• i,.., pp. 103-104).
A l'origine, il n'y avait dans les langues
que des interjections
et des expressions (le plus souvent) monosyllabiques, en fait des
onomatopé es
servant
int er j ecti ons
de
noms.
C'est
par
l'analyse
(qui expriment des propositions entières)
des
que
se
sont formés les autres mots et les "radicaux primitifs"
Comment considérerons-nous toutes ces syllabes
qui ont été successivement sur-ajoutées aux
signes originaires, qui forment tous les dérivés de ces radicaux primitifs,
et au moyen
desquels les uns et les autres sont devenus,
suivant le besoin, des verbes, des adjectifs,
des adverbes, etc.? Pour moi,
je déclare que
je les regarde comme de vraies prépositions··
(ibid., pp. 108-109).
Si la première fonction des prépositions est de marquer ··certains
rapports
simple,
entre
un nom et un autre nom,
soit combiné avec le verbe
.t,..,··
ou
un
adjectif,
(ibid., p. 109),
ont aussi un autre effet,
qu'elles ne produisent qu'en s'unissant à un
autre mot, dont elles deviennent la syllabe
Page 154
soit
elles
désinentielle,
(qui)
est de remplir à peu
près le même objet,
en formant ce qu'on
appelle les cas des déclinaisons. On peut
ajouter à ces cas les syllabes qui constituent
les conjugaisons,
lesquelles sont absolument
du même genre. Il (Ibid. )
Destutt
de
Tracy
entrent
dans
mettre,
pro-mettre,
mettre,
etc. ,
en
distingue
les
la composition des
prépositions
mots,
comme
.'pArAbl..
qui
sou-mettre,
d~-
r.-mettre,
des prépositions ins'parAbl •• , comme la désinence
pour
les
adverbes;
et
toutes
les
syllabes
désinentielles
qui indiquent les variations de genre, de nombre,
de mode, de temps, de personne, des noms, des adjectifs et des verbes, et toutes celles qui forment tous les dérivés des mots primitifs,
ont la
même origine que les prépositions proprement dites; elles rendent un service presque semblable.
C'est pourquoi nous les avons regardées aussi
comme des prépositions,
à la
seule différence
près, qu'étant inséparables des signes qu'elles
modifient, elles ne deviennent pas un élément du
discours distinct des autres .11 (Ibid., p. 150).
Le "rapport de dépendance"
entre les noms est souvent marqué "et
il peut toujours l'être par des prépositions." (Ibid.,
p.
171) .
Il faut noter aussi que les prépositions ont de multiples emplois
métaphoriques, ce qui les rend capables d'exprimer un nombre plus
grand
encore
accessoires.
prépositions
ceux-c1
de
Quoi qu'il
des
semblent
entre
rapports
rapports
des
en
les
idées
principales
soit de cette explication
idée
principale/idées
plus variés,
Page 155
et
les
idées
et
par les
accessoires,
accessoires
embrassent
aussi
ayant
à voir avec la
peu
accidentelles
bien les nuances affectives
exprimées
Grammaire,
par
que
les
les
des morphèmes et
plus
fines,
significations
jouant
un
rôle
déterminant comme "moyens de syntaxe".
Un dernier point,
ne
sont
pas seulement ajoutées aux idées
modifient,
du
mot
idées
du son).
Nous verrons dans un
ont la m@me idée principale,
accessoires;
or,
associée à deux mots distincts
cette même
qu'elles
si
moment
que
mais se distinguent
la m@me
idée
principale
deux
par
est
(ex.: Ilpère" et "papa"), pourquoi
idée principale n'éveille-t-elle pas dans l'esprit la
même
idée accessoire pour les deux mots,
idée
accessoire
d'un
mot)
L'idée
principales
mais sont aussi associées aux mots (sons) ou à l'idée
(idée
synonymes
les
mais d'importance: les idées accessoires
sinon parce
est attachée à l'un des deux mots
et pas seulement à l'idée principale
accessoire
est
donc liée
au
complexe
que cette
(ou à l' idé e
qu'il
exprime?
s ,on-idé e
(cf. ,
Auroux, 1979, p. 271; Dominicy, 1984, p. 134).
2) LES SYNONYMES
Il n'y a pas de synonymes "parfaits" dans la philosophie du
Page 156
langage
des Lumières.
synonymes
tous
Les
grammairiens
philosophes
les termes d'une même langue qui ont le
pour signification principale,
synonymes doivent se distinguer par les
car
s'''il
idées
y avait des synonymes parfaits,
dans une même langue.
et contraire l
246) ;
la Raison,
l
il
accessoires,
aurait
deux
Quand on a trouvé le signe
d'une
idé e, on n'en cherche pas un autre",
p.
même
comme "père " et "papa". Mais tous
les
langues
appellent
y
comme l'explique Du Marsais
cela serait parfaitement
inutile
qui ne produit jamais deux instruments
différents et appropriés pour accomplir exactement la même tâche.
Beauzée, dans l'article "Synonyme" de l'Encyclop'di., insiste lui
aussi
cité
sur
le
clarté,
la rationalité de l'usage des synonymes
même passage du Tr.it,
la
précision
et
responsable
mots synonymes,
préférence l
"ce
qui
d.s
réfléchi
qu'il
celui qui convient la "mieux
tout autre mot signifiant la même
dont
raison même,
conséquent il doit en
êtr~
la
locuteur
plusieurs
la situation,
de
idée principale :
l'autorité
la manière constate l'usage,
& par
du
entre
l
avoir
justesse,
exigent
choisisse,
se prouve dans chaque langue par
écrivains
la
trop.s;
et même l'élégance
après
des
est fondé
bons
sur
la
de même dans toutes
les langues formées et polies" (Beauzée). Lorsque deux mots d'une
même langue se voient assigner exactement la même
en
général
utilisé,
l'un
comme
ressemblance
de
des deux devient désuet et
"maint"
et
"plusieurs"
signification
conservé que l'un de ces termes,
inutile."
qui est cause
signification,
n'est
"c'est
que
plus
guère
la
grande
l'usage
n'a
et qu'il a rejeté l'autre comme
246).
(Du Marsais,
Page 157
Ainsi,
l'équation
n'est
jamais vraie dans les langues naturelles,
valeurs aj outé es
et un
M~
a donc toujours au
mo~ns
un contexte où deux
m~me
langue
l'autre.
des
~tre
ne peuvent
La
que
quelconques d'une
substitués
m~me
langue.
synonymes
indifféremment
les Messieurs font remarquer
Il
d'une
l'un
relation de synonymie ne vaut pas seulement
éléments du lexique;
les
ne coïncident jamais de part
in
M~
et d'autre pour un
y
... ,
i:z ,
parce
à
entre
que , les
phrases "Vous mentez!" et "Vous savez le contraire de ce que vous
dites"
expriment le
idées
m~me
accessoires près.
expriment,
"une
volonté
(Condillac,
De même,
semble-t-il,
l'indicatif produit un
fond de pensée
la
la
"Fais-le!" et "Tu le
même
pensée,
plus absolue dont on ne se permet
Sr •••• ir.,
en va-t-il de
demande
mais
pas
aux
feras!"
futur
de
représente
d'appeler"
p. 472); l'usage du futur de l'indicatif
m~me
s'il pleut",
le
commandement plus "positif" ; '
parait augmenter le "degré de puissance" du
être
pensée,
m~me
commandement.
pour les phrases "Pleut-il?" et
etc.?
(Nous reviendrons sur ce
Peut"Je
te
point
en
temps et lieu).
C'est
pour la
1.s
l'abbé Girard qui discuta le premier
cette
matière
langue française (L. just.ss. d. 1. 1.n9u. fr.nçois.
diff'r~nt.s
signific.tions
d.s
Page 158
.ots
qui
p.ss.nt
ou
pour
(1718),
s'Inon'l •• s
repris et augmenté sous le
d.s
T,..it~
justesse l l
qui
ouvrage
)
.
Pour
parler
"avec
il faut apprendre à reconnattre les idées accessoires
,
distinguent entre eux les mots synonymes;
beaucoup
titre
d'occasions une nécessité de choix,
"d'où
natt
dans
pour les placer
à
propos, et parler avec justesse. Il (Girard, cité par Auroux, 1979,
p.
Diderot,
269) .
l'Enc'lclop~di.,
dans
l'article
"Encyclopédie"
aborde aussi la question des synonymes en
des mêmes termes.
Condillac,
qui
fut
de
usant
également l'auteur
d'un
enseignait de la même façon au jeune
Prince de
est
Parme qu'il y a toujours une
préférable
concurrentes.
à
toutes
autres
expression dont le choix
expressions
(synonymes)
De même, Beauzée, dans l'article "Synonyme" : "Les
chef-d'oeuvres immortels des anciens sont parvenus jusqu'à
nous
les
entendons,
nous les admirons même;
mais
combien
beautés réelles y sont entièrement perdues pour nous,
nous
ne
connaissons
pas
toutes
caractérisent le choix qu'ils ont fait
leur langue!".
le
dévolue.
lexique
parce
nuances
fines
de
que
qui
& ont da faire des mots de
La Raison enseigne qu'il ne faut pas multiplier
les entités sans nécessité;
dans
ces
nous;
un mot nouveau ne se fait une
que s'il peut remplir une
tâche
à
Il en coate assez de former des mots nouveaux,
mémoriser et d'apprendre à les utiliser convenablement,
multiplier inutilement.
Page 159
place
lui
de
seul
les
sans les
3) LES TROPES
(1730) ,
reprend
et
Marsais
Du
développe ainsi l'explication de l'origine
du
sens
figuré qu'avaient déjà entrevue les Messieurs dans leur Logiqu. :
La liaison entre les idées accessoires,
je veux
dire, entre les idées qui ont rapport les unes
aux autres,
est la source et le principe des
divers sens figurés que l'on donne aux mots.
Les objets, qui font sur nous des impressions,
sont toujours accompagnés de différentes circonstances qui nous frappent,
et par lesquelles
nous désignons souvent,
ou les objets m~mes
qu'elles n'ont fait qu'accompagner, ou ceux dont
elles nous réveillent le souvenir. Le nom propre
de l'idée accessoire est souvent plus présent à
l'imagination que le nom de l'idée principale,
et souvent aussi ces idées accessoires, désignant les objets avec plus de circonstances que
ne le feraient les noms propres de ces objets,
les peignent ou avec plus d'énergie,
ou avec
plus d'agrément.
De là,
le signe pour la chose
signifiée, la cause pour l'effet, la partie pour
le tout, l'antécédent pour le conséquent, et les
autres Tropes dont je parlerai dans la suite.
(Tr.it, d.s Trop.s, p. 28).
Les
tropes apparaissent lorsque nous mettons le
nom d'une
idée accessoire à la place du nom de l'idée principale à laquelle
la
première se trouve régulièrement associée dans
locuteurs.
l'idée
Par
exemple,
l'esprit
à l'époque de la navigation
de voile était régulièrement associée à celle de
l'idée de
bateau faisait spontanément venir
Page 160
à
des
voile,
bateau;
à l'esprit celle de
voile.
Dans ces conditions,
l'idée
accessoire . à la place du nom de l'idée principale
il est possible de mettre le nom de
et
de
dire "voile l l pour "bateau". Le rapport entre l'idée accessoire et
l'idée principale est ici de la partie pour le tout (synecdoque).
C'est
sur
l'idée
la
nature des rapports entre
principale
figures
que
métaphore,
sont fondées
l'idée
les
accessoire
diverses
et
classes
de
lorsque le rapport est de comparaison,
de
ressemblance; métonymie, lorsque le rapport
est du signe pour la
chose signifiée, ou de contenant à contenu; synecdoque, lorsqu'on
met la partie pour le
rapport
est
de
("Metaphor" ,
tout ou
contrariété,
1962) et S.
vice versa;
ironie,
etc.
le
Comme
Auroux (1979),
lorsque
font
Max
le
Black
on peut représenter la
plupart des figures de signification comme des opérations F1, F2,
... ,
Fn,
(S1),
qui,
appliquées au signe ou
nom propre d'une idée
permettent à S1 d'exprimer une idée
j
i
différente de celle
qui constitue ordinairement sa signification propre, soit F1(S1)=
S~
(et similairement pour F2, F3, etc.). L'opération F1 peut être
fondée
sur
contrariété,
signifier
F2
un rapport de ressemblance,
etc.
une
Ces
idée
opérations
sur un
permettent
qui n'est pas sa
à
rapport
un
signification
de
mot
de
propre
ou
primitive.
"Les Tropes sont des figures par lesquelles ont fait prendre
à
un
mot
une
signification
qui
n'est
mot"
(ibid.,
"signification
propre"
signification
propre
classiques,
la
de ce
Page 161
pas
p.
d'un
précisément
la
Pour
les
est
sa
18) .
mot
primitiv.,
signification
qu'il
a
reçue
litt.ral.
sa
à l'origine
est
d'abord
"première signification",
par
et
imposition.
avant tout
La
celle
celle
signification
qui
se
présente
imm.di.t.m.nt et régulièrement à l'esprit des locuteurs.
la
théorie
jamais
s'ils
pour
sont
de la signification des
signification qu'une seule
idée
les
mots
n'ont
principale,
susceptibles d'une multitude d'usages
Auroux, 1979, p. 282).
ne
Lumières,
Et dans
figuré s
m~me
(cf.
Les significations primitive et littérale
coïncident pas toujours,
comme cela se produit dans le
cas
des catachrèses; les mots IIfeuille", "patte" et "aile" n'ont plus
leur signification primitive dans les expressions 'lune feuille de
papier'l,
Illa patte de la table"
et Ill'aile de l'hôpital ll ,
mais
celles-ci ne présentent jamais qu'un sens littéral à l'esprit des
locuteurs,
un sens littéral figuré
Il n'y a pas
le
cas
(cf.
Auroux,
1979, p. 280).
substitution d'une expression pour une .autre
des catachrèses,
contrairemeht aux
autres
figures
signification. Un siècle après Du Marsais, Fontanier
dans
de
(4)
exclura
les catachrèses de la tropologie et de la rhétorique des
figures
justement parce qu'elles sont des tropes forcés et nécessaires où
le locuteur ne fait,
à
une
1457b) ;
comme le disait Aristote, aucun
chose d'un nom qui en désigne une
autre'l
le signe d'une idée est simplement
nouvelle
jouent
l'évolution
des
la
langues,
en
permettant
la mémoire des locuteurs,
Page 162
Po4tiqu..,
langue.
par là un rôle important dans la
genèse
l'expression
nouvelles sans augmenter le nombre des mots,
surcharger
(L.
appliqué à une
qui n'avait pas de signe propre dans
catachrèses
Iitransport
car la
idée
Les
et
d'idées
et par suite,
signification
sans
des
expressions catachrétiques est "motivée".
Les
grammairiens
métaphores
et
les
philosophes
savaient
autres figures ne sont
bien
pas
de
que
ces
les
choses
réservées à une élite savante et lettrée. Boileau disait qu'il se
faisait
plus
de figures en un seul jour de
marché
aux
Halles
y
faisait
qu'il ne
s'en trouve dans toute l'En4id.;
Dumarsais
allusion
lorsqu'il
"il se fait
écrivait à son tour:
plus
de
figures en un seul jour de marché aux Halles qu'il ne s'en fait à
l'Académie
mots",
en plusieurs séances consécutives".
les carences lexicales,
recours aux tropes.
des
"bons
commun
au
langage
que
celui
désigner
ou
d'ailleurs,
des savants académiciens
est
est
On pensait également que
une
~tre
plus
un
le
humains dépassant le stade des gestes et
inarticulés devait
pour
expliquent en partie ce fréquent
d'Amérique
XVIII- siècle.
des
"disette de
Que le langage des enfants, des illettrés et
sauvages"
tropologique
La
lieu
premier
des
cris
tropologique; dès qu'un signe fut utilisé
chose,
les
humains
ont
naturellement
eu
tendance à l'appliquer aux choses qui ressemblaient à la première
chose nommée.
hommes
quand
Selon Condillac,
dans les
ne multiplièrent pas les mots
commencements,
sans
ils commencèrent à en avoir l'usage:
nécessité,
il leur en
trop pour les imaginer et pour les retenir." (Ess.i sur
p.
85) ;
sur-tout
coütoit
l'ori~in.
il leur fallait donc
utiliser en leur faisant prendre divers sens.
Page 163
"[l]es
les
Les sujets parlant
une
langue pauvre,
une langue dont le lexique est déficient
en
comparaison avec une langue associée à une "grande civilisation",
sont
constamment
obligés d'utiliser le peu de mots
qu'ils
avec
plus d'imagination que nous pour arriver à exprimer
ont
toutes
leurs pensé es,
tandis que les personnes "cultivées " ont
presque
toujours
mot juste".
par
le
d'exprimer des idées nouvelles à l'aide de mots déjà
en
langage
"le
Cette possibilité
offerte
usage permet une économie sémiologique appréciable, du moins dans
la mesure où ces significations nouvelles sont mati
tropes ne servent pas qu'à combler les carences
ont
encore
fonction
plusieurs autres usages.
ornementale,
permettent
v, ••.
lexicales;
Par exemple,
d'embellir
Mais les
le
ils
ils ont
une
discours,
de
l'ennoblir, de lui donner plus de concision, plus d'énergie, plus
de
force,
et même plus de clarté et de
d'intérêt et d'agrément.
les
idées
les
plus
précision,
Les tropes permettent aussi
abstraites
en
les
présentant
enfin
plus
d'exprimer
sous
les
apparences de choses sensibles, etc.
La théorie des tropes permet non seulement de préserver
validité de la théorie de la signification (cf.
Auroux, 1979, p.
283)
dont elle est un complément indispensable,
voir
clairement la rationalité sous-jacente à ces divers
tropologiques.
Les
tropes
ne contredisent pas
d'économie et de simplicité de la Raison commune;
toutes
ces manières "détournées" de s'exprimer,
Page 164
la
mais elle
les
fait
usages
principes
au
cqntraire,
qui
s'écartent
plus
ou
moins
permettent
exprimer
de l'expression simple
non
seulement
beaucoup
et
une économie
d'idées en variant
commune
des
considérable
l'usage des
idées,
(on
peut
mots),
mais
elles accroissent en plus l'efficacité de la communication
de concision,
plus d'énergie,
plus d'agrément,
etc.) ,
(plus
donnent
plus d'étendue au langage en nous rendant capables d'exprimer des
choses intangibles,
temps,
de décrire les passions, notre expérience du
notre expérience amoureuse,
l'usage
sache
heureux
religieuse,
des tropes exige de la part du
etc.
De
plus,
locuteur
qu'il
le trope qui convient le mieux au sujet
choisir
parle et aux circonstances de l'énonciation,
dont
il
comme le souligne à
plusieurs reprises Condillac dans D. l'.rt d'4crir •.
Au
siècle
suivant, Fontanier considère qu'''il est évident qu'on ne peut pas
les (=tropes) employer au hasard ni indifféremment.
ne
peut pas les employer au hasard
doit donc en
~tre
ni
Mais,
indifféremment,
si on
l'usage
nécessairement réglé et par la raison et par le
goüt." (L.s Figur.s du discours, p. 182).
Du
Marsais
Grammaire
la Grammaire,
faisait
de la tropologie
une
partie
de
la
"ce traité me parait être une partie essentielle
de
puisqu'il est du ressort de la Grammaire de
faire
entendre la véritable signification des mots, et en quel sens ils
sont employés dans le discours." (Tr.it4 d.s Trop.s, p. 22). Pour
Du
Marsais,
la Grammaire Générale doit donc prendre
l'explication
prendre
un
de
m~me
ces
"différents sens dans
mot dans une
m~me
langue",
Page 165
lesquels
en
charge
on
non seulement
peut
parce
qu'ils
sont
tentative
d'un
usage
et
en question
Générale.
de
"le bon sens
locuteur
doit
de la Grammaire
rendre
ne permet pas
idé es
des
di ffé rent es Il
utilisés sérieusement et littéralement,
qu'une idée principale.
de
certaines
exprimer
la
Mais cet
communication;
circonstances,
des
il
préserver
même
les
;
mots,
n'expriment jamais
est
des
idées nouvelles ou pour
Le
(15)
la
à
plus
usage est trop limité pour les
d'utiliser
manière des idées rebattues.
donc
toute
mais aussi parce que les tropes remettent
certains des principes du noyau dur
muets",
expression
de
que
Comme l'écrit Diderot, dans sa fameuse "Lettre sur les
et
besoins
universel
pour rendre compte de la compétence du
forcément s'y arrêter,
sourds
si fréquent
donc
rationnel,
dans
courants
pour
mots
exprimer
d'une
nouvelle
grammairien philosophe soucieux
l'intégrité de son programme de
recherche
devait
expliquer les divers usages (ou "écarts") tropologiques
invoquant
des
principes conforment à ceux du noyau dur
de
en
son
programme.
Cette
approche théorique de
la
non-littéralité
est-elle
sémantique ou pragmatique?
viv.,
Seuil,
sémantique
1975),
de la
la
tropologie classique est
"métaphore-mot"
"changent
de
sens l l
constaté
(chapi tre
dans
le
premier)
expliquant
discours.
à
la
Nous
suite
une
théorie
comment les
avons
de
mots
cependant
plusieurs
commentateurs, que la logique et la grammaire classique faisaient
Page 166
une
large place à la "pragmatique" (entendu au sens de
pourquoi
en irait-il autrement de la tropologie?
que la Grammaire,
comme le dit Du Marsais,
Morris);
D'autant
plus
doit faire Ilentendre
la véritable signification des mots ll (sens primitif et littéral),
et
leurs divers uSAge. dans le discours (écarts par
sens
littéral).
Si
la signification des mots et
énoncés ne sont Ildéterminés ll que dans le
rapport
le
discours,
au
sens
des
relativement
aux intentions des locuteurs, aux circonstances de l'énonciation,
cette détermination du sens (en contexte) vaut. fortiori,
semble,
pour
les
tropes.
Par ailleurs,
l'affirmation malheureuse que les
le
discours,
étrangères
aurions
mots
si on
s'en
il me
tient
Ilchangent de sens"
dans
qu'ils se chargent de significations nouvelles
leur signification
à
alors
courante
en termes
affaire,
plus
et
littérale,
contemporains,
à
et
nous
à
une
approche sémantique de la non-littéralité.
4) LES INVERSIONS
Si
la
pensée est la même
partout
pourquoi l'ordre des mots n'est-il pas le
langues?
mots
fut
Le problème
l'occasion
grammaticales
études
c., .
du
et
pour
tous,
toutes
les
des inversions et de l'ordre naturel
des
d'une
XVIII-.
des
u.
plus
Ricken
m@me dans
célèbres
y
controverses
consacra
plusieurs
D'après lui la théorie de l'ordre naturel est
du rationalisme;
alors
issue
défendue par Port-Royal, Du Marsais et Beauzée,
Page 167
cette
doctrine suscitera l'opposition de Batteux,
Diderot,
lieu
Condillac
tous sensualistes. Le problème de l'inversion serait le
d'un autre affrontement entre les deux principaux
philosophiques
toile
et
qui
de fond,
modernes
sur
française.
traversent le siècle
des
courants
Lumières(7).
il y a l'affrontement entre les anciens
les
mérites
Mais ce qui,
respectifs
au fond,
des
langues
En
et
les
latine
et
importe pour nous dans cette
querelle, c'est que le postulat de l'universalité de la pensée ou
de
l'uniformité de la
nature humaine, et le principe d'analogie
soient à l'abri des mauvais coups,
et que l'usage ne
contredise
pas constamment les principes de la Raison commune.
Dans
les
éléments de syntaxe
donnés
par
les
Chapitre XXIV
ou
Construction
traditionnelle
des
syntaxe
présentée et discutée.
doivent
une
la
convenance/syntaxe
Syntaxe
convenir ensemble",
genre et personne;
(ibid.);
partout
l'autre
utilisent
[lJ a
Syntaxe
arbitraire" ...
est
"quand les
mots
c'est-à-dire s'accorder en
153) .
La
nombre,
syntaxe
"la mesme dans toutes les
de regime
(p.
p.
154) ,
au
contraire,
des prépositions.
Page 168
est
et diffère d'une
les unes se servent de flexions
plutôt
régime
syntaxe de régime, "quand l'un des deux cause
est pratiquement
Il
distinction
de
de convenance,
variation dans l' autre l l (8.8.R.,
convenance
"De la Syntaxe
mots
de
Messieurs
Mais il
y
a,
Langues"
presque
langue
casuelles,
de
à
d'autres
disent
les
Messieurs,
des "maximes generales,
qui sont de grand usage dans
toutes les Langues" (p. 155). Parce nous parlons presque toujours
pour
(et
dire ce que nous attribuons aux
rarement
pour dire seulement ce
choses que nous
que
nous
concevons
concevons),
un
nominatif doit toujours
~tre
sous-entendu" (ibid.).
De même, il ne peut y avoir de verbe sans
nominatif
affirme,
(exprimé
marque
ou
le
en rapport avec un verbe "exprimé ou
sous-entendu),
jugement,
puisque
seul
le
verbe
et qu'il faut bien qu'il
quelque chose sur lequel porte le jugement.
Enfin,
n~
de
génitif
le régime des verbes
est habituellement marqué par les cas (accusatif ou datif)
prépositions,
"en
quoy
toutes les Langues" (p.
il faut toa.jours
157) .
ait
Ensuite, il ne peut
y avoir d'adjectif sans rapport à un substantif;
sans un nom auquel il se rapporte.
y
ou les
consulter l'Usage
de
Les Messieurs nous assurent
que
"s'il se rencontre quelque chose de contraire en apparence à
ces
règl es, c'est par figure ... "
L'ordr.
idées
natur.l des mots est donc calqué
dans le jugement
concevons,
"figures
et ensuite,
de
hyperbates,
construction,
~tre
(p. 154).
d'abord,
peuvent
l'ordre
marquer les objets que
ce que nous disons de ces
construction"
etc.)
sur
(syllepses,
affecter
objets.
ellipses,
l'ordre
des
nous
Les
pléonasmes,
naturel
de
la
mais la liaison des idées dans le jugement ne peut
altéré sans provoquer des absurdités et il est le
Page 169
m~e
dans
toutes les nations. Les propositions considérées grammaticalement
sont
des images de nos jugements (et des autres
l'âme"),
faveur
Iimouvements
de
mais ces images peuvent s'écarter de leurs modèles à la
de
certains
effets
expressifs,
qui
font
prendre
au
discours plus d'élégance, plus de vivacité, etc. Les figures nontropes, comme les figures tropes,
mettent souvent, en apparence,
l'usage en contradiction avec la Raison.
C'est
le
cas avec les
syllepses,
lorsque
nous
faisons
l'accord en tenant compte des pensées et du sens, et non des mots
effectivement uti.lisés,
comme "la plupart sont venus" au lieu de
"la plupart est venue",
ou "il est six heures" au lieu de "elles
sont
six heures",
etc.
Fontanier,
ex-professeur de
Grammaire
Générale, traite ces cas sous le titre "Synthèse"; voici ce qu'il
écrit
à
français
propos d'un cas curieux de synthèse dans
"Les vieilles gens sont soupçonneux".
peut-il @tre à la fois féminin et masculin dans une
le
genre
en
Comment "gens"
m~e
phrase?
Ne serait-ce pas là une bizarrie inconcevable
dans les lois de la grammaire, qui ne doivent
@tre fondées que sur la raison? Mais voyons
si la raison elle-m@me ne viendra pas ici
justifier l'usage
l'usage,
en fait de
langue,
est bien moins souvent en opposition
avec elle qu'on ne croit.
(Lits Figurlts du
discours, p. 309).
"Persuader et convaincre,
tel est le but de la R.ison
dans
le
discours", écrit-il ailleurs . (p. 463). Lorsque ses propres moyens
Page 170
lui font défaut,
de
la Raison fait appel aux ruses et aux artifices
l'esprit et de. l'imagination.
"hommes"
sont
réunissant
presque
les
Ainsi,
synonymes,
deux genres,
parce que
"gens"
est
"gens"
conçu
permettant l'ellipse
de
et
comme
"hommes"
("Les vieilles gens sont [des hommes] soupçonneux").
A part les
syllepses
aussi
ellipses
(ou synthè ses)
les Messieurs mentionnent
(lorsque des éléments du discours sont
les pléonasmes
renverse
retranchés)
(lorsque des éléments du discours sont
ou superflus dans l'énonciation).
les
et
redondants
Il y a enfin l'hyperbate, "qui
l'ordre naturel du discours"
(S.S.R.,
p.
160) .
Ces
figures furent souvent appelées "figures de grammaire",
car
grammairiens les considéraient traditionnellement comme
relevant
de
leur juridiction,
leur connaissance étant
fort
rendre compte d'un grand nombre de constructions.
les
utile
pour
L'ellipse,
en
particulier, joue un rôle très important pour retrouver, sous les
irrégularités
"l'analogie
de
de
la
la
langue,
langue".
les
Son
règles
usage
de
est
la
fondé
grammaire,
en
raison
(Condillac), puisqu'il est inconvenant et inutile de prononcer ou
de répéter des paroles dont on peut faire l'économie sans risquer
de
porter
atteinte à l'efficacité de
usage
de
moins
jusqu'aux
la
communication.
l'ellipse dans la Grammaire philosophique
grammairiens
latins
L'ordre
naturel
remonte
de
la
Renaissance,
est celui que suit
la
pensée
particulier Linacre et Sanctius c . ,
Cette
au
en
•
Page 171
dans
ses
opérations.
Du Marsais reprend et développe cette doctrine
dans
l'article "Construction" de l'Encycloplditt.
Du Marsais distingue
d'abord entre "construction" et
IIConst,.uc t i on, .
il,
peut
Il
syntaxe" .
di t-
ne présente que l'idée de combinaison et d'arrangement";
dire
on
ou
il y a là trois constructions différentes,
puisque
l'arrangement n'est pas le m@me,
seule syntaxe,
mais il n'y
"car dans chacune de ces
a
qu'une
constructions,
il y a
les mêmes signes des rapports que les mots
ces
ont entre eux;
rapports sont les m@mes dans chacune de
Marsais
distingue
encore
trois types
de
ces
ainsi
phrases".
constructions
Du
la
construction "naturelle" (ou "simple", "analytique", "nécessaire"
ou "fondamentale"), la construction "figurée", et la construction
"usuelle".
La
(ellipses,
construction
figurée,
pléonasmes, etc.),
provoque
rapport à la construction simple;
philosophe
doit
(ibid.) .
La
pénétrer
construction
le
avec
ses
certaines anomalies par
c'est pourquoi III e grammairi en
mystère
usuelle
de
est
leur
un
irrégularité I l
mélange
elle autorise des tours particuliers,
premières;
inversions
des
deux
des idiotismes
qui sont devenus des habitudes de parler d'un peuple. Mais ce qui
fait
d'une
sensé e,
c'est
naturelle.
naturelle
construction
figurée ou
usuelle
une
construction
la possibilité de la "réduire" à la
construction
Une phrase qui ne peut @tre ramenée à la construction
ou analytique n'est simplement pas une phrase
La construction naturelle
est le seul moyen nécessaire pour énoncer nos
pensées par la parole, puisque les autres
Page 172
sensée.
sortes de constructions ne forment un sens,
que lorsque par un simple regard de l'esprit
nous y appercevons aisément l'ordre successif
de la construction si.pl •.
Et parce qu'elle est nécessaire,
on la retrouve dans toutes les
langues
Ainsi je trouve que dans toutes les langues du
monde, il n'y a qu'une manière nécessaire pour
former un sens avec les mots
c'est l'ordre
successif des relations qui se trouvent entre
les mots, dont les uns sont énoncés comme devant être modifiés ou déterminés, & les autres
comme modifians ou déterminans
les premiers
excitent l'attention & la curiosité; ceux qui
suivent la satisfont successivement.
Et plus loin
Comme par-tout les hommes pensent, & qu'ils cherchent à faire connoitre la pensée par la parole,
l'ordre dont nous parlons est au fond uniforme
par-tout; & c'est encore un autre motif pour
l'appeller n.tur.l.
Dans l'ordre naturel du discours, les mots modifiés ou déterminés
précèdent
L'ordre
donc normalement les mots modifiants ou
de la construction naturelle est le
compréhension
linguistique"
selon
Page 173
déterminants.
"fondement de toute
l'expressionn
de
Ricken
Marsais soutient que la nature et la raison nous enseignent qu'il
~tre
faut
subir
avant d'opérer,
l'action d'un autre,
réelle ou imaginée"
Pourtant,
pour
~tre
qu'il faut
ou exister
et qu'il faut avoir
~tre
avant
"une
de
existence
qualifié de telle ou telle
Du Marsais n'hésite pas à parler de cet ordre
façon.
naturel
comme d'une
connoissance acquise dès les premières années
de la vie, par des actes si souvent répétés,
qu'il en résulte une habitude que nous regardons comme un effet naturel.
Je comprends mal,
à la lecture de ce dernier passage, que Ricken
puisse
Du
faire
simplement
de
sur
Marsais
l'idée
un
rationaliste
que l'ordre
naturel
en
est
se
basant
universel
et
qu'il devrait, en conséquence, @tre l'expression des idées innées
de
la
Raison
(c f . ,
note
admettait
l'existence
expression
linguistique.
doctrine
des
(7»),
ou parce
indépendante
Du
Marsais
des
qu'il
(Du
pensées
ne parle
idées innées lorsqu'il aborde la
Marsais)
avant
leur
jamais
de
la
question
de
la
genè se des idé es (cf.
p.,.ol. ou l'art. "Construction"); dans l'article "Fini, Finie" de
l'Encyclop~dj.,
non équivoques :
écartés
de
il dénonce la théorie des idées innées en termes
"Les partisans des idées innées se sont si fort
la voie simple de la nature & de la
droite
raison,
qu'ils soutiennent que nous ne connoissons le fini que par l'idée
innée que nous avons,
disent-ils,
Page 174
de l'infini";
et plus
loin,
critiquant
l'hypothèse
connoissons
les
rationaliste suivant laquelle
êtres particuliers,
l'idée de l'être en général",
cette
étrange
hypothèse,
que parce que
"nous
nous
plus
on
la
trouve
contraire
On sait par
que Du Marsais n'admettait pas la doctrine
des
"L'Eloge
sensualistes,
de
Du
Marsais"
par
toutes
facultés
trAnsform6.s,
la
formule
de
à
humaine;
des
si
••nsAtions
Condillac
partout
et
et ses grands moments sont donnés dès l'origine, pour
Quant à l'existence autonome des
leur expression,
de
existent
et que les
genèse des facultés est la même
ainsi dire,
Destutt
nature
de l'âme sont réduites
selon
cette
avant
ailleurs
faute d'admettre des notions communes innées, n'en
pas moins l'universalité de la
pour tous,
à
animaux-machines
d'Alembert),
admettaient
les
avons
il aj out e : "Pl us on ré fléchi t sur
l'expérience & aux lumières du bon sens".
(cf. ,
ne
les sensualistes
(Condillac,
Tracy) admettent que les idées formant
simultanément
Diderot,
un
dans l'esprit du locuteur et
pensées
jugement
que
c'est
dans l'expression du jugement qu'elles deviennent successives:
Si toutes les idées, qui composent une pensée,
sont simultanées dans l'esprit,
elles sont
successives dans le discours
ce sont donc
les langues qui nous fournissent les moyens
d'analyser nos pensées. (Condillac, 8r •••• ir.,
p.436).
(Bien
sl1r,
important
pour
pour
Condillac l'Acquisition du
le d6v.lopp.m.nt de la pensée,
langage
aussi
est
fort
bien pour
l'enfant que pour les peuples à l'origine; mais c'est là une tout
autre question) .
Chez Condillac,
Page 175
certainement
indépendant du
langage et
des signes artificiels;
mais il en va autrement du jUQamant comm. AffirmAtion:
même opération de
l'esprit,
mettre en ordre les
idées
mais on n'arrive à
qui
c'est la
distinguer et à
composent une pensée qu'en
leur
assignant des signes artificiels: il L' affirmation est, en quelque
sorte,
les
moins dans
votre esprit que dans les mots qui prononcent
rapports que vous
437-438).
perception
Les
apercevez. Il
rapports
(dans
le
(Condillac,
envisagés
d'abord
jugement de perception)
pp.
Sr •••• ir.,
relativement
le
sont
à
ensuite
relativement aux idées (dans le jugement comme affirmation).
perception
(ou sensation) ne devient une idée (la
la
Une
signification
d'un mot) qu'après avoir été l'objet de la réflexion, lorsqu'elle
est
considérée comme une "image",
quelque chose.
comme une
représentation
de
(Condillac, Ess.i sur l'origin. d.s connoiss.nc.s
hu •• in.s, p. 47).
Les sensualistes,
de Tracy,
nommément Condillac,
soutiennent des idées proches de celles de Du
en ce qui a trait à l'ordre naturel.
da. id' •• détermine,
idées":
Diderot et Destutt
chez Condillac,
Le
Marsais
principe de la
liAi.on
"l' arrangement naturel des
" pour ne point choquer l'arrangement naturel des idées,
il suffit de se conformer à la plus grande liaison qui est
elles"
(Ess.i sur l'origin. d.s connoiss.nc.s hu•• in.s,
Seules
comptent
la
liaison et la
subordination
des
entre
p. 92)
idées
lorsque le substantif présente d'abord l'idée principale dont
Page 176
on
parle,
que
que les adjectifs sont liés immédiatement au
ce
dernier
discours
phrases
se
les
son
régime,
naturel
des
idées.
"Alexander vicit Darium"
et
"Darium
et sont aussi "naturelles"
l'une que l'autre,
déclinaisons latines permettent de varier les
liaison
fréquentes
le
Les
vicit
sont l'une et l'autre conformes à l'arrangement
en respectant la
la
celui-ci
conforme à l'arrangement
latines
Alexander"
idées
précède le verbe et
substantif,
des
m~me
syntaxe.
idées
est
des
parce
que
constructions
Une construction qui n'altère pas
naturelle.
Les
inversions,
plus
dans les langues "transpositives" comme le latin
dans les langues "analogues" comme le français
de l'Abbé Girard, 1747
(9»),
(selon les
ont par ailleurs des
que
termes
avantages sur
le plan de l'harmonie, de la force et de la vivacité du style. Le
français, par contre,
avec sa structure en Sujet-Verbe-Objet, se
conforme
davantage
"à la plus grande liaison
favorise
plutôt
simplicité
la
et
la
des
netteté
idées",
du
discours.
Condillac en fait un principe dans son Rrt d'4crir.
(p.
"le principe que vous devez vous faire en écrivant,
est de
conformer toujours à la plus grande liaison des idées".
n'exclut
pas le recours à des constructions
peu qu'elles ne soient pas "vicieuses",
et
520)
Ce
"renversées",
c'est-à-dire,
vous
qui
pour
qu'elles
ne relâchent pas trop la liaison des idées.
Le problème de l'inversion est le premier abordé par Diderot
dans sa fameuse ilLettre sur les sourds et muets à l'usage de ceux
Page 177
qui
entendent
et
qui
parlent"
(1751)
Diderot
distingue
l'ordre naturel de l'ordre d'institution (ou ordre scientifique).
L'ordre naturel,
objets
pour Diderot,
sensibles ont été les premiers perçus,
sensibles,
exprimé es
distinguées.
Il
par
les
et
adjectifs,
substantifs
les
qualités
premières
les
abstraits
Les
("couleur" ,
"figure", "étendue", etc.) n'ont été inventés
la suite.
qu'un corps,
par
Les
impé né trabi 1 i té Il ,
que
c'est l'ordre de la genèse.
Si on veut maintenant définir ce
on dira,
substance étendue,
que
c'est
en suivant l'ordre d'institution
impénétrable,
figuré e,
colorée et
"une
mobile";
mais si on enlève de cette définition les adjectifs,
il ne reste
qu'un
définition,
être imaginaire appelé
"substance".
rendue selon l'ordre naturel de la genèse,
figuré e,
impénétrable,
étendue,
La même
devient
mobile,
"co10ré e,
Cette
substance".
dernière ne comporte aucune inversion suivant l'ordre naturel
la
genè se;
mais
la
première
définition
(selon
de
l'ordre
scientifique), elle, inverse l'ordre naturel.
Les adjectifs représentant, pour l'ordinaire,
les qualités sensibles,
sont les
premiers
dans l'ordre naturel des idées; mais pour un
philosophe, ou plutôt pour bien des philosophes qui se sont accoutumés à regarder les
substantifs abstraits comme des ~tres réels,
ces substantifs marchent les premiers dans
l'ordre scientifique, étant, selon leur façon
de parler,
le support ou le soutien des adjectifs. (pp. 350-351).
Diderot
attribue
à l'influence d'Aristote
philosophes de réifier les
cette
"êtres imaginaires"
des
désignés par les
substantifs abstraits, habitude qui aurait selon lui
Page 178
habitude
exercé
une
certaine influence sur la formation de la langue française. En ce
sens,
les
il Y a autant sinon plus d'inversions en français que dans
langues
anciennes.
Mais lorsqu'il examine la
propos du langage d'action et des
question
à
"propositions gesticulées", il
retrouve Du Marsais et Condillac
Sur quelque étude - du langage des gestes, il m'a
donc paru que la bonne construction exigeait
qu'on présentât d'abord l'idée principale, parce que cette idée manifestée répandait du jour
sur les autres, en indiquant à quoi les gestes
devaient ~tre rapportés. Quand le sujet d'une
proposition oratoire ou gesticulée n'est pas
annoncé, l'application des autres signes reste
suspendue. C'est ce qui arrive à tout moment
dans les phrases grecques et latines; et jamais
dans les phrases gesticulées, lorsqu'elles sont
bi en construites. (P. 360).
Cette
manière
présentant
d'abord
rapportent,
idé es" ,
de
etc.) ,
faire connaitre aux autres
même
puis les idées
Diderot
l'''ordre
l'appelle
qui
(en
s'y
didactique des
l'ordre auquel nous devons assujettir nos idées pour les
ordre,
il
pensées
l'idée principale,
communiquer clairement,
cet
nos
complètement et efficacement. Et suivant
on peut dire
"qu'il n'y a point,
ne peut y avoir d'inversion dans
Parce que le français,
et que
l'esprit"
peut-être
(p.
370) .
avec sa structure Sujet-Verbe-Objet, suit
à merveille cet ordre didactique,
Nous disons les choses 'en français, comme l' esprit est forcé de les considérer en quelque
langue qu'on écrive. Ciceron a, pour ainsi dire,
suivi la syntaxe française avant que d'obéir à
Page 179
la syntaxe latine.
D'où il s'ensuit, ce me semble, que la communication de la pensée étant l'objet principal du
langage, notre langue est de toutes les langues
la plus châtiée, la plus exacte et la plus estimable; celle, en un mot, qui a retenu le moins de
ces négligences que j'appellerais volontiers des
restes de la b.lbutift des premiers âges". (P.
371)
Destutt de Tracy appellera
"naturel" cet ordre
didactique,
que nous avons déjà rencontré chez Du Marsais et Condillac
ce qui est incontestablement naturel, c'est-à-dire
conforme à notre nature,
c'est que les signes
suivent les idées; que, par conséquent,
la phrase
commence par l'idée dont on est le plus préoccupé,
et que toutes les autres viennent ensuite à proportion de leur rapport avec celle-là. (8r •••• ir.,
p.158).
Sous l'effet d'une passion vive,
commencer par nommer,
qui la cause"
sang-froid,
ou l'affection qu'on éprouve,
n'y
a
assurément rien
de
d'exprimer d'abord l'idée dont on s'occupe,
remarque
ensuite
comme
y étant renfermée,
l'attribut" (ibid.,
construction
ou
"de
l'objet
Mais lorsque nous parlons calmement et de
(ibid.)
"il
il est tout à fait naturel
naturelle ou
p.
le
m~me
si,
que
l'on
sujet,
C'est là l'ordre
construction inv.r •• est tout aussi naturel.
Page 180
naturel
puis celle que
c'est-à-dire
159) .
dir.ct.,
plus
et
de
la
quelquefois,
la
La pensée, à coup sar, est extrêmement rapide;
nos
conceptions ont assarément un commencement et
cet
ordre
doit
être
respecté
commencement
ne
soit
pas
construction
directe est
pensé e"
165) .
(p.
("il ne
avant
et
que
une
fin,
et
que
le
L'ordre
de
la
marche
de
la
peut
fin").
"l'ordre conforme à la
pas
Il ne suffit pas que le sujet
avant l'attribut; il faut de plus
nom
la
se
mais toutes
soit
exprimé
que tout sujet commence par un
tout attribut commence
par
le
verbe
"être".
principe s'étend aux propositions incidentes ou subordonnées
Ce
aux
principales.
Il faut, par suite, que chacune des idées accessoires du sujet et de l'attribut soit rapprochée de l'idée principale, à proportion du
degré de liaison qu'elle a avec elle; et que,
dans l'énonciation de celles dont l'expression est composée de plusieurs signes, ces
signes soient rangés suivant l'ordre de leur
dépendance les uns des autres.
(Ibid. ,
pp.
165-166) .
Destutt de Tracy,
directe
et
naturelle
linguistique
qu'en
refaisant
marche
tout comme Du Marsais, fait de la construction
fondement
de
toute
compréhension
on ne peut bien saisir une construction
la construction analytique pour
de notre esprit",
intellectuelle"
le
(ibid.,
retrouver
ou "l'ordre invariable de
p.
159) .
Ricken a
inverse
"la
l'opération
peut-être
raison
d'affirmer que les sensualistes ont tendance à considérer l'ordre
des
mots comme un produit du développement
Page 181
historique
(Produkt
le résultat des
parler
d'un peuple;
habitudes
mais je pense que la doctrine
de
de
l'ordre
naturel a été soutenue également par les grammairiens philosophes
sensualistes ,
et
que cette controverse sur l'ordre naturel
des
mots n'est pas le reflet d'une controverse gnoséologique à propos
de l'origine de nos idées, mais plutôt --j'en fais l'hypothèse--,
le
reflet d'un
devant
et
processus
d'affirmation nationale
(le français
l ' emporter sur le latin pour la clarté et la
simplicité)
d'un souci de préserver le postulat de l'universalité
pensé e
(ou de l'uniformité de la nature humaine) .
quel
mots,
n'affecte en rien l'ordre
qu'il soit,
les diverses nations peuvent bien avoir
idées
habitudes de parler,
qui est la
~)
m~me
de
la
L'ordre
des
naturel
des
leurs
propres
cela ne change rien à leur façon de penser,
partout et pour tous.
LA TRADUCTION
Nous pouvons maintenant aborder le problème de la traduction
au siècle des Lumières.
traduction"
m~me
fins
En fait,
il n'y a pas de "problème de la
pour les grammairiens philosophes.
partout et pour tous;
l'expression
(ou
La pensée est
les langues servent partout les
l'analyse)
des
pensées
et
la
m~mes
leur
communication; de là il suit que toutes les langues doivent avoir
Page 182
des
mots
de
différentes
espèces,
"parce
appartiennent à des classes différentes;
que
nos
et elles (les
idées
langues)
n'ont de moyens pour lier les mots, que parce que nous ne pensons
qu'autant que nous lions nos idées.
vrai
de
toutes
les langues qui
(Condillac,
p.
linguistiques substantiels.
de
Vous comprenez que cela
ont
fait
433) .
Il
quelques
y
a
des
est
progrès."
universaux
Toute langue ayant atteint un stade
développement lui permettant de représenter
complètement
la
pensée, doit forcément disposer d'expressions servant à "marquer"
les objets de nos pensées,
et
l'action
de
notre
ce que nous attribuons à ces
esprit
qui
affirme,
nie,
commande, souhaite, etc., c'est-à-dire le sujet,
le
verbe
copule :
proprement
dit,
dont la
objets,
interroge,
l'attribut,
fonction est
unir les deux termes d'une proposition.
celle
de
et
la
Les universaux
de la Grammaire Générale assurent le traducteur de solides points
d'appui pour établir des correspondances entre les lexiques d'une
langue-source
et
d'une
langue-cible.
Nous
avons
vu
(chap.
premier, section 3), comment les grammairiens philosophes avaient
réagi aux "plans d'idées différents" de Maupertuis, qui mettaient
en question jusqu'à la possibilité de traduire.
Dans sa réponse
aux
Rlfl.xions •••
de
Maupertuis,
Turgot
ne se contente pas de réaffirmer l'universalité des sens et de la
pensée;
il identifie ce qui représente à ses yeux les principaux
obstacles
accessoires,
à
la
et
traduction
la
les
métaphores,
disparité du niveau
Page 183
de
les
développement
idées
des
langues
(1 eur
pl us ou moins grande "perf ecti on")
La difficulté de traduire n'est pas si grande
que l'imagine Maupertuis,
et elle ne vient
pas d'un pl.n d'idées diff'r.nt, mais des
métaphores qui à la longue s'adoucissent dans
une langue policée.
Deux langues imparfaites
se ressemblent ainsi que deux parfaites.
Il
me vient une comparaison sensible: une langue
imparfaite dira : t. conduite est pleine de
s.uts d. chtvr.,
et nous dirions plein. de
c.prices. C'est la même chose, et l'un vient
de l'autrej mais l'idée accessoire comme trop
grossière s'en est allée.
("Remarques
critiques sur les Réflexions philosophiques
de Maupertuis sur l'origine des Langues et la
signification des mots", op. cit., p. 26).
La
difficulté
de traduire augmente donc
proportionnellement
l'écart qui existe entre le développement de la langue-source
celui
la
de
langue-cible
("Deux
langues
ressemblent ainsi que deux parfaites")
traduire
langue
Maine
et
se
pas facile, en effet, de
les expressions d'une langue "policée" par celles d'une
et vic. v.rs.,
"primitive",
possible
langue
imparfaites
à
même si cela
est
toujours
à condition de bien vouloir enrichir le lexique
primitive
(10)
On se rappellera aussi la
de
la
réaction
de
qui ne croyait pas qu'on puisse jamais
de Biran,
trouver
"quelque langue étrangère qui fG.t formée sur des plans d'idées si
différents
des
nôtres
<11)
l'époque,
fut
La
que
position de
des
fG.t
Maupertuis,
donc rejetée en bloc par ses
réaffirmèrent l'universalité
l'esprit et
traduction
la
sens
et
héroïque
contemporains,
des
opérations
pour
qui
de
l'existence d'universaux linguistiques substantiels,
Page 184
cherchant
plutôt
différents"
à
expliquer l'apparence
des
"pl ans
d'idées
évoqués par Maupertuis en faisant valoir les
degrés
variables d'évolution et de perfection des langues (qui sont liés
au progrès de la civilisation et des "lumières"), et en mettant à
contribution les concepts d'idées accessoires,
de synonymes,
de
tropes, de figures de construction, de génie des langues, etc.
Le concept de traduction interlinguale est pensé, au XVIIIsiècle,
sur le fond d'une notion déjà familière aux
Les termes "traduction" et
considérés
comme
Condillac.
Mais
"parfaits",
tous
se
que
synonymes
nous
qu'il
n'y
les
uns des
autres
"version"
Girard,
a
par
pas
dans tous les contextes.
de
ont en commun l'idée d'une
et
synonymes
synonymes
certaines
Ainsi,
sont
Beauzée
qui bloquent la substitution de ces termes,
pour les autres,
"traduction "
savons
l'Abbé
les termes qui passent pour
distinguer
accessoires
par
latinistes,
doivent
idées
les uns
"version"
et
"copie qui se fait dans
une langue d'un discours premièrement énoncé dans une autre"(1:2) ;
et
les idées accessoires qui les distinguent sont expliquées
de
la
manière suivante par Beauzée dans l'article
de
"Traduction "
Il me semble que la v.rsion est plus littérale,
plus attachée aux procédés propres de la langue
originale, et plus asservie dans ses moyens aux
vues de la construction analytique;
et que la
tr.daction est plus occupée du fond des pensées,
Page 185
plus attentive à les présenter sous la forme qui
peut leur convenir dans la langue nouvelle.
et
plus assujettie dans ses expressions aux tours
et aux idiotismes de cette langue.
De plus.
et
Ilversion i i se dit plus volontiers des langues anciennes.
"traduction"
des
langues
mentionnés
s'entendent
Condillac.
est
en
modernes.
sur ce point
langue
moderne
Les
la
auteurs
tr.du.ction.
"La
et
trois
v.rsion
écrit
en
langue
ancienne. Ainsi la Bible franc oise de Sacy est une tr.du.ction. et
les
Bibles
latines.
grecques.
arabes et
syriaques
sont
vttrsions. Il
Enfin,
aussi
538) .
la traduction s'oppose non seulement à la
au
(figures
commentaire.
soucieuse
à son "génie";
d'adapter
version.
assujettie
aux
mais
"tours"
et les idiotismes) propres à
la traduction.
la
plus
langue-
l'auteur est libre d'ajouter ou
des éléments à la pensée qu'il cherche à rendre
langue;
il
la
est
elle.
la pensée traduite au génie de
Dans un commentaire.
retrancher
sa
La version est
tropes et non-tropes,
langue-source.
cible.
des
n'est plus assujetti aux règles strictes
de
dans
de
la
version et de la traduction. "Rien n'est plus difficile ...• écrit
Beauzé e.
et
rien n'est plus rare qu'une excellente
tr.du.ction,
parce que rien n'est plus difficile ni plus rare que de garder un
juste
la
milieu entre la licence du commentaire et la servitude
de
lettre. 11
Marmontel.
cosignataire
(avec
Page 186
Beauzé e)
de
l'article
"Traduction"
de
l'Encyclop4di. (il complète l'article
rubrique
variabl es
traduisante",
et
écrit-il,
de
ce
que
Mounin
appell e
le
ou d'historien,
ou à
plus indispensable des
est de rendre la pensée;
en
technique
l'ouvrage d'un poète.
devoirs
du
"Le
tr.duct.ur,
et les ouvrages qui ne
pensés sont aisés à traduire dans toutes les
cite
"l' opé rat i on
suivant que l'on a affaire à un ouvrage
philosophe
premier
que
une
insiste sur les degrés de
di fficul té
de
par
sont
langues."
exemple la fameuse traduction que fit Pierre
Il
Coste
de
laquelle parut en
1700
après
"Mais,
avoir
poursuit-il,
été revue et approuvée
par
Locke
lui-m~me.
si un ouvrage profondément pensé est
écrit
avec énergie, la difficulté de le bien rendre commence à se faire
sentir".
Et
la traduction sera d'autant plus malaisée que
les
caractères de la pensée exprimée seront liés de près au choix des
termes utilisés par l'auteur:
Ainsi à mesure que dans un ouvrage le caractère
de la pensée tient plus à l'expression, la traduction devient plus épineuse. Or les modes que
la pensée reçoit de l'expression sont la force,
comme je l'ai dit, la noblesse, l'élévation, la
facilité, l'élégance, la gr~ce, la naïveté,
la
délicatesse, la finesse, la simplicité, la douceur, la légèreté,
la gravité,
enfin le tour,
le mouvement,
le coloris et l'harmonie;
et de
tout cela, ce qu'il y a de plus difficile à imiter n'est pas ce qui semble exiger le plus
d'effort. Par exemple, dans toutes les langues
le style noble, élevé, se traduit;
et le délicat, le léger, le simple, le naïf,
est presque
intraduisible. (Ibid.)
Page 187
Ce que dit ici Marmontel, et ailleurs où il parle du charme
des
la
"ouvrages d'agrément"
matière",
n'est
où
"le travail est plus précieux que
pas sans rappeler ce
propos de la "fonction poétique",
le
genres
littéraires à la
palette de l'orateur,
il,
Jakobson
lorsque l'accent est
message pour son propre compte"(13) ,
différents
qu'écrit
"mis sur
Marmontel compare
palette
d'un
à
peintre;
de l'historien ou du philosophe n'a,
les
la
dit-
que des "couleurs entières qui se retrouvent partout", alors
que celle du poète "est mille fois plus riche en
couleurs",
couleurs peintes par le poète ne se retrouvent pas partout,
la mesure où
langage
ressources
dans
Ille coloris de l'expression tient à la richesse
métaphorique,
et
cet
chaque
traducteur
a
ses
traduction d'une poésie doit alors faire preuve de créativité
et
sa palette de nouvelles couleurs,
de tours et d'expressions
qui
langue
la
langue
Le
égard
du
entreprend
enrichir
particulières",
à
Les
enrichir
sa
propre
nouvelles,
Prenons les difficultés selon l'ordre que nous avons suivi,
en
commençant
par les idées accessoires et
les
synonymes,
La
traduction est elle-m@me une relation de synonymie interlinguale,
le premier "devoir du traducteur" étant de "rendre la pensée", la
pensé e
exprimée
signification
dans
la
langue-source
(le
sens
ou
des phrases n'étant rien d'autre que les idées
la
et
pensées exprimées par un auteur ou un locuteur), Dans une languePage 188
source (L1)
et une langue-cible (L2) ,
on peut trouver de part et
d'autre de nombreux synonymes (c'est-à-dire des termes ayant pour
signification
la
même
idée
principale) ,
mais
les
peuples
n'associent pas forcément les mêmes idées accessoires aux
termes
qu'ils utilisent.
Le traducteur d'une expression quelconque
énoncée
devra
dans
quelconque
M~
la
même
possible
trouver
un
mot
dans L2 qui satisfasse à l'équation
un traducteur doit s'efforcer de trouver, dans la
Dit autrement,
langue-cible,
autant que
M~
un mot quelconque
idée principale
I~,
qui non seulement signifie bien
mais qui soit de plus
mêmes valeurs ajoutées (idées accessoires);
trouver la perle rare,
chargé
s'il n'arrive pas
des
à
il n'aura d'autre choix que de recourir à
Les langues n'ont pas toutes les mêmes synonymes,
la périphrase.
et les peuples ne distinguent pas tous les mêmes nuances dans les
phénomènes ou dans les moeurs;
chacun procède selon ses
besoins
et intérêts,
et développe,
ces intér@ts,
un vocabulaire plus ou moins abondant pour décrire
les
en proportion de ces besoins et
mêmes phénomènes (les Esquimaux pour la
pour le chameau,
les Français pour le pain, etc.).
peuvent avoir plusieurs termes
L2,
les
Arabes
Deux langues
(synonymes) pour signifier de part
et d'autre la même idée principale;
de
neige,
de
mais il n'y a pas
correspondance un à un entre les synonymes de L1 et
forcément
ceux
de
car les idées accessoires ne sont pas forcément les mêmes de
part et d'autre.
Page 189
Pour
traduire
Turgot,
provient des métaphores;
métaphoriquement
lui,
on s'en rappelle,
"le coloris de
toute la
et ce que
l' expression l l
la richesse du langage métaphorique l l
I là
difficulté
de
Marmontel
appelle
tient,
d'après
,
Avant
•
eux,
Du
Marsais,
difficulté que représentent les tropes pour le traducteur. Toutes
les langues ont des tropes;
chacune
a
les siens.
donnera
souvent
malheureusement pour le
La traduction mot à mot
quelque chose d'outré et de
traducteur,
d'une
métaphore
ridicule
dans
la
I l
il
langue-cible.
Un mot ne conserve pas dans la traduction tous
les sens figurés qu ' il a dans la langue originale: chaque langue a des expressions figurées
qui lui sont particulières, soit parce que ces
expressions sont tirées de certains usages établis dans un pays,
et inconnus dans un autre,
soit par quelque autre raison purement
arbitraire. (Tr.it4 d.s Trop.s, pp. 36-37).
Dans ces conditions,
le traducteur n'a pas le choix
doit
à quelque autre expression
propre
avoir
recours
langue qui réponde,
s'il est possible,
figurée
à celle
de
de
sa
son
auteur l l (1 bid.) .
Du Marsais distinguait lui aussi deux types de traduction :
la version, et la traduction proprement dite.
Page 190
Dans la traduction
proprement dite,
la lettre,
" on doit alors s ' attacher à la pensée et non
lui-m~me
et parler comme l'auteur
à
aurait parlé, si la
langue dans laquelle on le traduit avait été sa langue naturelle"
(ibid. ,
37-38) .
pp.
Dans la version,
au contraire,
traduire littéralement,
pour bien faire voir "le tour
de
Du Marsais insiste sur le fait
la
langue-source.
dictionnaires
bilingues
de
son
époque
(en
on
doit
original "
que
particulier
les
les
dictionnaires latin-français) confondent souvent
les différents sens que l'on donne par figure
m~me
mot dans une m~me langue;
et les
différentes significations que celui qui traduit est obligé de donner à un m~me mot ou à
une expression, pour faire entendre la pensée
de son auteur. (Ibid., p. 38).
à un
Les lexicographes, soutient Du Marsais, ne doivent pas joindre " à
la
signification
propre d'un mot
quelque
autre
figurée qu'il n'a jamais tout seul en latin" (p.
usage normal et le plus courant,
signification
Dans son
39) .
un nom signifie
habituellement
une idée principale + [des idées accessoires]; mais dans certains
contextes,
nom
il arrive que cette idée principale signifiée par
soit "accessoire" relativement à une autre que
veut signifier,
le
le
locuteur
et que le nom de cette idée accessoire soit plus
présent à l'imagination que celui de l'idée principale qu'il veut
signifier;
mis
dans de tels cas,
pour celui de l'idée principale,
identifier le trope,
veut
où le nom de l'idée accessoire est
exprimer
le traducteur
devra
bien
déterminer quelle est l'idée principale que
l'auteur et son rapport à l'idée
Page 191
accessoire
qui
l'annonce.
Après
cela,
il
pourra
se
mettre
en
quête
de
l'équivalent le plus approprié dans sa langue.
S'il vient à bout des idées accessoires (les
et des tropes,
connotations)
le traducteur devra encore s'attaquer aux figures
de construction. A cet égard, la première tâche du traducteur est
de
retrouver,
inversions,
exprimée.
le
déguisement
pléonasmes,
analytiqu.
nécessaire
sous
ellipses,
natur.ll •.
ou
La
des
figures
etc.),
(syllepses,
construction
la
construction
analytique
à la compréhension véritable et entière de la
Le
traducteur devra donc,
pour retrouver la
réduire les métaphores (et autres tropes),
est
pensée
pensée,
combler les ellipses,
éliminer les redondances, et effectuer les renversements qui sont
nécessaires pour revenir à l'ordre naturel.
correspond
donc
grosso
Cette première étape
.odo à la version,
qui
est
comme
un
préalable à la traduction proprement dite où l'on doit s'efforcer
de
rendre autant que possible une figure par une autre
genre.
près
La version doit permettre au traducteur,
la
trappes
construction analytique,
de la langue-source (tropes,
idiotismes et autres "tours particuliers"),
les
ressources
pensée
tient de
que
en suivant
d'identifier
figures
du
les
de
construction,
pour
évaluer
rendre
en respectant les divers "caractères l l expressifs
l'expression
de
chausses-
et de mieux
lui offre la langue-cible
m~me
la
qu'elle
(noblesse, légèreté, naïveté, simplicité,
etc.) .
Page 192
La
traduction est un art complexe et global
négliger
aucun
traduction,
rendre
des
aspects des deux
pour être "bonne",
langues
, , fi ab le" ,
qui
en
ne
peut
cause.
Une
se doit avant tout de
avec exactitude le même "fonds de pensée".
Les
Lumières
appellent "version" une traduction qui s'en tient à cela. Mais la
version
ne donne jamais un
"ouvrage d'agrément",
heurte constamment au g'ni. de la langue-source.
.ontr,r
le
"traduire",
génie de la langue-source,
car
traduit pas;
le génie d'une langue,
elle
se
La version doit
mais elle
ne
peut
le
ne
se
par définition,
et s'il ne peut être traduit,
chercher à le traduire?
car
pourquoi
devrait-on
Montrer le génie de la langue-source, ce
n'est pas encore traduire au sens strict.
Dans la Sr •••• ir. g'n'r.l • • t r.isonn'., la notion de génie
des langues n'apparaît que négativement;
s'intéressent
avant tout
à
parce que les Messieurs
"ce qui est
commun
toutes
à
les
langues", le génie des langues apparatt dans leur oeuvre comme ce
qui résiste aux principes de la Grammaire Générale, aux principes
qui
sont valables pour toutes les langues.
qui
est
propre
Générale,
langue.
mais
Ce
à
une langue ne relève
plutôt
de la grammaire
L'explication de
pas
de
la
particulière
qui distingue deux langues du point de vue
Page 193
ce
Grammaire
de
de
cette
leur
génie, c'est, selon Auroux (1979, p. 109), "la différence dans la
signification
encore,
des
selon A.
particuliers
mots
Joly,
et
des
tournures
grammaticales",
"l'organisation spécifique des éléments
qui distinguent une langue
d'une
autre"
(14).
génie d'une langue dépend du génie du peuple ou de la nation
la
parle
et c'est (encore une fois) par un
accessoires
que
ou
Condillac
explique
la
recours
notion
aux
de
Le
qui
idées
génie
des
langues :
Je demande s'il n'est pas naturel à chaque
nation de combiner ses idées selon le génie
qui lui est propre, et de joindre à un certain fonds d'idées principales différentes
idées accessoires, selon qu'elle est différemment affectée. Or ces combinaisons,
autorisées par un long usage, sont proprement
ce qui constitue le génie d'une langue.
(Ess.i sur l'origin. d.s connoiss.nc.s hu•• in.s, p. 103).
comme beaucoup d'autres,
Condillac,
poètes
que
croyait que "c'est chez les
le génie des langues s'exprime
le
plus
vivement."
(Ibid.) .
De-là, poursuit-il, la difficulté de les traduire : elle est telle qu'avec du talent, il seroit
plus aisé de les surpasser souvent que de les égaler toujours.
A la rigueur,
on pourroit m~me
dire qu'il est impossible d'en donner de bonnes
traductions
car les raisons qui prouvent que
deux langues ne sauroient avoir le m~me caractère, prouvent que les m@mes pensées peuvent rarement ~tre rendues dans l'une et dans l'autre avec les m~mes beautés. (Ibid.).
Le
génie des langues dépend de celui des
cause
de
leurs
institutions,
de
Page 194
leurs
peuples;
moeurs
certains,
et
de
à
leurs
pratiques,
s'habituent
accessoires
à associer à certains termes
des
différentes de celles qu'associent d'autres
idées
peuples
(avec d'autres institutions, moeurs, etc.) aux termes équivalents
(quant à la signification principale) de leur langue
Ces
idées accessoires,
respective.
et les tournures grammaticales
typiques
d'une langue, lui confèrent un certain caractère, un génie bien à
elle
qui
ajoute quelque chose de particulier à la
plupart
des
pensées qu'elle sert à exprimer.
Si une théorie de la traduction doit donner les
de
l'art
de
traduire,
principe possible,
montrer comment la
maximes
alors
il
ou règles qui guident
et fournir aux
est
effectivement
pouvant
la
pratique,
l'âge
à
et pas seulement un "empirisme de la traduction"
au XVIII- siècle,
une théorie qui sous-tend,
justifie la pratique de la traduction,
en
traducteurs
y a bel et bien une théorie de la traduction
classique,
Il y a,
traduction
identifier les principaux obstacles
affecter le succès de l'entreprise,
des
fondements
(U5) •
guide
et
et le traducteur désireux
de pénétrer les arcanes de son art n'était pas totalement livré à
un
empirisme
de
trucs et de recettes,
intuitions de locuteur bilingue.
6) L'ORIGINE DES LANGUES
Page 195
ou
aux
aléas
de
ses
J'ai
déjà
traité en passant le
sujet
de
l'origine
des
langues au chapitre premier (section 5). Je voulais alors montrer
qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition entre les rationalistes
et les sensualistes en ce qui concerne le lien qui unit la Raison
et illustrer le principe suivant lequel l'usage de
et la Parole,
la parole est une activité rationnelle orientée vers une fin.
voudrais
seulement
ajouter ici quelques
remarques
Je
concernant
cette problématique et faire voir plus clairement comment opèrent
les
principes
(chap.
de choix rationnels,
premier, section 5),
avancées
suivis
que
nous
avons
formulés
dans les explications conjecturales
par les grammairiens philosophes à propos des
par
les
"premiers
hommes "
lors
de la
procédés
formation
des
langues.
On
distingue souvent trois thèses
dans
la
problématique
classique de l'origine des langues
qu'elle fut
enseignée ou inspirée à Adam par Dieu dans le Paradis
Terrestre,
conformément au récit de la 8.nts. (Chap. II, verset 18-23);
2) qu. 1 •• pr.mi.r •• 1.n;u•• fur.nt 1 P ouvra;. d. la
ou
des
Rai.on,
créations libres de nos facultés naturelles supérieures;
Page 196
qu'elles
se
formèrent à coup de
conventions
et
d'impositions
volontaires;
3)
qu. 1 •• pr.mi.r •• langu •• fur.nt l'ouvrag. d. la
qu'elles ne sont qu'une suite de notre "conformation
Natur.;
naturelle",
c'est-à-dire, au fond, de nos besoins et passions.
Les classiques adoptent en général deux attitudes à l'égard
de
la
thèse
philosophes
de
l'origine
(Beauzée,
divine
Beattie)
certains
l'acceptent
d'admettre qu'il ait été possible à des
~tres
grammairiens
tout
en
refusant
humains d'arriver à
se donner une langue sans aucun secours extraordinaire; d'autres,
plus nombreux,
prennent
mentionnent avec respect le texte biblique,
ensuite
l'épisode
de
la
la liberté de supposer qu'après le
Tour de Babel,
leS humains
se
mais
Déluge
ou
dispersèrent,
retournèrent en quelque sorte à l'état sauvage, et furent bient8t
dans
l'obligation
seules
facultés
imaginèrent
de
se donner une langue à
naturelles.
alors
divers
Ces
l'aide
grammairiens
scénarios,
S.d.nk.n.xp.ri •• nt où interviennent les besoins,
de
leurs
philosophes
conjectures
ou
les passions et
la Raison.
Les auteurs classiques qui ont eu recours à la
conjectures"
"méthode des
ne se faisaient pas d'illusions sur la validité
Page 197
de
leurs
résultats.
Rousseau,
dans son Discours sur l'origin. d.
(1754), écrit à propos des conjectures sur l'état de
nature et les commencements de l'humanité
Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des
vérités historiques,
mais seulement pour des
raisonnements hypothètiques et conditionnels
plus propres à éclaircir la nature des choses
qu'à en montrer la véritable origine,
et
semblables à ceux que font tous les jours les
physiciens sur la formation du monde. ( 1 . )
chap.
bien
l'utilité
des
conjectures
en
II1) ,
Condillac montre
histoire,
qui
permettent
quelquefois de suppléer "au silence des historiens",
des
lacunes
dans nos connaissances du
conjecturer a ses règles",
risque
alors
de
ne
"qu'ébaucher un roman"
des
l'origine
passé;
mais
et si elles ne sont pas
1979,
pp.
57
d'où
cit., p. 110)
vient leur
de
suivies,
on
(17)
Les spéculations des classiques sur
ne
sont,
du
comme
dit
qu'une
reste,
p.
14,
Kant,
façon
note 24;
et 60) et l'idée d'arbitraire.
Si les langues sont fondées partout sur les
alors
"l'art
rien
langues
d'autre,
combler
faire
d'approfondir "l'essence du langage" (Chomsky,
Auroux,
de
diversité?
Certains,
m~mes
comme
principes,
Maupertuis
évoqueront l'épisode de la Tour de Babel. D'autres
Page 198
évoqueront
climat,
les différences dans le milieu
les
moeurs etc.,
peuples (cf. l'art.
probablement
diversement
"Langage"
De Jaucourt);
"tempérament" et le génie
l'Enc'lclop4ditt,
de
ainsi,
de l'Enc'lclop4ditt)
Marsais
l'abondance
ajoute que les langues
(quand
une
(8ra ••• irtt,
diffèrent
langue n'est pas
sont
des
principalement
par là que les langues diffèrent selon Condillac
Du
des
Beauzée,
ou les choix qu'ils font
et c'est
le
signé D. J.,
les différents peuples
mots (sons) et des "moyens de syntaxe",
435).
ambiant,
influencés dans les "décisions" (comme dit
"Langue"
art.
ou le
naturel
aussi
aussi
développée
p.
par
ou
"parfaite" qu'une autre), et par les idiotismes (Frag.ttnt sur ltts
caustts d. 1. paroI., in
~.ria
linguistica, pp. 226-227).
Les commentateurs contemporains n'ont pas toujours
il
me
semble,
grammairiens
l'origine
pensée
appelle
la
philosophes
des
qui
à
tentation
et
de
leurs
thèses
nature"
traversent l'époque
"conventionnaliste"
voulant
(1.)
que
les
en
D'après
principaux
fondamentales
question.
courants
Ainsi,
la thèse qui présente les
langues
Joly,
représenterait le point de vue
cartésienne",
les
langues par rapport aux deux grands
comme des créations libres de la Raison,
thèse
situer
résisté,
et
soient
la
thèse
A.
sur
de
Joly
langues
"naturaliste",
la
"l'ouvrage
la
de
conventionnaliste
rationaliste de la
"linguistique
et la thèse naturaliste, celui des sensualistes et
de la "linguistique condillacienne".
Page 199
Descartes, les Messieurs de
Port-Royal,
seraient
Locke,
partisans
Président
de
Harris,
Maupertuis,
de la première,
Brosses,
Turgot,
et
tandis
Rousseau et
quelques
que
autres
Condillac,
Court
de
le
Gébelin
seraient les champions de la seconde. C'est ainsi que l'on oppose
couramment
la Raison à la Nature et
à
l'instinct,
l'invention
consciente
et réfléchie à l'imitation instinctive de la
nature,
l'innéisme statique à la genèse de nos idées et facultés.
Je crois avoir montré
thèse
(chap.
premier,
section 5) que
la
naturaliste ne doit pas @tre
entendue
littéralement,
du
et il semble bien que ceux qui tentent
de
moins chez Condillac,
la soutenir jusqu'au bout (de Brosses,
finalement
comme
Court de Gébelin) doivent
faire une place au point de vue
"conventionnaliste",
l'a montré C .
• 'chaniqu, d,s l.n9u,s ,t d,s Princip,s physiqu,s d, l'Ety.o1ogi,
(1765)<19'
la
nature peut bien nous arracher des
pleurs et des grimaces,
convention,
mais pas un mot,
ni aucune règle,
cris,
des
ni une chanson, ni une
car toutes ces choses présupposent
ce que Rousseau appelait la "puissance de choisir", quelque chose
qui
perd
ne s'explique pas par les lois de la
tous ses droits à partir du moment où l'homme
faire selon certaines
r.gl ••
" par
conformation"
431) .
mécanique.
une suite de sa
Le
La
nature
commence
ce qu'il ne faisait jusque là
premier langage d'action,
Page 200
(Condillac,
8r •••• ir',
"la première des
à
que
p.
langues"
comme
disaient
Lamy (1675),
déjà les cartésiens Cordemoy (1666)
n'est
premier
langage
personne
n'ait
communiqué
Ensuite,
qu'une "suite de notre
est inné,
jamais
sans
le
naturel;
eu
à
vouloir
nous
avant
et
conformation";
nous le parlons
l'enseigner.
de
vouloir
qu'ils
involontaires,
ces
pouvaient
signes naturels,
en simulant,
utilisés
L'esprit humain
transformer
en
en quelque sorte,
signes
nouvelle,
faite"
(ibid.) .
il
les
hommes
réactions
signes
naturels.
S'il fait
le fait sur le modèle d'une autre
C'est ainsi que tous les arts
avons
volontairement
"n'a qu'une manière de procéder.
chose
que
communiquer.
ces
les
ce
sans
Nous
en observant mutuellement leurs réactions,
comprirent
Bernard
sont
une
qu'il
nés.
a
Les
premiers signes artificiels
seront faits eux aussi sur le modèle
des
suivant
signes
naturels,
en
l'analogie,
et
ainsi
nouveaux signes inventés pour répondre à d'autres besoins.
seulement
nombre
les
à
partir du moment où ils
disposent
suffisant de signes conventionnelles ou
humains
perçoivent
peuvent
de
mieux
et ce qu'ils pensent,
en
mieux
des
volontaire
sont
signes
et libre.
des
ce
et lier leurs idées
sont
le plus souvent
et
des
tacites.
que
qu'ils
avec
une
Le
grand
d'un
usage
Mais l'invention et l'usage de ces
explicites,
"n'ont pas dit,
et
c'est qu'il
activités régies par des règles
quelquefois
mot,
artifiels,
d'un
artificiels
liberté que seul permet l'usage de signes artificiels.
avantage
C'est
librement
analyser
des
signes
conventions,
Les
hommes
f.isons unfl 1.n9ufl : ils ont senti le besoin d'un
ils ont prononcé le plus propre à représenter la
qu'ils vouloient faire connoître" (Condillac,
Page 201
chose
8r •••• irfl, p. 433;
je souligne);
"le plus propre",
le plus approprié,
c'est celui
que la Raison ou la réflexion présente au "pouvoir de choisir",
Diderot distingue trois
après l'état du 1.n9a9. ani.al
langues
l'état
"états" dans le développement
for.ation,
de
naissance
et
l'état
l'état
L'état
est un mélange de langage d'action et du
sons articulés,
conservent
la même
terminaison,
sans
de
langage
"un composé de mots et de gestes",
partout
n.iss.nc.,
de
p.rf.ction.
de
des
des
où les
mots
déclinaison
ni
conjugaison.
Dans l'état de formation, les cas, les genres, les
conjugaisons,
etc. ,
disposaient
des
exprimer".
Dans
l'''harmonie'',
font leur apparition; dès lors, les humains
"signes
l'état
oratoires
de
nécessaires
perfection,
on
pour
s'est
tout
attaché
"parce qu'on a cru qu'il ne serait pas inutile
à
de
flatter l'oreille en parlant à l'esprit." ("Lettre sur les sourds
et muets", p. 372).
Dans les commencements, des hommes ignorants et grossiers ne
pouvaient
aux
toujours
choisir
les sons qui conviennent
choses et aux idées qu'ils expriment;
réflexion
n'étaient
faisaient n'étaient
présente
à
pas
assez étendues
peut-~tre
ell e-même"
(cf. ,
leur raison
et
les
choix
pas toujours le fait d'une
Turgot,
Page 202
le
op.
ci t. ,
mieux
et
leur
qu'ils
"raison
p. 50).
linguistic.,
de
C'est en suivant l'analogie, par une sorte
"métaphysique d'instinct et de sentiment",
que les
premiers
mots se forment et que leur application à une classe d'objets
détermine.
c'est
Mais
m@me pour un rationaliste avoué comme
notre insu"
"à
que nous sommes
éternelle"
Chomsky,
1767,
1966,
p.63,
de
envisager
pp.
par
Beauzée,
la
xv-xvi;
"raison
cité
par
note 110; cf. également Leibniz, Houv •• ux
chap. l, p. 61,
ess.is ••• ,
principe
guidés
se
à propos de maximes
contradiction
innées comme le
"on emploie ces maximes
expres sément ") .
Suivre
l'analogie
n'est
sans
les
pas
un
comportement qui exclut la Raison, comme semble le penser A. Joly
("Introduction" au T.bl •• u d.s P,.og,.ts d. 1. sci.nc. g,. •••• tic.l.
de Thurot,
p.
46); au contraire, c'est l'analogie qui permet de
justifier et d'expliquer le choix, elle le "fonde en raison", car
s'il
n'était
que
communication,
dans
le
d'un
fait
hasardeux
les commencements,
caprice,
aurait été tout à
Grammaire Générale à la théorie rationnaliste de l'esprit,
qu'on ne doit pas identifier le
communes" avec la Raison (1966,
ouvrage
18),
(p.
de
lorsqu'il
décrit
la
communication
et
qui
"fournit
13) ,
notions
la
manière
"typiquement
distinguer le
Chomsky
langage
mentionne
le
qui caractérise la vie mentale de
la base
souligne
Dominicy
(1984.
p.
Chomsky,
"en
qui concerne
ce
des
admet
et ailleurs dans le m@me
j
animale,
"princ ipe de ' choix ré fléchi' ,
l'homme",
p. 62)
"système
qu'avait A. W. Schlegel de
cartésienne "
humain
fait
Chomsky, qui plus que tout autre a lié le sort de la
inefficace.
lui-même
la
du
que
langage
l'interprétation
l'innéisme ...
Page 203
humain".
soulève
M.
de
plus de
difficultés encore, dans la mesure où aucun auteur
ma connaissance du moins,
ses
positions
laquelle
la
à
des données linguistiques pour appuyer
en la matière , I I
Grammaire
n'utilise,
L' hypothèse
fondamentale
Générale tente d'expliquer
par
l'existence
des universaux linguistiques n'est pas une hypothèse portant
sur
les idées innées (ou notions communes), mais plutôt une hypothèse
que j'appellerais volontiers, avec le linguiste hollandais
S. C.
Dik,
Cette
l'hypoth •• e moyen-fin
("Means-Ends hypothesis")
(20)
hypothèse est "rationaliste" au sens large du terme qui
pas les sensualistes et ceux qui rejettent l'innéité des
c'est la Raison,
communes;
les
au
idées
Les langues sont
ou instruments en vue d'une fin
et
Sans
pensées.
Raison
n'auraient pu atteindre cette fin;
ou
besoins
en matière de communication qui surviennent constamment,
fur et à mesure qu'ils se présentent.
moyens
notions
dans son usage pratique, qui façonne
langues et satisfait du mieux qu'elle peut tous les
nouv.~ux
n'exclut
la
ni
communication
réflexion,
les
des
des
humains
c'est donc par le choix (plus
moins réfléchi selon les auteurs)
des moyens qu'ils
y
sont
parvenus,
et non grâce à un bagage inné de notions communes. Par
ailleurs,
il
me
semble que les idées innées,
ou
ces
vérités
premières imprimées par le Créateur dans nos âmes encore vierges,
furent
le
plus
relativement
mathématique,
certitude
invoquées
par
aux sciences abstraites et
métaphysique),
les
théoriques
rationalistes
(géométrie,
dont les vérités paraissent d'une
irrévisable en plus d'être indépendantes des
de l'expérience;
raison,
souvent
sens
et
pour Leibniz par exemple, toutes les vérités de
c'est-à-dire
toutes
les
Page 204
propositions
analytiques,
sont innées (Nouv •• ux .ss.is ••• , Livre I, chap. II
nécessaires,
et
III).
Quant
aux principes
concernant
pratique,
Locke
reconnaît que l'inclination de l'âme vers le bien, l'envie
d'~tre
heureux et l'aversion pour la misère,
Leibniz,
lui,
ne
se
ont
fait bien sQr pas
la
quelque chose d'inné;
tirer
l'oreille
pour
admettre des principes de pratiques innés.
Il
davantage
est vrai qu'en général,
les sensualistes
sur l'origine des langues,
d'ailleurs surtout discutée
ont
écrit
une problématique qui
dans la deuxième moitié d'un
fut
XVIII-
siècle dominé par l'empirisme en France et en Angleterre. Mais je
ne
crois
pas
pertinente
que
l'opposition
rationalisme/sensualisme
pour l'étude de la Grammaire Générale.
La
soit
Grammaire
Générale est un programme de recherche relativement autonome
par
rapport
des
aux discussions gnoséologiques concernant le statut
notions communes;
pas
le
à tout le moins,
noyau dur du programme.
Les
soucieux de décrire la genèse de
sensation,
alors
impossible
à
sensualistes
que
les
réaliser
seront
ces discussions
sensualistes
aussi
une
partie
plus
croient
cette
d'entre
elles;
attentifs
aux
gnoséologiques liées à l'acquisition des signes et,
plus
nombreux
Mais
la
à écrire sur le sujet de l'origine
Grammaire Générale,
théorie de l'esprit,
grammairiens
sont
plus
toutes nos idées à partir de la
rationalistes
pour
n'affectent
philosophes qui sont des
Page 205
les
questions
en
général,
des
langues.
bien que fondée en partie
jouit d'une certaine immunité;
t~che
sur
il Y a
"rationalistes"
au
la
des
sens
strict (Arnauld.
Beauzée). et d'autres qui sont des sensualistes
convaincus (Condillac.
Destutt de Tracy).
mais il n'y a pas
Grammaire Générale rationaliste ou sensualiste.
de la Grammaire Générale,
l'expression
quelconque.
complète
Les
de
universaux
les catégories qui sont nécessaires
d'un
jugement ou
d'un
acte
de
à
pensée
dépendent de la structure de l'acte en question.
et
non des idées innées. Les sensualistes ne refusent pas l'idée que
l'homme possède.
par nature,
une
"âme rationnelle" pourvue
certaines facultés; ce qu'ils refusent.
encore un coup.
de
ce sont
les idées innées. les principes abstraits des rationalistes; pour
les
ils
facultés.
"histoire
tâcheront
naturelle".
d'être
plus
attentifs
à leur genèse à partir de
la
à
leur
sensation.
Mais même pour un sensualiste radical comme Condillac.
l'acte de
juger (comme la pensée considérée en général) est le même partout
et
pour tous.
mêmes
bien que tous les peuples ne se fassent
n'ayant
idé es.
institutions.
La
pas
tous
décomposition
de
les
la
mêmes
pensée
communication se fait partout de la même façon.
invoquer
des idé es
tous
même chez les sensualistes.
les
pratiques
et
exigée
par
la
sans qu'on ait à
sur ce point des notions communes innées.
(la "marche de l'esprit")
pas
Et
l'ordre
est le même partout et pour
bien que l'ordre des
mots
ne
problématique
de
soit pas partout le même.
Le
XVII-
siècle
s'occupe
peu
de
la
l'origine des langues; ce sera surtout l'affaire des sensualistes
Page 206
du
siècle des Lumières.
tout
moment
Arnauld et Lancelot nous
que les signes ont été
"inventés",
rappellent · à
sans
préciser
davantage comment cette invention a pu se faire. Mais l'oratorien
Bernard
Lamy,
dans
sa
Rh,toriqu. ou l'.rt d.
p.rl.r
(1675),
qui admet explicitement les vérités innées, examine par hypothèse
ce
qu'aurait
l'avait
pu être l'origine du langage articulé si
donné à notre "premier ancêtre".
d'hommes
Il imagine
Dieu
ne
un
groupe
descendus du ciel ou sorti des entrailles de la
Terre,
qui se retrouve d'un coup sur une ile déserte,
sans contact avec
aucune communauté parlante. De quelle façon ces hommes tout faits
mais auxquels manque encore l'usage de la parole arriveront-ils à
se
donner
pensées
par eux-mêmes une langue pour
et
leurs
besoins les plus
commencer avec ce que l'on a,
naturels
(cris inarticulés,
qui
et.c.)
s'imposent
"première langue".
aux
organes
premiers
de
Les
à
se
communiquer
pressants?
Il
faut
bien
et dans ce cas, ce sont les signes
mouvements de la
eux en
premier
tête,
et
et
moyens de communiquer,
devant
des
yeux,
constituent
cris inarticulés donnent de
la parole,
leurs
l'exercice
l'insuffisance
nos humanoïdes
leur
de
imaginaires
ces
se
rendent compte graduellement qu'ils peuvent faire plus facilement
avec leur seule voix ce qu'ils font maladroitement avec tout leur
corps. Ils découvrent ainsi qu'il ne tient qu'à eux de multiplier
à volonté les sons articulés pour y attacher de nouvelles
Le langage des sons art iculé s fut alors "pré fé ré"
choisi de préférence) au langage d'action,
Cc' est-à-dire,
parce qu'il constitue
un instrument de communication plus efficace,
complet
plus commode, plus
et plus approprié aux fins de la communication
Page 207
idées.
humaine.
Les
raisons
articulés
auteurs.
de
cette
sont
nombreuses
et
se
pour
le
langage
retrouvent
des
chez
sons
plusieurs
Le langage des sons articulés peut @tre utilisé de nuit
comme de jour,
et n'exige pas une aussi grande proximité que
langage d'action;
langage
préférence
l'exécution d'une "proposition gesticulée"
d'action
est
souvent
interprétation,
hasardeuse.
contraire,
d'une
est
la
laborieuse,
lente,
du
et
son
Le langage des sons articulés,
rapidité qui égale presque
celle
au
de
la
pensée et l'exécution d'une proposition orale est aisée, efficace
la nuit comme le jour,
une
distance
humaine.
variété,
De
qui
et elle peut être entendue et comprise
n'est limitée que par la portée
plus,
les sons articulés sont d'une
la
très
voix
grande
au point qu'en les assemblant suivant certaines règles,
on parvient à exprimer n'importe quelle pensée,
idée,
de
à
même les plus "abstraites " ,
n'importe quelle
d'une façon univoque et
avec
une précision que le langage d'action 'ne peut toujours approcher.
Locke (Ess.y ••• ,
Livre III,
chap. II)
énumère les avantages du
langage des sons articulés (en particulier l'abondance des
sons,
la rapidité et l'aisance de leur production) avec l'intention
faire
voir que les sons articulés étaient (et de loin) les
aptes à servir les fins de la communication.
raisons,
d'action;
le
il
langage
des sons articulés
constituait
une
méthode
(21
)
le
"principe de dominance" (P.2).
"Le
langage
communication
efficace à tous égards et le choix de cette méthode est
au
langage
plus
Pour toutes ces
supplanta
de
de
plus
conforme
d'articulation
ainsi formé, et préféré avec tant de raison à ceux du geste et de
l'intonation,
les
bannit
presqu'entièrement"
Page 208
(Maupertuis,
Diss.rt.tion
sur
l.s diff'r.ns .oy.ns dont l.s ho ••• s
s.
sont
s.rvis pour .xpri •• r l.urs id'.s. op. cit •• p. 94).
Revenons aux humanoïdes du Père Lamy.
sont les plus
"commodes".
Soit.
choix du matériel linguistique.
dit
Lamy?
Les
sons
articulés
Mais comment s'effectuera
de ces sons "artificiels"
Il donne alors trois règles pour procéder
rationnel des mots.
Premièrement
des mots de peu de syllabes.
comme
au
choisir autant que
le
choix
possible
faciles à prononcer et à mémoriser.
L'apprentissage ne doit pas. en effet. être trop coüteux en temps
et en énergie.
la
parole
règle
surtout dans les commencements où les organes
manquent
est
en
encore de souplesse
accord
rationnel P.1).
avec
notre
Deuxièmement
et
d'exercice
premier
principe
(cette
de
choix
choisir autant que possible des
mots dont le son ressemble ou rappelle le bruit qu'émet la
nommée.
dans
car
(Condillac.
utiliser
a le plus de chances
l' "analogie"
8r •••• ir..
est alors on ne
p. 432).
le moyen qui offre.
disponibles.
les
plus
entendue
plus
sensible
Il est rationnel de chercher à
comparativement aux autres
grandes chances de
succès.
moyens
Toutes
le succès
nos
d'une
surtout dans un environnement qui n'est pas stable et où
l'on doit tenir compte d'autrui.
en
d'être
peut
actions sont susceptibles de succès ou d'échec;
action,
chose
Cette façon de nommer les choses est en effet celle qui.
les commencements.
(P.3).
de
particulier
lorsque
n'est jamais pleinement assuré,
le succès dépend
Page 209
de
la
compréhension
d'autrui,
moyen
l'upt.k. (pour parler comme Austin).
de
(linguistique) doit se faire en fonction d'autrui,
qu'il sait ou de ce que l'on pense qu'il sait;
on
Le choix
succè s .
utiliser
Il fallait sans doute,
certains
traits saillants et
dans
ce
en agissant ainsi
augmente ses chances de voir ses actes de parole
avec
de
du
les
s'accomplir
commencements,
mutuellement
connus
de
l'environnement pour arriver à attirer l'attention sur une
chose
sans
aucun
pouvoir la montrer.
bruit
particulier,
"couleurs"
ou
on
Pour les objets qui n'émettent
pouvait
encore
certains caractères
douceur de certains sons,
utiliser
expressifs,
les divers accents,
la
certaines
dureté,
la
la rapidité ou la
lenteur de la prononciation, etc., pour essayer de les suggérer à
l'auditeur.
Et troisièmement : choisir un ensemble de paradigmes
de flexions,
genre,
mots
un ensemble de marques pour les cas,
les temps,
entre
les modes,
etc.,
le nombre, le
qui permettent de lier les
eux lorsque les choses qu'ils désignent
entre elles.
Sans cela,
sont
notre discours n'aurait aucune
liées
clarté;
seule une syntaxe peut y mettre de l'ordre et lier convenablement
les
mots dans le discours de façon à éviter les
ambiguités,
la
confusion,
l' obscuri té,
précision.
Les langues "n'ont des moyens pour lier les mots, que
parce
et satisfaire le besoin de clarté et de
que nous ne pensons qu'autant que nous lions
(Ibid., p. 433).
que
produisent
ressemblances
tel autre,
idées."
On voit que l'analogie joue un raIe déterminant
dans les deux dernières règles de Lamy,
sons
nos
soit par l'imitation des
les choses nommées,
soit
dans la langue même (tel verbe se
en
créant
conjugue
des
comma
tel substantif se décline sur le modèle de tel autre,
Page 210
etc.).
Les langues ne se sont améliorées que sur une très longue
période de temps, période au cours de laquelle elles ont dü faire
concurrence
au
langage
définitivement.
réalisation
Ces progrès,
d'une
communication.
rhétorique",
Les
d'action,
même
avant
bien sür,
fin
de
le
supplanter
contribuèrent tous à la
maximiser
l'efficacité
de
la
Et les ornements dans le discours, les "fleurs de
y contribueront par la suite à leur façon.
langues diffèrent donc d'abord par
comme signes des idées (elles sont
les
sons
"arbitraires"
choisis
en ce sens que
les raisons qui motivent le choix ne sont pas partout les m@mes),
par
l'abondance de ces sons (les langues "policées" en ont
que les langues "primitives"),
plus
par les idiotismes (chaque langue
a les siens -- latinismes, gallicismes, etc.), et par les "moyens
de
syntaxe",
Si
régime.
commun
en
à
nécessaires
particulier en ce qui concerne la
Grammaire Générale doit expliquer
la
les
toutes
à
tous
langues,
les
et
systèmes
que
de
ses
syntaxe
ce
qui
est
sont
principes
la
signes,
de
thé ori e
de
l'origine des langues doit expliquer d'où provient leur diversité
sans
remettre
en
cause
ces
mêmes
principes.
Les
principes
fondamentaux qui régissent les langues policées doivent déjà être
à
l'oeuvre
dans les commencements,
langues; et ce sont bien,
principes.
l'origine
Les
des
lors de
du moins pour
conjectures mises
formation
l'essentiel,
les
des
m~mes
de l'avant dans la théorie de
langues protègent le noyau dur
Page 211
la
de
la
Grammaire
Générale en montrant comment
(et
ont
doivent
partout
évolué) en
reconstruire
les langues se sont partout formées
respectant
ses
principes;
l'''histoire naturelle" de la
parole
déroger aux enseignements de la Grammaire Générale.
manière
d'une
commencements
variation
de
l'art
eidétique,
de
parler
les
sans
Un peu à la
conjectures
fournissent
elles
une
sur
les
sorte
de
confirmation des principes qui sont vraiment essentiels à
toutes
l es langues (ou systèmes de signes).
Mais
les instruments d'analyse et
de
pensées
que sont les langues naturelles,
genèse,
ne pouvaient remplir adéquatement,
fonctions d'analyse et de communication.
communication
parce qu'ils
dè sIe
ont
une
départ,
ces
Leur évolution consiste
justement à remplir de mieux en mieux ces
fonctions.
Condillac,
dans
hu. •• in.s,
conjecture que dans les commencements,
exemple,
85) ;
"Monstre
les hommes disaient,
par
terrible" pour "Ce monstre est terrible"
(p.
c'était avant que les verbes ne fussent en usage. Lorsqu'il
affirme,
(p.
des
dans sa S,. •••• i,.., que le verbe est
467) ,
jugement,
et
que
c'est
"l'~me
sans lui nous ne pourrions
donc
relativement
à
une
du discours"
prononcer
langue
aucun
achevé e,
"policée", qui remplit adéquatement ses fonctions d'analyse et de
communication des pensées.
On peut ainsi dire du verbe qu'il est
nécessaire (exprimé ou sous-entendu) dans toutes les propositions
et admettre,
sans contradiction,
qu'il pouvait
Page 212
~tre
absent dans
les
langues
encore
contemporains
en
état
de
formation.
linguistes
admettent qu'il y a des langues qui n'ont
(22)
(comme le sémitique ancien),
simple
Les
juxtaposition
et
c'est
d'éléments nominaux que l'on
pas
par
la
obtient
une
Ilphrase nominale" avec, comme seul trait marquant la prédication,
une
pause
entre
les
termes.
philosophes à ce contre-exemple,
dans
toutes
La
réponse
nécessaire
donc
simplement à dire que Il [1] es langues ne
que
les
grammairiens
eux qui tenaient le verbe
pour
qu'autant qu'elles analysent"
des
les
propositions,
(Condillac,
se
.tr~
consisterait
perfectionnent
Sr •••• ir., p. 435), et
hommes n'analysent qu'autant qu'ils
en
ressentent
le
besoin, qu'ils en voient l'utilité. Il n'y a donc rien d'étonnant
à
constater l'absence de certains éléments
proposition dans des langues
lorsqu'on
policée
l'analyse
constate
par
et
"nécessaires"
"primitives" ou fort anciennes.
l'absence de tels éléments dans
ailleurs pourvue de tous les moyens
à l'expression des pensées,
même
***
Page 213
Et
langue
théorie
à
de
contre-exemples
s'il s'agit là d'une solution qui
fort prisée par les linguistes contemporains.
une
nécessaires
c'est la
l'ellipse qui sauve la Grammaire Générale de ces
"apparents",
de la
n'est
pas
NOTES
(1) Cf.
William of Ockham, Ockh •• 's Th.ory of T.r.s
: Part I of
the Su ••• logic •• , trad. M. Loux, Notre Dame (Ind.), Notre Dame
Press,
1974; en particulier, les paragraphes 10 et 33; également
Claude
Panaccio,
"Nominalisme
occamiste
et
nominalisme
contemporain", in Di.logu., XXVI (1987), pp. 281-297.
(2)
Pierre Fontanier,
Flammarion, 1977.
L.s Figur.s du
discours
(1830),
Paris,
(3)
Nous adoptons ici une idée du linguiste Edward Sapir, L.
L.ng.g..
Introduction à l'étude de la parole
(1921)
(Paris,
Payot,
1967, pp. 28 et p.ssi.). La conception exposée par Sapir
à propos des
significations morphologiques rappelle d'ailleurs
étrangement celle des grammairiens philosophes;
je me permets de
citer in .xt.nso un assez long passage qui le montre clairement :
Ce qui distingue ces éléments, c'est que chacun
d'eux est le signe d'une idée particulière, que
ce soit d'un concept unique (ou image)
ou d'un
nombre de ces concepts, ou images, étroitement
liés entre eux pour former un tout. Le mot isolé n'est pas forcément le plus simple élément
d'expression; les mots anglais
sing, sings,
singing, sing.r
(chanter, il chante, chantant,
chanteur)traduisent chacun une idée bien déterminée et intelligible, quoique cette idée soit
isolée et par conséquent sans valeur pratique
au point de la fonction. Nous admettons tout de
suite que ces mots sont de deux sortes
: le
premier sing est une entité phonétique indivisible, traduisant la notion d'une certaine activité spécifique; les autres mots participent
tous de la même notion fondamentale, mais gr~ce
à
l'addition d'autres éléments phonétiques,
cette notion prend une signification particulière qui la modifie ou la précise; ces mots représentent des concepts composés qui se sont
greffés sur un concept fondamental.
Nous pouvons donc analyser sings, sing.r, singing, comme des expressions binaires comprenant un concept fondamental ou concept concret (sing) , et
un autre de caractère plus abstrait : personne,
nombre, temps, conditions,
fonctions ou plu214
sieurs combinés.
Si nous symbolisons sing par la notation algébrique A, nous devrons symboliser sings et s1ng.r par la formule A + b. L'élément A peut être
soit un mot complet et indépendant (s1ng), soit
la substance de base, ce qu'on appelle la racine,
ou la souche,
ou encore le radical d'un
mot. L'élément b
(s, ing, er)
indique un concept secondaire et normalement plus abstrait,
qui impose au concept de base une limitation de
forme, en comprenant ce mot dans son sens le
plus large
nous pouvons l'appeler "élément
grammatical" ou affixe ...
Chacun de ces types d'éléments grammaticaux ou
de modification possède cette particularité qu'
il ne peut pas, dans la plupart des cas, être
employé isolément, mais doit être associé, de
quelque façon que ce soit, ou soudé, au radical
pour que sa signification prenne toute sa force. Il est donc préférable pour nous de modifier notre formule A + b, en A + (b),
les parenthèses symbolisant l'incapacité d'un élément à
être isolé. (pp. 28-29).
Sapir utilise les majuscules pour les concepts fondamentaux,
et
les minuscules pour les "éléments grammaticaux". Les idées
accessoires
que
nous examinons ici ne sont
pas
toutes
représentées par des éléments grammaticaux distincts, comme les
idées accessoires qui distinguent entre eux des termes synonymes.
(4) Pierre Fontanier, L.s Figur.s du discours.
En particulier le
"Supplément à la Théorie des Tropes", p. 213 .t p.ssi •.
(5) Denis Diderot,
"Lettre sur les sourds et muets à l'usage de
ceux qui entendent et qui parlent", dans O.uvr.s co.pltt.s d.
Did.rot, éd. par J. Assézat, Paris, Garnier Frères, 1875 (Kraus
Reprint Ltd, Nendeln, Liechtenstein, 1966), p. 363.
(6) Cf.,
pour la controverse concernant l'ordre naturel, Ulrich
Ricken, 8r•••• ir. .t philosophi. .u sitcl. d.s Lu.itr.s
controverse sur l'ordre naturel et la clarté du français,
Villeneuve-d'Ascq,
Université de Lille III,
1978; et du même
auteur,
"Die Kontroverse Du Marsais und Beauzée gegen Batteux,
Condillac und Diderot -- Ein Kapitel des Auseinandersetzung
zwischen Sensualismus und Rationalismus in der Sprachdiskussion
der
Aufklarung", dans Histor'l of Linguistic
Thought
and
Cont •• por.r'l Linguistics, éd. par H. Parret, Berlin-New York,
Walter de Gruyter, 1976, pp. 460-487.
215
(7)
U. Ricken,
"Die Kontroverse Du Marsais und Beauzée gegen
Batteux, Condillac und Diderot"; l'article commence ainsi:
So wie die Entwicklung der franzosischen Aufklarungsphilosophie wesentlich gepragt war durch die
Auseinandersetzung mit der rationalistischen Ideenlehre Descartes', dem Kernstück seiner Metaphysik, so reflektieren sich auch in der sprachtheoretischen Diskussion des 18. Jh.
die gegensatzlichen Positionen des Sensualismus und des
Rationalismus.
Das ist naheliegend für solche
vieldebattierten Probleme wie das
Verhaltnis
Sprache - Denken, den Sprachursprung, die Methodik des Spracherlernung, die Zweckmassigkeit oder
Unzweckmassigkeit einer bildhaften Sprache. Weniger zwingend erscheint auf den ersten Blick die
Relevanz der philosophischen Grundpositionen für
die Theorie der Wortstellung.
/Tout comme le développement de la philosophie
française des Lumières fut essentiellement portée
par la confrontation sur la doctrine rationaliste
des idées de Descartes, le coeur de sa métaphysique,
de m@me les positions contradictoires du
sensualisme et du rationalisme se reflétèrent
dans la discussion grammaticale du XVIII- siècle.
Cela est manifeste pour des problèmes vivement
débattus comme le rapport Langage-Pensée, l'origine des langues,
la méthode d'enseignement des
langues, et l'utilité ou l'inutilité d'une langue
artificielle.
La pertinence des positions philosophiques fondamentales semble moins contraignante à prem1ere vue en ce qui concerne la théorie de l'ordre des mots./
Ricken parle ensuite de la distinction entre le corps et
les
organes des sens d'une part,
et l'âme,
d'autre part, l'~e dont
les opérations les plus importantes reposent sur des idées innées
(d.r.n
Nichtigst.
D.nkop.r.tion.n .«f
.ing.bor.n.n
Id •• n
b.r«h.n); puis il touche un mot à propos de la pensé e "pure l l et
indépendante du corps, pour finalement conclure:
Die r.ison, ein Ausdruck der allen Menschen gemeinsamen eingeborenen Ideen, wurde zur Basis der
rationalistischen Grammatik. Weil die Sprache aIs
Mitteilungsinstrument des Denkens auch in ihrem
Aufbau den Prinzipien des Denkens entsprechen
muss, galt die in allen Menschen gleiche r.ison
216
aIs die gemeinsame Grundlage der Grammatik
Sprachen.
aller
ILa raison,
une expression des
idées innées et
communes à tous les hommes,
devint la base de la
grammaire rationaliste. Parce que le langage comme moyen de communication de la pensée doit aussi
refléter dans sa structure les principes de la
pensée, la raison, la même dans tous les hommes,
valut comme fondement commun de la grammaire de
de toutes les langues.1
Un peu plus loin (p.
463),
il dit que le problème de l'ordre
naturel des mots est devenu le point central d'une controverse
dans
laquelle
s'opposent des positions
rationaliste
et
sensualiste méconnaissables (unv.rk.nnb.r). Il voit finalement en
Du Marsais un défenseur des principes sensualistes sur les
points les plus importants de sa Grammaire et de sa méthode
d'enseignement, mais,
ajoute-t-il,
en ce qui a trait à la
doctrine de l'ordre des mots, Du Marsais "hat
die Theorie vom
ordr. n.tur.l
verteidigt und ",eiter ausgebaut" la défendu et
renouvelé la théorie de l'ordre naturel/.
Je crois qu'on pouvait
faire cela tout en restant sensualiste, comme j'essaie de le montrer dans cette section.
Il n'y a pas d'inversions relativement
à la pensée, même dans les cas où nous sommes dominés par des
passions, l'ordre le plus naturel consistant toujours à présenter
l'idée principale,
puis les idées qui s'y rapportent.
C'est
ainsi,
aussi bien chez les rationalistes que chez Du Marsais,
Condillac, Diderot ou Destutt de Tracy.
Enfin,
je ne crois pas, comme le présuppose Ricken, que les
discussions grammaticales aient été fortement influencées par les
positions
gnoséologiques opposées des sensualistes et
des
rationalistes (ou celles des co •• on s.ns. philosoph.rs),
ni sur
la question de l'ordre naturel, ni sur la problématique de l'origine des langues, ni sur les rapports entre le langage et la pensée. Condillac est un bon spiritualiste,
et même s'il ne parle
pas d'''intellection pure" à la manière de Descartes et Malebranche, ou de "pensée pure" comme dit Ricken,
les sensations,
pour lui,
ne deviennent des idées qu'en devenant l'objet de la
réflexion
(c'est-à-dire de la Raison),
qui les considère comme
des représentations, comme des images, qui sont simultanément devant l'esprit avant que le discours ne leur impose un ordre successif.
Bien sar,
Condillac, plus qu'aucun autre peut-être, est
sensible aux effets positifs de l'acquisition du langage sur le
développement de la pensée,
de ses facultés et opérations; mais
de leur cSté,
les rationalistes rêvaient d'une "caractéristique
universelle",
une langue qui représenterait si clairement et si
efficacement toutes nos pensées que sur n'importe quel problème
suscitant une querelle entre deux partis,
il suffirait de dire,
217
comme le souhaitait Leibniz,
"Asseyons-nous et calculons!".
science est une langue bien faite" disait aussi Condillac.
"La
(8)
C'est surtout à partir des grammairiens philosophes de la
Renaissance,
en particulier Linacre,
Scaliger et Sanctius, que
les figures de rhétorique sont invoquées pour protéger les règles
de la Grammaire contre des anomalies apparentes. Des figures
comme l'énallage et l'ellipse sont très importantes pour le
traitement des modes (Jacques Julien, R.ch.rch.s sur l'histoir.
d. 1. c.t'gori. du .od. v.rb.1 d'Rristot •
•
Port-Roy.1, thèse
pour l'obtention du doctorat de troisième cycle en linguistique
générale,
Université de Paris VIII, Vincennes, sous la direction
de J.-C. Chevalier, juin 1979). Sur l'ellipse, cf. les travaux de
G. Clérico et de M. Breva-Claramonte sur Sanctius. Aussi, de B.E.
Bartlett,
"Les rapports entre la structure profonde et l'énoncé
au XVIII- siècle",
in L.ng.g.s,
1980.
Voir aussi les articles
"Enallage" et "Ellipse " de Du Marsais dans l' Encyc1op'di..
Du
Marsais rejette l'énallage, que les "grammatistes" invoquent un
peu trop souvent à son goüt pour justifier des usages qui sont
carrément fautifs.
Mais l'ellipse demeure pour lui une figure
très précieuse pour retrouver les règles universelles de la
Grammaire apparemment bafouées par certains usages d'une langue,
et pour retrouver,
sous les déguisements des constructions
usuelles et figurées, la construction analytique.
(9) Peter Swiggers, dans son "Introduction" aux (Jr.is princip.s
d. 1. 1.ngu. fr.nçois. (1747) de l'Abbé Gabriel Girard (GenèveParis, Librairie Droz, 1982), présente la typologie des langues
de l'Abbé Girard
(langues "transpositives",
"analogues" et
"mixtes") et affirme que la première fonction de cette typologie
est de préserver "l'universalité de la forme de concevoir":
"La
première fonction de la typologie des langues est donc -- et ceci
n'est pas paradoxal -- d'assurer la thèse de l'isomorphie entre
les niveaux de la réalité, de la pensée et de la parole, et de
réaffirmer l'universalité de la forme de concevoir"
(p. 45).
Cette typologie des langues est bien sÜr étroitement liée à la
question des inversions et de l'ordre naturel;
c'est pourquoi
nous nous sentons pleinement justifier de faire figurer la
théorie de l'ordre naturel dans la "ceinture de protection" de
notre programme de recherche.
(10) R. Jakobson, Ess.is d. 1inguistiqu. g'n'r.1., Paris, Editions
de Minuit, 1963, p. 82.
(11) Maine de Biran,
"Not es sur 1 es ré fI exions de Maupertuis et
(1815),
in Sur
Turgot au sujet de l'origine des langues"
l'origin. d.s 1.ngu.s, éd. par R. Grimsley, op. cit., p. 88.
(12)
Beauzée & Marmontel, art. "Traduction" de l'Encyc1op'di •.
218
(13)
R. Jakobson,
"Linguistique et poétique",
dans
Ess.is
dtt
1inguistiqutt g'n'r.1tt, op. cit., p. 218.
(14)
Joly,
À.
phi10sophiqutts
"Introduction"
sur 1. gr •••• ir.
à
Httr.ts
ou
univ.rstt11tt,
trad.
rttchttrchtts
F.
Thurot
(1796), Genève et Paris, Librairie Droz, 1972, p. 46.
(15) G. Mounin, L.s prob1t.tts th'oriqutts dtt 1. tr.duction, Paris,
Gallimard, 1963, p. 12.
(16) J.-J.
Rousseau,
Discours sur l'origintt d. l'in'g.lit"
op.
cit., p. 254.
(17) E. Kant, "Conjectures sur les débuts de l' histoire humaine"
(1786), dans Kant, L. phi10sophitt d, l'histoir.,
Paris, Editions
Gonthier, 1947 (pour les Editions Montaigne), p. 110.
(18) À. Joly, "Introduction" au r.b1 •• u d.s progrts d. 1. sci.nc.
de F. Thurot
(Discours préliminaire à IIHermès"),
Bordeaux, Editions Ducros, 1970.
gr •••• tic.1.
(19) Charles Porset, "Note sur le mécanisme et le matérialisme du
Président de Brosses", dans L.ng.g.s, déc.
1980, p. 61 : "il est
significatif qu'à mesure qu'il avance dans ses analyses,
on le
voie réintroduire l'arbitraire et le contingent au coeur de la
langue. Il
(20)
S.
C. Dik,
"Somes Remarks on the Notion ' Universal
Semantics''', dans Logic, ~.thodo10gy, .nd Phi10sophyof Sci.nc.
1~, éd. par Suppes, Henkin, Joja, Moisil, 1973, p. 842.
cit., p. 8 :
The comfort and advantage of society not being
to be had without communication of thoughts, it
was necessary that man should find out some external sensible signs, whereof those invisible
ideas, which his thoughts are made up of, might
be made known to others.
For this purpose nothing was so fit,
either for plenty or quickness, as those articulate sounds, which with so
much ease and variety he found himself able to
219
make. Thus we may conceive how Hords, which were by nature so weIl adapted to that purpose,
came to be made use of by men as the signs of
their ideas; not by any natural connexion that
there is between particular articulate sounds
and certain ideas,
for then there would be but
one language amongst aIl men; but by a voluntary imposition, whereby such a word is made arbitrarily the mark of such idea.
Encore un coup:
le langage est un moyen en vue d'une fin; c'est
pourquoi
le véritable langage humain ne commence qu'à partir du
moment où des gestes ou des sons en viennent à
être utilisés
volontairement et
librement.
Locke ne discute pas du langage
d'action,
comme le feront
ses successeurs;
il relève les
avantages du langage des sons articulés sans dire par rapport à
quoi il est plus avantageux.
L'homme sort des mains du créateur
avec les organes qu'il faut pour produire les sons articulés qui
lui conviennent.
Mais cela ne suffit pas,
car les perroquets en
font autant;
ce qui tranche,
c'est la capacité de les utiliser
pour être signes des conceptions de l'âme. Mais pour Condillac et
les sensualistes français,
ce n'est que peu à peu que le langage
des sons articulés s'est imposé;
plus il fut utilisé, plus ses
avantages
furent remarqués,
comme les enfants qui commencent à
parler et qui nous pressent de leur apprendre le nom de toutes
les choses qui les entourent.
(22) Cf.
E.
Benveni ste, '" Etre' et 'avoir' dans 1 eurs f onct ions
linguistiques",
chap.
XVI des Problt •• s
d.
Iinguistiqu.s
g4n4r.I.s,
op.
cit..
Benveniste commence son article en
remarquant que l'existence de "phrases nominales" caractérisées
par l'absence de verbe est "un phénomène universel", m~e s'il
admet que ces phrases ont "pour équivalent une phrase à verbe
'~tre'" (p.
187). Il admet aussi que cette absence à eu tendance
à se combler avec le temps
"En nombre de langues,
à diverses
époques de l'histoire, la fonction jonctive, assurée généralement
par une pause entre les termes,
comme en russe,
a tendu à
se
réaliser dans un signe positif,
dans un morphème. Mais il n'y a
pas eu de solution unique et nécessaire.
Plusieurs procédés ont
été
employés;
la création ou l'adaptation d'une forme verbale
n'est que l'un de ces procédés." (p.
189). Quelquefois, au lieu
d'une simple pause,
c'est un pronom qui fait office de copule,
comme en araméen ou dans les langues turques.
Ailleurs, dans "La
phrase nominale" (chap. XIII du m~me ouvrage), il remet encore en
cause le "privilège" du "verbe d'existence" étant donné l'ampleur
du phénomène représenté par les phrases nominales, phénomène
présent
dans presque toutes les familles de
langues,
à
l'exception des langues européennes modernes
"A
quelle
nécessité
est donc liée la phrase nominale pour que tant de
langues différentes la produisent pareillement,
et comment se
fait-il -- la question semblera étrange, mais
l'étrangeté
est
dans les faits -- que le verbe d'existence ait,
entre tous les
220
verbes,
ce privilège d'@tre présent dans un énoncé
où il ne
figure pas?11 (p. 152). Mais plus loin Cp. 154) dans le même texte
il
dé fini t
le verbe comme Ill' élément indispensable à
la
constitution d'un énoncé assertif finill;
suit immédiatement sa
célèbre bipartition des fonctions verbales en fonction con'siv.
et fonction .s•• rtiv.;
cette approche est d'ordre syntaxique et
non morphologique;
en ce sens,
les phrases nominales peuvent
servir également à produire des énoncés assertifs finis,
m~me si
la Iifonction verbale l l est
Iimatériellement ii
absente;
cette
approche permet de conclure que Illa phrase nominale ne saurait
@tre considérée comme privée de verbe ll (p.
159),
les fonctions
verbales,
définies syntaxiquement, pouvant se réaliser autrement
que dans une forme verbale caractéristique.
Il n'y a donc pas
ellipse du verbe dans les phrases nominales.
***
221
CONCLUSION
Cette première partie n'est, pour ainsi dire,
qu'un rappel
de l'arrière-plan théorique de la théorie idéationnelle des modes
d'énoncé
des
grammairiens
Lakatos,
j'ai
philosophes.
En
voulu présenter la Grammaire
Générale
comme un programme de recherche scientifique,
un
noyau
dur
de conceptions ou de
comme
des
principes,
principes aussi généraux
longtemps s'imposer sans tôt ou tard
~tre
et
à
"statique"
la
suite du noyau dur.
Il y
utiles
m'apparaissaient
a
notre
nécessaires
ne
peuvent
que j'ai tenté de
quelque
chose
rat i onnell e"
dépit
préconisé e,
est
de
Lakatos;
qui
de
notre
pl us
qu'un
compte tenu des limites
"reconstruct i on
semble
Je pense qu'en
"roman historique".
Mais une telle approche ne va pas de soi.
comme
me
attaqués -- et défendus
des quelques écarts relativement à la méthode
simple
qui
dans l'usage que j'ai fait de la méthode de
je m'en suis expliqué au chapitre premier.
enquête,
classique
(environ 150 ans);
--, une ceinture de protection fut construite,
décrire
de
en isolant d'abord
invariant pour toute la période considérée ici
et
m'inspirant
nous
l'avons fait,
la
Grammaire
Page 222
Peut-on
Générale,
isoler,
oeuvre
de
philosophe( 1
le
)
des grands courants philosophiques qui traversent
,
siècle,
Plusieurs
nommément
le
rationalisme
et
commentateurs pensent que non.
le
sensualisme?
Il est vrai qu'on
ne
peut isoler totalement la Grammaire Générale de la logique, de la
théorie de l'esprit et de la rhétorique,
pas
les
traits d'une discipline
(Dominicy,
1984,
critique"
p.
quelconque
corps
de
autonome et
M. Dominicy
7) .
"s'efforce
qui
et qu'elle ne
de
doctrine qui
un
d'un
la
théorie
p. 14). Nous
(Ibid.,
l'avons
vu
naturel
et de l'origine des langues, où les rationalistes et les
sensualistes
opposées
sont
théorie
de
souvent présentés comme soutenant
l'ordre
des thèses
sur des questions grammaticales précises.
Ce
l'approche
dans
particulier à propos de la
"courant
l'inexistence
caractériserait
linguistique entre Port-Royal et Humboldt ."
en
professionnalisée
mentionne
prouver
présente
la
courant
critique
de Chomsky,
est
une
réaction
et elle est justifiée et
mesure où celui-ci liait tout le
Grammaire Générale à la
vis-à-vis
de
compréhensible
développement
de
"théorie rationaliste de l'esprit"
la
et à
ses thèses sur l'innéité des notions communes. Mais, nous l'avons
vu
également,
Descartes,
toutes
est
sortes
"illimité"
la
un
de
Raison,
pour Condillac pas
"instrument universel,
rencontres",
une
moins
qui peut
faculté
servir
pour
en
caractère
d'un
qui nous rend capables d'adaptar toutes
aux situations nouvelles,
que
nos
actions
et en particulier, d'adapter nos actes
Page 223
de
parole
aux sens exprimés par ceux des
mots, c'est à la Raison que nous devons
pertinent.
d'une façon
"en toutes
autres.
d'~tre
sortes
En
capables de parler
de
rencontres".
Raison est au-dessus des instincts et des habitudes.
fait peu de choses par instinct,
d'autres
La
Parce qu'il
l'homme serait, sans la Raison,
"l'enfant de la nature le plus délaissé"
(2)
selon l'expression
de Herder.
Les rapports entre la Raison et le
langage,
ou
entre
la
pensée et le langage, ne sont pas affectés de manière essentielle
par
les querelles gnoséologiques.
passages
de
Descartes
et Cordemoy que cite Chomsky ne montrent nullement
en
quoi
idées innées interviennent dans l'usage normal
la
les
parole ou dans son apprentissage;
de
conclure,
comme il le fait
l'apprentissage
de
Et les quelques
ces passages ne permettent pas
(1966,
p.
4),
que
la parole ne peuvent être liés
l'usage
à
en termes plus actuels,
peu
Descartes a écrit sur l'apprentissage du
"dressage"
ou de
bref,
"condi t i onnement"
question des idées innées.
Page 224
(3)
qu'il
appel
à une certaine forme
il
n'y
ou
Le
langage
les articles 44 et 50) fait plutôt
l'''industrie" et à l'''habitude'',
ce
"l'intelligence générale".
appelle,
que
de
est
à
de
nullement
A l'inverse, lorsque Turgot écrit que
"les langues ne sont
elle-m~me",
point l'ouvrage d'une raison présente à
forcément le lien qui unit la Raison au langage,
pas
que la Raison puisse avoir conduit
leur
insu;
il ne
rompt
car il n'exclut
"les premiers hommes"
s'il avait voulu dire que la Raison n'a rien à
à
voir
avec les langues, il l'aurait dit, tout simplement. Au lieu d'une
exclusion,
une
nous avons une restriction
ce n'est peut-être
"raison présente à elle-même",
mais rien ne dit
que
n'est pas tout de même la Raison qui forme les langues;
ouvert
qui
le
combien
louange la
premier
138) ,
"vraie métaphysique dont Locke
le chemin",
écrit
qu' "elle
nous
a fait
instrument de l'esprit que l'esprit
sentir
(les
signes ou les langues --A. L.) et dont il fait tant d'usage
dans
opérations,
mécanique
de
sa
offroit
a
a
formé
ses
cet
ce
ailleurs
("Ré fI exi ons sur l es langues",
Turgot,
pas
de considérations importantes
construction
et
de
son
action".
sur
Il
la
parle
également des
"signes de nos idées inventés pour les communiquer
aux
à
autres",
la manière des
Messieurs
de
Port-Royal.
Livre
rationalistes
l
Les
et
II;
admettent que la Raison
nous dirige souvent à notre insu;
art.
"Conjugaison"
de
les sensualistes (Du
l' Encyclop4di.;
Condillac,
Marsais,
L'Rrt
d.
admettent quant à eux une "métaphysique de sentiment"
qui aurait présidé à la formation des langues.
<4)
Il y a là plus
un déplacement d'accent qu'une opposition farouche.
comme
dans
artificiels
l'autre,
est
le
processus
reconstruit
et
d' "invention"
pensé
Page 225
sur
le
Dans un
des
modèle
cas
signes
d'une
d'ci.ion volontaire,
là,
d'un choix r.tionn.l,
et c'est surtout par
il me semble, que la Raison intervient dans la formation des
langues
et
l'usage
de la parole,
que le
langage
des
signes
artificiels est une création de la Raison, et que l'aptitude à le
parler
normalement
"chos e
étendue"
est la
"meilleure
(un corps humain)
preuve"
qu'une
est bel et bien
simple
une
"chose
pensante", et pas seulement un automate. Cette interprétation est
simple,
conforme à un grand nombre de textes, et
claire que
l'interprétation
Chomsky
et de
(comme
Ricken),
l'idée
vague que le langage est le "reflet"
ses
qui
de
recourt à l'innéisme
beaucoup plus
quelques autres
et
contente
de
de la Raison et
de
Nous avons vu
de
idé es inné es ou le "miroir" de l' espri t .
se
quelle façon la notion de choix opérait chez Condillac.
à plusieurs reprises,
art.
Beauzée,
parle des "décisions de l'usage" (par ex.,
"Préposi t i on" de l' [ne yel op4düt)
de quelque bizarrerie qu'on accuse l'usage, ce
prétendu tyran des langues,
j'ai reconnu dans
un si grand nombre de ses décisions,
taxées
trop légèrement d'irrégularité,
l'empreinte
d'une raison si éclairée, fine,
& en quelque
sorte infaillible,
que je ne puis croire le
systême des pr4positions aussi inconséquent
qu'on l'imagine dans notre langue.
Toute invention,
toute résolution de problèmes
nouveaux,
comme
toutes les actions en général (langagières ou non), requièrent le
consentement
choisir".
de
Pour
la volonté,
c'est-à-dire d'une
les rationalistes et les empiristes,
d'union entre la Raison et le Langage,
Je
"puissance
le
trait
c'est la notion de choix.
ne vois là aucune différence ou opposition majeure entre
Page 226
de
les
deux grands courants.
Même chose en ce qui concerne la doctrine de l'ordre naturel
des
mots
des sensualistes
(Du Marsais,
Destutt de Tracy)
la
défendent autant que les rationalistes (Arnauld, Beauzée); il n'y
a pas d'inversion relativement à la pensée;
suivant
le
même ordre,
et la manière la
nous pensons tous en
plus
"naturelle"
parler consiste à exprimer d'abord l'idée principale dont on
le
plus occupé,
et les
autres par la suite selon
qu'elles
de
est
se
rapportent plus ou moins à la première. On peut pécher contre cet
ordre pour des raisons d'élégance ou pour rendre la communication
plus "efficace";
mais sous l'empire de la passion,
il peut être
tout aussi naturel de nommer d'abord cette passion ou l'objet qui
la
cause,
et
de renverser certains membres de
Beauzée
Marsais,
développer,
et
Destutt
de
Tracy
en cette matière, des idées
ne
la
font
phrase.
encore
Du
que
qui respectent le cadre
théorique posé par la 8r •••• ir. g4n4r.l • • t r.isonn4., lorsqu'ils
font de la construction analytique la base de toute compréhension
langagière.
Même remarque encore à propos des rapports entre le langage
et
la
pensée.
Il est évident que les
sensualistes
sont
attentifs aux effets positifs de l'acquisition du langage sur
Page 227
plus
le
développement
réflexion)
de
la pensée
(mémoire,
imagination,
raison
et qu'ils insistent fortement sur le fait
que
les signes d'institution permettent d'analyser et de
librement
semble
tandis qu'un
Descartes,
seuls
communiquer
au
contraire,
regretter que nos idées soient si étroitement
mots,
été
nos pensées,
ou
liées
aux
qu'il soit si difficile de les en détacher, parce qu'ayant
choisis par des hommes grossiers et ignorants,
souvent à une conception "claire et distincte"
ils
nuisent
des idées.
Mais
Beauzée admet lui aussi la nécessité des signes pour analyser les
pensées
et les rendre communicables,
l'Encyclop4di.
(Du Marsais) .
comme son
prédécesseur
Et nous avons vu que,
de part
à
et
d'autre, sensualistes et rationalistes admettent l'antériorité de
la
pensée
sur
l'esprit,
les
son
expression
idées
verbale.
doivent s'ordonner
Simul tané es
pour
rendre
dans
possible
leur analyse et leur communication, car il y a peu de pensées qui
peuvent être rendues parfaitement par un seul geste.
opposer
les rationalistes aux sensualistes
l'autonomie
le
celles-ci étant les fruits de
pour les premiers,
opération purement spirituelle,
l'âme
(Pr4cis d.s l.çons
l'"intellection
pour
Condillac,
est
une
qui se déroule tout entière dans
pr41iain.ir.s,
p.
Descartes, qui inclut sous le terme "pensée"
416),
les
comme
chez
"opérations de
l'imagination et des sens"
("Raisons qui prouvent l'existence
Dieu
qui est entre
et
la
distinction
de
il faut aussi
pour les seconds,
que la sensation,
de
(comme
et des produits de la sensation et
l'usage des signes artificiels,
considérer
question
des idées et pensées relativement aux signes
fait Ricken),
pure"
sur la
Si on veut
Page 228
l'esprit
et
le
de
corps
humain", annexe aux
tant
"Secondes Réponses"),
que significations des mots,
choses
élaborées
par
et que les idées,
sont des représentations
la réflexion (Ess.is
connoiss.nces
sur
47) ;
p.
en
des
l'origin,
des
l'engouement
des
rationalistes pour le projet d'une "caractéristique universelle",
une langue si bien faite qu'elle permettrait un véritable
des
idé es;
pour
eux
aussi,
les langues
sont
précieux pour le développement de la pensée,
un
calcul
instrument
mais peu de langues
sont aussi bien faites que celles parlées par les mathématiciens,
et Condillac sur ce point les rejoint pleinement,
la science comme "une langue bien faite"
moins
arbitraire
et l'algèbre,
et la mieux faite de toutes
les
surplus, si les pensées, pour les rationalistes,
indé.pendantes des signes,
(comme Descartes),
l'affirmation
partout
éloignés
de
et
les
faire
(Condillac,
artificiels
communication
lui qui voyait
comme
la
langues;
au
sont à ce point
pourquoi se plaignent-ils
quelquefois
de leur trop étroite association?
Enfin 3°)
répétée des sensualistes que les idées se
la
même manière et que même les
peuples
forment
les
plus
sans commerce avec nous en viendraient sûrement
mêmes
abstractions
Lettre à Maupertuis,
qui
des
sont
et
raisonnemens"
mêmes
les
25 juin 1752).
nécessaires
pensées ne sont pas
à
Si les
l'analyse
partout
"à
et
les
signes
la
à
mêmes,
la
traduction est néanmoins, en principe, touj6urs possible pour les
la pensée peut toujours
sensualistes et les rationalistes;
rendue
fidèlement
accesso1res
par
rapport
près.
d'une
langue
dans
une
aux
autre,
Les pensées ont donc une relative
aux diverses langues dans lesquelles
Page 229
on
être
idé es
autonomie
peut
les
exprimer.
Ricken
qualifie de "méconnaissables"
les positions rationalistes et sensualistes qu'il rencontre
les discussions grammaticales de l'époque;
part,
qui
je pré fère,
ne voir là que des positions · de grammairiens
finissent
toujours par se rejoindre sur les
plus importants de la science grammaticale;
n'enlève
leur
à
originalité
pour
ma
philosophes,
principes
ce qui,
comme
dans
les
bien
sQ.r,
philosophes
ou
grammairiens.
Certes,
les sensualistes,
du siècle de Louis XIV,
connaître,
vont limiter sévèrement notre pouvoir de
et rarement les voit-on
expliquer
comment
dans l'âme,
tout
contrairement aux rationalistes
les
échafauder des systèmes pour
objets pouvaient faire
des
impressions
ou comment l'âme pouvait mouvoir le corps;
cela se fait-il?
C'est le secret du Créateur",
"Comment
répond
(J.,.i.
dans
Marsais
lingu.istic.,
p.
parallélisme,
d'occasionnalisme ou de choses de ce genre.
220)
Pas
d'"harmonie
Du
préétablie",
de
Cette
confiance aveugle dans les pouvoirs quasi illimités de la Raison,
cet enthousiasme,
et
c'est
se
est cause des "mauvais systèmes "
montrer "raisonnable"
que
de
(Condi llac) ,
reconnaître
notre
ignorance en des matières qui sont "au-dessus de la raison". Mais
pour
le
reste,
sensualistes,
terme
le
rationalisme n'est pas mal
si j'ose dire.
"rationaliste"
ne
servi
par
les
Il est permis de regretter que le
soit
utilisé,
Page 230
en
histoire
de
la
philosophie,
que
pour
désigner les partisans
cartésienne des idées innées.
au
"rationalisme empiriste "
de
la
doctrine
M. Auroux a m@me consacré un texte
(~)
des Lumiè res ,
où il
discute
surtout, comme il se doit, les thèses de Condillac.
Il
y a,
nous l'avons dit,
rationalistes
(Arnauld, Beauzée),
(Du Marsais,
Condillac,
rattacher à la
sympathies
grammairiens
philosophes
d'autres qui sont sensualistes
Destutt de Tracy),
J.
comme le Père Buffier,
des
Beattie et J.
m~me,
et il y en a
Gregory, que l'on doit
Ilphilosophie du sens commun". Quant à Harris, ses
pour le néo-platonisme de
Cambridge
(principalement
représenté par R. Cudworth)
sont bien connues.
Cependant, malgré
les
philosophiques
théorie
divers
partis
pris
tous
les
connaissance,
acceptent
connaissance,
grammairiens
en
philosophes,
que le langage est l'expression
de
la
à
ma
de
la
pensée, que sa principale fonction est la communication des idées
et pensées,
est
la
que la nature humaine est uniforme et que la
même
partout et pour tous,
linguistiques,
qu'il y
a
des
que l'usage normal de la parole est une
pensée
universaux
activité
rationnelle régie par des règles et orientée vers une fin, et que
l'analogie
joue
un
raIe
l'évolution des langues.
fondamental
dans
la
formation
Il y aurait donc un certain
"corps de
doctrine qui caractériserait la théorie linguistique entre
Royal et Humboldt".
mon
avis,
et
Port-
C'est ce que la méthode de Lakatos permet, à
de mettre en évidence.
Page 231
La Grammaire Générale
jouit
donc.
comme discipline philosophique,
d'une relative
par rapport aux théories de la connaissance,
autonomie
comme le
reconnaît
M. Dominicy (1984, p. 14)
Il est bien évident que la philosophie du langage
professée par les Lumières se réclame presque
toujours de Locke, puis de Condillac, et manifeste
dès lors un anticartésianisme constant. Toutefois,
il n'existe pas de grammaire lockienne ou condillacienne,
dans la mesure où l'appareil mis en
place à Port-Royal continue à fonctionner pour
l'essentiel.
La méthode de
Lakatos offre aussi
l'avantage de mettre un
peu d'ordre dans les diverses théories dont se sont
grammairiens
philosophes
et
qui
débordent
le
occupés
cadre
les
de
la
Grammaire proprement dite, c'est-à-dire l'analyse et l'examen des
"éléments de la proposition " .
Ces diverses théories (la ceinture
de protection) protègent, confirment ou complètent les
fondamentaux du noyau dur.
mots
principes
Les idées sont les significations des
et chaque mot ne peut avoir plus qu'une seule signification
(idée) principale;
à l'occasion,
susceptibles
partout
mais ils peuvent se charger, régulièrement ou
d'idées accessoires de toutes sortes,
de
divers usages figurés.
et pour tous
langues,
car
des
nous
m~me
la
la
puisque la traduction, en principe, doit
toujours @tre possible (du moins pour le
l'ordre
La pensée est
il faut alors expliquer à quoi tient
difficulté de traduire,
pourquoi
et ils sont
" sens
mots n'est pas le m@me
parlons
tous
avec
entendre nos pensées et ces pensées sont,
principal"),
dans
l'intention
toutes
de
pour l'essentiel,
et
les
faire
les
m@mes partout et pour tous. L'usage de la parole est une activité
Page 232
rationnelle
qui
simplicité;
d'où
fait
une
toutes langues
l'on
rencontre
l'économie
.
L'analogie est un principe
ne
sont-elles
principes
Ces
ont-ils
la
tropes
d'où viennent toutes ces irrégularités
partout et
diversité?
à
fondamental
que
qu'apparentes?
langues sont partout fondées sur les mêmes principes
leur
et
vient l'abondance des synonymes et des
dans toutes les langues?
en
large place à
Les
d'où vient
prévalu
dès
le
commencement? Et comment expliquer l'absence de catégories jugées
"nécessaires" à l'analyse de la pensée,
langues
en particulier dans
très anciennes ou appartenant à des civilisations
les
m01ns
évolué es?
J'admets volontiers qu'il faudrait mener une
pour
vaste
examiner
les
rapports entre le
noyau
plus
enqu~te
dur
et
ceinture
de protection de la Grammaire Générale et en faire
histoire
plus détaillée.
par
ce
centrales
survol,
pour
un
la
une
Mais je crois avoir déjà mis au jour,
nombre
important
de
notions
l'analyse des modes verbaux et des
déclaratifs.
•••
Page 233
qui
seront
énoncés
non
NOTES
(1)
Du Marsais,
L.s v4ritabl.s princip.s d. 1. gr •••• ir.,
ou
Nouvell. gr •••• ir. raisonn4. pour appr.ndr. la l.ngu. l.tin.
(1729)
"Pourquoi fonder les régIes de grammaire,
dira-t-on,
sur des observations de logique et de métaphysique?
Faut-il
être philosophe avant que d'être grammairien?"
"Je réponds qu'il seroit à souhaiter que ceux qui enseignent
la grammaire fussent philosophes.
Les grammairiens qui ne sont
pas philosophes,
ne sont pas même grammairiens.
La grammaire a
une liaison essentielle avec les sciences qui traitent de nos
idées,
et des opérations de notre esprit, parce que la grammaire
traite des mots,
en tant qu'ils sont les signes de ces idées et
de ces opérations." In (Jaria l inguistica,
p.
285) .
Les
philosophes
français
des
Lumières
appellent
souvent
"mé taphys ique" la thé ori e de l' espri t ou thé ori e des idé es.
(2) J.G.
Herder, Tr.it' sur l'origine d. la l.ngu. (1770), trad.
par P.
Pénisson,
Paris, Aubier-Flammarion,
1977, p. 68. Cette
"illimitation" constitue le point de départ de Herder.
Les
animaux ont un "cercle" ou une "sphère"
d'actions pour la
plupart très limité,
contrairement à l'homme; plus le cercle est
étroit, plus les instincts dominent et gouvernent les créatures.
Sur ce point,
Herder semble très proche de Descartes et
Condillac.
Paris,
Gallimard,
(3) Descartes, L.s Passions d. l'a •• (1649),
"Que chaque volonté est naturellement jointe à
1969. Art.
44
par industrie ou par
quelque mouvement de la glande; mais que,
dans cet article,
habitude,
on la peut joindre à d' autres l l ;
Descartes écrit
Et lorsqu'en parlant nous ne pensons qu'au sens
de ce que nous voulons dire, cela fait que nous
remuons la langue et les
lèvres beaucoup plus
promptement et beaucoup mieux que si nous pensions à les remuer en toutes les façons qui
sont requises pour proférer les mêmes paroles,
Page 234
d'autant que l'habitude que nous avons acquise
en apprenant à parler a
fait que nous avons
joInt l'action de l'âme,
qui,
par l'entremise
de la glande, peut mouvoir la langue et les lèvres,
avec la signification des paroles qui
suivent de ces mouvements plutôt qu'avec les
mouvements mêmes.
Et à l'art. 50, on peut lire
encore que chaque mouvement de la glande semble
avoir été joint par la nature à chacune de nos
pensées dès le commencement de notre vie,
on
les peut toutefois joindre à d'autres par habitude, ainsi que l'expérience fait voir aux paroles qui excitent des mouvements en la glande,
lesquels, selon l'institution de la nature,
ne
représentent à l'âme que leur son lorsqu'elles
sont proférées de la voix,ou la figure de leurs
lettres lorsqu'elles sont écrites, et qui,
néanmoins, par l'habitude qu'on a acquise en pensant à ce qu'elles signifient lorsqu'on a
ouï
leur son ou bien qu'on a vu leurs lettres,
ont
coutume de faire concevoir cette signification
plutôt que la figure de leurs lettres ou bien
le son de leurs syllabes.
(4) Du Marsais, art. "Conjugaison" de l'Enc'lclop'dift
S'il eut été possible que les langues eussent
été le résultat d'une assemblée générale de
la nation, & qu'après bien des discussions &
des raisonnemens,
les philosophes y eussent
été écoutés & eussent eu voix délibérative;
il est vraisemblable qu'il y auroit eu plus
d'uniformité dans les langues.
Il n'y auroit
eu qu'une seule conj~g.ison & un seul paradigme,
pour tous
les verbes d'une langue;
mais comme les langues n'ont été formées que
par une sorte de métaphysique d'instinct &
de sentiment,
s'il est permis de parler ainsi;
il n'est étonnant qu'on n'y trouve pas
une analogie bien exacte,
& qu'il y ait des
irrégulari té s.
D'Alembert dans l'''Eloge de Du Marsais",
déclare que
langues "ont été plus l'ouvrage du besoin que de la raison"
Page 235
les
Un des plus grands efforts de l'esprit humain
est d'avoir assujetti les langues à des règles; mais cet effort n'a été fait que peu à
peu. Les langues, formées d'abord sans principes,
ont été plus l'ouvrage du besoin que
de la raison.
La Raison,
encore une fois,
n'est pas totalement exclue;
nos
besoins en matière de communication,
comme tous nos besoins,
demandent à être satisfaits. Mais la satisfaction de nouveaux
besoins exigent souvent de la réflexion,
une capacité de choisir
librement, comme on la vu chez Condillac.
(5) Cf.
S.
Auroux,
"Un rationalisme empiriste",
XII/3, pp. 475-505.
Page 236
DEUXIEME PARTIE
1
LA SEMANTIQUE IDEATIONNELLE DES MODES D'ENONCE:
LR THEORIE BENERRLE DES HODES
~ERBRUX
(DE PORT-ROYAL A DESTUTT DE TRACY)
237
INTRODUCTION
Le
verbe
fut longtemps
considéré
par
grammairiens
occidentaux
comme
ou comme "l'âme
du
discours".
Tous les grammairiens admettent qu'il y a autant
de
propositions
"le mot par excellence",
les
dans une période qu'il y a de verbes
sous-entendus) .
Sans
verbe,
(utilisés
nous ne pourrions prononcer
ou
aucun
jugement (Condillac), ni aucun autre acte de pensée.
Du point de vue de la morpho-syntaxe,
d'un
système
complexe
de
flexions
le verbe est
variées
pour
porteur
marquer
la
personne, le nombra, le temps et le moda, qui sont les principaux
Accidents du verbe(1) .
importants
ces
Le temps et le mode sont particulièrement
pour les grammairiens (surtout après
deux accidents sont propres au verbe,
parties
du
discours
(comme les
pronoms)
Priscien),
tandis que
peuvent
car
d'autres
porter
les
marques de la personne et du nombre.
Mais le mode semble jouir d'une certaine primauté
temps et les principaux accidents du verbe mentionnés plus
même s'il n'est pas,
sur
le
haut,
de tous ces accidents, "celui qui a le plus
238
d'étendue"
(:2)
du verbe sans
le
fait
En effet,
•
~tre
qu'un
l'impératif,
le mode détermine les autres accidents
m~me
de la
manière déterminé par eux.
verbe soit à l'indicatif,
détermine
le
susceptible (en français
nombre
et deux à l'impératif);
n'admettra
pas le
l'indicatif
(singulier
subjonctif
temps
dont
huit temps à l'indicatif,
subjonctif
m~me
des
au
de la
m~me
Ainsi,
façon,
ou pluriel) ,
et de
m~me
à
il
est
quatre
au
un
nombre de personnes suivant qu'il
ou à l'impératif;
ou
verbe
est
encore pour le
à
nombre
car c'est le mode qui détermine
si
le
verbe doit ou non en porter la marque (c'est le cas dans tous les
modes, sauf l'infini tif) .
comme le remarque Beauzée dans l'article "Mode" de
De plus,
l'Encyclop~die,
En d'autres
moins aux vues de celui qui parle".
modes sont,
majorité
siècle
des grammairiens occidentaux,
avant J.C.) à André Martinet
reconnaissent
que
les
Thrace utilisait .nklisis
ce qu'ils servent à
ani.i);
les
(4)
grande
de Denys de Thrace
(Synt.x.
modes
La très
(3).
g~n~r.l.,
servent
à
conventionnellement certaines "inclinations de l'âme"
que
mots,
de tous les accidents du verbe, ceux qui tiennent le
à l'int.ntionnAlit. du sujet parlant
plus
accidents du
"semblent tenir de plus près aux vues de la Grammaire, ou
verbe,
du
les modes, davantage que les autres
1985),
exprimer
(Denys
pour désigner aussi bien les
exprimer,
et
pour les Modistes du Moyen âge,
239
(11-
de
modes
Priscien,
les modes indiquent les
diverses "qualités" (indication, commandement, souhait, doute) de
co.positio,
la
du
lien
qui
unit
construction intransitive élémentaire;
les
deux
termes
d'une
les grammairiens de Port-
Royal parlaient dans le même sens des "actions. de nostre
esprit"
ou des "mouvemens de l'ame"; Du Marsais, qui reprend sur ce point
le vocabulaire des Messieurs,
"considérations
particulière-s
anglais des Lumières (par
associent
aux
operations
of
parle aussi de certaines "vues" ou
modes
de
l' espri t";
exemple,
Harris,
grammairiens
Monboddo,
certaines .n.rgi.s of
th • • ind,
les
th.
et Monboddo soutient
Gregory)
.ind,
m~me
ou
des
qu'il
est
essentiel au verbe d'exprimer l'une ou l'autre de ces "énergies",
ce qui fait du mode plus qu'un simple Ilaccident" du verbe;
Beauzé e,
Condillac et Destutt de Tracy,
Acc •• soir ••
qui
accessoires
indiquent
jours
encore,
distinguent
Martinet
(Syntax.
modes qu'un très court passage,
qu'ils
servent
locuteur
leur
à
ce sont certaines id •••
les modes entr'eux
les états de
l'~me
g~n~r.l.)
du
fut,
ces
locuteur.
qui ne
De
nos
consacre
aux
rendre explicite Ilune prise
par rapport à l'actionll(S).
de
à
C'est donc
surtout
dans
philosophes
langues
modes
verbaux
l'un des lieux privilégiés pour
discussion des rapports entre le langage et la pensée.
240
du
propositionnelles.
donc penser que la théorie générale des
l'époque classique,
sujet
position
l'étude des procédés que nous utilisons dans les
peut
idées
écrit tout de même à leur
humaines pour exprimer nos diverses Attitud..
On
et
théorie des modes verbaux que les grammairiens
feront
chez
la
Je
distingue deux
approches dans la théorie
générale
modes des grammairiens philosophes.
La première est
principalement
Marsais,
Gregory
par Port-Royal,
et de Sacy.
Du
Pour ces
représentée
Harris,
grammairiens,
des
Monboddo,
certains
énoncés
servent conventionnellement à exprimer des jugements catégoriques
(comme ceux dont le verbe est à l'indicatif), et d'autres servent
à
exprimer
soit des jugements non
subjonctif) ,
(impératif,
soit
catégoriques
des actes de pensée
interrogatif,
(conditionnel,
autres que
optatif, etc.).
le
jugement
Les modes sont alors
considérés comme des m.rqu.ur. dP.ct •• d. p.n •••. Par exemple, Du
Marsais
(art.
énoncés
en
catégoriques)
"Construction")
propositions
et
(qui
non
la classe
expriment
La
telle qu'on la trouve déjà dans
seconde approche,
tous
que
j'appelle
les
jugements
des
actes
: ce qui correspond grosso .odo
distinction traditionnelle entre les énoncés
déclaratifs,
de
des
en .nonciations (qui expriment
pensée autres que le jugement)
la
divise
déclaratifs
de
à
et
Aristote
(DfI
r.ductionnist.,
est
représentée principalement par Buffier, Beauzée, Condillac, Court
de Gébelin, Beattie et Destutt de Tracy. Pour ces auteurs, toutes
nos énonciations expriment,
importe le mode.
après analyse,
des
jugements,
peu
Ainsi, un énoncé bien formé dont le verbe est à
l'impératif ou à l'optatif,
signifie rien de plus,
ou encore un énoncé interrogatif, ne
quant au "fond de pensée" (ou
241
"structure
profonde") ,
première
qu'un
personne
"J'ordonne
souhai te
que ... I l
le
le verbe
"Je demande +
et
Les
phrases
principal
l'indicatif
(ou "Je t'ordonne de.
etc. )
interrogatives
dont
du singulier de
que ... "
"comment",
dont
énoncé
si.
Il
+
"
principal signifia
locuteur qui ordonne,
comme
infinitif)
(ou
impératives,
l'action
la
à
présent,
+
"Je
"pourquoi",
optatives
ne sont que des ellipses de phrases
verbe
est
et
déc larat ives
accomplie
par
le
exprime un souhait ou interroge. Les modes
autres que l'indicatif, et l'ordre des mots dans l'interrogation,
sont
le
signe
restitution
d'une
d'une
ellipse qui
hyperphrase
n'est
signifiant
comblée
que
par
directement
la
l'état
psychologique du locuteur.
Avant d'examiner plus en profondeur ces deux
crois
utile
conceptions
de
faire
logiques
un
et
bref
retour
approches,
historique
grammaticales du verbe
et
sur
des
je
les
modes
verbaux qui ont marqué la tradition grammaticale en Occident.
Les
premiers
grammairiens
grecs,
Denys
de
Thrace
et
Apollonius Dyscole, utilisent surtout des critères morphologiques
pour définir le verbe, qu'ils nous présentent comme une partie du
discours sans inflexion casuelle,
le temps,
la passion
admettant des inflexions
les personnes et le nombre,
c. , .
L'absence
et signifiant l'action ou
de flexion casuelle apparaît comme
242
pour
un
critère
aussi
important que la présence
sémantiquement,
la passion.
du
des
autres
flexions;
le rôle du verbe consiste à désigner l'action ou
Enfin,
notons l'absence du mode dans la définition
verbe des grammairiens grecs,
les autres accidents du
étant mentionnés comme il se doit;
mais lorsque Denys de
verbe
Thrace
donne la liste des accidents du verbe, c'est le mode qui vient en
note
premier (cf.
Chez Priscien,
(1»).
est sensiblement différente
de
la définition du verbe
elle mentionne toujours
flexion casuelle et que la signification principale du
est
l'action ou la passion qu'il désigne,
accidents
propres,
t~.poribus
du
verbe
soit
le
~t
d'existence"
.odis
qu'elle signale
temps
(7')
et le mode
mais les
sont
ceux
le
"~tre",
fut
perdue dans la traduction de Priscien qui
rh'..
par v.rbu. subst.ntivu.,
les
Apollonius
et
impératif,
optatif,
et
Priscien reconnaissent cinq
l'infinitif apparait comme le cas non marqué,
mode
cu.
"verbe
parce
qu'il
cette idée,
rend
qui
hyp.rktikon
français.
modes
subjonctif et infinitif.
sont
signifie
fut retrouvée au XVIII-
grammairiens philosophes anglais
seuls
lui
Cependant, les grecs appelaient
(hyp.rktikon rh' •• ) le verbe
verbe
deux
qui
verbe
marque l ' existence d'un attribut dans ' un sujet;
par
l'absence
siècle
Denys,
indicatif,
Chez Apollonius,
le plus simple, le
dans lequel tous les autres peuvent se résoudre,
comme
un
radical commun exprimant simplement l'action (pr.g •• ) sans marque
de nombre ni de personne.
de temps,
Quant aux modes personnels,
explicite
l'acte
illocutoire qu'ils servent à exprimer conventionnellement
aux
Apollonius
phrases
les
dont
analyse de manière à
rendre
le verbe est à l'indicatif,
243
à
l'impératif
et
à
l'optatif,
il fait correspondre,
respectivement,
des phrases à
l'indicatif présent se terminant par un infinitif ("marcher")
et
commençant par "Il affirme (ou "définit") + marcher", "Il ordonne
+
et "Il souhaite + marcher"
marcher",
loin
que
cette conception des rapports
l'infinitif)
et
grammairiens
les
autres
philosophes,
modes
Nous verrons plus
ce)
entre
revient
tels Harris,
l'indicatif
chez
(ou
plusieurs
Beattie et
Destutt
de
Tracy.
Mais
bien
philosophes
d'Athènes
sujet du verbe.
lui) ,
" [l]
e
quelque
grammairiens
avaient déjà exposé
d'Alexandrie,
plusieurs
verbe est ce qui aj out e à sa propre
CCP)
•
Ici
les
critères
le verbe a une signification propre,
idées
au
s igni fica t ion
sont
surtout
un
certain
il affirme l'existence d'un attribut dans un sujet; et
"ajoute à sa propre signification celle du temps".
Par ailleurs,
les philosophes (péripatéticiens et stoiciens) développeront
classifications
d'énoncé) .
les
et "il indique toujours quelque chose d'affirmé
autre chose"
sémantiques
attribut;
les
Pour Aristote (et bon nombre de logiciens après
celle du temps",
de
avant
pour
Ainsi,
l es
"genres
de
di sc ours"
(ou
des
modes
Aristote distingue (D. l'int.rprlt.tion, 17a)
"le discours dans lequel réside le vrai et le faux"
des
genres de discours"
tout discours n'est pas une
seulement le discours dans
244
proposition, mais
lequel réside le
"autres
vrai et le faux, ce qui n'arrive pas dans tous
les cas; ainsi la prière est un discours, mais
elle n'est ni vraie, ni fausse.
Laissons
de côté les autres genres de discours
leur
examen est plutôt l'oeuvre de la Rhétorique ou
de la Poétique.
C'est la proposition que nous
avons à considérer pour le moment.
également L. Po,tiqu"
(Cf.
exemple,
distinguaient
interrogatif,
1456b) .
Les
cinq genres de
impératif,
péripatéticiens,
discours
déprécatif
déclaratif,
vocatif<10) .
et
stoïciens en distinguaient deux fois plus.
Ces
permis
de
influence
sur
penser
leur
1973,
Nuchelmans,
qu'elles ont
classification
p.
et
V-
siècles,
à
pu
exercer
des
modes
une
fut utilisé
une prolifération
exhortatif,
moins
on
certaine
verbaux
(cf.
pour la première
des
modes,
avec
minatif,
s'attache
Marius
qui ajoutent à la liste désormais
classique des grammairiens grecs des modes promissif,
général,
il
D'après Julien (1979), on assiste, aux IV-
Victorinus et Pompeius Festus,
impersonnel,
et
102) .
Il semble que le terme .odus
fois par Quintillien.
Les
classifications
étaient sans doute connues des grammairiens d'Alexandrie,
est
par
à
etc.
la
concessif,
(c f. Jul i en, 1979).
forme
et
aux
En
critères
morphologiques, plus on a tendance à multiplier les modes.
La
tradition
des
grammairiens,
245
avec
leurs
cri tè res
morphologiques,
sémantiques,
chez
les
et
se
celle
ou
A.vec eux,
la passion,
succession
et
avec
leurs
critères
rencontrent pour la première fois au Moyen
Modistes(11).
l'action
des logiciens,
le
le verbe
mais plutôt
flux;
et
ne
l'être,
s'ils
age
désigne
le
plus
devenir,
retiennent
les
traits
morphologiques soulignés par les grammairiens (les flexions
le temps,
flexion
les modes,
casuelle),
le nombre,
pour
les personnes et l'absence
c'est surtout les
aspects
la
sémant iques ,
de
la
"manière de signifier" du verbe qui les intéressent.
Cependant,
ils
logiciens;
ne
retiendront pas tels quels les critères
des
l'affirmation n'est retenue que par Michel de Marbais (12) ,
et le
temps
comme
est ramené au rang de simple accident du verbe
chez les grammairiens ---, et on dit maintenant, comme le faisait
déjà Boèce(13), qu'il est consiQnifi' par le verbe. L'affirmation
est
remplacée
par
le
critère de
.'pArAtion
la
le
verbe
séparément du sujet, une modification ou un changement
signifie,
quelconque dans le sujet, ce qui distingue le verbe du participe,
qui
signifie lui aussi le changement et la succession,
liaison
avec
le sujet dont il prend,
adjectivale,
mode
du
le genre et le nombre.
verbe
La
mentionné e
crée
le
exprime
co.positio
une
en raison
Chez Thomas
"qualité"
est
ce
de
qui
entre
les
intransitive élémentaire.
sont l'indication,
correspondent,
deux
parties
sa
annule
la
de
le
la
séparation
c'est
d'une
en
nature
d'Erfurt,
particulière
plus haut entre le sujet et le verbe;
lien
mais
ce
qui
construction
Les diverses qualités de la co.positio
le commandement,
respectivement,
le souhait et le doute (qui
à l'indicatif,
246
à l'impératif, à
l'optatif
et
au
Modistes,
servent
lesquels
se
de
verbaux,
verbaux,
pour
les
donc à exprimer certains états de
l ' âme
sur
fondent
etc.
commandement,
nombre
subjonctif).
(14)
les
Les
modes
"qualités"
d'indication,
de
Les médiévaux ont introduit un certain
•
distinctions
importantes pour
comme
distinctions
les
l'analyse
.ctus
des
modes
exercitus/actus
conceptusj nous reviendrons à l'occasion sur ces distinctions.
L'un
des plus
grands
s.u d. c.usis 1ingu ••
Sanctius
l'existence des modes,
fondée,
grammairiens
parce
que
de
la
1.tin.~,
Renaissance,
1587),
niera
catégorie grammaticale qui lui parait mal
les grammairiens ne s'entendent pas
sur
la
nature, le nombre et la dénomination des modes. Ramus avait déjà,
exprimé les m@mes doutes à leur sujet.
avant lui ,
Sanctius sera
suivi sur ce point par quelques grammairiens, et m@me, plus tard,
par Claude Lancelot, dans sa
~'thod.
pour .ppr.ndr. faci1e.ent et
.n p.u d. t •• ps 1. 1.ngu. 1.tin. (1644).
qu'il écrira avec Arnauld,
les modes ont
la place qui leur revient dans la théorie du verbe.
un
commentateur
espagnol
de Sanctius ,
Sr •••• ire
Mais dans la
Périzonius,
critiquera l'attitude
du
Maitre
sur la question des modes et introduira l'idée que
modes sont aux verbes ce que les cas sont aux nomSj
ce qui
les
fait
du mode un moyen de syntAxe, et pas seulement un moyen d'exprimer
les
attitudes
grammairiens
du locuteur.
philosophes
(en
Cette idée sera critiquée
particulier
247
Beauzée),
par
les
car
la
comparaison entre les flexions casuelles et les modes verbaux
ne
mène
la
pas loin
mesure
l'indicatif
ressemble
au nominatif
les deux apparaissent comme des cas
où
linon
"directs", qui se tiennent seuls "debout et droits"
Heidegger <1~)
avec
le
vocatif,
comme dirait
et le subjonctif retient quelque
parce
subordonné es
déviants " ,
l ' impératif a également une certaine ressemblance
,
l'accusatif,
dans
qu'il
sert
à
former
des
chose
de
propositions
qui font office de complément d'objet
de
certains
verbes.
Mais on voit mal comment poursuivre la comparaison. Nous
verrons
tout
de
certains
m~me
grammairiens
Marsais, Beauzée, Destutt de Tracy)
subjonctif,
car
ce
philosophes
qualifier d'oblique
mode ne sert qu'à former
des
le mode
propositions
incidentes ou accessoires qui sont des parties d'une
proposition
complète,
tout
choucrout e"
n'est qu'une part i e de l' ëI. t tribut. L' idé e que le mode
est
un
moyen
subjonctif,
la
comme
(Du
de
"de la choucroute" dans "Je mange de
syntaxe
vaut
est
l'ajout
d'un
grammairien anglais Thomas Linacre,
par
"should" <1 . )
par
surtout
pour
le
qui marque la subordinAtion. Une autre innovation de
Renaissance
anglais,
d'ailleurs
la
les
verbes
mode
"potentiel"
par
le
et ce mode serait marqué, en
auxiliaires
"may" ,
"might",
ou
Nous verrons que cette idée sera plus tard reprise
•
l'écossais
J.
Beattie.
Notons
enfin
cette
théorie
psychologique très remarquable que Scaliger a soutenue (De causis
1540) ,
dl11ibl1ratio
< 17)
chez l' homme" ,
de
qui subordonne les modes verbaux à
une "capacité de choix qui ne se
que Scaliger reprend d'Aristote<1&),
laquelle il explique l'oriQin. du mode.
248
Le mode
trouve
la
que
et à l'aide
aurait
été
inventé
pour répondre à un besoin :
"il a été indispensable
de
rendre manifeste par une physionomie déterminée des verbes ce qui
se
faisait
pendant
après"(19).
la
délibération
et
ce
qui
se
faisait
D'après Julien (1979), cette théorie n'est pas sans
rapport avec celle de Port-Royal.
les Messieurs écrivent en effet, à propos des modes
Il
les
hommes ont trouvé qu'il estoit bon d'inventer
encore
d'autres
inflexions pour expliquer plus distinctement ce qui
passoit
dans
esprit"
leur
(p.
Cependant,
112) .
l'interprétation que nous avons proposée dans la première
est
juste,
l'invention
seulement
Port-Royal
la
et
délibération
a
l'utilisation
avec les modes,
quelque
du langage
chose
en
à
si
partie
voir
général,
avec
et
pas
et ce que disent les grammairiens
à propos des modes,
ils le disent aussi
des
se
de
autres
flexions et parties du discours.
Dans
(première
de
pensé e,
les
j'examinerai
d'abord
section) la théorie des modes comme marqueurs
d'actes
et
réductionnistes.
sont
exposées
chapitres
par
la
qui
suite
suivent,
(seconde section),
l es thé ori es
Ces deux sections sont divisées en chapitres où
les théories des grammairiens
estime en général @tre les plus importants.
* * *
249
philosophes
qu'on
NOTES
(1) Dans l'art.
"Accident" de l'Encyclopldi.,
Du Marsais donne
une liste de neuf accidents dans les verbes: l'Acception (propre
ou figurée),
l'espèce (s'ils sont primitifs, comme "parler",
"boire",
ou dérivés,
comme "parlementer", "buvoter"), la figure
(s'ils sont simples,
comme "venir",
ou
composés,
comme
"convenir"),
la voiK (active, passive,
neutre),
le mode,
le
temps,
la personne,
la conjug_i.on (distribution de toutes les
inflexions des verbes),
et enfin l'AnAlogie ou l'anomAlie (s'ils
sont réguliers ou irréguliers). Ces accidents du verbe sont déjà
présents chez Denys de Thrace,
sauf l'acception.
Il donne, dans
l'ordre: les inflexions (modes), les voix, les espèces,
les figures,
les nombres,
les personnes,
les temps,
et
les
conjugaisons;
voir
aussi Jacques Julien,
R.ch.rch.s
sur
l'histoir. de la cat'gori. du .od. v.rbal d'Rristot. •
PortRoyal, thèse de doctorat en linguistique générale, sous la
direction de J.-C. Chevalier (Paris VIII), juin 1979.
(2) Du Marsais,
art. "Conjugaison" de l' Encyclop'di.
"le mot
voix est celui qui a le plus d'étendue; car il se dit de chaque
mot,
en quelque mode,
temps,
nombre ou personne que ce puisse
être" .
(3) S.
Auroux,
"Act es de pensé e et act es 1 ingui st iques dans la
Grammaire Générale", dans Histoir., Epistl.ologi., Langag., VIII:
2, 1986.
(4) G. Nuchelmans, Th.ori.s of propositions. Ancient and Medieval
Conceptions of the Bearers of Truth and Falsety, Amsterdam,
North-Holland, 1973, p. 101. Voir aussi Jacques Julien
(1979),
passi •.
(5) A. Martinet, Synt.x. glnlr.l., Paris, Coll. V, Armand Colin,
1985, pp. 134-135.
(6)
On trouve ces définitions mentionnées un peu partout; par
exemple, G.L.
Bursill-Hall, Sp.culativ. 8r •••• r of th. Hiddl.
Rg.s. The Doctrine of part.s orationis in the Modistae. La HayeParis, éd. Mouton,
1971, p.
197; Nuchelmans (1973), Julien
(1979), etc.
250
(7) Busill-Hall, op. cit., p. 198.
(8) Nuchelmans,
1973, p.
102; voir auss i Jacques Jul i en, "Mode
verbal et Di.th.sis chez Apollonius Dyscole", dans Histoir ••
Epist~.ologi •• Langage, VII-l, 1985.
(9)
Aristote, De l'int.rprftation, trad.
J.
Librairie Philosophique J. Vrin, 1966, p. 81.
Tricot,
Paris,
(10) Nuchelmans, 1973, pp. 97 et suiv ..
(11) Bursill-Hall, op. cit., p.
196; voir aussi I. Rosier,
"Grammaire, logique, sémantique, deux positions opposées au XIIIsiècle
Roger Bacon et les Modistes",
dans
Histoire.
Epist~.ologi •• L.ng.g., Tome 6, fasc. 1, 1984, pp. 21-34.
(12) Ibid., p. 196.
(13) Sa définition est citée par Bursill-Hall, op. cit., p. 197
"Verbum est, quod consignificat tempus ... ".
(14) Bursill-Hall, op. cit., pp. 215 et suiv., et Irène Rosier,
L. gr •••• ir. splcul.tiv. d.s Nodist.s,
Presses Universitaires de
Lille, 1983, pp.
118 et 121;
le mode verbal,
en tant qu'il
Ilindique" une "qualité" de la co.positio,
est un "mode de
signifier accidentel du verbe"; voir aussi I. Rosier et A. de
Libéra, "Intention de signifier et engendrement du discours chez
Roger Bacon", Histoir •• Epistl.ologi •• L.ng.g., VIII-2, 1986, pp.
64-65 pour la distinction entre l'.ctus signific.tus et l'actus
.x.rcitus relativement à la typologie médiévale des énoncés.
Aussi G.
Nuchelmans,
"The Distinction !Ictus .x.rcitus/!lctus
signific.tus in Medieval Semantics", dans N•• ning .nd Inf.r.nc.
in N.di.v.l Philosophy, éd. par N. Kretzmann, Kluwer Academic
Publishers, 1988.
(15)
M.
Heidegger, Introduction i
1 • • It.physiqu.,
Paris,
Gall imard,
1967, p.
69. C'est l'infini tif du verbe "@tre" qui
sert à désigner, dans la plupart des langues européennes, l'objet
de l'ontologie. C'est pourquoi Heidegger examine les modes dans
la grammaire grecque. Il glose .nklisis (.odus) par "inclination
vers un c8té", et rapproche l'.nklisis de la pt6sis (c.sus), qui
désignait à
l'origine toute espèce de modification des mots,
aussi bien les noms que les verbes.
(16)
Ian
Michael,
th"
251
Tradition to 1800, Cambridge, C.U.P., 1970, pp. 115 et 425.
(17) Cf. le chapitre consacré à
1979.
Linacre dans la thèse de Julien,
(18)
Julien (1979) cite (p.
276) le passage du Tr.it4 d. 1'*_.
(III,
II,
434a),
où
Aristote
n'attribue
l'imagination
délibérative qu'aux êtres doués de Raison.
(19) Julien, 1979, p. 277.
* * *
252
SECTION l
LES MODES VERBAUX EN TANT QUE NRRQUEURS D1RCTES DE PENSEE
Dans
la première section de
présentons
d'actes
la
Du Marsais,
philosophes,
l'expression
de
Les
Harris,
le
jugements,
littérales
verbaux
de
que
sont
discours
n'est
aussi
de
et d'autres
pas
philosophes,
sont
(ou auraient pu
jamais
par
commandements,
traités,
de
"mouvements de l'âme".
les
~tre)
ces divers actes de pensée,
ne
marqueurs
seulement
et les
par
ces
"marques Il
énoncés
déclaratifs exprimant des actes de pensée autres que le
catégorique
nous
Monboddo, et Gregory. Pour ces
mais
d'interrogations,
modes
partie,
théorie qui fut principalement défendue
grammairiens
souhaits,
seconde
théorie des modes verbaux en tant
de pensée,
Port-Royal,
cette
non
jugement
grammairiens
comme des phrases elliptiques qui expriment,
après
analyse, des jugements.
Dans
la
section
"réductionnistes"
comme Buffier,
que
"[tJout
nous
traiterons
des
des grammairiens philosophes qui
Beauzée,
discours est
propositions l l
II,
(Condillac,
thé ories
considèrent,
Condillac, Beattie et Destutt de Tracy,
une proposition ou une
Sr •••• ir.,
p. 450),
suite
de
une proposition
étant l'expression d'un jugement, seul acte de pensée retenu dans
cette approche.
253
CHAPITRE PREMIER : PORT-ROYAL
Les
logiciens
divisaient
les
parties
du
les grammairiens,
d'clin~bl.5
et
ind'clin~bl ••.
divise
en
deux groupes
objets
des pensées,
eux,
en
en
mots
Le grand Àrnauld, pous sa part, les
il Y a les mots
"qui signifient
les
& les autres la forme ou la maniere de
nos
pensées" (t!Jra ••• irfl gfnfral • • t raisonn'.,
30) .
discours
ci-après
t!J.t!J.R.,
p.
Cette division correspond à
la plus grande distinction de ce qui se passe
dans notre esprit,
(qui) est de dire qu'on y
peut considérer l'objet de nostre pensée;
&
la forme ou maniere de nostre pensée, dont la
principale est le jugement.
Mais on y doit
encore rapporter les conjonctions,
& autres
semblables operations de nostre esprit;
&
tous les autres mouvemens de nostre ame; comme les désirs, le commandement,
l'interrogation, &c.
Il s'ensuit de là que les hommes ayant eu besoin de signes pour marquer tout ce qui se
passe dans leur esprit,
il faut aussi que la
plus générale distinction des mots,
soit que
les uns signifient les objets des pensées,
&
les autres la forme & la maniere de nos pensées,
quoy que souvent ils ne la signifient
pas seule, mais avec l'objet,
comme nous le
ferons voir. (t!J.t!J.R., pp. 20-30).
Les
noms,
adverbes,
articles, '
appartiennent
pronoms,
au
participes,
premier
254
prépositions,
groupe;
les
et
verbes,
conjonctions
discours
et
interjections,
appartenant
signifier
"rien
hors
au
monde.
ne
sert
second
second.
groupe ont
de nous";
conception de l'esprit,
aucune
au
Les
en
aucune n'est
parties
commun
le
de
signe
d'une représentation de quelque
à décrire quelque chose qui se
passe
du
ne
d'une
chose;
dans
le
C1 )
Ainsi, les interjections, qui sont "des
qu'artificielles",
exprimer
"Hal",
comme
"Hé las l " ,
"mouvemens de nostre ame",
les
servent
quelque chose
vives
stupéfaction,
une
forme
ou
exprimées
par
les
n'est
se
Les
mais
qui
qui
à
représentation de quelque chose qui se passe hors de lui ( 2 ) .
émotions
locuteur,
etc. ,
une
dans
du
plus naturelles
pas
passe
l'esprit
V01X
interjections
(surprise,
horreur, etc.) peuvent donc être considérées comme
manière de nos pensées,
au
même
titre
que
le
jugement, le désir, l'interrogation, le commandement, etc.
Il
en
va
de
même
l'interrogation, comme n.,
latin,
pour
les
marques
"la particule de l'interrogation"
de
en
qui "n'a point d'objet hors de nostre esprit, mais marque
seulement le mouvement de nostre ame,
de
diverses
sçavoir
une
chose."
(Ibid. ,
par lequel nous souhaitons
p.
151) .
Les
pronoms
interrogatifs sont des pronoms (ils tiennent "la place d'un nom")
255
auxquels
"est
jointe
la
s igni fica t i on
de
m," .
Mais
cette
"signification ajoutée" est quelquefois exprimée par "l'inflexion
de la voix,
appelle
(?)
(ce
Il
dont l'écriture avertit par une petite marque, qu'on
la marque de l'interrogation,
(Ibid., p. 152).
mouvement
tantôt
par
de l'âme qui
les
interjections.
pronoms
souhaite
dans
savoir) ,
ainsi
comme
disent
s'exprime
tantôt
inflexions de la voix étant
qu'artificielles",
figure
Cette signification ajoutée ou accessoire
des signes conventionnels,
"naturels",
Oc que l'on
par
des
"plus
les Messieurs
à
donc
signes
naturelles
propos
des
Toutefois, Àrnauld et Lancelot ne rangent pas les
le groupe des mots qui signifient la forme
manière des pensées,
ou
la
car leur principale fonction est de marquer
confusément les objets de nos pensées.
Les
conjonctions
ne
marquent
pas
non
plus
des
représentations de quelque chose, mais seulement la forma logiqu.
de
ces
l'esprit
représentations,
sur
des
certaines
propositions
conjonctions comprend la
propositionnel,
ou
opérations
"simples".
plupart des
opérateurs
y compris l'adverbe de négation
La
qu'effectue
liste
du
"non",
"ou", "si" et "donc";
si on fait bien reflexion,
on verra que ces particules ne signifient que l'operation mesme de
nostre esprit, qui joint, ou disjoint les choses,
qui les nie, qui les considere absolument,
ou avec condition; par exemple,
il n'y a point d'objet dans le monde hors de nostre esprit,
qui ré256
des
calcul
"Sc",
ponde à la particule non, mais il est clair qu'
elle ne marque autre chose que le jugement que
nous faisons qu'une chose n'est pas une autre.
(9.9.R., p. 151).
M.
Dominicy a donc parfaitement raison d'appeler "assertoriques"
opérateurs
ces
(les
conjonctions)
qui
"dé rivent
de
proposition modifiée une autre proposition" (Dominicy,
166) .
à
Mais l'assentiment ou l'affirmation,
juste
cité,
(3)
qui marque
non
ne le serait
mais l'adverbe
"le jugement que
qu'une chose n'est pas une autre".
faisons
dans les
parties
pensées,
entre celles qui expriment certaines op'rAtions de notre
comme les interjections et le verbe.
lorsqu'ils
à
des
"forme"
la
de
nos
"operations de nostre
seraient
assertoriques,
interrogatifs
tandis
pensées.
esprit"
toujours
que
Les conjonctions
mais elles servent bien à rendre
parlent des conjonctions,
lesquelles
esprit,
et celles qui expriment des mouvements
n'expriment pas de "mouvement",
manifeste
les
et
Lancelot,
renvoient constamment
(9.9. R. ,
exprimées
les
Arnauld
par
des
interjections,
151) ,
29,
pp.
opérateurs
les
pronoms
et les modes verbaux ne signifient jamais que
"mouvements de l'âme"
non assertoriques,
la
de Port-
du discours qui expriment la forme et la manière de nos
de l·ame,
plus
(ou
nous
Notons que les MM.
Royal semblent mettre une certaine différence,
comme les "conjonctions",
p.
comme dans le passage tout
,
où ce n'est plus le verbe,
"c onj onct ion ")
1984,
marqué par le verbe
l'indicatif dans les propositions simples,
dans les propositions "composées"
la
et seraient assimilables à des
opérateurs
c'est-à-dire des opérateurs qui tirent
proposition une autre proposition qui n'exprime plus un
257
des
d'une
jugement
catégorique (Dominicy).
d'une
proposition
Les parties du discours formant le .odu.
se réduisent donc aux
interjections
et
aux
verbes avec leurs modes.
Il Y a enfin le verbe,
d'abord
que Lancelot et Arnauld
définissent
"un .ot dont le principal usag. est de
comme
signifier
l'affir •• tion
c'est à dire de marquer que le discours où
mot
est le discours d'un homme qui ne conçoit
est employé,
seulement
(6.8.R.,
les
choses,
95) .
p.
Il
mais
y
qui en juge St
qui
les
a quelque chose d'étrange
pas
affirme"
dans
cette
définitionj les Messieurs disent d'abord "principal usage",
"signification
divers
point
principale"
grammairiens (Aristote,
considéré le verbe
est l'affir.ation"
(p.
98j
que
l'affirmation)
verbe
lorsqu'il
Cesse-t-il
d'~tre
lui est
Buxtorf,
Scaliger)
je souligne).
de
principal
n'est pas utilisé
n'avoir
essentiel,
en quel
du
qui
verbe
s'oppose
sens
peut-
(marquer
Qu'arrive-t-il donc
"essentiel"?
selon
à
Nous sommes passés de
"secondaires",
l'usage
puis
et reprochent plus loin
Puisqu'un usage "principal"
forcément à d'autres usages
dire
96),
"selon ce qui luy est
"principal" à "essentiel".
on
(p.
ce
l'usage
au
"principal"?
verbe?
La réponse des Messieurs,
c'est
"que l'on s'en sert encore
pour signifier d'autres mouvemens de nostre amej
258
&c. Mais ce n'est qu'en changeant d'inflexion
et de Mode." (Ibid.,
auteurs
pp.
95-96). Il Y a une ambiguïté ici : nos
disent que l'on se
"sert encore du verbe pour signifier
d'autres mouvemens ... " , e t la présence de l'adjectif
("autres")
semble indiquer que l'affirmation est également un "mouvement
de
l'âme"
le
comme les autres;
jugement,
par
ailleurs,
l'affirmation,
ou
est l'une des "trois operations de nostre esprit"
(p.
27) dont traitent les logiciens (concevoir, juger, raisonner)
la
"signification
principale"
96) ,
du verbe
lorsqu'il
"est celle qu'il
l'indicatif"
(p.
pourrait
effet se demander si l'affirmation
en
"autres
mouvemens
modes,
si
les
l'affirmation,
exprime
de l'ame" ce que l'indicatif est
"mouvemens
comme
le
de
l'ame"
regret,
par
a
ne
pas
aux
aux
autres
pré suppos ent
exemple,
à
On
l'affirmation.
n'est
Et
pas
présuppose
un
jugement que tel état de choses est le cas (et le souhait que cet
état de choses ne soit jamais arrivé) .
l'indicatif,
dans la 8.8.R.,
grammairiens
de
tradition
des
déclaratif vs
Port-Royal
philosophes,
Nous verrons bientôt
n'est pas vraiment un
semblent
qui
ici
partent
qui distinguent,
et la
sous l'unité d'une
marquent plus
aucun
m~me
259
la
le plus souvent,
catégorie,
des
formes
et
des
formes
"mouvement de
participe, gérondif, supin).
entre
tradition des grammairiens,
verbales qui ne marquent plus l'affirmation,
ne
Les
l'opposition
de
non déclaratif et marginalisent,
le discours non déclaratif,
qui
déchiré s
mode.
que
m~me
l'âme"
(infini tif,
Il n'y a pas
affirmer
dans
une
Sr •••• ire et
la
Arnauld,
Lancelot
"l' action
de
et
notre
divers es idé es,
différence
nette entre
Logiqu.e
la
Nicole
définissent
esprit,
il affirme
bien
par
de
le
laquelle
juger
Port-Royal
jugement
joignant
et
(4)
•
comme
ensemble
de l'une qu'elle est l'autre, ou nie
de l'une qu'elle soit l'autre" (L. Logiqu.. ou. l'.rt de penser, p.
aussi, S.S.R., p. 28).
59; je souligne; cf.
Le jugement est une
opération de l'esprit indépendante du langage, la
langue
que ce soit,
m~me
en quelque
quelque chose qui se fait entièrement
dans
l'esprit du sujet qui donne son assentiment à l'inclusion ou à la
non-inclusion d'une idée dans une autre (Dominicy,
165)
.(~)
('Ile discours d'un homme qui
ne conçoit pas seulement les choses,
affirme") ;
Le
toutefois,
et explicitement,
Goffic,
mais qui en juge
est catégorique
lui,
que cette "affirmation" est
prise
sert à marquer la force assertive
77),
l'affirmation,
(.ctu.s
mais
.x.rcitu.s)
Contrairement
une
(6)
les
clair
verbe
"il
& qui
est
(1978,
p.
235).
Le
(Nuchelmans,
1983,
p.
par
le
comme manifestation d'un acte de jugement"
autrui(?)
cit., p.
Ailleurs (8.8.R., p. 95), l'affirmation parait s'opposer
au jugement et lui @tre postérieure
locut.ur
op.
AffirmAtion
Accomplie
qui fait entendre ses
à ce qui sera le cas plus
pensées
tard
à
chez
Condillac, l'affirmation, à Port-Royal, est autant dans la pensée
que dans les mots.
en
L'affirmation peut
pensée qu'en parole;
qu'un acte illocutoire,
~tre
accomplie aussi
elle est tout autant un acte de
ou mieux
260
bien
pensée
un acte illocutoire qui peut
être
accompli
l'affirmation,
lien
pensée
mais
Ou
pas
seulement 'ICEu
Le
•
comme le font les
"j'affirme"
verbe
mots
"affirmation"
qui
affirmation conçue par le locuteur
signifie
marquent
une
(.ctus signific.tus) ,
parce qu'ils ne la signifient qu'entant que par
une reflexion d'esprit elle est devenuë l'objet
de nostre pensée;
& ainsi ne marquent pas que
que celuy qui se sert de ces mots affirme, mais
seulement qu'il conçoit une affirmation.
(6.6.
R., p. 95).
un
En
locuteur
accompli t
une
affirmation marquée par la copule implicitement contenue dans
verbe adjectif
signifie
une
tandis que le
affirmation
attribuée à Pierre.
conçu. par le
De même,
locuteur
participe
et
par
lui
si je dis "J'affirme", j'accomplis
une affirmation marquée par la copule ("Je suis
affirmant"),
je m'attribue une affirmation conçue.
(1984,
signale
Royal
Dominicy
p.
une ambiguïté dans la notion d'''affirmation'' chez
tantôt le terme recouvre à la fois
idée dans une autre) .t l'assentiment,
ont
le
tendance à le restreindre seulement
à
nos
164)
Port-
l'inclusion
et tantôt,
et
(d'une
auteurs
l'inclusion.
Mais
dans l'interprétation générale que M. Dominicy adopte finalement,
la copule exprime l'inclusion
et
l'assentiment,
aussi
symbolise par la barre de jugement de Frege.
dans les modes autres que l'indicatif,
l'assentiment
(ou
l'affirmation)
et
[l'inclusion + un mouvement de l'âme].
261
qu'il
Il semble bien que
le verbe cesse de marquer
ne
signifie
plus
que
Avec le critère de l'affirmation, les grammairiens de PortRoyal semblent revenir à la définition du verbe des logiciens. En
fait,
Arnauld
direction;
Harris,
et
Lancelot ne font que quelques
Beauzée,
verbe
Condillac,
perd
reconnaissait
plus
deux
des
Aristote
dans un sujet,
sont
en
cette
les grammairiens philosophes des Lumières (Dumarsais,
Beattie,
fonctions
signification
essentielles
signifier l'existence
et indiquer le temps.
que des
Destutt de Tracy,
"significations
principale
etc.)
Dans la 8r •••• ir. de Port-Royal,
iront plus loin sur cette voie.
le
pas
du
que
d'un
lui
attribut
L'attribut et le temps
aj outé es Il
verbe
qui
aj outé es
,
est
de
à
ne
la
marquer
l'affirmation. Pour cette raison, le verbe, sous sa forme la plus
pure,
est le verbe
éternelles",
"~tre"
tel qu'utilisé dans les
à la troisième personne du singulier de l'indicatif
présent, comme dans: "Tout corps .st
plus
grand que sa partie",
attribut,
aucune
car
particulier,
tous,
une
"signification
personne
qui
d'sign.tion
•• rqu.
dé fini tion
principale"
où le verbe
particulière
du
ilLe tout
n'exprime
et
aucun
aucun
temps
et
verbe
qui
principaux
"ajoute"
pour
d.
qu.1qu.
du no.br.,
à
accidents
(pour les verbes "adjectifs")
.ttribut,
& du t •• pS"
"l es hommes se portent naturellement
262
.st
Mais les Messieurs proposent
ses
l'.ffir •• tion
d. 1. p.rsonn.,
C'est parce que
divisible",
ces propositions sont vraies partout
l'expression d'un attribut
.ot
etc. ,
et sans égard à aucun temps.
néanmoins
"propositions
(p.
à
sa
et
"Un
avec
103) .
abreger
leurs
expressions" (p.
96) qu'ils ont joint à la
signification
principale du verbe d'autres significations pour les réunir en un
seul
mot.
celle-ci
Le mode n'est pas absent de
cette
caractérise le verbe à l'indicatif,
l'affirmation
"on
ne
sçauroit trouver
l'affirmation qui ne soit verbe,
marquer,
lorsqu'il
de
ni de verbe,
au moins dans l'Indicatif"
(p.
définition,
mot
car
exprime
qui
marque
qui ne serve à la
101; je souligne). Mais
l'indicatif n'est pas vraiment un mode pour Arnauld et Lancelot.
Cette restriction nous renvoie à
haut
l'embarras
si le verbe n'est pas verbe qu'à
signalé
l'indicatif,
plus
s'il
ne
cesse pas d'être verbe à l'impératif, à l'optatif, au subjonctif,
etc. ,
il
faut
dépendent
en
donc que ces emplois . "secondaires"
quelque
façon
de
l'indicatif.
des
Je ne
verbes
crois pas
que l'on puisse interpréter la primauté de l'indicatif chez PortRoyal
fait
par
une simple question de fréquence d'emploi
Julien dans sa thèse (1979,
usage l l
p.
par "usage le plus fréquent")
plus "fondamental"
453) qui
(comme
rend
le
"principal
L'indicatif
n'est
parce qu'il est utilisé plus fréquemment,
pas
ou
parce que les assertions seraient en fait plus fréquentes que les
ordres,
parce
les priè res ,
qu'il
serait
les expressions de souhait, etc., ou enfin
premier
dans
l'ordre
de
la
genè se.
J'essaierai plut8t de développer l'idée que l'indicatif est
"fondamental "
que
les
autres
modes
263
parce
que
ces
plus
derniers
"présupposent" logiquement l'indicatif et qu'ils en dépendent
en
quelque
le
manière,
nominatif.
un peu comme les cas obliques présupposent
Ainsi, de même qu'un nom au nominatif ne perd pas sa
qualité de nom (ni sa signification)
un
cas obl ique
dans
(9)
sont
opérateurs
(que
des
Plutôt,
appelle
verbe
les modes autres
"modifications"
Dominicy
dans
d'~tre
le verbe ne cesse pas non plus
,
ses emplois "secondaires".
l'indicatif
lorsqu'il est utilisé
de
"non
l'indicatif,
des
assertoriques")
qui
suspendent l'affirmation catégorique normalement exprimée par
verbe à l'indicatif,
comme le génitif,
référence
du
nom
Socrate",
ne
réfère pas à Socrate,
(la description
modes sont des "ajouts",
par exemple,
définie:
"la
mais à sa
présuppose
suspend la
blancheur
blancheur).
toujours une forme
comme un
définit pas un nom
au génitif ou au datif,
les
Messieurs
ne
(substantif) en donnant sa
Les
nom,
Et comme on
signification
mais celle qu'il a au nominatif, de même
définissent
pas
le
verbe
signification au subjonctif ou à l'optatif,
l'indicatif.
de
nom au
nominative du même
tout comme l'''accessoire'' présuppose le "principal".
ne
le
des "accessoires" du "verbe indicatif";
les modes présupposent donc le verbe indicatif,
génitif
que
en
donnant
sa
mais celle qu'il a à
Mon interprétation, comme celle de M. Dominicy dont
je me suis largement inspiré, présente l'indicatif comme le "pôle
non marqué des oppositions modales" (Dominicy, op. cit., p. 166),
tout
comme
Lancelot,
verbes
le nominatif est un cas
lorsqu'ils
énumèrent
à la fin du chapitre XIII,
"non
marqué" .
les "princ ipaux
mentionnent
Arnauld
acc idens"
"ceux
qui
et
des
sont
communs à tous les verbes, la diversité des personnes, du nombre,
264
1
.
& des temps" (p.
le
104) ,
mode n'y figure pas,
n'est pas pour eux,
et le mode est absent de cette liste; S1
c'est sans doute parce que
à proprement parler,
un "mode". L'indicatif
n'est
d'ailleurs pas traité au chapitre des
n'est
qu'en l'opposant aux autres modes personnels
l'aligner sur eux et le
(10)
des
Les
modes
l'affirmation
marquée
modes
faire entrer dans la
autres que l'indicatif
obliqu..
contextes
l'indicatif
verbaux.
qu'on
peut
catégorie du
mode
créent,
semble-t-il,
en
ou
catégorique du
"verbe
Ce
indicatif";
retirant
l'affirmation
par le verbe est alors suspendue et la liaison du
sujet
et du prédicat n'est alors plus présentée que comme possible,
d'une
dépendante
probabl e
Le
(1:2)
rattache
condition,
alors
ou
d'un
"mouvement de l'âme"
fait
ou
contingent
ou
exprimé par le mode
à la "matière d'un jugement possible"
se
(suj et
+
prédicat), selon l'expression de M. Dominicy (op. cit., p. 167)
"les
opérateurs
, quoique' ,
qui,
non-assertoriques
(' ne' ,
le
subjonctif,
etc.) dérivent de la proposition modifiée une
prononcée
ou
écrite,
exprime un
"mouvement
de
l'âme",
différent de l'assentiment et attaché à la matière d'un
possible".
tu
marches"
jugement
Ainsi, en supposant que "Marche l", et "J'ordonne que
soient des énoncés équivalents,
le contenu
clausule ("que tu marches") n:J •• t pa. l'obj.t d:J un•
phrase complète,
elle,
exprime bien un jugement;
accompli par l'énonciation du locuteur
ma1s
signifiée
par son énoncé
(.ctus
265
la
même si la
dans ce
de parole qui était consignifié par le verbe
plus
de
affirmation;
il ne serait que la "matière d'un jugement possible",
l'acte
phrase
signific.tus)
ne
cas,
serait
comme
la
phrase
"Plat
à Dieu qu'il vienne",
exprime un souhait
vienne "
entre
indique
signifie le m@me souhait.
il n'y a
aucune
pas
Reste à préciser
et le reste
trace de cela dans la G.G.R.,
place pour les explications des modes par
ellipse,
comme le faisaient les grammairiens de la
et m@me Lancelot dans sa /44thod. de latin ( 1 3 )
Logiqu.,
le
locuteur
("Pla.t au Ciel"), alors que "Je souhaite qu ' il
l'hyperphrase ("J'ordonne que")
mais
que
•
le
de
rapport
l'énoncé;
qui
ne
fait
effacement
ou
Renaissance ,
De même,
dans la
Arnauld et Nicole ne font aucune tentative pour réduire
les énoncés non déclaratifs aux déclaratifs (Nuchelmans, 1983, p.
75) ,
comme
le
faisait Apollonius,
plusieurs grammairiens des Lumières
Destutt de Tracy).
et comme le
(Harris,
Nous y reviendrons.
feront
Buffier,
encore
Beattie,
Jetons d'abord un coup
d'oeil au système des modes.
* * *
Les modes verbaux,
les
dans la 8r •••• ir.
principaux marqueurs des actes de pensée,
"manières de nos pensées".
L'affirmation
la principal. manière de nos pensées,
commandement, la prière,
sont
266
des
diverses
(ou le jugement)
la concession,
Nous
sont exprimées par les modes autres
modes se répartissent finalement en
ou
est
mais l'interrogation,
les i mp l e dé sir ,
aussi des manières de nos pensées.
dernières
Les
de Port-Royal, sont
l'avons
que
mod •• d.
vu,
le
etc. ,
ces
l ' indicatif.
l'affirmation
distinguaient
traitaient
pas
encore
sous
l'affirmation
ce
(ou
(les
Messieurs
ne
conditionnel
du
subjonctif
et
le
dernier
de
Le subjonctif
les formes
l'entendement),
en
-rais)
tandis
relève
que
les
de
modes
optatif, concessif et impératif relèvent de la volonté.
Considérons
d'abord les modes de l'affirmation
les verbes reçoivent différentes inflexions,
selon que l'affirmation regarde differentes
personnes
& differens temps. Mais les hommes ont
trouvé qu'il estoit bon d'inventer encore d'autres
inflexions pour expliquer plus distinctement ce qui se passoit dans leur
esprit;
Car
premièrement
ils ont remarqué qu'outre les affirmations simples,
comme il .i •• , il .i.oit, il
y en avoit de conditionnées & de modifiées; comme quoy qu1il .i •• st,
qu.nd il .i •• roit. Et pour
mieux distinguer ces affirmations des autres,
ils ont doublé les
inflexions des mesmes temps,
faisant
servir les unes aux affirmations simples; comme ai •• , .i.oit, & reservant les autres
pour les affirmations modifiées;
comme
. i •• st,
.i •• roit . ..
Donzé
(1967,
n'expliquent
ce
"conditionnée "
interpréter
Lancelot.
118) observe que ni la Sr •••• ir.
p.
ces
Une
qu'il
et
faut
entendre
"modifiée";
ni la Logiqu.
par
ici
en conséquence,
termes en faisant retour sur
affirmation est
"simple",
il
les
cherche
H,thod.s
de
(selon
la
"simple et directe"
H,thod. d'espagnol; je souligne)
lorsqu'elle ne sert qu'à marquer quelque idée
267
à
positive tout en restant grammaticalement indépendante. En un mot, l'indicatif est le mode de l'énonciation autonome. Il y a subjonctif, en revanche,
dès que l'idée, .odifi'.
par quelque interprétation,
s'exprime en subordonnée; la Sr •••• ir. l'appelle alors conditionn4.,
et la H4thod~ d'espagnol, d4p.nd.nt •. (Donzé, p. 118; je souligne).
(Il me
semble
"conditionnées" ,
proprement dit,
que la
Sra ••• ire
appelle
les affirmations qui
"c ondi t i onné es"
"modifiées",
relèvent du
et
non
"subjonctif"
se rapportant plutôt aux formes
L'indicatif, utilisé dans les affirmations "simples",
par excellence,
est donc,
"autonome",
le mode
"direct",
"indépendant"
et
comme le nominatif dans les noms. Au siècle suivant,
Du Marsais appellera
mode indicatif,
"directes" les propositions énoncées par le
et "obliques" les propositions énoncées par
les
autres modes.
Quant aux modes de la volonté,
ils dépendent de la
dont nous voulons les choses
outre l'affirmation; l'action de nostre volonté se peut prendre pour une maniere de nostre
pensée,
& les hommes ont eu besoin de faire
entendre ce qu'ils vouloient,
aussi bien que
ce qu'ils pensoient.
Or nous pouvons vouloir
une chose en plusieurs manieres,
dont on peut
considerer trois, comme les principales. (S.S.
R., p. 113).
268
manière
IO) si ce que nous voulons obtenir ne dépend pas de nous, il
s'agit alors d'un "simple souhait"
s'emploie.
pas
en
car
"les mesmes
& pour l'optatif."
inflexions
(Ibid. ,
ajoutaient Utin •• devant le subjonctif,
DiflU,
qui
Ce mode a des inflexions particulières en grec, ma1S
latin,
subjonctif
et c'est le mode optatif
pour
obtenir
le
même effet.
p.
servent
114) .
pour
Les
Romains
PICt
et les Français,
Mais
il
n'y
le
a
pas,
~
à
proprement parler, d'optatif en latin et en français, "puisque ce
n'est
pas seulement la maniere differente de signifier qui
estre
fort
multipliée,
mais
les
doivent faire les modes." (Ibid.)
différentes
inflexions
signifier",
qui
Malgré cette déclaration, le
point de vue des Messieurs est bien d'abord celui de la
de
peut
de la fonction;
la présence ou
"manière
l'absence
inflexions ne les empêchent nullement de reconnaître (de
des
déduire
littéralement) des modes auxquels ne correspond aucune inflexion,
comme
des
espèces naturelles dans un
"tableau périodique"
qui
attendent qu'on les reconnaisse, qu'on leur donne un nom et qu'on
leur assigne une place.
IIO)
lorsqu'on se contente d'accorder une chose
qui
"concessif" (.odus potltnti.lis,
requis.
"Les
hommes
marquer
ce mouvement,
si
c'est alors le mode "potentiel"
absolument on ne la désire pas,
ou
même
est
inflexion
pour
aussi bien qu'ils en ont inventé en
Grec
auroient pa inventer
pour marquer le simple désir.
Mais ils ne l'ont pas fait,
se servent pour cela du subjonctif." (Ibid.).
distingue par l'ajout du quit
une
En français, on le
"Qu'il dépense",
269
& ils
"Qu'il
perde",
"Qu'il
périsse",
rencontré
un
"Qu ' il
mode
le
fasse",
potentiel chez
que
servirait
marqué,
Nous
Linacre,
( •• V,
anglais par des verbes auxiliaires
mode
etc.
qui
avons
déjà
s'exprime
en
etc.); mais le
shou.ld,
les Messieurs appellent
"concessif"
ou
"potentiel " ,
plutôt
permission.
Il
serait
en
accorder une
à
franç ai s,
par
le
"que"
et
les
donc
terminaisons
du
subjonctif. Le texte de la 6.G.R. n ' explique pas le rôle du " que"
dans ces tournures, s'il est adverbe ou pronom relatif et dans ce
dernier cas,
quel est
l'''antécédent''
(sous-entendu,
s'il y
a
lieu) .
IIIO)
enfin, lorsque nous voulons une chose qui dépend d'une
personne de qui nous pouvons l'obtenir, en lui adressant un ordre
ou
une prière,
c'est alors l'impératif qui doit
être
utilisé .
"C ' est le mouvement que nous avons quand nous commandons,
nous
prions." (Ibid.,
personne
du
proprement
p.
"parce
singulier,
soy-mesme";
à
115) .
Ce mode n'a pas
qu'on
n'a pas
il
ne
non
se
plus
de
ou que
première
commande
de
point
troisième
personne,
"parce qu'on ne commande proprement qu'à ceux à qui on
s'adresse
& à qui on parle".
l'indicatif
se
prennent
Le mode impératif et le futur
souvent l'un pour
tuerez point"/"ne tuez point! ") ,
prière
rapport
se
rapportent
l'autre
("vous
de
ne
parce que le commandement et la
toujours à quelque
au moment de l'énonciation.
chose
de
Ce mode n'a pas
futur
reçu,
par
en
français, de flexion particulière; on le marque en retranchant le
pronom
personnel
"vou.s
ai ."z ,
270
est une simple
affirmation
. i •• z
un
impé rat i fil
Cette
116) .
(p.
procédure
"transformationnelle" (effacement) est à rapprocher de celle
par
laquelle nous formons des questions, en inversant l'ordre naturel
des
mots
entre
le pronom et le
signifie l'affirmation
ai •• -t-iI?
.st-c.?
mais
S1
verbe
je
"j'ai ••
ainsi,
dis,
cela signifie l'interrogation"
(8.8.R. ,
p.
152) .
La
concession,
l'ordre,
présupposent un allocutaire,
pensé e" ;
ces
seulement"
ou
actes
ne
la
prière,
en
tant
ne sont pas de simples
peuvent
être
par un être solitaire.
acc ompl i s
Commander
qu'ils
"actes
"en
ne
de
pensé e
peut
être
seulement une "action de notre esprit"; c'est un acte illocutoire
qui présuppose tout un contexte d'énonciation ("on ne se commande
point
proprement à soy-mesme").
impératif,
c'est
commandons,
ou
volonté
"le
mouvement
que nous prions",
Ce qui est marqué par le
que
nous
c'est
que nous avons que l'allocutaire fasse cette
"mouvement de
Dans
quand
et ce mouvement,
dépend de lui et que nous voulons obtenir.
locuteur,
avons
l'âme"
lui,
l'esprit
la
qui
du
ne se fait pas que dans l'âme.
ce classement des modes en modes de l'affirmation et de
volonté,
nous
Si le mode marque un
qui se fait tout entier dans
le commandement,
chose
mode
la
la direction d'Ajustement de l'énonciation semble jouer
un certain rôle
former notre jugement pour éviter l'erreur
trouver la vérité est quelque chose qui djpend da nous,
271
qui
et
est
notre responsabilité
de
la
une
"précipitation",
"faute" de jugement résulte
d'un "défaut"
d'attention,
"vanité" qui nous retient d'admettre: "je me trompe
ri en" (Logi qu..,
les
modes de la volonté,
revient
pas au locuteur;
l'allocutaire
mesure
où
dans
la
Providence,
ou
Premi er di sc ours,
pp.
souvent
ou
de
la
& je ne sais
37-38). Par contre, dans
la r •• ponsabilité d.
l'ajustam.nt
elle ne revient ni au locuteur,
l'expression du "simple
souhait" ,
satisfaction du souhait dépend
du
ne
ni
à
dans
la
de
la
sort,
et elle tombe sur l'allocutaire dans le commandement
la prière et la concession.
Le mode concessif
une dénégation illocutoire d'une interdiction
correspond
Cc' est-à-dire,
à
la
dénégation illocutoire d'un ordre de ne pas faire quelque chose) ;
que
l'action
permise
l'allocutaire,
s'abstenait
mais
d'agir,
soit
il
accomplie
n'encourrait
ou
non
aucune
et le locuteur verrait
m~me
dépend
de
sanction
s'il
d'un
bon
oeil
Lancelot
n'en
cette abstention.
Quant
traitent
aux modes impersonnels,
m~me
Arnauld
pas au chapitre XVI, intitulé
et
"Des divers Modes ou
manière des Verbes", où seuls figurent les modes de l'affirmation
et de la volonté.
qu'ils
ne
Ce regroupement me paraît significatif;
retiennent pas l'affirmation
et
qu'ils
parce
n'expriment
aucun "mouvement de l'âme", les modes impersonnels sont traités à
part.
L'infinitif est
traité au chapitre XVII,
272
les participes,
au
chapitre XX,
L'infinitif
est
"personnels",
modes
puis les gérondifs et
immédiatement
chapitre
XXI.
les
modes
après
sans doute parce qu'il fait partie de la liste des
devenue
(indicatif,
traité
supins,
classique
impératif,
depuis
les
subjonctif,
Grecs
et
optatif et
les
Romains
infinitif) ,
et
aussi parce qu'il retient quelquefois l'affirmation.
En
effet,
certains
selon Arnauld
contextes,
et
Lancelot,
l'infinitif,
joue le rôle d'un pronom relatif
en
liant
deux propositions,
fait
L'infinitif
proposition
manière
sujet
devienne
ou
C'est
fait
une
en
sorte
partie de la
l'attribut (ou même
à
Mais
substantifs
portent
et •• 1u • • st fugi.ndu.
en fait
que
la
première,
de
au
la
même
d'une
au
proposition
la plupart du temps, les infinitifs sont des
qui ne retiennent
pas les marques du nombre,
pourquoi
verbe)
une
seconde
qu'un pronom relatif joint une proposition incidente
"principale".
noms
Scio
seul une proposition,
autre.
en
nos auteurs n'en ont
pas
l'affirmation,
de la personne ni du
finalement pas
et
ne
temps.
traité
au
chapitre des modes du verbe.
Les
participes sont
traités comme des
"noms adjectifs",
parce qu'ils ne retiennent pas l'affirmation du verbe, quoiqu'ils
273
signifient
par
personne) ,
c'est-à-dire un certain attribut,
pour le genre,
ailleurs la m@me chose que le verbe
avec des
le nombre, le temps et la voix.
l'affirmation
et
la personne à
un
(hormis
la
marques
Ainsi, lorsqu'on
participe
on obtient le m@me effet qu'avec un verbe: ••• tus su.
Le gérondif est un "nom substantif",
qui
à la voix active,
"adjoC.te à la signification de l'action du verbe,
de nécessité ou de devoir. Il
(6.6.R.,
134) .
p.
"c'est un nom substant i f qui est pas s i f"
(j bi d.,
=
et
une autre
Quant au supin,
p. 135).
* * *
Les
conjonctions,
les
verbes
et
leurs
modes,
et
les
interjections, nous l'avons vu, ont en commun de ne désigner rien
qui soit "hors de l' espri t Il.
qui
sont
Mettons de côté les interjections,
"des voix plus naturelles
qu'artificielles",
l'on peut décrire, suivant Dominicy,
comme
"rp.atière du jugement possible"
conjonctions,
aussi en
que
"des opérateurs non-
assertoriques qui s'appliquent 'à vide'll (1984,
que la
et
p.
exprimée.
Les
les modes verbaux et les modalités aléthiques
ont
commun de
Ilcomplexifier"
274
n'est pas
parce
167) ,
selon la forme
(et
non
la
matière)
les propositions
car
Y a
il
forme,
dans lesquels
"des propositions dont la complexion tombe
c'est-à-dire,
sur
l'affirmation
II,
propositions
quand
la
ils ont une occurrence;
"qui
VI,
et
négation"
p. 166), contrairement aux
sont complexes selon
complexion
la
sur
(ibid.) ,
la · matière"
tombe sur le sujet
ou
l'attribut
de
la
proposition (comme "Alexandre qui était fils de Philippe vainquit
Darius
qui était Roi des Perses") .
complexe selon la forme,
l'attribut,
Lorsqu'une
c'est au verbe,
proposition
est
et non au sujet ou
que se rattachent les propositions incidentes.
à
Par
exemple, dans "Je soutiens que la Terre est ronde", "Je soutiens"
ne
se rapporte nullement à
copule;
le
"plus
"expl ica t ive"
est:
en
la terre
ou
deux
expres sément" ,
"déterminative".
est rond.,
proposition
"principale".
Celui
comme
Ainsi,
&
l'autre pl us
soutient
mais à
la
"incidente" ,
l'affirmation
nous
convainquent que ... "
la
"Je soutiens que la Terre
et pas seulement
Arnauld et Nicole
"Il n'est pas vrai que .. "
"
"est
expressément par le
mentionnent
d'autres opérateurs transpar.nt. ("Je nie que ... "
que ..
incidente
"la Terre est ronde",
et
qui dit
qu'elle l'est.
une
II, VIII, p. 176). "Je soutiens" est
affirme que la Terre est ronde,
ronde"
"ronde",
l'une à l'ordinaire par le verbe
manieres
verbe j . souti.ns" (Logiqu.,
ici la
ou à
la copule exprime déjà l'affirmation, mais "Je soutiens"
fait
exprimée
"Terre"
"Les raisons
est
qu'il
encore
"Il est
vrai
d'astronomie
"la Terre est ronde")
qui
sont
aussi des propositions incidentes qui concernent le verbe et
la
matière de la proposition,
avant de toucher quelques mots
275
non
à
propos des modalités aléthiques.
verbaux
(autres
impersonnels)
Comme ces dernières, les modes
que l'indicatif,
seraient
mais en
excluant
opérateurs
des
non
les
modes
transparents
complexifiant les propositions selon la forme plut8t que selon la
matière
Terre
"Il est nécessaire que la Terre soit ronde"
est nécessairement ronde") contiendrait de la
(ou
même
"La
façon
une proposition "incidente" affectant l'affirmation contenue dans
la propos i t i on "princ ipal e" .
Port-Royal
ne
Dominicy signale que "la théorie de
sépare pas clairement les
modalités
des
modes"
(1984, p. 211); car avec les modalités, dans certains contextes,
l'affirmation ou la négation exprimée par la
copule
(éventuellement niée)
fera l'objet
d'une "modification" non assertorique, assimilable,
.ut.tis .ut.ndis, aux "modifications" que peuvent apporter les modes autres
que l'indicatif.
Les "incidentes"
rendront alors quelques-unes des différentes
variétés d'engagements que le sujet parlant
contracte vis-à-vis de ses destinataires
quant à la vérité de l'inclusion,
ou de la
non-inclusion, exprimée par la "principale".
(Dominicy, 1984, pp. 211-212).
Tâchons de faire le point sur le
indicatif"
savons
et le verbe dans les
pensé es,
être
entre le
"verbe
autres modes personnels
nous
que les modes autres que l'indicatif sont des
"non assertoriques"
forme,
rapport
qu'ils
opérateurs
qui complexifient les propositions selon
servent à exprimer la forme ou la manière de
et que les "formes ou manières de nos pensées"
indiqué es
(ou
"consigni fié es")
276
par
le
verbe
la
nos
peuvent
dans
l'énonciation,
les
ou signifiées directement par l'énoncé;
modes autres que l'indicatif,
verbales,
apparaissent
accessoires
comme
comme les
autres
de plus,
inflexions
des significations "ajoutées"
par rapport à la signification principale
du
ou
verbe
(marquer l'affirmation); enfin, la forme de nos pensées, dans les
propositions complexes selon la forme (quand la complexion
sur
le
verbe),
s'exprime "expressément" par
incidentes (l'Je soutiens que",
que" ,
etc.) .
"Je nie que",
que" ,
"Je
demande si",
propositions
"Il est nécessaire
m~me
Pourquoi n'en serait-il pas de
personnels autres que l'indicatif?
des
pour les modes
Les hyperphrases "Je souhaite
"J'ordonne
que",
etc. ,
seraient
incidentes marquant explicitement de quelle manière est
l'inclusion
présentée
d'une
de
l'attribut
comme
condition
subjonctif,
d'un
ou
jugement
d'un autre
simplement possible
fait
que
l'on
comme
(pour
les
le
comme
énoncé s
pour le concessif et l'impératif.
l'indicatif)
expriment
les temps,
bien
étonnant
que
les
Messieurs
plus
ment i onné es
hyperphrases
invraisemblable
appellent
haut,
et
et les
il n'est
diversité des personnes"
ce
que font
les
277
pas
les
n'est
pas
il
Messieurs
et "la diversité des
modes
"inc ident es"
de penser que l'on puisse faire avec
l'indicatif
Si les
"s igni fica t ions
des
à la signification principale du verbe,
que
dans
l'optatif,
dans
ajoutées"
autres
est
dépendante
catégorique
ignore
verbales pour les personnes,
que
modifiée
l'inclusion
l'indicatif,
de l'acte de parole,
(autres
sujet;
des
comme "pouvant" ou "devant" @tre une conséquence
interrogatifs)
flexions
le
effective dans
comme
dépendante
dans
tombe
temps",
les
pour
modes
"la
c'est-à-
dire, les rendre "expressément " par des noms et des pronoms (pour
les personnes)
102) .
Les
et par des adverbes
Messieurs
disent
(pour les temps)
que ces
(6.8.R. ,
significations
ont
ajoutées pour satisfaire la tendance des hommes à "abreger
expressions"
souhaite
que",
signifieraient
bizarrement,
"ordonner",
Les
. 96) .
(p.
" J'ordonne
propositions
que",
"Je
sont les complétives des
que
etc. ,
nos grammairiens
verbes
jansénistes
jugements catégoriques ("Je
ou
soutiens
présent
que",
"Je
De quelle façon la conjonction
le relatif "que" joint l'incidente au verbe dans ces phrases,
cela n'est pas trè s clair
la
assez
appellent
affirment
"j'ordonne que").
etc.)
"souhaiter",
alors que ces "incidentes" à l'indicatif
suppose que",
("Je
et
"principales",
des
leurs
que",
explicitement le "mouvement de l'âme",
ce
été
"incidentes"
permets
p.
cinquième
édition
(1~).
(Nuchelmans, 1983, p. 82).
de 1683 de
la
Logiqutl
(chap.
Dans
premier,
seconde partie; "Des mots par rapport . aux propositions"), Àrnauld
et Nicole proposent l'analyse suivante des phrases "Jean répondit
"Je suppose que vous serez
qu'il n'était pas le Christ",
et
"Je
vous
répondit qu'il
mot
147) .
nom;
"
de r'pondit,
Il
"que"
"conserve l'usage de lier une
dans
"Jean
proposition,
avec l'attribut enfermé dans
n"toit p.s 1. Christ,
savoir,
le
dis que vous avez tort"
sage",
qui signifie fuit
r.spondtlns."
p.
a aussi un autre usage qui est de se "rapporter" à
le "que"
est donc une contraction de
et l'antécédent de ce "qui"
est
le
un
"une chose qui est",
"réponse" dans
"Jean fit une
réponse qui est
il n'était pas le Christ". Et pareillement dans
les autres cas
"Je fais une supposition qui est
278
vous
serez
sage",
"Je vous dis une chose qui est: vous avez tort", etc. Si
on devait analyser de la même manière les phrases
vous marchiez",
"Je
donne
"Je souhaite qu'il parte",
un
ordre
qui
est
vous
"J'ordonne que
etc. ,
c'est-à-dire
marchez",
etc. ,
ces
propositions ne seraient plus complexes selon la forme, parce que
l'incidente est rattachée à l'attribut,
substantif
obtenu
par
décomposition
plus précisément,
lexicale
du
verbe
signifie
directement le mouvement de l'âme
normalement
par
modes impératif ou optatif.
cette
les
Dans
hyperphrases ne sont pas appelées "incidentes";
plutôt
la
phrase introduite par "qui est",
est" ,
laquelle
(Nuchelmans, 1983, p. 82,
incidentes
qu..
est
pp. 200, 211)
dans
est
"sens
= "déterminative");
VIII
de la
ronde",
qui
en
(1983,
tandis que M.
y voit plutôt des relatives
le chap.
chose
qui
affaibli"
Les
avis
Nuchelmans dit que "la clause introduite
seconde
dites complexes selon la forme,
est
l'incidente
écrit dil«t.d s.ns.). Ces propositions
une clause relative restrictive"
"restrictive"
indiqué
les
sont-elles explicatives ou déterminatives?
semblent diverger;
qui
analyse,
ou "une
n'est "affirmée" que dans une
à un
comme
p.
par
81)
(où
Dominicy (1984,
"explicatives".
partie,
les
Mais
propositions
"Je soutiens que la Terre
apparence sont très
semblables
à
celles
analysées dans l'ajout de l'édition de 1683 ("Je suppose que vous
serez sage", etc.), sont analysées d'une tout autre façon,
nous l'avons vu.
comme
Laquelle de ces deux analyses s'imposent?
seule
l'intention du
certains
contextes,
trancher
la question de savoir quelle partie
locuteur
d'une
permet
de
proposition
est l'''incidente'' et si elle doit être rattachée à l'attribut
279
Dans
de
cette
proposition,
intention,
en
ou
être
rattachée
la
à
copule;
S1
mon
énonçant "Tous les philosophes nous assurent
que
les choses pesantes tombent d'elles-mêmes en bas", est d'affirmer
que les choses pesantes tombent d'elles-mêmes en bas, la première
partie
de la proposition est l'incidente;
si mon intention
est
d'affirmer que les philosophes nous assurent de quelque chose, la
seconde partie de l'énoncé constitue l'incidente se rattachant
"une
chose"
via
le "qui" dans
assurent une chose qui est
M.
"Tous les
philosophes
B"
Auroux représente simplement
représente une "simple
"modifiées"
ainsi
les
affirmation'l,
les
(mt.) est clairement rattachée au verbe,
première
analyse
"incidente"
que"),
proposition
d'Arnauld
celui-ci
"principale";
opérateur non transparent,
l'''incidente''.
et
est
Nicole.
un
propositions
n'absorbe
pas
lorsque
mais
B" ,
où
la
comme dans
la
Parfois,
opérateur
si "A
92)
p.
modalité
soutiens
propositions
seraient représentées par "A (est + mt.)
proposition
nous
"
complexes selon la forme chez Du Marsais (1979,
est
lorsque
transparent
l'affirmation
l'''incidente''
de
la
est
un
l'affirmation est comme absorbée
C'est le cas pour les affirmations
volonté
mouvement
chose"
(auxquels
on peut
de l'âme par lequel
joindre
comme une sorte d'optatif)
280
par
"modi f ié es"
l'interrogatif
"nous souhaitons de
la
("Je
et "conditionnées" (modes de l'affirmation) et pour les modes
la
à
sçavoir
de
ce
une
l'inclusion marquée par
le
verbe
n'est
alors
plus
présentée
comme
"effective",
ou
"actuelle".
Les modes sont conçus à Port-Royal comme des
ne
sont
pas
personne,
"communs
à tous les verbes"
le nombre et le temps
car le
accidents qui
(comme
le
sont
"verbe indicatif"
la
n'en
porte pas la marque), et comme des "significations ajoutées" à la
signification
"principale" du verbe (à
semble-t-il,
d'économie,
dans
le
but
d'abréger
l'indicatif) ,
le
aj outé es ,
discours,
par
souci
et pas seulement "pour expliquer plus distinctement"
ce qui se passe dans notre esprit.
C'est ainsi que
l'attribut,
les personnes et les temps sont présentés (chap. XIII, pp. 96-9798) ,
les
et au chapitre XVI, les modes sont mis sur le même pied que
Si
inflexions pour les personnes et les temps.
permettent
d'abréger
inflexions,
n'est-il
rejette
ces
les
autres
pas
"la
8.6.R.
"signification
avec
"éternelles"
exprimant
où
ellipse
pourrait-on
ajoutée"
où le
par
et
(Dominicy,
décharger
personnes
dans
temps et la personne
les
"mouvement
les
ne
de
"incidentes" ("Je souhaite que",
encore,
selon l'analyse de 1683,
281
le
les
1984,
verbe
de
comme on peut le
par les modes,
les
que
qu'affectionnaient
Lancelot inclus"
"expressément "
propositions
etc.) ,
Ne
temps
les
excessif d'affirmer
explications
14)7
note
modes
le discours au même titre que
grammairiens antérieurs,
178,
les
p.
la
faire
propositions
comptent
l'âme"
pas,
par
"J'ordonne
en
des
que",
en décomposant
le
verbe de la principale pour en tirer un
terme
individuel auquel
se rattache l'incidente complexifiant l'attribut?
"réduction"
du non-déclaratif au
déclaratif
Mais une telle
demeure
problématique (dans la première analyse) sans une
du
raIe
sont
joué
par le
relatif
"que"
"complexes selon la forme",
verbe
(la
copule
complexion,
+
(" i l
mj. ")
que"
est nécessaire
=
interprétation
dans les propositions qui
ces
cet ajout au verbe,
adverbiale
suppos e
"est
toutefois
propositions où c'est le
qui
est
complexe.
Cette
serait donc, au fond, de nature
=
que"
"supposément" ,
"nécessairement",
etc.) ,
comme
les
"Je
flexions
temporelles,
qui peuvent être rendues par des adverbes (c'est-à-
dire par des
syntagmes prépositionnels
[prép. + nom]) .
Dans la
Logiqu. (1, VIII), Arnauld et Nicole disent que les additions que
l'on fait à
un terme
deux sortes
mais les
(pour
en faire un terme complexe)
soit des explications,
soit des
sont de
déterminations;
additions qu'ils envisagent ne touchent que la matière,
et non la "forme ou la manière" des pensées. Et ils ne disent pas
si les "additions" faites aux verbes par les
"modes"
sont
des
déterminations ou des explications.
Les Messieurs ne présentent aucune procédure
les
comme
énoncés non déclaratifs aux déclaratifs,
certains
reviendront
grammairiens
aux
philosophes
procédures
du
siècle
de réduction à
282
pour
réduire
le
feront
qui
suivant,
l'indicatif
(et
à
l'infinitif)
d'Apollonius.
On
peut
cependant,
d'indications très sommaires, établir de telles
le
partir
à
procédures
cadre logico-grammatical de Port-Royal sans en
dans
trahir
trop
l'esprit, en particulier en adoptant l'analyse présentée en 1683.
Les
Messieurs,
marginalisent
excluent
conformément
le
discours
à la
non
tradition
aristotélicienne,
déclaratif,
au
l'indicatif des modes proprement dits
point
(c'est
qu'ils
le
"pÔle
non marqué ") , lui conférant la place d'honneur dans la théorie du
verbe;
par contre, ils ne cherchent
déclaratif
au
déclaratif,
et
nullement à réduire le non-
les
modes
"l' action de nostre volonté" siègent,
à
côté
autonomie,
car
Ill es
marquer
à
dans le système des modes,
de l'indicatif et des modes de
relative
servant
l'affirmation
hommes ont eu
besoin
avec
de
une
faire
entendre ce qu'ils vouloient, aussi bien que ce qu'ils pensoient"
p. 113) . Par ailleurs, on peut admettre la réduction du
(8.6.R.,
non-déclaratif
au
déclaratif
sans
admettre
que
toutes
nos
énonciations expriment toujours et seulement des jugements (c'est
ce que fait,
J.
par exemple,
Harris,
qui s'inspire
largement
d'Apollonius, et qui pourtant rapporte à la volonté bon nombre de
nos énonciations) .
Les modes se présentent donc finalement comme des marqueurs
"d'actes de pensée",
Iimaniè res
ou
de notre pensé e ll ,
ou des "mouvements de
s'opposent à la simple affirmation.
Nicole
ne
ou
des
l'âme",
qui
des "actions de notre esprit",
réduisent pas les
Et si Arnauld,
énoncés
283
Lancelot
interrogatifs,
et
optatifs,
impératifs, etc., à des énoncés déclaratifs, et distinguent comme
ils
le
c'est
font les modes de l'affirmation et ceux de
la
volonté,
peut-être à cause de la tradition aristotélicienne
l'influence
particulier,
Arnauld,
envers
1f4dit.tions
des
le
paragraphe
on le sait,
Descartes,
idées
et
souvent
.'t.physiqu.s
9 de
la
de
ou
Descart es
second.)
If~ditation
de
(en
(16)
;
n'a jamais renié sa "dette philosophique"
dont il retient "une série de thèses sur
les signes auxquelles il imprime un tour
plus explicite;
ensuite le cogito,
les
original
et
dont il se plaît
à
soul igner le caractère august ini en" (Dominicy, 1984, pp. 19-20)
Du Marsais reprendra pour l'essentiel,
irritants,
la
théorie de Port-Royal;
Ilpropositions"
(exprimant
respecte
en
sa distinction entre
(exprimant des jugements) et
"une
action de l'esprit"
corrigeant les
les
différente
les
"énonciations"
du
la distance placée par les Messieurs entre
jugement),
l'indicatif
et les autres modes, et l'autonomie relative de ces derniers, car
lui
non
"énonciations" à des énoncés déclaratifs.
dans
la tradition péripatéticienne),
marqué
contre,
entre
ne réduit
nous le verrons bientôt,
plus,
les
Comme à Port-Royal (et
le clivage est
les énoncés déclaratifs et
point
non
clairement
déclaratifs.
Par
Beauzée, qui adopte l'approche réductionniste (pour lui,
toutes nos énonciations expriment, après analyse,
et qui s'emploie
à
des jugement s)
critiquer la distinction de Du Marsais
son article "Proposition" de
l'Encyclop~di.,
284
dans
cite à l'appui de sa
L'art
critique
d,
p.ns.r
d'Arnauld et Nicole
et
ailleurs
s'il
admet
verbe
de
lui
néanmoins que Il [c'] est surtout à
est
employé
selon
sa
la
arrive
1767) de critiquer sévèrement
théorie du verbe de Port-Royal sur la question de
il
côté
à
la
l'affirmation,
l'Indicatif
signification
que
le
essentielle
&
fondamentale ll (6r ••• aire 94n4rale,
Livre III, p. 208); il est le
seul ,
qui n'ajoute pas quelque idée
parmi les modes personnels,
Ilqui est la caractéristique de chaque mode ll .
accessoire au verbe
L'approche
6r •••• ir.
l'usage
paraît
être
,t r.isonn4e;
94n4r.l,
servent
à
verbales.
plus
Ilabréger
tard
les
puissance
est
On peut comprendre qu'un
la
selon
lorsqu'il marque la
force
Ilaccessoires ll
grammairiens
le discours ll ,
dans
défini
et les modes ne sont que des
diront
en
le verbe
qu'on en fait à l'indicatif,
assertive,
(comme
réductionniste
comme
du verbe
philosophes),
les
autres
qui
flexions
grammairien philosophe de la
trempe de Beauzée puisse la développer sans avoir l'impression de
trahir
Tout
l'esprit de l'héritage logico-grammatical de
Port-Royal.
se passe comme si les héritiers de Port-Royal avaient
deux lectures de la même oeuvre,
demeurent
et développé deux approches qui
toutefois incompatibles sur un
(nommément
Beauzée,
Condillac,
toutes nos
énonciations
où
le
Beattie
verbe est
point
et
pour les
uns
Destutt de Tracy),
à
un mode personnel
(ou Ilfini ll ) expriment des jugements; pour les autres
Harris, Gregory),
fait
(Du Marsais,
elles expriment parfois des jugements, parfois
des actions de l'esprit autres que le jugement (ou
catégorique) .
285
l'affirmation
* * *
286
NOTES
(1)
Comparez cette division des parties du discours avec celle
de Vanderveken, 1988, pp. 16-17:
"Ainsi, il existe deux espèces
différentes de mots et de traits syntaxiques dans les langues
naturelles. Certains mots et traits syntaxiques, comme les signes
de ponctuation, l'ordre des mots et le mode du verbe, contribuent
à
la signification des énoncés à
l'intérieur desquels ils
apparaissent
en
déterminant
les
forc.s
illocutoir.s
des
énonciations de ces énoncés alors que d'autres mots et traits
syntaxiques,
comme le temps et la personne du verbe, contribuent
à
la signification des énoncés à
l'intérieur desquels ils
apparaissent en déterminant les cont.nus propositionn.ls de leurs
énonciations".
Il y a une analogie certaine entre les parties du
discours qui marquent les objets de nos pensées et les mots et
traits syntaxiques qui déterminent le contenu propositionnel des
énoncés, d'une part, et entre les mots qui marquent la "forme ou
la manière de nos pensées" et les mots et traits syntaxiques qui
déterminent les forces illocutoires, d'autre part.
Toutefois les
conjonctions, dans la théorie des actes de discours, n'ont pas le
même statut que dans la Sr •••• ir. de Port-Royal
conjoindre
n'est pas un acte que l'on peut mettre sur le même pied
qu'asserter, ordonner, promettre, etc.
(2)
Arnauld & Lancelot ne consacrent que cinq petites lignes aux
interjections;
elles sont ce qui,
dans le langage, est le moins
langage. Destutt de Tracy exclura les interjections des jljments
d. lA proposition, car elles expriment en fait une proposition
entière.
Si
les
interjections sont des
"opérateurs nonassertoriques qui s'appliquent "à vide"" (Dominicy),
c'est peutêtre bien parce qu'il y a
ellipse de la "matière de la
proposition",
ou parce qu'elle n'est pas encore pleinement
développée et analysée.
(3) Le Goffic (1978),
Nuchelmans (1983) et Dominicy (1984),
ont
tous remarqué les problèmes causés par l'absence d'explications
données par Port-Royal sur la nature de l'acte de juger dans les
propositions composées. Souvent, il semble que la force assertive
soit exprimée par les "conjonctions" elles-mêmes, plutôt que
par le verbe des propositions conjointes;
"L'assentiment porte
donc sur la matière du jugement dans son ensemble,
et ne saurait
être exprimé par l'un ou l'autre verbe" (Dominicy, 1984, p. 166).
(4)
Cf.
P.
Le Goffic,
"L'assertion dans la gr •••• ir. et la
logiqu. de Port-Royal", dans Str.t'gi.s discursiv.s, Lyon, P.U.
de Lyon, 1978, pp. 235-244;
sur "affirmation" et "jugement",
pp. 235-236.
287
(5)
Dominicy,
1984, p.
164
"Port-Royal osc i Il e entre deux
tentations
celle d'amalgamer l'inclusion et l'assentiment sous
le couvert du mot "affirmation"; celle,
toute contraire, de
restreindre le concept d'affirmation à la seule inclusion".
Dans
l'indicatif,
le verbe exprimerait l'inclusion + l'affirmation,
et dans les autres modes,
l'inclusion + un mouvement de l'âme
différent de la simple affirmation.
(6) G.
Nuchelmans (1983; p. 100 et suiv.) attire l'attention sur
la distinction médiévale actas exercitas/actas significatas à
propos des exemples de Port-Royal
(affir.o,
Petras affir.at);
cette distinction est également reprise par le grand logicien
belge Geulinx. Cf. aussi, du même auteur, "The Distinction Actas
exercitaslActas significatas in Medieval Semantics", dans Heaning
and Inference in Hedieval Philosophy,
éd. par Norman Kretzmann,
K1uwer AcademicPublishers,
1988, pp. 57-90; en particulier, p.
59, où l'auteur attire l'attention sur le fait que les interjections présentent une nette similarité avec les modes verbaux
dans la mesure où elles signifient "some affective state ou emotion in the non-cognitive part of the soul".
Un locuteur sincère
qui dit "Aïe!" montre qu'il ressent une certaine douleur et ne
fait pas que la "signifier";
il ne désigne pas, ne nomme pas sa
doul eur:
il l'" exprime" . De même,
un 1 ocut eur s incè re qui dit
"Fais-le!" montre qu'il désire que la chose soit accomplie;
il
accomplit un commandement et ne le signifie pas comme s'il avait
dit
"J'ordonne que tu le fasse".
La théorie des modes verbaux
de H. Reichenbach
(cf. notre "Conclusion générale") rappelle par
moment ces distinctions.
(7)
Si l'affirmation est ce qui caractérise le verbe et si
l'affirmation est autant dans la pensée que dans les mots, y
aurait-il un verbe mental correspondant au verbe oral ou écrit?
Les auteurs classiques n'ont pas développé une théorie du
"discours mental" comme les médiévaux à partir de Boèce. Il arrive qu'on parle des idées comme si elles étaient à leur tour des
signes des choses dans le monde;
ainsi, Turgot: "Les idées sont
un langage et de véritables signes par lesquels nous connoissons
l'existence des objets extérieurs"
(Deaxit.e discoars :
Sar
l'histoire des progrts de l'esprit ha.ain,dans ~aria lingaistica,
éd. par C. Porset, p. 129). De même Locke s'exprime quelquefois
comme si les idées étaient des signes d'un langage; dans le chap.
III (Essay, Livre III, p.
21),
il explique que le g4n4ral
et
l'aniversel n'appartiennent pas aux choses réelles,
"but are the
inventions and creatures of the understanding, made by its own
use, and concern only signs, whether words or ideas". Ce qui intéresse les grammairiens de Port-Royal, c'est d'abord l'expression de la pensée dans le discours,
c'est "l'art de parler"; ils
n'envisagent pas la pensée elle-même comme un discours; mais apparemment, rien n'interdit d'aller dans ce sens, et certains commentateurs,
comme Nuchelmans, parlent quelquefois de "propositions mentales" à propos de Du Marsais
(qui parlait de la propo288
sition considérée logiquement comme étant celle de l'entendement). Mais dans l'art. "Déclinaison" de l'Enc'lclop~di., il écrit
pourtant: "si nous considérons notre pensée en elle-m~me,
sans
aucun rapport à l'élocution,
nous trouverons qu'elle est trèssimple;
je veux dire que l'exercice de notre faculté de penser
se fait
en nous par un simple regard de l'esprit, par un point
de vue, par un aspect indivisible
il n'y a alors dans la pensé e, ni suj et, ni attribut, ni nom, ni verbe, &c.".
(8)
Cf.
D.
Vanderveken, 1988,
où les actes illocutoires sont
présentés comme des unités de pensée conceptuelle.
(9) Voyez ce qu'Aristote écrit .concernant les "cas" : "De Philon,
•
Philon,
et autres expressions de ce genre,
ne sont pas des
noms, ce sont des cas d'un nom. La définition de ces cas est pour
tout le reste identique à celle du nom, mais la différence c'est
que,
couplés avec est, ~t.it ou s.r.,
ils ne sont ni vrais, ni
faux,
contrairement à ce qui se passe toujours pour le nom.
Par
exemple, de Philon est
ou d. Philon n'est p.s
sont des expressions qui n'ont rien de vrai,
ni de faux. "
(Aristote,
D.
l' interpr,t.tion ,
trad. Tricot, Paris, Vrin, 1966, p. 80. Quand
je dis qu'un nom ne perd pas sa qualité de nom dans les cas
obliques, je veux dire qu'un nom se décline comme un nom,
un adjectif comme un adjectif,
etc.,
et non bien sÜr qu'il peut continuer à tenir le m~me rôle qu'un "nom" au sens fort,
au nominatif.
(10) F. Récanati, dans "Déclaratif/non déclaratif", L.ng.g.s, no.
67 (sept.
1982),
essaie de "montrer qu'il n'est pas évident que
ce qu'on appelle la "modalité déclarative" soit,
comme les
modalités impérative et interrogative,
un indicateur de force
illocutionnaire
il n'est pas évident qu'il soit légitime de
parler d'une 'modalité' déclarative plutôt que d'une "absence de
modalité" qui serait caractéristique des phrases déclaratives par
opposition aux
phrases interrogatives et
impératives."
(P.
24).
Plus loin
"Dans la conception que je défends,
la
modalité déclarative s'oppose aux modalités non déclaratives en
ce qu'elle est (illocutionnairement) 'non marquée'."
(P.
30).
Récanati fait jouer à la "modalité déclarative" le m~me rôle que
l'indicatif dans la 9.8.R •.
Dans un autre ordre d'idées,
Madame
Claude
Imbert
("Port-Royal et
la géométrie des
modalités
subjectives",
dans Le te.ps de 1. r'flltxion,
III, 1982, p. 312)
laisse entendre que "l'intention propre du chapitre janséniste
(sur les modes verbaux)
vise l'inadmissibilité des modalités
subjectives"; par "modalités subjectives",
il faut entendre ici
les modes de la volonté (s'opposant aux modes de l'affirmation),
c'est-à-dire l'optatif,
le concessif et
l'impératif.
Les
arguments de Madame Imbert sur ce départ des modes d'affirmation
et des modes de la volonté sont davantage d'ordre moral que
d'ordre grammatical et tentent de mettre en parallèle la doctrine
logico-grammatica1e des Messieurs avec les discussions morales du
289
Grand siècle.
Toutefois,
ces arguments
"externes",
pour
intéressants qu'ils soient,
ne me semblent pas jeter une grande
lumière sur les questions proprement grammaticales, et je préfère
ne pas les discuter ici.
(11)
Pour un point de vue contemporain sur ce sujet,
Zuber,
Hon-D.cl.rative Sentences, Amsterdam,
John
Publishing Company, 1983.
voyez R.
Benjamins
(12) Condillac,
dans sa 6ra •• aire (p.
472), illustre assez bien
ce point de vue
"Mais si au lieu de dire tu fais, vous faites,
je dis fais,
f.ites, l'affirmation disparaît, et la co-existence
de l'attribut avec le sujet, n'est plus énoncée que comme pouvant
ou devant
être une suite de mon commandement."
Notez l.Cl. la
pré s enc e des modal i t.s "pouvoir" et "devoir".
(13)
Robin Lakoff,
"La Grammaire générale et raisonnée,
ou la
grammaire de Port-Royal", dans History of Linguistic Thought and
Cont •• por.ry Linguistics, éd. par H. Parret, de Gruyer, 1976, pp.
361-362, montre que Lancelot,
dans ses H~thod.s,
a
souvent
recours
à
l'ellipse pour expliquer les modes autres
que
l'indicatif;
mais elle l'admet elle-même : "there is no evidenc'e
of this in the 6.6.R.".
(14) R.
Donzé, L. gr •••• ir. g4n4r.l. et r.isonn4. de Port-Roy.l,
Berne, Francke, 1967, p. 118.
(15)
Le meilleur parti à prendre est peut-être celui suggéré
par M.
Dominicy,
dont l'interprétation reprend l'analyse de
l'édition de 1683
le
"que" aurait une fonction métalinguistique en plus de rattacher la proposition incidente à un
"antécédent";
ainsi l'énoncé
"Je suppose que vous serez sage"
est d'abord paraphrasé et rendu par "Je fais une
supposition
qui est que vous serez sage";
par suite,
cette paraphrase se
laisse ramener à
"Je fais une supposition qui est
"Vous
serez sage"".
Le "qui" rattacherait la proposition " Vous serez
sage" à son antécédent,
le terme "supposition",
ce dernier signifiant la même chose, dans cette phrase, que "Vous serez sage".
L'exemple analysé par Dominicy s'apparente fortement à des exemples de "propositions complexes selon la forme",
comme "Je soutiens que",
etc., et comme le serait, dans notre interprétation,
des phrases comme "J'ordonne que",
"Je souhaite que",
etc.
(Je
donne un ordre qui est
"
"
Je formule un souhait qui est
"
"
etc.), les propositions "incidentes" (en fait la matière
de la propos i t ion "modi fié e") étant cette foi s placé es
entre
les guillemets.
Ainsi,
"Marchel" serait paraphrasé en "J'ordonne que tu marches",
qui à son tour le serait en "Je suis donnant un ordre qui est
"Toi, marcher"",
ou quelque chose du
genre.
Le "mouvement de l'cime" indiqué par le mode est d'abord
290
signifié par un verbe
("ordonner"), puis par un
substantif
obtenu par décomposition lexicale du verbe
("un ordre")
et
auquel le
"qui" rattache la
proposition qu'il
introduit.
J'ignore
pourquoi
les Messieurs évitent les
explications
traditionnelles
de ces énoncés par un recours aux
ellipses.
De toute
man1ere,
les Messieurs n'ont pas développé cette
analyse pour les modes autres que l'indicatif. Mais leur analyse
de 1683 . rappelle étrangement l' analyse dite "parataxique"
de
Davidson ("On Saying That", Synthese 19 (1968-1969), pp. 130-146;
et
"Moods and Performances",
in Ife~ning and Use,
éd. par A.
Margalit, Dordrecht, Reidel, 1976, pp. 9-29); il analyse ainsi la
phrase "Jean affirme qu'il pleut"
"Jean fait une assertion
dont le contenu est donné par l'énoncé suivant.
Il pleut".
Le
"que "
(that) joue le rôle d'un pronom démonstratif ("ceci") qui
réfère à l'énoncé qui suit le point;
l'échec de la substitution
des identiques s'explique par le fait que la référence du "ceci"
n'est pas la m@me après la substitution.
Les énoncés non
déclaratifs s'analysent donc toujours en deux énoncés
le
premier est toujours à
l'indicatif présent,
et le second,
également à l'indicatif
(le plus souvent),
est la référence du
"ceci".
L'interprétation de Dominicy rapproche l'analyse de 1683
que font
les Messieurs du qu.. de l'approche "citationnelle"
proposée un certain temps par Quine
dans Hord .nd Object,
Cambridge (Mass.), The M.I.T. Press, 1960; en particulier pp. 211
et suiv.; voir aussi Montague et Ka1ish,
"That", dans Montague,
For.al Philosophy,
New Haven,
Yale University Press,
1974;
en
particulier p.
86, pour un bref exposé des deux principales
approches proposées en philosophie contemporaine.
(16) Descartes, 1f4dit.tions .It~physiqu.es, 1f4ditation s.conde :
"Mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce
qu'une chose qui pense? C'est-à-dire une chose qui doute,
qui
conçoit, qui affirme,
qui nie,
qui veut,
qui ne veut pas, qui
imagine aussi,
et qui sent." Ce sont bien là (sauf peut-~tre la
conception)
ce que Port-Royal appelle des "manières de nos
pensées".
Zeno Vendler,
dans R.s Cogitans
(Ithaca,
N.Y.
et
London: Cornell University Press, 1972) fait aussi un lien entre
la théorie des actes de discours et ce passage de Descartes.
Dans L.s passions d. l' ••• ,
Descartes fait
entrer toutes nos
pensées dans deux classes principales
"les unes sont
les
actions de l'âme,
les autres sont ses passions"
(I,
art,
17);
toutes nos volontés relèvent de la première, et nos connaissances
et perceptions,
de la seconde.
On retrouvera la m~me division
chez Harris
(H.r.ts),
qui
lui s'inspire davantage de
la
philosophie
grecque
classique
et
de
la
tradition
aristotélicienne.
* * *
291
CHAPITRE DEUXIEME
Avec
neutre
Du Marsais,
DU MARSAIS
le verbe reçoit une définition
eu égard aux modes.
qui
Le grammairien attitré de la
est
grande
Encyclop4di. ne dit pas que le verbe sert à marquer l'affirmation
(ce
qu'il
ne fait proprement
qu'à
l'indicatif),
mais
et l'existence (réelle ou
l'.nonciation (ou l'action de l'esprit)
imaginée) du sujet sous telle ou telle qualification.
du
verbe
de
d'Aristote
Du
que
bipartite
de
Marsais est
celle de Port-Royal
est
de plus
dit
ou
chose
réelle
•
Il adopte
ou
<:2 )
Ilmodifiée"
une
partie
Le
signifie
imaginée d'un certain
attribut
auquel est
comme
soit
dans
lié e
cette
Cette conception, contrairement
accorde
Port-Royal,
l'existence,
substant i f) ,
analyse
verbe
au
verbe
ca té goréma t ique ll (Nuchelmans, 1983, p. 95)
toujours
l'analyse
une
constitue
d'autre.
imaginée du sujet de la proposition,
celle de
de
"Le verbe est donc le signe de l'existence réelle
existence et tout le reste"
à
(1)
proche
La théorie
car c ' est lui qui indique que quelque
de quelque
l'existence
dans un suj et
plus
la proposition où le verbe
essentielle de l'attribut,
chose
bien
plutôt
le
l'existence
IISocrate
est l l
une
"signification
verbe
comme
,
telle
soit
d'une certaine manière (verbe adjectif),
IISocrate marche [est marchant] Il.
292
signifie
(verbe
l'existence
comme
dans
Dans l'article
"Construction",
Du Marsais analyse l'idylle
"Les moutons" de Madame Deshoulières;
et voici ce qu'il écrit
à
propos du verbe de la phrase "Que vous êtes heureux!"
Et,s heur,ux, c'est l'attribut; c'est ce qu'
on juge de vous.
le verbe ... outre la valeur ou signification
particuliere de marquer l'existence,
fait
connoître l'action de l'esprit qui attribue
cette existence heureuse ~ vous; & c'est par
cette propriété que ce mot est verbe
on
affirme que vous existez heureux.
le verbe,
outre la valeur ou signification
particuliere du qualificatif qu'il renferme,
marque encore l'action de l'esprit qui attribue ou applique cette valeur à un sujet.
Etes : la terminaison de ce verbe marque encore le nombre, la personne & le temps présent.
Dans
une
phrase comme "Dieu est tout-puissant",
seulement
"tout-puissant" qui est jugé de Dieu,
ce
n'est
pas
mais qu'Il
est
tout-puissant; c'est l'existence avec la toute-puissance. C'était
revenir
à
l'idée des philosophes
et
grammairiens
grecs,
avaient
fait du verbe "être" le v.rb.
d~exi!lit.nce.
Du
qui
Marsais
substituera cette conception à celle de Port-Royal (Sahlin, 1928,
p.
307) et il la développera surtout dans sa Lettr. d1une
jeune
langue
de.oisell,
Dans
cette lettre adressée à
l'Abbé
Girard,
Marsais écrit "qu'à la vérité la définition que Port-Royal
293
Du
donne
du verbe,
a besoin d'explication;
mais,
qu'étant une fois bien
entendue, et énoncée selon ce que l'auteur a voulu dire, elle est
très juste."
mais
si tôt
Tome troi s ième,
après il ajoute que
séparé de l'attribut;
" [l]
dans
les
(p.
331)
cas obliques"
(l'existence) ,
doit
pas
il en est la partie essentielle,
pas une simple liaison ou copule,
le prétendent."
e verbe ne
330)
p.
j
être
et n'est
comme la plupart des logiciens
Du Marsais compare le verbe aux "noms
en plus de
le verbe indique
sa
encore,
signification
propre
par sa terminaison, un
certain rapport avec le sujet, une certaine "vue de l'esprit, qui
regarde
expressément
un
sujet comme étant de
telle
ou
telle
manière" (pp. 330-331)
Du Marsais maintient l'idée d'Arnauld et Lancelot qu'il y
des mots qui servent à marquer les objets de nos pensées,
que
d'autres,
comme
les
les
articles,
a
tandis
prépositions,
les
conjonctions et les verbes avec leurs différentes inflexions,
ne
"vues
de
sont
en
usage
l'esprit",
que pour faire connattre
expression qui, dans le cas du verbe, paratt synonyme
d"'action de l'esprit" (Sahlin,
1928,
d'abord et avant tout le signe d'une
particulière de l'esprit";
moins,
qu'il
différentes
marque
le verbe,
p.
308).
"action" ou
des autres mots,
294
est
"considération
dans les modes "finis" du
toujours une action de l'esprit.
se distingue
Le verbe
comme
C'est par
il l'affirme
là
dans
l'article "Conjugaison" de l'Enc'lclop.difl
le verbe marque encore l'action de l'esprit qui
applique cette valeur [= la valeur particulière
de chaque verbe] à un sujet, soit dans les propositions,
soit dans les simples énonciations;
& c'est ce qui distingue le verbe des autres
mots, qui ne sont que des dénominations.
Lorsque
cette
action
de
l'esprit
est
une
affirmation ,
locuteur énonce une proposition; dans tous les autres cas,
le
c ' est
une énonci.tion qu'il produit.
Du Marsais présente peu d'idées nouvelles
modes verbaux;
mesure où
p.
Il
concernant
mais son approche est justement nouvelle dans
les
la
i l prend pour point de départ la propos i t i on Il CSahl in ,
367), c'est-à-dire non la proposition considérée logiquement,
mais bien la
Ilproposi ti on cons idé ré e grammat ical ement Il
quand on considère une proposition grammaticalement,
on n'a égard qu'aux rapports réciproques qui sont entre les mots; au lieu que dans
la proposition logique,
on n'a égard qu'au
sens total qui résulte de l'assemblage des
mots
en sorte que l'on pourroit dire que
la proposition considérée grammaticalement est
la proposition de l'élocution;
au lieu que la
proposition considérée logiquement est celle
de l'entendement, qui n'a égard qu'aux différentes parties,
je veux dire,
aux différents
points de vue de la pensée;
il en considère
une partie " comme sujet,l'autre comme attribut,
sans égard aux mots...
CArt. IIConstruction ll).
295
Tout
discours
laisse
se
ramener
propositions, d'énonciations
rapporter
à
un
but
à
assemblage
de
& de périodes, qui toutes doivent se
principal"
(art.
Toute
proposition ou énonciation comprend "deux parties essentielles "
le sujet, et l'attribut;
le
verbe"
et
l'attribut
"commence
toujours
"contient essentiellement
par
le
verbe " .
La "proposition considérée grammaticalement",
la proposition
énonciations
assemblage
qu'ils
au sens
que
les
de mots,
ont
large
qui
comprend
propositions au
sens
qui par le concours de
entr ' eux,
énoncent
un
c'est-à-dire
aussi
bien
strict,
différens
jugement
ou
"est
les
un
rapports
quelque
considération particuliere de l'esprit qui regarde un objet comme
tel."
(Ibid.) .
Cette
considération particulière de
l'esprit
peut se faire en plusieurs manieres différentes,
& ce sont ces différentes manieres
qui ont donné lieu aux modes des verbes.
Les mots,
dont l'assemblage forme un sens,
gant donc ou le signe d'un jugement, ou
l'expression d'un simple regard de l'esprit
qui considère un objet avec telle ou telle
modification; ce qu'il faut bien distinguer.
(Ibid.) .
Nous
retrouvons
ici le même clivage qu'à
Port-Royal
entre
le
discours déclaratif et non déclaratif. "Juger, c'est penser qu'un
296
objet est de telle ou telle façon;
c'est affirmer ou nier; c'est
décider relativement à l'état où l'on suppose que les objets sont
en
eux-mêmes.
Il
Et c'est bien sÛr l'indicatif qui est destiné
marquer nos jugements,
ré el
de
l'objet
à marquer que nous reconnaissons
dont on parle",
qu'il est
"tel que
disons, indépendamment de notre maniere de penser"
propositions
jugement";
à
"l'état
nous
le
"Tout es 1 es
exprimées par le mode indicatif énoncent autant
de
elles énoncent directement quelque chose à propos
de
l'état actuel d'un objet.
Il en va autrement des énonciations.
Mais quand je dis Soyez sage,
ce n'est que dans
mon esprit que je rapporte à vous la perception
ou idée d~.tr. s.g.; sans rien énoncer, au moins
directement,
de votre état actuel,
je ne fais
que dire ce que je souhaite que vous soyez:
l'action de mon esprit n'a que cela pour objet,
& non d'énoncer que vous êtes sage ni que vous
ne l'êtes point. (Ibid.)
Dans les modes autres que l'indicatif,
il y a toujours le signe de l'action de l'esprit
qui applique,
qui adapte une perception ou une
qualification à un objet, mais qui l'adapte,
ou
avec la forme de commandement,
ou avec celle de
condition, de souhait, de dépendance, &c.,
mais
il n'y a point là de décision qui affirme ou qui
nie relativement à l'état positif de l'objet.
Tous les modes du verbe, autres que l'indicatif,
297
nous donnent ces sortes d'énonciations,
l'infinitif, sur-tout en latin ...
(Ibid.)
La
"proposition considérée grammaticalement"
Proposition directe 'nonc'e
p~r
se
le .ode
même
divise donc en
indic~tif;
Proposition oblique ou si.ple 'nonciation expri.'e
par quelqu'un des autres .odes du verbe.
Les
modes
divers
Franç oi s
sont
besoins
différentes
de
Thurot <3>
l'indicatif
f ormes
l'énonciation",
•
verbales "approprié es
comme
le
Il semble que dans les
et dans le cas de la fiction,
existence "imaginée" et non "réelle".
dira
modes
aux
plus
tard
autres
que
le verbe exprime
une
Les propositions
obliques
ne disent rien, du moins directement, sur ce qui se passe dans l e
monde.
tous
Dans
ses modes,
le verbe
marque
donc
toujours
l'action
de l'esprit et l'existence réelle ou imaginée du
sujet
de
proposition
telle
la
auquel
est
attribué
telle
ou
qualification.
La proposition considérée grammaticalement se divise donc en
proposition proprement dite, qui exprime un jugement catégorique,
et
en énonciation.
Les propositions et les énonciations ont
en
commun de contenir un sujet et un attribut (qui contient toujours
le
verbe),
et
"action
d'exprimer une
298
de
l'esprit " .
Selon
Nuchelmans (1983,
Marsais
(4)
s'expriment
Nous l'avons
,
le mode,
vu,
les
et la
jugements
tous par le mode indicatif et les
indépendamment de notre pensée
pour les propositions)
propositions
propositions
obliques
l'indicatif) ,
le
énonciations
(ou
plus
choses
locuteur,
aux
lien entre le sujet et l'attribut n'est
état
monde,
mots
que
comme actuel,
"adapte"
par
les
modes
l'l'action de l'esprit"
existant
indépendamment
de
ne vise plus
la
pensé e,
simplement une qualification à un sujet en
non
supposé s
autres
présenté
de
marquées
qui
d'ajustement
ou des
Dans les
direction
catégoriques
(direction
l'esprit au monde -- pour les jugements
choses
le
il Y a deux critères utilisés par Du
expriment renvoient à des états de choses qui sont
exister
de
91) ,
pour opérer cette division
d' aj ust ement
les
p,
pas tel qu'il est,
mal.s tel que
ou comme il voudrait qu'il soit,
être,
ou comme il devrait être,
etc,
La direction d'ajustement est alors,
cas, du monde vers l'esprit
un
mais
présentant
le
voit
le
ou comme il pourrait
ou enfin comme il serait si""
dans la plupart
des
(ou des choses aux mots),
Le système des modes de Du Marsais est établi dans l'article
"Conjugaison",
La définition et la liste qu'il donne des
n'ont rien de révolutionnaire
Par .odes on entend les différentes manieres
d'exprimer l'action, Il y a quatre principaux
l'impéramodes, l'indicatif, le subjonctif,
299
modes
tif,
& l'infinitif, auxquels en
langues on ajoüte l'optatif.
L'indicatif
modes
et l'infinitif,
certaines
qui étaient absents du tableau
dans la 6ra ••• ire de Port-Royal,
reprennent ici la
qu'ils avaient dans la grammaire gréco-latine.
(ou
" suppositif" comme l'appelle Girard [1747])
mentionné
<4)
subjonctif,
et
Du Marsais range les formes en
écrit-il,
énonce
conditionnel
n'est même
pas
avec
-rais
le
l'action
d'une
manière
"c'est le seul mode qui forme des propositions, c'est-
à-dire qui énonce des jugemens".
Royal,
place
comme Àrnauld et Lancelot.
"L'indicatif,
absolue";
Le
des
L'indicatif est, comme à Port-
le mode de l'énonciation directe, autonome, indépendante,
contrairement
aux autres modes qui ont quelque chose
d'oblique,
d'indirect, de dépendant.
La conception du subjonctif qu'offre Du Marsais
cependant, selon Sahlin (op. cit., pp. 372-373),
l'époque,
autre" .
avec
sa
notion de
représente
un progrès pour
"subordination d'une
idé e
Voici ce qu'il en dit dans l'art. "Conjugaison"
Le subjonctif exprime l'action d'une maniere
300
à une
dépendante, subordonnée, incertaine,
conditionnelle, en un mot d'une maniere qui n'est
pas absolue, & qui suppose toujours un indicatif : quand j'ai •• rois,
afin que j'ai.asse;
ce qui ne dit pas que j'ai •• , n1 que
j'ay. ai.'.
Du
Marsais
sémantique,
Modistes.
lui,
semble
celle
ici
du
accorder
doute
ou
de
car
une
l'incertitude,
valeur
comme
le
subjonctif
dépend
toujours
d'une
les
chez
"propos i t i on
et c'est même de là que lui vient son nom. Du Marsais
reprend
l'idée
de
Périzonius,
"Conjonctif"
appelaient
est
j'aimasse",
qu'il
cite
Anciennement,
quelquefois
souvent
"conjonctif" le
précédé
d'une
"quoiqu'il aimât",
les
mode
l'article
grammairiens
subjonctif
parce
("afin
que
Mais Du Marsais, comme
"l' indica tif est souvent
sans cesser pour cela
de conjonctions,
dans
conjonction
etc.) .
Péri zoni us, rej et te cette idé e, pui sque
précédé
subjonctif
Mais c"est l'idée de subordination qui l'emporte
absolue" ,
qu'il
au
d'être
appellé
indicatif"; "ce n'est nullement en vertu de la conjonction que le
verbe
est mis au subjonctif,
c'est uniquement parce
qu'il
est
subordonné à une affirmation directe, exprimée ou sous-entendue".
Lorsque
le
subjonctif
est utilisé,
c'est
toujours
op.
c it. ,
p.
proposition subordonnée (Sahlin,
"mode adjoint li dépendant.
371).
d'un sens énoncé par un
(art. "Conj onct if") .
301
dans
une
Il est un
indicatif"
Du
Marsais
n'admet pas de mode optatif
en
latin
et
en
français, car ces langues n'ont pas d ' inflexion particulière pour
ce mode et ce n'est pas seulement
la fonction qui fait le mode
l'ajoute
malgré
"la différence de service"
(Sahl in,
op.
cit.,
tout à la liste des modes et
le
p.
371) .
seul
ou
Il
exemple
qu'il donne d'une phrase optative est français.
L'optatif que quelques grammairiens ajoutent aux
modes que nous avons nommés, exprime l'action avec la forme de désir & de souhait : pl~t-à-Dieu
qu'il vienne.
Les Grecs ont des terminaisons
particulières pour l'optatif.
Les Latins n'en
ont point; mais quand ils veulent énoncer le
sens de l'optatif, ils empruntent les terminaisons du subjonctif,
auxquelles ils ajoutent la
particule de désir utin •• , plüt-à-Dieu que. Dans
les langues où l'optatif n'a point de terminaisons qui lui soient propres, il est inutile d'en
faire un mode séparé du subj onct if.
(Àrt. "Conjugaison") .
Dans
l'art.
"Déclinaison" (Encyclop4ditl) Du Marsais reprend
point
de vue de Port-Royal concernant l'optatif
point
admettre
"[c]e
n'est pas de la différence de service que l'on doit
le mode optatif en latin ni
la différence des modes dans les verbes".
cette
on
ne
françois",
subj onct i f
en
latin
et
car
tirer
concessif
des
ces derniers reconnaissant eux-mêmes
pour exprimer le "mouvement de l'âme" signifié par ce
utilise,
doit
C'est sans doute pour
raison qu'il ne mentionne m@me pas le mode
grammairiens de Port-Royal,
que
en
"on
le
en
français,
(pré cé dé de que en franç ai s) .
302
les
mode,
terminaisons
du
L'impératif
est
traité
fort
brièvement
dans
l'article
"Conjugaison"; Sahlin se contente de citer le passage suivant
L'impératif marque l'action avec la forme de
commandement; ou d'exhortation, ou de priere;
prens, viens, va donc.
Dans
l'analyse
l'article
grammaticale
"Construct i on" ,
de
l'idylle
"Les
moutons"
de
Du Marsais commente ainsi la phrase :
"Innocens animaux, n'en soyez point jaloux"
C' est ici une énonciation à l'impératif.
Soyez, est le verbe à l'impératif
c'est la négation.
ne point,
Jaloux, est l'adjectif: c'est ce qu'on dit que
les animaux ne doivent pas être. (Je souligne).
L'impératif
n'est
pas davantage examiné,
mais
l'analyse
ressortir la modalité impliquée par son usage (devoir)
Port-Royal,
comme
jamais
elliptiques
commençant
infinitif) ,
par
les phrases impératives ne
ou équivalentes à des phrases
"J'ordonne que ... "
"Je vous prie de ... ",
303
(ou "Je vous
ou
sont
à
fait
Comme
à
présentées
l'indicatif
ordonne
de "
"Je vous exhorte de ... " .
+
Le traitement
L'infinitif,
point,
beaucoup
plus
les modes autres que l'indicatif,
exprimer des énonciations,
à
auss~
comme
de l'infinitif est
surtout en
sert
latin.
Du Marsais semble se rapprocher de Port-Royal.
qu'il en dit dans l'art.
poussé.
lui
Sur
ce
Voyons ce
"Conjugaison"
L'infinitif énonce l'action dans un sens abstrait,
& n'en fait par lui-m~me aucune application singulière & adaptée à un sujet; .i.er, donner,
V,nir; ainsi il a besoin, comme les prépositions,
les adjectifs, &c. d'~tre joint à quelqu'autre mot
afin qu'il puisse faire un sens singulier et adapté.
Du
Marsais
semble faire ici de l'infinitif un cas
les
comme
grammairiens
grecs,
l'infinitif proprement dit
ma~s
distingue
marqué,
clairement
("boire", Iimanger"), qui est une forme
verbale, de l'infinitif substantivé
est toujours un nom (cf.
il
non
art.
("le boire", "le manger") qui
"Adjectif" in l'Encyclop'ditl,
et
Sahl in, op. ci t., pp. 375-376). Dans l'art ic l e "Construct ion", il
parle
aussi
de
"phrases énoncé es dans
l'infinitif,
exprimer
partiel
qui
un
sens
des énonciations,
avec un nom,
l'action
du verbe,
exemple,
dans
le
par
L'infinitif sert lui aussi à
mais il le fait en formant "un
& ce sens est exprimé par une
est ou le sujet d'une proposition logique,
constitue
abstrait
"Etre
ce qui est très-ordinaire en
fertile
est
nuisible",
sujet de la proposition;
304
énonciation
ou le
terme
latin."
"être
le second cas
sens
de
Par
fertile"
est
plus
intéressant
faisaient
rappelle
l'analyse
qu'Arnauld
de "Scio malum esse fugiendum";
clementem" ,
constitue
"vouloir".
des
"me
esse
clementem"
dans
("moi
'·'Je veux être sage",
et
dans
quelquefois
esse
indulgent ")
désire"),
comme
qui "détermine" le verbe
Cette "détermination" d'un verbe se fait
infinitifs,
Lancelot
"Cupio me
être
le terme de l'action de "cupio" ("je
"être sage"
par
et
par
des
quelquefois
phrases
complètes
(clauses propositionnelles)
Ces sortes d'énonciations qui déterminent un
un verbe, & qui en font une application, comme
quand on dit j . veux .tre s.9' (.tr. s.ge détermine je v,ux)
ces sortes d'énonciations,
dis-je,
ou de déterminations ne se font pas
seulement par des
infinitifs,
elles se font
aussi quelquefois par des propositions même,
comme quand on dit, je ne sai qui a fait cela;
& en latin nescio quis f.cit, nescio uter, &c.
L'infinitif ne fait pas à lui seul un sens déterminé et
il doit être mis en rapport avec un verbe à un mode
"fini",
pp.
introduire
"infinitif"
377) ,
Du
Marsais
personnel ou
D'après Sahlin (op.
comme le disait Du Marsais.
370,
complet;
aurait
grandement
contribué
cette répartition des modes en modes "finis" et
(Beauzée dira plus tard,
modes "persônnels"
et "impersonnels")
comme on le
fait
"application"
particulière
personne déterminée,
de
à
mode
encore,
dans la Grammaire Générale
et dans la grammaire française. Dans tous les modes finis,
une
cit.,
l'action
un nombre et un temps (cf.
du
verbe
art.
il y a
à
une
"Fini" de
l'Encyclop4die). Même si le verbe à l'infinitif n'exprime pas une
"action de l'esprit",
Du Marsais peut néanmoins en faire un mode
305
parce
qu'il
donne
une définition
du
mode
("les
différentes
manières d'exprimer l'action") qui est suffisamment générale pour
inclure
l'infinitif,
certaine "manière",
car
lui
aussi
exprime
l'action
d'une
précisément d'une manière abstraite. Mais si
l'infinitif est bien une forme verbale,
il devrait,
comme
tous
les verbes, être le signe d'un acte de l'esprit et de l'existence
réelle
ou imaginée du sujet sous telle ou
telle
qualification;
comment
est-ce possible s'il n'est pas adapté ou appliqué
sujet?
Du Marsais, dans l'article "Construction", dit que cette
lIa pp l i c a t ion"
se fait
à
un
"surtout à quelque mode fini"
Il Y a dans une période autant de propositions
qu'il y a de verbes,
sur-tout à quelque mode
fini;
car tout verbe employé dans une période
marque ou un jugement ou un regard de l'esprit
qui applique un qualificatif à un sujet.
Et plus loin il ajoute
J'ai dit sur-tout i qu.lque .od.
fini;
l'infinitif est souvent pris pour un nom,
v.ux lir. : & alors même qu'il est verbe,
forme un sens partiel avec un nom,
& ce sens
est exprimé par une énonciation qui est ou le
sujet d'une proposition logique,
ou le terme
de l'action d'un verbe, ce qui est très ordinaire en latin. (Je souligne).
Dans ce passage assez confus,
(dans "Je veux lire")
est
Du Marsais semble dire que
"pris pour un nom"
"lire"
sans cesser d'être
verbe; serait-ce parce qu'il nomme l'action qui est le complément
d'objet
de
"Je veux"
tout en
ou d'une énonciation entière?
tenant
lieu
d'une
proposition
L'infinitif forme un "sens partiel
306
avec un nom",
dit-il d'abord,
formé
total,
équivalent
cu.pio).
par
un
un nom"
à
nom
pour parler plus loin, d'un "sens
avec
un
infinitif,
( •• esse c le.ent •• ,
Sens "partiel" ou sens "total"?
sens
comme
complément
de
Et où trouve-t-on le nom
avec lequel l'infinitif doit former un sens "partiel" ou
"total"
"Je veux lire", si "lire" figure là comme verbe? Du Marsais
dans
semble
éprouver
l.Cl.
un problème
analogue
définissant le verbe par l'affirmation,
les
est
qui
modes
de
problématique;
l'affirmation
et
de même Du Marsais,
de
Port-Royal
en
le statut du verbe
dans
la
à
volonté
devenait
en faisant du verbe le signe
de l'action de l'esprit et de l'existence, accorde un statut égal
au
verbe
dans tous les modes finis,
mais dans
son
cas
c'est
l'infinitif qui résiste et fait problème, car. il ne marque aucune
"action de l'esprit".
Les
propositions
interrogatives
et
Dans
(interjections) ne sont traitées qu'en passant.
"Construct i on" ,
exclamations
les
l'article
il dit simplement
Notre syntaxe marque l'interrogation en mettant
les pronoms personnels après le verbe, même
lorsque le nom est exprimé.
Du
Marsais
ne
nous dit pas quelle
"action
exprimée par les phrases interrogatives.
présentées comme des "adjoints"
de
est
Les interjections sont
de la proposition,
307
l'esprit"
c'est-à-dire
des mots qui n'entrent ni dans le sujet, ni dans l'attribut de la
proposition.
Elles
des émotions.
. Ce sont quelquefois des adverbes qui marquent ces
sentiments
ou
heureux!"
marquent le plus souvent des sentiments
émotions,
comme
le "que" dans
"que est pris adverbialement,
"Que
vous
& vient
du
ou
êtes
latin
quantu., ad quantu., à quel point, combien: ainsi que modifie le
verbe;
il marque une maniere d'être,
& vaut autant que l'adverbe
CArt. "Construction").
Comme à Port-Royal,
les phrases non déclaratives
jamais décrites comme elliptiques.
les
(autres
que
le
jugement
de
catégorique)
et
diverses
caractérisent
ne sont jamais présentées comme servant à
discours.
les
l'esprit
marques
sont
directement
actions
le
diverses
Elles expriment
ne
syntaxiques
qui
les
abréger
Les propositions de la forme "Je dis que P"
sont
interprétées comme à Port-Royal
Ce mot qu. est encore souvent le représentatif
de la porposition
(sic)
déterminative qui va
suivre un verbe:
je dis qu.; qu. est d'abord
le terme de l'action j . dis,
dico quod;
la
proposition qui le suit est
l'explication de
qu.; je dis que les gens de bien sont esti.~s.
Nuchelmans
interpréter
une
est
(1983,
pp.
92-93) montre que Du Marsais
le "que" à la manière d'Arnauld et
contraction de
"une chose qui est"
les gens de bien sont estimés").
308
aurait
Lancelot,
("Je dis une
pu
comme
chose qui
Il arrive aussi que
le
"que l l
soit le terme de l'action du verbe qui
"Le livre que je lis".
Royal
sur
les
déterminatives,
"J'affirme"
6r~ •• aire
incidentes
dans
et on ne trouve pas
de Fort-Royal,
ou
d'expressions
l'analyse
m~me
sur l'interprétation
analogues,
interprétation de la théorie des modes de Du Marsais,
et
de
de remarque,
tentative de réduction du non-déclaratif au déclaratif.
ni
de
aucune
Dans son
S. Àuroux
présente sa doctrine en opérant cette réduction :
(1) "vous ~tes sage" et (2) "soyez sage" expriment toutes deux un rapport entre le même sujet
À et le même prédicat B;
par ailleurs (2)
est
construit à partir de
(1)
par adaptation dans
(2) du signe de
l'affirmation présent en
(1);
on peut donc écrire (1) comme "À est B" et
(2)
comme "À (est + ordre) B".
La forme propositionnelle générale devient "St. (est + mt,) Pt. I l ,
où mt. exprime une modalité ajoutée à la copule;
dans le cas où il s'agit d'une affirmation mt. =
O. Pour distinguer l'acte de l'esprit correspondant à la modalité et la proposition sur laquelle porte cet acte, on pourrait soutenir que
l'on dispose d'un certain nombre de propositions de base pz, pz .. . p",
et de fonctions
propositionnelles F., Fb ... Ft., susceptibles de
porter sur ces propositions primitives.
Àinsi
F. (P1), Fb (P1), Fe: (pd. .. pourraient signifier
respectivement "il est vrai que P1 11 ,
"Je crois
que P1 11 , "J'ordonne que P1 I l , etc. Mai s Du Marsais est soucieux de conserver la structure
propositionnelle "S est F"; s'il distingue parfaitement le dictum
(qui correspond à nos pn)
et le modum (qui correspond à nos Ft.) , il s'efforce de faire entrer les deux comme composants
d'une structure propositionnelle unique.
Dès
lors 'nonci~tion et juge.ent ne correspondent ~
~ucune diff'rence synt~xique.
(1979,
op. cit.,
pp. 92-93).
309
Fort-
explicatives
lui non plus ne fait jamais
"performatifs explicites",
comme dans la
comme
Du Marsais accepte la doctrine de
propositions
mais
suit,
et
=
que m~
L'idée
0 me para ft plus conforme à la théorie du
des modes de Port-Royal qu'à celle de
Du
Marsais
entrer, contrairement à ses illustres prédécesseurs,
verbe
qui
fait
l'indicatif
et l'infinitif dans la. listè des "principaux modes". A vrai dire,
m~
c'est dans le cas de l'infinitif que
=
O.
sert lui aussi à exprimer des énonciations,
Mais si l'infinitif
"F"
quelle sorte de
peut bien lui correspondre? M. Auroux, il est vrai, n'examine pas
vraiment
la
théorie des modes de Du
distinction,
critiquée
énonciation,
et
logique,
et
non
vu,
se
l'avons
il
le
par
Beauzée,
entre
grammatical.
reflète
Mais
cette
immédiatement
peut,
les
point
pas
la
la
même
(complexe ou non) ,
Si
on
(une
envisage,
il y
celle de l'attribut
(ou logiquement),
en
a
(complexe
et
bien sÜr,
la
rien
il en
va
et les phrases "vous @tes sage" et "soyez sage!" n'ont
même
Il
complexité ou "structure
f onc t i on I l
ou le
même
propositionnelle générale,
repré senté e
donnée
nous
y avoir "aucune différence syntaxique", puisque
Sémantiquement
autrement,
vue
l'indicatif pour les propositions, et
ou non) contenant un verbe et commençant par un verbe,
plus.
de
modes
énonciations comme dans les propositions,
marque du sujet
de
et
distinction,
les
la
"la proposition considérée grammaticalement", il ne
en effet,
dans
plutôt
proposition
dans
autres modes pour les énonciations.
grammairien,
mais
fait en se plaçant d'un
catégorie grammaticale)
les
Marsais,
par
l'analyse
"S
est
profonde",
"service".
Enfin,
chez Du Marsais,
P" (ou
bipartite
"S~
(est
bi en sG.r
la
forme
est peut-être
+
de la proposition
310
ni
m~)
p~
adoptée
")
mal
étant
par
le
grammairien philosophe;
Il
{S j.
([ est + mj.] pj.)} Il
,
nous aurions plutôt
IIS~ Il
où
quelque chose comme
représente le terme sujet,
"([est + md
pj.)", l'attribut, le verbe et ses "modalités"
isolés
les
par
on
par "11 est vrai que",
"modalités"
que",
Si
crochets.
etc. ,
et
qu'on
analyse le
signifie
"que"
données dans l'article "Construction",
que
vous
"ordonne
soyez sage"
[suis
l'attribut
complexe
complément
le
pronom)
composé
"que"
que
vous
d'un verbe
qui représente
que",
les
"J'ordonne
selon les indications
la proposition "J'ordonne
aurait le pronom
ordonnant]
+
étant
directement
"Je crois
et
la
"Je"
pour
soyez
suj et ,
sage"
transitif
complétive
et
serait
ayant
pour
(comme
et la joint au verbe de la proposition principale
un
(comme
une conjonction) .
On pourrait également remplacer "que" par "une
chose
comme à
qui
est "
Port-Royal.
Le
résultat
de
cette
réduction du non-déclaratif au déclaratif serait une "proposition
directe"
(comme
il
se doit) dont l'un des
termes
serait
une
énonciation ou "proposition oblique", formée par le subjonctif ou
"J'ordonne
l'infinitif ( " J'ordonne que vous soyez sage",
d'être
sage", etc.)
L'ennui
avec la théorie des modes
de
l'hétérogénéité de ce qui est appelé "mode".
Royal,
en
catégorie
Du
Marsais,
c'est
La théorie de Port-
excluant l'indicatif et les modes impersonnels de
"mode",
lui conférait plus d'unité;
les
modes
la
sont
alors tous des "modifications " de l'indicatif. En définissant les
311
modes comme "différentes manières d'exprimer l'action du
il
réintroduit
l'infinitif;
dans
la
catégorie
"mode"
verbe " ,
l'indicatif
et
le premier étant le seul mode "direct", l'infinitif
figurant parmi les modes "obliques",
même s'il n'exprime
"inclination" ou aucun "mouvement de l'âme",
* * *
312
aucune
NOTES
(1)
Gunvor Sahlin,
C~sar Chesneau Du Harsais et son
r~le
d.ns
l"volution d. 1. gr •••• ir. g'n'r.l.,
Paris,
P.U.F.,
1928, p.
310
"Par cette conception,
Du Marsais se distingue non
seulement des grammairiens de son temps,
mais aussi des logiciens ... et il représente la conception aristotélicienne dans un
état plus pur qu'aucun de ses contemporains.
Il a donc retenu
d'Aristote l'idée que le verbe exprime l'énonciation,
et de plus
l'idée que la signification de l'existence est inhérente à
tout
verbe.
Comme il à
(sic)
en outre retenu l'idée que toute
proposition n'équivaut pas à un jugement vrai ou faux,
il en
résulte que tout verbe n'est pas une énonciation de l'état réel
du sujet, et par conséquent n'exprime pas une affirmation. Par ce
retour à Aristote,
il s'est encore affranchi de la théorie de la
copule, qui ne peut que mener la grammaire à des absurdités."
(2) C.C. Du Marsais, Lettr. d'un. j.un. de.ois.ll. ~ l'auteur des
princip.s d. 1. l.ngu. fr.nç.is., in O.uvr.s d. Du Harsais,
Tome troisième, Paris, Imprimerie Pougin, 1797 (an V), p. 331.
~r.is
(3) F.
Thurot,
"Remarques" à sa trad.
du H.r.ts de J. Harris,
op. ci t., p.
154
"1 e verbe est susc ept ibl e de rec evoir des
formes
différentes,
.ppropri'.s
aux
div.rs
besoins
de
l'Inonciation:
ce sont ces formes auxquelles on a donné le nom
de .od.s.
Elles peuvent @tre plus ou moins multipliées, selon le
génie des langues et des peuples qui les parlentj mais comme une
grande multiplicité de formes diverses nuiroit à la clarté et à
la facilité de l'énonciation,
bien plus qu'elles n'y serviroit,
le nombre en sera nécessairement borné.
Il y aura seulement, à
cet égard,
quelque différence d'une langue à l'autre:
les unes
admettront un mode dont les autres ne connoîtront pas l'usagej
les unes croiront devoir exprimer par une forme particulière
telle vue de l'esprit,
que les autres ne jugeront pas nécessaire
de fixer par une distinction expresse."
(4) Cf.
Sahl in, op. ci t., pp. 368-369 : "Du Marsai s est arrié ré
par rapport à son époque en ce qu'il range simplement les formes
en -r.is,
etc.
dans le subjonctif, sans tenir compte du progrès
qu'avaient effectué Buffier et Girard dans la conception de la
nature de ces formes." Et p.
376:
"il n'est pour rien dans un
des progrès les plus remarquables que la grammaire générale ait
effectués à propos des théories
sur le modes,
savoir la
constitution du mode conditionnel en un mode particulier".
Ce
sont en effet les théories de Buffier (1709), Restaut (1730)
et
313
surtout Girard
(1747)
qui
ont fait avancer la théorie du
conditionnel, et de même, plus tard, Beauzée (1767) et Destutt de
Tracy (1803).
***
314
CHAPITRE TROISIEME
JAMES HARRIS
L'ouvrage de J. Harris, Her.es : or, a Philosophieal Inquiry
(1751),
Coneerning Language and Universal 6ra ••• r
est le premier
ouvrage important de Grammaire Générale à paraître en Angleterre.
L'influence qu'il a eue sur les grammairiens anglais se compare à
celle de la 6r •••• ire g4n4rale et raisonn4e du côté des Français,
du
moins si on en juge par la réception immédiate
très positive,
qu'on
et
de
par les nombreuses rééditions et
en a faites
Les essais de
(1)
Grammaire
l'oeuvre,
traductions
"Universelle"
(les Anglais préfèrent le plus souvent l'adjectif "universelle" à
, 'générale"
pour
qualifier
la
partie
théorique
des
études
grammaticales) qui ont précédé le Her.ts de Harris en Angleterre,
comme
l'Essay
TON.rds
a Re.l
Ch.raeter
(1668) de l'évêque Wilkins,
retentissement
que
les
a
.nd
Philosophieal
n'ont manifestement pas eu
philosophiques
idées
et
grammaticales de Harris. François Thurot, le premier historien de
la
Grammaire,
juge
l'oeuvre
lui
consacrer
importante
pour
recherches
philosophiques
grammaticale
une
de
Harris
assez
ou
traduction
qui
sur
paraîtra à Paris en 1796 (an IV)
les Allemands avaient déjà, de
leur côté, une traduction depuis 1788 CHer.es oder philosophisehe
Untersuehung
connue
théorie
de
über
die .llge.eine
Herder,
linguistique
figure
6ra ••• tik),
parmi les sources
de von Humboldt,
315
en
et
son
probables
particulier
oeuvre,
de
la
par
sa
distinction
Destutt
avis
et
l'energy
entre
de
le
tIIork
(chez
von
Humboldt,
Tracy était toutefois d'un
sur la portée et la valeur de l'oeuvre
de
Harris,
autre
allant
même jusqu'à approuver les très sévères critiques que Horne Tooke
lui adressait dans ses Diversions of Purley (1786)
Mais les
(2)
critiques visant l'oeuvre de Harris semblent avoir été,
large
part,
effet,
son
Aristote,
etc.
suscitées par sa vénération pour les
Her.ts est rempli de notes où il cite
Ammonius,
anglais
l"'aristocratisme
Anciens;
en
favorablement
Denys d'Halicarnasse, Apollonius, Priscien,
A la fin du XVIII- siècle,
d'intellectuels
pour une
c'est une attitude que beaucoup
"radicaux",
culturel"
du
qui
s'opposaient
country
savant
à
gentle.an,
percevaient comme "réactionnaire" ou "rétrograde" (cf. Bergheaud,
1985, pp. 150-151, et 1979, p. 20).
La théorie de Harris concernant le verbe s'apparente,
celle de Du Marsais, aux conceptions aristotéliciennes.
par dé fini t i on,
principaux
(significatifs "absolument") et en
(significatifs "par relation") .
se
soit des attributs de substance,
donc
mots
accessoires
Les premiers signifient soit des
divisent en substances et attributs.
diviseront
Tous les
significatifs et se divisent en mots
mots sont,
substances,
comme
en substantifs et
en
car tous les
~tres
Les mots principaux
attributifs.
Les
se
mots
accessoires "prennent leur signification de leur union avec un ou
plusieurs mots" (p. 30);
déterminer
le sens,
s'ils sont joints à un seul mot pour en
on les appelle alors djfinitifs,
316
et
s'ils
servent à l'union de plusieurs mots,
Tous
les
quatre
mots
se laissent ramener à l'une ou
catégories.
attributifs
on les appelle
Les
connectifs.
l'autre
verbes appartiennent à
la
de
ces
classe
des
(comme l'adjectif et le participe, l'adverbe étant un
attributif
de
"second
ordre"
(3) )
Les
•
verbes
sont
les
attributifs qui expriment l'existence; pour qu'un @tre quelconque
puisse être imaginé ou décrit
comme
noir
ou
blanc,
sage
ou
éloquent, agissant ou pensant, etc.,
il faut d'abord de toute nécessité qu'il exist.,
avant qu'il puisse être susceptible de modification;
car l'existence peut @tre considérée comme
un genre universelle,
auquel tous les @tres de
toutes les espèces peuvent @tre rapportés dans
tous les instants.
Par conséquent
les mots qui
expriment l'existence,
ont un droit naturel de
prééminence sur tous les autres,
comme étant de
l'essence m@me de toute proposition, dans laquelle on peut toujours les trouver exprimés ou sousentendus; exprimés, dans les propositions de cette forme, le sol.il EST brillant;
sous-entendus,
lorsque nous disons le soleil se Itve, ce qui signifie, en analysant les termes, le soleil EST se
l eVilnt. (P. 82)
Les
verbes
le
exprimer
"absolue",
genre universel."
soit
(p.
à
absolue.
ne
sert
lui
seul
82)
absolue
"modi fié e" ;
modifiée dans "Le soleil se lève"
"~tre"
"sont tous employés
etc. ,
"~tre",
(=
jamais
ne peut
L'existence
dans
"La
que
soit
vé ri té
est",
Le
verbe
"est se levant")
exprimer
est
pour
l'existence
Lorsqu'il exprime l'existence modifiée,
"le verbe .tre
d'une
modification
qu'à
part icul iè re" ,
exprimer
et
simple affirmation."
l'existence
dans ce cas
CP.
83) .
, , i 1 n' a guè r e s qu e l ' e f f et d'un e
Comme chez Du Marsais et (nous le
317
verrons)
Beauzé e,
définissent
le
Condillac,
verbe
et
en
général
d'abord et avant
l'existence (absolue ou modifiée);
tout
tous
ceux
comme
qui
signifiant
par là le verbe n'est
jamais
seulement une copule a fonction cohésive et assertive, car il est
toujours chargé d'une signification catégorématique,
L'affirmation est-elle un trait essentiel des verbes, comme
à
Port-Royal?
implicitement
Harris
que
dit
le
verbe
substantif
contenu dans tous les autres verbes,
(ibid.);
et plus loin, il précise que c'est la "forme" des verbes
qui
indique
qu'ils
partie
de
qu'il
cette
général
qui fait
parce
exprime
en
affirmation
"est
leur
"contiennent
essence"
implicitement
l'affirmation de la coëxistence de l'attribut avec le sujet"
86) ,
Reste à savoir si cette "affirmation" est propre au verbe à
l'indicatif,
ou
si
"affirmation" n'est qu'un
"prédication",
La
puisque
distingue différentes
Harris
"c ons idé ré es
seconde
interprétation
grammaticalement" ,
indique clairement que le terme
chez
Harris
("Remarques"
être
pris
du traducteur,
Subbiondo
(4)
ici
p,
paraît
espèces
de
is
the
appartiennent
des attributs)
essence
19)
qui écrit,
of
mot
préférable,
"proposition"
dans
toute
human
(Thurot)
(s~nt~nce)
étendue"
son
C'est aussi ce que
à propos de
la
communication",
donc à la classe des attributifs
pour
propositions
"The sentence was the result of an act of
Harris
which
"doit
autre
et que son traducteur
nous
penser
(p,
(i l s
semble
théorie
de
predication,
Les
verbes
signifient
ils signifient l'existence d'un attribut dans un
318
suj et,
et
ils
"consignifient"
l'affirmation du verbe,
le
temps
<~)
Si on
ret ire
on en fait un participe, et si on retire
du participe l'expression du temps, on en fait un adjectif.
Harris
distingue
ttre,
substantif
"deux
aussi
suivant
qu'il
significations
exprime
un
être
du
verbe
muable
ou
immuable" (p. 84), muable comme les objets des sens, et immuables
comme les objets de la science ou de l'intellect.
n'aurait
.tre
Le verbe
donc pas la même signification dans "cette
orange
est
mare" et dans ilIa diagonale du carré est incommensurable avec son
côté" (les exemples sont de Harris);
verbe
Le
.tre ne semble pas admettre de modifications
dans Her.ts
temps
principale d'un verbe,
ne peut jamais devenir
"11 parle",
marquer différents temps
("11 mange",
qui
temps
la
signification
et le
m~me
"Il mangeait",
p4riode
parlant I l
(p.
ou proposition,
12)
aristotélicienne
etc.), lice
chose
(p. 89).
Le point de départ de l'analyse du langage dans
ilIa
le
verbe,
si le temps étoit autre
sans doute n'arriveroit pas,
qu'une idé e purement acc es s oire"
etc.) ,
le
temporelles.
car différents verbes peuvent marquer
("11 mange",
même
dans le second exemple,
dont tout le monde fait
Her.~s
usage
est
en
La proposition est ainsi définie, à la manière
Il
un
certain no.bre de .ots
319
dont
l'ense.ble
sens"
en
CP. 16). Le mot est défini comme "une voix articulé qui,
vertu
d'une
convention établie,
signification quelconque" (p.
comme
idles,
"un syst •• e de sons
mais
A
337) .
la
318) ;
exprime
ou
de celles qui sont
générales"
voix
des
nos
(p.
animaux
lesquels sont "le produit immédiat de
organisation naturelle",
une
à son tour,
signes ou. sy.boles de
différence des sons émis par la
dépourvus de raison,
sens
et le langage,
a,.ticu.l~s~
principalement
un
les mots sont "le résultat de
leur
[la]
volonté et de certaines conventions" des êtres humains
(p.
308).
Si les mots étaient premièrement, immédiatement et principalement
signes
des
infinité de
idées
mots
particulières,
pour
dépasse de beaucoup nos
nous
aurions
besoin
d'une
exprimer toutes nos conceptions,
ce qui
capacités cognitives.
sera reprise peu après par Monboddo
Cette
(6)
La proposition est "la plus grande étendue
dont la grammaire s'occupe" Cp. 12).
de jeu
conception
Harris
(de
discours)
distingue d'entrée
Iidifférentes espèces de proposition l l
Quant aux différentes espèces de propositions,
quel est
l'homme assez ignorant pour ne pas
connottre, lorsqu'on lui parle dans sa langue
maternelle, si l'on commande,
si l'on prie ou
si l'on desire? (ibid.)
Les
di ffé rent es
espèces de propositions sont
(fondées sur le jugement ou la sensation),
320
les
affirmatives
les interrogatives et
les
aussi
impératives (fondées sur divers sentiments,
à l'expression de souhaits --- propositions
Pour
éviter
propositions,
de
multiplier
Harris
fonde
sa
à
sa pens"j
servent
"optatives").
les
classification
espèces
sur
"les
de
deux
(aussi bien celle des
et la volont •.
Un homme
qui
c'est-à-dire que son
discours
est
sens que celle de l'intelligence),
"expliqu..
l'infini
la perception
facultés actives de l'âme"
parle
et qui
l'exposé ou le développement des affections ou des mouvements
son ame.
moins
C'est en effet ce qui arrive à tout homme qui parle,
qu'il
ne soit faux ou dissimuléj
et encore dans
cherche-t-il à en imposer par une sincérité apparente"
Par
passions
mais
les
15) .
Puisque
"énergies"
ce
(p.
Harri sent end "non-s eul ement l' acti on dtr
volonté,
mouvements
de
et
parler
de
les div.rs
c'est
l'âme,
(energi es) ,
que
app,titsj
exposer les
Harris
un
affections
appelle
"il est évident,
en
cas
14) .
vou.l oi r ,
mot
et
tou.t
autres
quelquefois
soutient-il,
à
des
que tout
discours, ou toute proposition, en tant qu'elle représente ce qui
se passe dans l'ame,
doit par conséquent se rapporter à l'une ou
l'autre de ces facultés."
(Ibid.)
(7')
Les propositions affirmatives se rapportent à la perception,
321
car affirmer,
c'est "faire connoître une perception des sens
ou
de l'entendement" (ibid.).
Interroger,
commander,
prier,
car
être
compte
propositions
autant de différents actes de la faculté
celui qui interroge veut être informé,
veut
des
est-ce autre chose que
&c.
connoftre
"faire
obéi,
que
&c . "
celui
connaître
une
qui
(Ibid.).
de
vou.loir?
qui
commande
Harris ne semble pas se
affirme veut
perception ...
celui
aussi
Mais,
informer
chose
faire
rendre
ou
faire
certaine,
les
propositions, chez lui, n'expriment pas toujours des jugements ou
affirmations.
son
Le terme "proposition"
le
sens
plus
grammaticalement"
Harris
étendu,
comme
doit donc être entendu
la
"proposition
en
considérée
de Du Marsais.
commence l'exposition de sa
théorie
générale
des
modes verbaux (Chapitre VIII) par un rappel de ses considérations
sur les deux facultés actives de l'âme,
et conclut finalement
C'est donc des diverses espèces d'affections
qu'on a à exprimer, et des différentes manières de le faire, que résulte la variété des
.odtts ou .oeu.fs. (P. 133)
Plus
loin
espèces
de
(p.
136,
note (2»,
il affirme que
.odes se déterminent en grande
322
partie
"les
diverses
d'après
les
diverses espèces de propositions".
(Le reste de la note
à la classification péripatéticienne des espèces de
renvoie
propositions
et mentionne aussi les travaux des stoïciens en la matière) .
Harris traite des modes indicatif,
interrogatif,
impératif,
(L'impératif
demande"
fait,
et
déprécatif
qu'autant
sont
naturelles"
cite
volontiers
"[t]ous
les
chez
Apollonius)
premier,
les modes ont une
exprimer
les grammairiens
sera
(p.
en particulier,
139) .
la classification
déprécatif,
(à
la
et
celle
Cette thèse, déjà
(en
particulier
et
Gregory;
du nombre des
des modes est aussi sensible à
le
demande
323
un
à un supérieur),
vérité) que nous
modes.
d'autres
positions relatives des
lorsqu'on demande à
nature des propositions (catégorique,
d'engagement
l'âme
s'en servira pour exclure l'infinitif,
( i mpé rat if,
lorsqu'on
commune,
Monboddo
dimensions de l'interlocution, comme les
interlocuteurs
ces
d'Apollonius
gréco-latins
aussi reprise par
de
"di st inct ions
ces
propriété
qui n'exprime aucune "affection de l'ame",
Mais
"mode
"ne sont, dans le
définitions
d'exprimer les affections de l'ame"
présente
appelés
Les modes
137-138) ;
(pp.
infinitif.
renvoient bien sQr aux diverses affections de
Harris
Priscien;
aussi
de formes littérales destinées à
naturelles"
subjonctif,
(precati ve) et
dépré cati f
Cr.qu.isitiv.) par Harris) .
distinctions
et
le
potentiel,
ou
inférieur,
selon
hypothétique) et le
y
attachons
la
degré
Cindica tif,
lorsque
nous sommes certains,
"contingentes",
interrogatif,
potentiel pour
les
propositions
"pour nous informer lorsque
nous
doutons d'une chose" (p. 136))
Le
136) ,
et
mode indicatif est également
m@me ".ode de science" (p.
exprimer les vérités,
appelé
151) ,
en particulier les
"dé clara tif"
( p.
parce qu'il sert
à
"vérités nécessaires",
et les syllogismes.
Quand nous déclarons ou que nous indiquons
simplement qu'une chose est ou n'est pas,
que ce soit un acte de la perception ou de
la volonté, peu importe, cela détermine le
mode appelé indiciltif. (P. 134)
Nous
utilisons
absolument
l'indicatif
pour
affirmer
positivement
"ce que nous regardons comme certain" (p. 136). Il se
distingue aussi des autres modes par le fait qu'il " ...
le temps tout entier,
(p.
et
renferme
et l'expression de ses moindres divisions"
145).
Les modes "potentiel" et "subjonctif" sont en étroit rapport
les
catégoriques,
seulement
deux
servent à faire
des
affirmations
non
où un état de choses est présenté comme incertain,
possible,
indétermination.
La
contingent
ou
affecté
d'une
certaine
principale différence entre ces deux
324
modes
tient
au fait que le mode potentiel est
toute la phrase"
l' abs 01 u
(p. 134),
pouvoir ... "
subordonné
à
"le
comme dans
tandis
l'indicatif",
que
et
la
fin ou la cause finale"
voleurs
se
lèvent la nuit,
dominant
de
"Quand il seroit vrai que
le
"sert le
marquer
mode
subjonctif
plus
(ibid.) ,
afin qu'ils
"n'est
souvent
comme
puiss~nt
que
[à]
dans
"Les
égorger
les
voyageurs"
cette fin,
dans les événements de la vie humaine
est toujours un contingent; il est très-possible,
malgré toute notre prévoyance,
qu'elle ne soit
pas conforme à ce que nous imaginons, voilà pourquoi cette incertitude est exprimée avec plus de
force, par le mode dont nous parlons ici.
(pp. 134-135).
Harris s'exprime comme si le potentiel et le subjonctif n'étaient
au fond que deux variantes du m@me mode :
fois
qu'il est ainsi subordonné,
"Ce mode,
n'est plus
toutes
appelé
les
potentiel,
mais subjonctif" (p. 135). Un peu plus loin, sans même mentionner
le
subjonctif,
il dit que nous avons établi un
"pour les propositions contingentes",
Ces modes expriment
sorte d'affirmation foible et conditionnelle"
pour
cette
raison,
potentiel
le subjonctif apparaissant
alors comme une variante du potentiel.
appelle,
mode
"mode
de
(p.
145)
conjecture"
"une
Harris
le
mode
potentiel.
Mais
potentiel
les modes qui relèvent de la
et subjonctif) ne suffisent pas
325
perception
(indicatif,
"pour les besoins
et
l es "usages de la vi e" •
La création des autres modes est motivée,
dans les langues humaines, par "la conscience de notre faiblesse"
ou pour amener autrui "à se rendre à quelques-uns
(p.
de nos désirs"
135)
si nous interrogeons, c'est le mode int.rrog.tif;
si nous exigeons, si nous demandons, c'est encore
un autre mode,
qui lui-m~me a plusieurs esp.ces
subordonnf,s. A l'égard de nos inférieurs, c'est
le mode i.plr.tif;
à
l'égard de nos supérieurs,
c'est le dfpr4c.tif. (P. 136)
Harris remarque,
modes
en comparant les modes entr'eux,
relevant de la volonté
(interrogatif et mode
diffèrent de ceux qui relèvent de
potentiel)
en ceci
au
réponse,
premiers" (p.
rôle
dans
perception
de
demande)
(indicatif
et
"que ces deux derniers exigent rarement une
lieu
qu'elle
est
indispensable
pour
les
deux
139). La direction d'ajustement joue clairement un
l'analyse
perception
la
que les
forment
des
modes de
Harris;
les
modes
des énonciations qui "s'ajustent
de
au
la
monde"
lorsqu'elles sont accomplies avec succès, tandis que les modes de
la
exigent
volonté
s'ajuster
à
une
"réponse"
l'énonciation.
Et
l'interrogatif au mode de demande,
parce
si
que
le
monde
compare
on
doit
maintenant
on constate "qu'ils diffèrent
l'un de l'autre, non-seulement par la nature de la rlponse qu'ils
exigent,
mais à d'autres égards encore" (p.
139) .
Àu mode
de
demande (impératif et déprécatif), on peut répondre tantôt par un
discours,
tantôt
simplement
par
convenable à une demande du genre
326
une
action.
La
réponse
"Donnez une obol e à ce pauvre
homme", est une action, un acte de charité.
Mais l'interrogatif,
lui, exige toujours comme réponse une proposition
affirmative".
mode
dé fini t ive ou
Harris remarque qu'il y a une très grande affinité
entre les modes interrogatif et indicatif;
le
Il
la réponse exigée par
interrogatif est presque toujours une
verbe principal est à l'indicatif;
"le verbe conserve la même forme,
phrase
dont
le
de plus, dans ces deux modes,
et ils ne sont distingués
que
par l'addition ou la suppression d'une particule, ou par un léger
changement de position dans les mots, ou quelquefois enfin par le
seul changement du ton ou de l'accent de la voix"
Harris
d'abord,
distingue
également
différents
les y.s/no questions,
(pp. 140-141).
types
de
questions;
qu'il appelle " ques tions simples
ou dé fin i es" ,
comme "Ces vers sont-ils d'Homère?", auxquelles on
peut répondre
par une proposition affirmative ou négative
[ne sont pas]
vers sont
et
d' Homè re") ,
non;
ou, pour abréger,
oui
"complexes" ,
comme liCes vers sont-ils d'Homère ou de
vers?".
comme
les questions "indéfinies",
On
compl exes
ne
en
aux
ces
questions
soit
par
une
complète ("Ces vers sont d'Homère"),
soit
par
une
distinctions
poursuit
sont
mais on peut le faire
phrase elliptique (simplement "Homère").
ces
Virgile?";
"De qui
peut répondre par "oui" ou "non"
in dé fin i es;
et
proposition
par les
ensuite, les questions qu'il appelle
" par ticules"
et enfin,
(' 'Ces
des Anciens,
en
Harris reprend (encore)
particulier
d'Arnmonius.
sa comparaison de l'interrogatif et du mode de
expliquant
pourquoi le
second,
contrairement
n'admet pas toutes les personnes ni tous les temps
la raison toute simple qu'il est aussi absurde,
327
au
demande
premier,
c'est
dans les
Il
"par
modes,
de se commander à soi-même,
que
celui
parole" (p.
c'est
que
impératif,
car
qui
qu'il le serait,
dans les
parle devfnt le sujet à qui
142)
"le
il
adresseroit
qui
143-144) .
commandement
ou le
dé sir,
qui
sont
et
en
Harris,
Harris
observe,
comme beaucoup
d'autres,
que
français) des impératifs passés
ces
formes
et
le
(pp.
l'on
qu'il
(comme on peut en trouver en grec
passées
("Àyez fait
d' i mpé rat i f
ceci
à mon
expriment,
selon
"le désir que l'on a de voir la chose faite au moment où
l'on parle" (p . 144, dans la note infrapaginale).
aussi
mode
avec
de leur nature sont immuables et nécessaires?"
dans certaines langues
ret our! ")
du
ne peuvent nécessairement se rapporter qu'au futur
commande souvent en utilisant le futur de l'indicatif,
existe,
la
et si l'impératif n'admet pas tous les temps,
que peuvent-ils avoir de commun avec le présent et
passé,
pronoms,
"mode d'instruction"
le
Harris appelle
mode interrogatif,
et
"mode de
législation", le mode impératif.
L'infinitif,
par
enfin,
se distingue d'abord des autres
le fait que le verbe,
personne ou à une substance.
donnent soif",
ne se rapporte pas à
une
Dans la phrase "Courir et danser me
"courir" et "danser"
de tout autre mot,
faire
à ce mode,
modes
"subsistent
indépendamment
et il n'est ni nécessaire ni possible de
précéder d'un nom de personne ou de substance"
Cp.
les
146) .
Une autre caractéristique importante des infinitifs tient au fait
qu'ils "perdent leur caractère d'attributifs",
328
[et] prennent
m~me
celui de substantifs"
commun
la
l'infinitif
propriété
(p.
147) .
d'exprimer
Si tous les modes ont
une
"affection
n'est pas vraiment un mode puisque
de
en
l' cÎme",
cette
propriété
lui fa i t dé fa ut.
Harris rappelle la conception des stoïciens et d'Apollonius
selon
laquelle l'infinitif est la forme simple et
verbe,
car
primitive
l'infinitif exprime l'action contenue dans le
sans rien y ajouter.
C'est pourquoi les verbes,
personnels,
"se résoudre par l'infinitif,
peuvent
verbe
dans les
qui
du
modes
en
est
comme le prototyp., et par quelque mot ou proposition qui exprime
leur caractè re part icul i er" (p. 148)
m~me
Ainsi, "Ambulo" signifie la
chose que "Indico me ambulare" ("Je déclare moi marcher") et
"Marche!",
la
m~me
chose que
"Je t'ordonne
de
marcher",
etc.
L'infinitif a aussi la propriété de se lier "naturellement à tous
les
verbes qui indiquent quelque tendance,
l'ame,
nous
mais rarement avec les autres" (p.
pouvons dire "Je veux vivre",
Priscien
appelait
tendances,
dans
des
v.rb.
mal.s pas "Je
ces
demeurent
"Je dé sire
exprimant
des
On peut
unir
comme
alors séparées et bien distinctes.
"
vivre".
dans
mais les actions désignées par les
autrement avec les "verbes de la volonté"
"
mange
verbes
une même phrase des verbes à l'indicatif,
"Je demande
329
"
de
C'est pourquoi
149) .
désirs ou la volonté du locuteur.
ens eigne et il marche",
verbes
voluntiva
désir ou volonté
Il
"Il
deux
en
va
les phrases "Je veux
etc., sont incomplètes
et
défectueuses tant qu'on ne leur ajoute pas un
infinitif
exprime "l'action propre vers laquelle elles tendent"
Ce n'est qu'alors qu'''elles forment un tout complet,
aux lois de la raison et aux règles de la syntaxe"
Quant aux interjections,
qui
150) .
(p.
et conforme
(ibid.).
elles expriment certaines émotions
vives (stupéfaction,
douleur, etc.), et ne se laissent ramener à
aucune
du
des
parties
proposition.
lancées
Les
dans
discours
servant
à
l'analyse
interjections se prononcent à
une
part,
proposition sans en altérer la
de
ou
forme
la
sont
ou
la
signification.
Enfin,
assez
Harris
conforme
à
présente une
conception du
celle que l'on a
grammairiens philosophes français.
déjà
pronom
rencontrée
relatif
chez
les
Il renvoie m@me, sur ce sujet,
à la 9r •••• ir' 9'n'ral • • t r.isonn', de Port-Royal
(voir
p.
72,
la fin de la note appelée à la page 70, où Harris réfère au chap .
IX à
"un
excellent
ouvrage
français,
intitulé
Le pronom relatif cumule les fonctions
du pronom et de la conjonction. Si, au lieu de dire: "La lumière
est un corps et la lumière se meut avec une très grande vitesse",
nous disons
"La 1 umiè re est un corps qu.i se meut avec une trè s
330
grande vitesse",
et son intégrité,
plus une,
non seulement la proposition conserve son unité
mais en plus elle "devient, s'il est possible,
plus entière" (p.
pronom "subjonctif",
les autres
mais
il
(ibid.)
70)
parce que,
En conséquence, il appelle ce
dit-il,
"il ne peut pas, comme
(pronoms), exciter de lui-m@me une idée dans l'esprit;
ne
sert qu'à unir une idée à une
D'ailleurs,
autre
qui
les propositions où figure un tel
précède "
pronom
sont toujours des propositions complexes, avec deux nominatifs et
deux verbes.
***
331
NOTES
(1)
André Joly, qui signe l' "Introduction" de l' édi tion du H.r.ts
de 1972
(dans la traduction de Thurot),
affirme avoir
dénombré pas moins d'une dizaine d'éditions en moins d'un
siècle,
et cite abondamment des témoignages élogieux de ses
contemporains.
Il mentionne plusieurs grammairiens anglais
importants qui auraient été
influencés par Harris,
dont
Robert Lowth,
Joseph Priestley, Monboddo et James Beattie
("Introduction",
pp. 8-9), et décrit la réception du H.r •• s
en Allemagne et en France.
Voir aussi I. Michael (1970, op.
cit.,
p.
172;
cité par Joly, p. 9), qui parle du H.r •• s de
Harris comme étant "by far the most penetrating of all the
works written in the name of Universal Grammar".
Sur la
réception du Her •• s de Harris en France, cf.
P.
Bergheaud,
"Remarques sur la réception de Harris en France",
in
Histoir •• Epist~.oIogi •• Lang.g •• Tome 7, fasc. 11, 1985, pp.
149-162;
Sur les critiques adressées à Harris par Horne
Tooke, cf., du m@me auteur,
"De James Harris à Horne Tooke",
in Historiographia Linguistic., VI:1, 1979, pp. 15-45.
J'utilise, pour mon exposé, la traduction française de Thurot
qui est tout à fait fiable, n'ayant pu obtenir l'original anglais à temps.
J'indique ici et là les équivalents anglais
(qu'on trouve chez d'autres grammairiens)
lorsque cela me
semble pertinent.
(2) Destutt de Tracy ( Sr •••• ir., 1803, p.
116), parle de Horne
Tooke comme d'un "grammairien vraiment philosophe",
et dans
la note 1 (p. 116),
il écrit
"Aussi réduit-il bien à sa
juste valeur son compatriote Harris,
qui a été un moment si
vanté chez nous, quoiqu'il ne le mérite guère. Au reste, nous
ne devons pas nous en plaindre,
puisque cela nous a valu la
traduction qu'en a faite le citoyen Thurot,
et les excellentes notes qu'il y a jointes, qui sont autant de dissertations
souvent précieuses, et toujours très-supérieures au texte qui
en est la cause occasionnelle".
(3) La théorie des "ordres" de Harris a pu être comparée à celle
des "rangs" et de la "subordination syntaxique" de Jespersen
CTh. Phi Iosophy 0 f Sra ••• r,
1924); cf.
l' Il Introduct i on" de
Joly, pp. 79-80.
Il y a des substantifs de premier ordre
("Jul es", "homme", etc.)
et des substant ifs de sec ond ordre
(les pronoms); de m@me, les attributifs de premier ordre comprennent les adjectifs, les verbes et les participes,
et les
attributifs du second ordre,
les adverbes.
Harris se
distingue de la tradition et des autres grammairiens philoso332
phes en rangeant les adjectifs avec les verbes et les participes parmi les attributifs, au lieu de les faire entrer dans
la classe des substantifs et de distinguer les " noms substantifs" des " noms adjectifs".
Sur la théorie des parties du
discours de Harris, cf. A. Joly,
"James Harris et la problématique des parties du discours à l'époque classique", in
History of
Linguistic Thought and
éd. par H. Parret,
pp. 410-430.
Conte.porary Linguistics,
New York & Berlin,
W. de Gruyter,
1976,
(4) Joseph L.
Subbiondo,
"The Semantic Theory of James Harris",
in Historiographia Linguistica,
III:3,
1976, p. 279. Sur la
réception du Her •• s de Harris en Angleterre, voir p. 285.
(5) Cf. A. Joly, "Temps et verbe dans les grammaires anglaises de
l'époque classique", in Histoire. Epist4.010gie. Langage. Tome 7, fasc. 11, 1985, pp. 112-113.
(6) James Burnett (Lord Monboddo), Of the Origin and Progr.ss of
Language (1774),
vol.
1, AMS Press,
Inc., New York, 1973,
chap.
1. Monboddo (p.
8) parle de son "worthy and learned
friend Mr Harris";
et en note infrapaginale : "The Author of
H.r.es, a work that will be read and admired as long as there
is any taste for philosophy and fine writing in Britain".
Michael (op. ci t., pp. 430-431) écrit
"James Harri s, in
1751,
is unusual among writers on universal grammar
in making a definite enumeration of moods,
firmly based on
meaning".
Il mentionne l'hypothèse des deux facultés actives
de l'âme
(Perception et Volonté),
et celle qui établit la
dépendance des modes vis-à-vis des "espèces de propositions".
Il s'étonne ensuite que Harris n'ait pas posé deux modes primaires et qu'il ait présenté au lieu un ensemble de quatre
modes dans son analyse des intentions du locuteur
(sp.aker's
int.ntion).
Il écri t aussi que Harris "seems later in the
chapter to treat the infinitive as a mood also"; mais il
s'agit,
semble-t-il, d'une concession à la tradition qui a
toujours traité
l'infinitif au chapitre des modes verbaux.
Mais Harris ne peut en faire un mode, puisque l'infinitif
perd même son caractère d'attributif et n'exprime aucune
énergie ou affection de l'âme.
(7) 1.
H.r •• s,
***
333
CHAPITRE QUATRIEME
JAMES BURNETT (LORD MONBODDO)
Of th. Origin and Progress of Language de Monboddo est
oeuvre immense,
publiée en six volumes, entre 1773 et 1792. Elle
fut partiellement traduite en allemand peu de temps après
1786)
avec une introduction de Herder.
Il fut
(1784l'auteur
auss~
d'un autre ouvrage tout aussi gigantesque (Rnci.nt Netaphysics
or
une
th. Science of Universals) mais qui n'eut pas le
que le précédent.
m~me
:
impact
Monboddo ne cherche aucunement à dissimuler sa
dette envers James Harris;
bien au contraire,
Of th. Origin and
Progr.ss of Language est plein de références au H.r.ts de
Harris
et de commentaires élogieux à son endroit; il avoue de plus qu'il
doit
largement à son
particulier
engouement
les
am~
son goût pour l'étude des
langues anciennes et surtout le
pour la philosophie grecque
langues
grec)
et
(en
son
classique.
Ce chapitre consacré à Monboddo constitue une sorte de trait
d'union
entre
le
précédent et
s'inspire souvent de Harris,
les
modes verbaux
le
suivant;
car
s~
Monboddo
les réflexions de James Gregory sur
(chapitre suivant)
départ celles de Monboddo.
334
prendront pour
point
de
Le premier Volume de Of the Origin and Progr.ss of
Language
est entièrement consacré au problème de l'origine du langage,
l'auteur
tente de montrer (premier Livre) que le
pas une faculté
" naturelle "
à l'homme
Langage
(ou Etat politique)
n'est
(n'en déplaise à Chomsky
qui d'ailleurs ne mentionne pas l'oeuvre de Monboddo),
Société
où
et que la
tIc ondi t i on"
n'est pas non plus une
naturelle à l'homme, bien qu'elle soit une condition nécessaire à
l'invention du langage (deuxième Livre).
L'homme dans l'état
de
nature est l'oeuvre de Dieu, mais l'homme vivant en société, doué
de raison et communiquant avec ses congénères au moyen de
conventionnels, est ce que l'homme a fait de l'homme.
décri t
les
(troisième Livre)
premiers
inart iculé s
avec
Condillac,
s'il
même
du
indirectement
des
langues
à
des
la
manière
connaissait
son
oeuvre
plusieurs
il
marqué
partir
langage des gestes un peu à
qui il se dit en accord sur
ne
Enfin,
les principales étapes qui ont
développements
et
signes
cris
de
points,
qu'imparfaitement
et
(1)
C'est le second volume qui nous occupera ici. Il constitue à
lui seul un traité de Grammaire Générale. Le premier Livre traite
de l'analyse
l'analyse
des
"partie formelle"
de l'ensemble des différentes
mots,
second,
de la
ou
qu'ils
des mots en tant
de l'aspect matériel,
du langage
(c' est-à -dire
"manières de signifier "
sont
signifiants) ,
le
et le troisième, de la syntaxe et
335
de la "composition" en général.
Monboddo reprend à son compte et réinterprète
des parties du discours proposée par Platon (Le
262a)
et
Aristote (Traité de
parties du discours,
ce
qui
toutes
l'interprétation)
sont rapportées soit au no.,
d'une
qui
inhèrent
existence
les
aux
soit au
c'est-à-dire
"autonome"
au contraire,
les verbes,
imaginaire) ;
accidents
jouit
26ld-
Sophiste,
Les noms servent à désigner les substances,
verbe.
division
les huit mentionnées par Denys de Thrace et
l'interjection des Latins,
tout
la
(réelle
ou
servent à désigner
les
substances,
soit
1 es
qua 1 i tés ,
quantités, relations, ainsi que l'action et la passion.
En bref,
le
discours
verbe pour Monboddo recouvre toutes les parties
qui
servent à désigner des êtres tombant sous l'une
des
catégories d'Aristote,
à l'exception de la
du
ou
l'autre
substance
(les
substances étant désignées par les noms).
Dans
cette conception élargie du
verbe, les catégories de
l'action et de la passion sont particulièrement importantes
la
mesure
locuteur
affection
où
elles
sont intimement
liées
qui exprime nécessairement dans tout
dans
l'esprit
discours
dans
du
quelque
ou "énergie" ("energy of the .ind of the speaker")
de
son esprit relative à l'action (ou passion) dénotée par le verbe.
336
Tous les mots,
les
en conséquence, se divisent en ceux qui expriment
substances,
ceux
qui expriment les accidents et
ceux
qui
expriment les affections ou dispositions de l'esprit du locuteur:
all speech whatever, besides what it may express
concerning the nature of things,
does of necessity express some energy, passion,
disposition,
or, as l would chuse to call it by one word, affection, of the mind of the speaker : for it denotes his joy,
grief,
surprise,
or some other
passion; or it communicates his prayers, wishes,
commands, or volition of any kind;
or it simply
declares the judgement of his mind concerning any thing, that is, affirms or denies.
As therefore the expression of these accidents or attributes of the mind of the speaker are essential
to speech,
l would chuse to
separate them from
other accidents,
which may be expressed or not
by speech,
and to consider them by themselves,
calling them th, aff.ctions of th. sp.aker's
.ind, and leaving to the accidents of substances
the common name of accidents.
We may therefore
say,that every word expresses substance,or accident, or the affections of the mind of the speaker. The first is what l call a noun,
the other
two are verbs.
(Of the Origin and Progress of
Language, vol. II, pp. 32-33).
Les noms substantifs, les pronoms et les articles se rapportent à
la
et toutes les autres parties
catégorie du nom,
(les
verbes
proprement
dits,
les
adjectifs,
du
discours
participes,
adverbes, conjonctions, prépositions et interjections) à celle du
la
verbe.
suite
de
Harris,
Monboddo
s'écarte
de
tradition en refusant de ranger les adjectifs parmi les noms;
s'il
peut paraître étrange de ranger les prépositions parmi
verbes,
in
their
c'est qu'elles
subjects,
"denote relations of things ...
so that they are qualities
considered as having a separate
existence"
337
which
la
et
les
inherent
are
(ibid., p. 175)
not
(2)
Il semble bien que toutes les
pas
(ou ne contribuent pas)
parties du discours qui ne servent
dénot er
à
des
choses
ayant
existence autonome sont ici considérées comme verbes.
une
Et il y a,
en conséquence, des verbes qui sont indéclinables.
Les
verbes
"verbes"
par
"proprement dits"
cec~
se distinguent
de
l'esprit du
locuteur.
l'esprit
est
exprimée
séparément,
no
Lorsqu'une
c ' est
that is,
le
the
par
"which denotes
speaker,
either
asserting that the thing is, or co •• andin9,
substantif
l'existence.
Les
de
une
or ",ishin9, that it shou.ld be" (ibid., pp. 33-34).
verbe
une
affection
soit
soit par le verbe substantif .tr.,
more than the affection of the mind of
prayin9,
autres
qu'ils expriment à la fois un accident et
affection
interjection,
des
exprime
affections
aussi,
comme
l'esprit
de
chez
exprimé es
Mais
Harris,
par
les
interjections sont des "passions", comme la joie, la surprise, la
et
parce
st upé fact i on,
etc. ;
sentiments
non des idé es,
et
qu'elles
les
n'expriment
interjections
que
peuvent
des
être
considérées comme les restes des plus anciennes formes de langage
parmi les hommes.
Les affections ou
verbe
"énergies"
de l'esprit exprimées par le
ne sont pas en général des passions,
338
mais
plutôt,
comme
chez
Harris,
volitions.
(Monboddo écrit ".ss.,.tion")
des jugements
Les
volitions
peuvent être de
deux
et
des
espèces
le
souhait et le commandement. Ainsi, "there is no verb of this kind
(le verbe au sens strict), which does not either assert, wish, or
command" (ibid., p. 118).
(3)
Monboddo place l'interrogation dans
la catégorie du souhait ou "simple désir", car, écrit-il,
"every
man that interrogates, wishes or desires to be informed"
la note infrapaginale) .
théorie
Notons que, de la même façon,
des actes de discours,
type directif,
(Ibid. ,
dans
la
les questions sont des actes
de
une espèce du genre
,..qu.t.
(l'allocutaire a une
option de refus) ayant le d4si,. comme condition de sincérité.
Le
verbe,
locuteur,
en plus d'exprimer une énergie de
signifie aussi,
l'esprit
.t,.e,
à l'exception du verbe
Monboddo appelle en un mot l'.ction,
c'est-à-dire
par le
L'expression
d'une
opération
l'esprit
et
action
ou
lOis essential to every verb in every language" (ibid.,
les circonstances,
le
verbe
particulière.
est
de
locuteur.
Le mot .ss.nti.I ne semble pas des plus appropriés dans
p. 118).
que
énergie
que
la chose même
qui est affirmée, niée, commandée ou souhaitée
d'une
ce
du
puisque Monboddo affirme plus loin
tt,..
n'exprime
aucune
action
opération
ou
Mais il précise également plus loin (p. 124) qu'il
"essentiel" au verbe d'exprimer un accident
(en
plus
énergie de l'esprit)
et que sous les accidents exprimés
verbe,
à la fois
il
122)
(p,
comprend
l'existence
339
et
d'une
par
l'action.
le
Par
ailleurs, il est moins explicite que les Messieurs de
sur
la
manière
dont
les
verbes
signifient
Port-Royal
l'action
l'opération, bien qu'il semble aller dans le même sens.
qu'il
ou
Voici ce
écrit sur le sujet
the action of the verb, is necessarily implied
in the signification of the verbj
for if we
were to affirm, that we do affirm,
or did affirm, the energy itself,
in such case,
would
be the thing affirmed. (Ibid.)
Les grammairiens de Port-Royal,
on s'en souvient, distinguaient,
à propos d'énoncés comme affir.o,
celle
j'affir.e, deux affirmations
qu'accomplit le locuteur et qui est exprimée par la
du verbe,
et celle qu'il conçoit et s'attribue en la
directement.
forme
signifiant
C'est, semble-t-il, une distinction de ce genre que
Monboddo avait en vue dans le dernier passage cité, car plus loin
(p.
167) ,
il explique que cursus.
contrairement à curro, n'est
pas un verbe même s'il dénote une action,
aucune
énergie
commandant
parce qu'il
de l'esprit affirmant que cette
qu'elle
n'exprime
action
doive exister ou souhaitant
existe,
qu'elle
puisse
exister. Malheureusement, il ne discute aucun exemple où c'est un
verbe qui signifie directement une énergie de l'esprit. Les trois
principales
énergies
de
l'esprit
exprimé es
par
le
verbe,
l'affirmation, le commandement et le souhait, sont des opérations
(ou actions) qui peuvent devenir la signification principale
verbes "affirmer",
dit
Ilcommander" et "souhaiter".
des
Mais Monboddo ne
pas clairement si les énergies de l'esprit ne
peuvent
être
signifiées directement que par ces verbes utilisés à l'indicatif.
340
Le verbe,
exprime
reliée
en plus des énergies de l'esprit et de l'action,
aussi
sous
souhait.
la personne ou la chose à laquelle
la forme de l'affirmation,
Il
exprime
aussi,
l'action
du commandement
comme chez Harris,
est
ou
du
Du Marsais
et
plusieurs autres, l'existence de l'action signifiée par le verbe.
L'expression
de
l'existence
de
l'action
dans
un
sujet
est
d'autre
que
également essentielle à tous les verbes,
for when we affirm any thing, we assert that
it does exist; when we command it, we desire
that it should exist;
and when we wish for
it, it is that it •• y exist.
This general
idea therefore of being or existence is implied in every verb, whatever the action of
i t may b e. (1 bi d., p. 120).
Nous
l'avons
vu,
le
verbe .tre
n'exprime
l'action de l'esprit et l'existence.
en
faisant
rien
Monboddo suit la
du verbe .tr. le plus simple des
verbes,
tradition
tous
les
autres pouvant se décomposer en verbe .tr. + participe.
Enfin, le verbe consignifie le temps.
aj outé e"
C.djunct)
verbes.
syntaxique
les
verbes
Reprenant
Cette "signification
est nécessairement impliquée
Aristote,
Monboddo
dans tous
explique
par le fait que l'existence est impliquée
et
que tout ce qui existe ici-bas
341
existe
ce
les
trait
dans
dans
tous
le
temps;
par
suite,
"monde
sublunaire"
corruption,
ont
~tl,
marquer
seuls
toutes
sont
les choses qui existent
soumises
la
à
dans
génération
et donc aux grandes divisions du temps
ou seront.
le
notre
et
à
elles sont,
Que seuls les verbes aient cette capacité de
temps se comprend donc par le fait qu'ils
sont
à exprimer une énergie de l'esprit affirmant qu'une
existe,
la
commandant qu'elle doive exister ou
souhaitant
les
chose
qu'elle
puisse exister.
Monboddo critique les définitions qui, comme celle de PortRoyal,
font
du
l'affirmation.
verbe
Cette
une
partie
définition,
du
dit-il,
parce qu'elle ne tient compte que d'une
l'esprit exprimées par le verbe,
(le
discours
est
seule
signifiant
"incomplète",
des
énergies
sans mentionner les deux autres
commandement et le souhait) .
Il ne semble pas accepter
plus l'idée (qu'on trouve aussi dans la 6ra •• air. de
que
les
part i es" ,
énoncés éternels
etc.)
explique-t-il,
ne
substantif
Port-Royal)
l'une
de
non
de
ses
temps;
car,
les choses éternels et immuables n'existent peutmais elles ont néanmoins une
l'idée de durée (duration)
temps.
("Le tout est plus que
c ont i ennent aucune marque
être pas dans le temps,
du
de
Plus
comme
dur'.,
et
est à ses yeux plus générale que celle
loin cependant
(p.
168),
il
parle
du
verbe
du "verbe métaphysique"
qu'il juge particulièrement approprié à l'expression des
éternelles "which have nothing to do with time,
di spos i t i on of the mind" ...
342
persons,
vérités
or the
Après
analyse,
Monboddo
formule
de
cette
manière
sa
définition du verbe :
It is a word principally significant of accident,
of the energy of the mind of the speaker relative
to that accident,
of the substance to which the
the accident belongs, and it is consignificant of
time. (Ibid., p. 124).
Mais
parmi toutes les choses signifiées par le verbe
nombre,
voix,
etc.) ,
(personne,
l'existence et l'énergie de l'esprit sont
les seules qui lui soient vraiment nécessaires (cf. pp. 166-167).
Cette
capacité
des verbes d'exprimer sans
ambiguïté
plusieurs
significations constitue selon Monboddo l'un de leurs traits
plus
remarquables,
car elle permet d'éviter une
inutile des mots en exprimant
un
seul.
étaient
justement,
multiplication
commodément ces significations
primitives
à son avis,
en
la"gu~g~s)
fort imparfaites parce qu'elles
inutilement les mots et parce qu'elles créaient
à
fois des mots tout à fait nouveaux au lieu de chercher
à
multipliaient
chaque
langues
Les
les
les dériver à partir d'un certain nombre de
racines par
l'ajout
de terminaisons nouvelles.
Venons-en
Monboddo
est
enfin
ambiguë;
aux modes.
elle
La
définition
ne dit pas clairement
343
qu'en
si
donne
le
mot
"modes" s' appl ique aux é nergi es de l' espri t
ou aux infl exi ons des
verbes chargées de les exprimer.
The .odes or .oods of verbs, as they are commonly
called,
are no other than those energies of the
mind of the speaker, which l have sa id are essential to the verb, expressed by different forms or
inflexions of i t. (Ibid., p. 161).
Cette définition à elle seule laisse supposer
l'énergie
ou
que
le
mode
est
l'affection de l'esprit plutôt que l'inflexion qui
l'exprime; mais la suite du texte laisse entendre le contraire:
Of these l have only mentioned threej affir.ation,
expressed by the mood called the indicativej wishing, or praying, expressed by the optativ.j
and
co •• and, expressed by the i.p.rativ •. The int.rrogative is reckoned by some among the moodsj but as
it is not expressed by any different
form of the
verb, but only by particles,
or by a certain arrangement of the words,
l do not chuse to calI it
a mood ... (Ibid.).
Ici
ce sont plutôt les énergies de l'esprit qui
sont
par
les modes,
inflexions,
lesquels sont conçus comme
des
exprimées
et
c'est
bien un critère morphologique qui détermine ce qui
compte
comme
mode
nl.
le
Cette ambiguïté
du
potentiel,
pour
raison,
ni
l'interrogatif,
ne sont des modes pour Monboddo.
terme "mode",
des
cette
qui se dit tantôt des énergies de l'esprit, tantôt
inflexions qui les
expriment,
n'est pas relevée par Monboddo.
bien
qu'assez
inoffensive,
Nous verrons (chapitre
suivant)
que Gregory, quelques années plus tard, y sera plus attentif et y
échappera
en distinguant soigneusement les
344
"modes de la pensé e"
des "modes grammaticaux".
que
Les modes servent donc à exprimer ces énergies de
l'esprit
sont
souhait.
l'affirmation,
L'affirmation
Monboddo
est
le
commandement
et
exprimée par l'indicatif
et
le
le
subjonctif;
se distingue ici de Harris et ne reconnatt pas de
potentiel,
mode
celui-ci n'ayant pas d'inflexion qui lui soit propre.
Le subjonctif est rapporté à l'affirmation,
"for it expresses an
affirmation
L'indicatif
qualified"
"absolument" ,
p.
(ibid. ,
162) .
tandis que le subjonctif affirme "relativement
conditionnellement";
son
affirmation
est
liée
affirmation ou dépend d'une autre affirmation.
de
chose de l'optatif,
exprimer
affirme
le
une
autre
Monboddo dit
peu
sinon que les Grecs s'en servaient
de
le premier étant utilisé par
les
Grecs de préférence au dernier lorsque l'affirmation portait
sur
quelque
une
chose
toutefois
de contingent ayant rapport à un désir ou
de l'auteur.
Dans les langues
subjonctif pour exprimer le souhait,
fait
soit
l ' indicatif.
et Monboddo déplore
peu utilisé ou souvent remplacé
pour la plus parfaite
des
le
défini
et
indifféremment
Mais dans la langue des Grecs (qu'il
ami Harris,
à
modernes, on se sert
que l'anglais n'ait pas de mode subjonctif bien
qu'il
son
remarqua
avec le subjonctif,
inclination
du
il
pour
l'affinité
l'optatif
souhait;
à
et
tient,
langues,
par
comme
exception
faite peut-être du sanskrit), il y a, dit-il, deux subjonctifs
le
subjonctif proprement dit,
et l'optatif,
345
qui était le
plus
souvent
utilisé
comme un subjonctif lorsque le temps
du
verbe
principal était au passé.
L'infinitif n'est pas un véritable mode verbal pour Monboddo
(liAs
to the infinitive,
l hold it to be no mood,
commonly called SOli -- p.
exprime simplement l'action du verbe avec,
temps
comme nom,
verbe
à
participe,
fait une
verbal
<:5>
<4>
qu'il n'explique pas)
(ce
ou encore il sert,
un
autre
verbe,
partie du
car
non
Il
L'infinitif
est
utilisé
comme moyen de syntaxe, à lier un
ou un verbe
discours à
lui
l'esprit.
dit-il, l'addition du
à
un
comme beaucoup d'autres
Monboddo,
be
162); la raison de cette exclusion est
l'infinitif n'exprime aucune énergie de
simple
though it
part
plus
n'exprime
l'esprit.
***
346
entière,
Quant
au
grammairiens,
en
nom.
et
aucune
non un
énergie
mode
de
NOTES
Cl)
Of the Origin and Progress of Language,
Vol.
I,
(seconde
édition), édit. par J. Balfour, Edimbourg et T. Cadell, Londres,
1774;
réimprimé en 1973 par AMS Press,
Inc., New York.
Dans la
suite,
j'utiliserai surtout le Volume II,
re~mprimé en 1973 par
le même éditeur à partir de l'édition de 1809. Dans la "Préface",
pp. ix-x, Monboddo mentionne les travaux de Rousseau (le Discours
sur l'origine de l'in~galit~,
et l'Essai sur l'origine des
connaissances hu.aines de Condillac,
mais il avoue n'avoir connu
ce dernier ouvrage que par les extraits traduits dans la Critical
RevieN. H. Àarsleff (The Study of Language in England, 1780-1860,
Princeton, Princeton U.P., 1967, p. 37, note 45) nous apprend que
les extraits en question furent traduits par Thomas Nugent dans
Critical RevieN,
II,
1756, pp.
193-218. Il attire aussi notre
attention sur le fait que la section première de la seconde
partie de l'Essai de Condillac s'intitule justement "De l'origine
et des progrès du langage"
(cf.,
Essai
sur l'origine des
connoissances hu.aines,
éd. de G. Le Roy, Oeuvres philosophiques
de Condillac, Paris, P.U.F., 1947 (Vol. I), p. 60).
(2)
Cette conception des prépositions comme "verbes" apparaît
bien étrange,
certes.
Toutefois,
on retrouve une conception
apparentée chez nul autre que Donald Davidson,
dans l'un de ses
articles
les plus célèbres
"The Logical Form of Àction
Sentences", dans
The Logic of Decision and Iktion,
éd. par N.
Rescher,
Pittsburgh,
University of Pittsburgh Press, 1966; voir
en particulier les pages 91-93.
Davidson analyse en effet
l'énoncé I l (Ex) (x consists in the fact that l flew my spaceship to
the Morning Star) I l de la manière suivante
I l (Ex) (FlewCI,
my
spac eship, x) & To (the Morning Star, x)) I l , où la prépos i t i on Olt 0"
est traitée comme un verbe. Castaneda (l'un de ses commentateurs)
avoue que cette conception le rend perplexe "beyond limit"
(p.
108). Dans sa réplique, Davidson avoue à son tour : "My proposal
to treat certain prepositions as verbs does seem odd, and perhaps
it will turn out to be radically mistaken"
(p.
118); mais il
défend néanmoins
sa conception de façon à
rencontrer
les
objections de Castaneda en proposant lia special form of "to"
which means
'motion-toward-and-terminating-at''',
que Davidson
appelle toujours un "verbe". Par substitution, on obtient alors
I l (Ex) (Motion-toward-and-terminating-at (the
Morning Star,
x)) I l .
Les motivations qui conduisent Davidson à
traiter certaines
prépositions comme des verbes sont toutefois bien différentes de
celles
de Monboddo qui ne dispose pas
d'outils
logicomathématiques aussi sophistiqués.
(3)
On
trouvera
une
conception
347
analogue
dans
l'Essai
de
s' •• ntiqu. [1897] de M. Bréal, Genève, Slatkine Reprints, 1976,
p.
342
"le caractère particulier du verbe est de pouvoir,
à
l'énonciation d'un fait, mêler un élément qui révèle notre propre
état d'âme".
D'après Bréal,
les modes constituent le véritable
fond de la conjugaison du verbe indo-européen,
son principal
"motif", ses plus anciennes formes.
(4) Il s'agit sans doute d'expressions composées des auxiliaires
.tr. ou avoir suivi, par exemple, d'un participe ou d'un syntagme
(nominal,
verbal
ou prépositionnel),
comme "avoir marché deux
milles",
".voir à marcher deux milles", ".tre sur le point
de marcher deux milles", etc.
(5) Cf.
Ibid.,
pp.
173-174
"The participle,
though in our
common grammars it be set down in the conjugation of every verb
as a part of it,
yet is truly a separate part of speech;
for it
does not express any energy of the mind of the speaker, which as
1 have said, is essential to the verb".
***
348
CHAPITRE CINQUIEME : JAMES GREGORY
James Gregory était professeur de physique
( 1 )
d' Edimbourg
Literary
En 1792,
Ess.ys
(2)
attention
s'intitule
parut
1790
en
Edinburgh,
juillet
,
le texte qui
retiendra
"Theory of the Moods of
dans les Tr.ns.ctions of the
ma1s
fut lu,
1787),
devant
l'Université
il fit paraître des Philosophical and
mais
•
à
ici
Verbs"
Roy.l
(3)
membres
de
la
qui
Society
en deux séances (le 18 juin et
les
notre
Société
le
of
16
Royale
d' Edimbourgh.
Cet essai de Gregory représente à mon avis, sous sa forme la
plus
achevée,
d'actes
de
la
théorie
pensé e.
Il
des modes
verbaux
contient
comme
plusieurs
marqueurs
innovations
intéressantes pour la sémantique et la pragmatique des modes,
en
particulier par l'introduction du concept d'op4r.tion soci.le
de
l'esprit, qu'il emprunte à son ami Thomas Reid
(4),
et qui permet
un élargissement du cadre des théories idéationnelles du langage.
Le
texte de Gregory,
qui fait près d'une soixantaine de
pages,
est
l'une des études les plus fines et les plus minutieuses
qui
ait
été consacrées aux modes verbaux par
des
les
grammairiens
Lumières.
Certaines de ses idées seront retenues par l'auteur de
l'article
"Sr •••• r "
Brit.nnic.
(:5)
de la troisième édition de
qui le cite avec
349
approbation,
l'Encyclop.edia
sans
toutefois
réaliser
de véritables progrès sur la doctrine du
physicien
et
grammairien philosophe écossais.
Les modes verbaux représentent pour Gregory "a very curious
and interesting point in the theory of language"
qu'il
n'a
pas
grammaticale
pleinement
qui
fait
le
lui
bonheur
semble
satisfaisante
d'entreprendre
verbaux.
eu
Il
trop
par
de
rencontrer
une
vraiment
j ust e,
cet te
ma t iè re,
en
lui-même
(p. 193).
cette
recherche
déplore en particulier que les
Parce
doctrine
complète
il
sur
décida
les
grammairiens
peu d'observations précises sur les faits
et
de
modes
aient
langue
relatifs aux modes, ainsi que le manque de notions distinctes les
concernant,
l'admission
rapide
et
négligente
de
principes
généraux mal établis,
et l'usage vague de termes mal définis
et
peu
éviter de retomber dans
il
expl iqué s .
propose
une
Pour
méthodologie
inspiré e
des
ces
erreurs,
sciences
physiques
(vraisemblablement de Newton). On recueille d'abord le plus grand
nombre d'observations pertinentes pour notre sujet;
ensuite,
"déduit" de ces observations certains principes généraux;
on
enfin,
on vérifie ces principes par de nouvelles observations ou par des
expériences.
texte
(pp.
Fidèle à cette méthodologie, la première partie du
195-214)
expose un
certain
nombre
d'observations
relatives aux modes; Gregory en tire six principes ou conclusions
(exposés aux pages 214-216)
le reste du texte est une discussion
de ces principes.
350
Tout au long de son essai,
Gregory renV01e à la
doct~ine
des
modes exposée par Monboddo dans le second Volume de Of th. Origin
Même s'il juge la doctrine de Monboddo
and Progress of Language.
très
incomplète
et par moment très
obscure,
il
la
considère
néanmoins comme la meilleure (ou la moins mauvaise ... ) qu'il
pu
lire
sur le sujet.
théorie
des modes,
La meilleure façon de faire
dans les circonstances,
ait
avancer
la
c'est d'essayer
de
corriger et de compléter la meilleure théorie disponible.
Commençons par les "observations" de Gregory concernant les
modes.
Pour
nous l'avons vu,
Monboddo,
simple "accident" du verbe,
fait
.ind
partie
pas
un
car l'expression d'une .nergy of the
l'essence
de
le mode n'est
du
verbe.
Par
conséquent,
l'infinitif ne pouvait être qu'un nom verbal, puisqu'il n'exprime
aucune attitude du locuteur.
Gregory s'écarte de Monboddo sur ce
point. Comme d'autres grammairiens (Arnauld, Lancelot, Du Marsais
entre
autres),
contribue
il
souvent,
remarque
qu'en
en tant que verbe,
dans
"Non
comme
L'infinitif
est donc un verbe sans mode.
of
.ood,
verb"
la
à exprimer
sed
est
complètes,
conclusion suivante
surtout
latin
l'infinitif
des
pensées
valere
vitali.
De cela,
il
tire
la
"It is only the capacity or susceptibility
that can with propriety be said to be essential
to
a
(p. 196). De la même façon, ce n'est pas la division, mais
divisibilité
qui est essentielle à
351
une
ligne
géométrique,
comme le mouvement et le repos ne sont pas essentiels aux
bien que la mobilité et la capacité
qui est essentiel au verbe,
tel mode.
au repos le soient. Ce
c'est donc de pouvoir prendre tel ou
Lorsqu'un infinitif est utilisé comme moyen de syntaxe
pour lier un verbe à un autre,
donc
d'~tre
corps,
pas
pour autant
ou un verbe à un nom, il ne cesse
un
d'~tre
verbe;
d'ailleurs,
souligne
Gregory, les phrases où un infinitif est utilisé de cette manière
sont "convertibles" en des phrases synonymes où apparaissent soit
soit d'autres parties du
des verbes portant la marque d'un mode,
comme liTa be or not ta btl, that is the question",
discours,
qui
est "convertible" en une phrase moins élégante et énergique, mais
not
shall
"The question is,
synonyme
néanmoins
Gregory rejoint
be".
whether we shall be
cependant
Monboddo
affirme que l'infinitif n'est pas vraiment un
celui-ci
appartient à l'essence des modes d'exprimer
qu'il
une
or
lorsque
mode
et
certaine
énergie de l'esprit du locuteur(6).
Gregory
nombre
des
optatif,
n'insiste
critique Monboddo pour avoir
(indicatif,
modes à trois
seulement
subjonctif
se rapportant
le
pas
limité
au
indûment
le
impératif
et
Mais
il
premier).
moins que son prédécesseur pour
ne
reconnaître,
dans une langue particulière, que les modes verbaux explicitement
marqués
l'anglais,
par
une
comme
interrogatif,
flexion
la
verbale
plupart
ni de potentiel,
des
caractéristique;
langues,
nl. d'optatif.
352
n'a
pas
ainsi,
de
mode
Gregory
diverses
observe
énergies
habituellement
qu'un même mode peut
de
l'esprit,
exprimées
énergies
de
l'esprit
flexions
verbales.
par
ou
des
d'autres
ne sont pas toujours
Le subjonctif,
pas,
dans
tous ses usages,
"conditionnelles et qualifiées";
où
le
subjonctif
supposition"
une
énergie
énergies
du
(p.
ou
202) ,
de
grec,
à exprimer
plus,
les
par
des
est
souvent
des
affirmations
exprime
"a
very
la supposition constituant,
autres.
l'interrogation
et
à son avis,
De
du
plain
mème,
par une
particule
ou par l'ordre des mots.
qu'il distingue soigneusement, et plus clairement
aussi
les
commandement
L'originalité de Gregory tient pour une large part au
avant lui,
ne
Gregory donne quelques exemples
l'indicatif
de
sont
et le subjonctif
peuvent être rendues par des circonlocutions,
(Utin •• + subjonctif)
qui
exprimées
même en
de l'esprit distincte des
souhait,
exprimer
à
énergies
modes;
utilisé pour exprimer l'énergie du souhait,
sert
servir
les .odes de pens'e (.oods of thou.ght)
que
fait
quiconque
(qu'il appelle
des
quelquefois
et
les
modes grammaticaux correspondent à deux manières d'envisager
les
(gra ••• tical
.oods).
Les modes de pensée
modes : soit relativement à la pensée (qui est la même partout et
pour
tous),
soit relativement à une
353
langue
particulière.
Les
modes
les
grammaticaux comprennent toutes les marques qui
modes de pensée,
particules
qu'il s ' agisse de
ou de l'ordre des mots.
flexions
Voici comment
expriment
verbales,
il
de
présente
cette distinction
Whatever may be thought
of the preceding observations,
it must at least be admitted,
that the
moods of verbs may be considered in two very different points of viewj
either with relation to
any particular language,
or with relation to hu.an thought,
which must be supposed the same in
aIl ages and nations.
For the sake of distinctness,
l shall calI the expressions of them,
by
inflection or otherwise in language,
gra •• atical
.oodsj
and the thoughts,
or combinations of
thoughts,
so expressed,
as weIl as similar
combinations of thoughts,
though not always, or
~erhaps never expressed in the same way,
l shall
calI energies,
or .odifications,
or .oods of
thought. Cp. 204).
Les
modes
grammaire
excède
grammaticaux
sont
de chaque languej
de
formellement
établis
par
mais le nombre des modes de
beaucoup celui des modes grammaticaux,
oblige souvent à utiliser le même
ce
la
pensée
qui
nous
mode grammatical pour exprimer
différents modes de pensée.
Il n'est donc pas étonnant qu'eu égard à
l'expression
des
modes de pensée, toutes les langues humaines présentent de graves
dé fic i en ces .
Gregory
domaine
which
"in
affirme même qu'il ne connaît aucun
language is
more
deficient,
than
autre
in
the
expressing of those energies or modifications of thought, sorne of
which
always
are,
and aIl of which might be expressed
354
by
the
grammatical moods of verbs." (Ibid.)
modes grammaticaux,
de
Malgré cette déficience
la meilleure méthode pour étudier les
en
modes
pensée consiste encore à étudier les modes grammaticaux
dans
diverses langues, à comparer entre eux les modes de pensée qu'ils
servent
exprimer,
à
certains
et
à
examiner les raisons
qui
font
modes de pensée sont ainsi exprimés alors que
que
d'autres
ne sont exprimés qu'indirectement. Il est évident que très peu de
modes de pensée sont exprimés par des modes
syntaxiques)
(types
dans la plupart des langues indo-européennes.
Toutefois,
aucun
grammaticaux
mode
les
modes de pensée qui ne sont
grammatical caractéristique peuvent
exprimé s
néanmoins
par
être
signifiés par un énoncé dont le verbe principal est à la première
personne
infinitif
du
singulier
(une
de
procédure
d'Apollonius Dyscole)
l'indicatif
de
présent,
résolution
"Je vous exhorte de
suivi
analogue
"
à
d'un
celle
"Je vous avise
de ... ", etc.
L'énumération des modes de pensée présentée par Gregory
fort révélatrice et intéressante en elle-même
Affirming, denying,
testifying,
foretelling or
prophecying, asking, answering, wishing, hoping,
expecting, believing, knowing, doubting,
supposing, stipulating, being able, commanding, praying, requesting,
supplicating,
loving, hating,
fearing,
despairing,
being accustomed,
wondering, admiring, warning, swearing, advising, re355
est
futing, exhorting, dissuading, encouraging, promising,
threatening,
and perhaps numberless
other modifications of thought, for which l cannot easily find names, aIl admit very readily of
being combined with the general
import of a
verb ... " (pp, 206-207)
Sur les trente-six exemples donnés par Gregory, plus de la moitié
(environ une vingtaine) sont des verbes illocutoires dénotant des
actes
illocutoires;
d'autres
perlocutoires (dissuader,
psychologiques
haïr,
ou
savoir,
malheureusement
l'énumération
que
disait
encourager,
attitudes
craindre,
pas
bien
des
très
etc.) ,
des
actes
soit à des
états
propositionnelles
admirer,
ce
etc.) .
que
que Wittgenstein
nous faisons des phrases
à
(croire, aimer,
(On
ne
viennent
disait
en
dans
.bl.
des
parlant,
voit
faire
being
termes dispositionnels comme
Ce
emplois
correspondent soit
ou
multiples
Gregory
le
(quoique moins catégoriquement) de ses modes de pensée
ils sont "innombrables" (nu..berless). Mais sitôt après, il ajoute
qu'en
raison
des
différences
de
degré,
et
des
nombreuses
ressemblances et affinités rencontrées parmi les modes de pensée,
il
est
possible
Malheureusement,
classification
très
difficile,
première
Il
les
Gregory
ordonner
il
nous
de
les
pas
procède
ne
dans son texte;
et
si
aurait
légué rien de
les modes de pensée peuvent
~tre
catégories comme chez Monboddo (affirmer,
l'affirmation,
une
telle
moins
tâche
que
la
propositionnelles!
par ailleurs que le débat autour de
ou à une seule,
à
classifier!
s'il avait accompli cette
ébauche d'une logique des attitudes
ajoute
savoir
de
la
question
rapportés
à
de
trois
souhaiter, commander),
"as many philologists think they
356
may"
(p.
en
avons.
207), ne fait guère progresser la connaissance que nous
La
première
tâche
à
accomplir,
avant
toute
classification, c'est de les examiner soigneusement.
Tous
ces actes ou modes de pensée ont
chose que Gregory appelle,
Ce concept
d' "énergie"
anticipation d'un
Et
understanding
which
they
les
them
quelque
est clairement une approximation
autre concept
tous
commun
après Harris et Monboddo, une energy.
"dynamique",
illocutoire" (Frege, avant Austin, utilisait
sens) .
en
peuples,
perfectly,
écrit-il,
celui
de
et une
"force
Kraft
dans le
m~me
"are
capable
of
language
in
whether they use a
can be expressed by mere inflections
or
not . I l
(p.
209) .
Ce qui étonne un peu dans l'énumération des modes de
de Gregory
présupposent
(citée plus haut),
une
c'est
interaction
verbale
la
présence
entre
(au
pensée
d'actes
moins)
qui
deux
personnes (commander, promettre, supplier, questionner, etc.), et
qui
ne semblent pas pouvoir se réduire à de simples
de l'esprit"
"opérations
d'un sujet solitaire. C'est ici que Gregory reprend
de Thomas Reid la distinction entre les op4rations solitaires
l'esprit
(telles croire, désirer, douter, etc.), qui peuvent être
accomplies
l'~sprit
de
par
un sujet isolé,
(commander, promettre, supplier, questionner, etc.), qui
357
impliquent
une
croyance
en
l'existence
d'autres
~tres
intelligents auxquels ces opérations se rapportent. D'après Reid,
toutes
les
opérations
il dit
langues
sont faites pour exprimer
aussi
sociales que les opérations solitaires
même,
Ifan (1785),
dans ses
Essays
on the
bien
les
de
l'esprit;
Intellectual
Po Ners of
que l'expression des opérations sociales de l'esprit
lOis the primary and direct intention of language"
Gregory
(7')
reprend cette thèse dans la seconde des "conclusions"
qu'il tire
de ses "observations"
That the energies expressed by the moods of verbs
are chiefly the social operations of mind, as they
have been very properly termed by Dr Reid; that is
to say,
such as
imply the belief of sorne other
intelligent being to whom they relate,
and which
cannot be supposed to take place in a
solitary
being. (P. 215).
Dans
le commentaire que fait Gregory de cette "conclusion"
224-225) ,
il
soutient étrangement (quoique qu'il admette
(pp.
qu'il
puisse y avoir des exceptions) que l'énergie exprimée par le mode
indicatif
(l'affirmation
et la
négation),
est
une
sociale de l'esprit
No man could be supposed even to for. (not to
say utt.r)
a proposition,
a question,
or a
command, who did not believe that there were
other intelligent Beings besides himself, who
might understand him. In general too,
(for l
admit there may be exceptions to this)
the
person who utters a proposition wishes to be
believed, he who gives a command wishes to be
obeyed,
he who puts a question wishes to be
answered,
and aIl of them wish to be understood.
These are aIl operations of thought,
358
opération
which cannot be supposed to
sol i tary Being. (pp. 224-225)
L'affirmation
mode
est l'énergie la plus fréquemment exprimée par
grammatical;
l'interrogation,
que
par
ensuite
le
commandement
un
et
cette dernière énergie n'étant souvent exprimée
("merely
by the tone
of
voice
of
the
Enfin, toujours parmi les plus fréquentes et les plus
importantes
énergies
grammaticaux,
et
viennent
l'intonation
speaker")
take place in a
mentales
exprimé es
par
les
modes
vient le souhait. Le souhait, comme la supposition
l'étonnement,
n'est
pas à proprement parler
une
opération
sociale de l'esprit bien qu'en certaines circonstances on
puisse
le
"These
may
considérer comme une opération sociale de l'esprit
aIl
be supposed to take place in
Robinson Crusoe in his island,
of Rome"
(p. 225).
a
solitary
being,
like
as weIl as in Cicero in the Forum
Dans toutes les langues quelque peu évoluées,
ces énergies sont exprimées par des modes grammaticaux.
Que le commandement et l'interrogation soient de plein droit
des
opérations sociales de l'esprit,
d'autant
plus
n'admettaient
les
que
pas en
grammairiens
on le
comprend
classiques
philosophes
du
"dédoublement "
général de
aisément,
sujet
lui
permettant, par exemple, de "se commander à lui-même". Mais qu'on
ne
puisse
(affirma t ion)
l'existence
"former"
seulement
sans
que
d'autres
dans
ce jugement
êtres
son
implique
intelligents
359
esprit
un
la
capables
jugement
croyance
de
en
nous
comprendre,
c'est là une opinion peu courante dans la
philosophique
pensé e,
classique.
Gregory
négation,
la
Dans
mentionne,
à
son
énumération
croyance (believing) ,
exemples) .
every
ou
Sur ce point,
language,
social
encore
acts,
"juger"
can
be
modes
de
sans préciser s'il y a
"affirmer" ,
et "former
(qui ne figure pas
Reid est plus clair,
a question,
des
côté de l'affirmation et
différence pour lui entre "croire",
proposition",
grammaire
a command,
qui écrit
a promise,
expressed as easily and
parmi
as
de
la
une
une
ses
"In
which
properly
are
as
(Reid, op. cit., p. 73).
judgement, which is a solitary act."
Revenons à la première de ses "conclusions"
That the energies, or modifications of thought,
expressed by the moods of verbs,
are such as
may be expressed separately by other verbs, and
chiefly by active verbs;
or in the phraseology
of the author of the essay on the Origin and
Progress of Language, That the energies of the
mind of the speaker,
denoted by the moods of
verbs,
are truly accidents,
and chiefly actions. (P. 214).
Ce n'est pas là une nouveauté,
procédure
insiste Gregory, puisqu'une telle
de résolution était déjà bien connue
verbes dénotant les énergies mentales
des
Grecs.
Les
(ces "actions" de l'esprit)
marquées par les modes grammaticaux sont effectivement des verbes
actifs
("affirmer",
ajoute
toutefois
tous
les
"commander",
"souhaiter",
un bémol à cette conception
modes grammaticaux sont,
360
dans
une
etc.) .
Gregory
traditionnelle
certaine
mesure,
"c onvert ibl es"
(en
première
personne
présent),
mais
un
du
au
énoncé contenant un
singulier ou du
sens
(r,sol vabl.) ,
"ré sol ubl es"
strict,
verbe
pluriel
dit-il,
actif
de
ils
ni même parfaitement
à
la
l'indicatif
ne
sont
pas
"convertibles".
(L'usage que fait Gregory des termes "convertible" et "résoluble"
ne
permet
pas de dire avec certitude quelle différence
entre les deux;
de
que
"convertible",
avec en
plus
analyse ou décomposition de la phrase originale.
.odo,
quelque
phrase
une
que
chose
ces
procédures
laissent
de la phrase originale;
la
l ' i dé e
que l'on
l'indicatif
meaning,
trouve
également
toujours
synonymie
(exprimant l'affirmation)
and
chez
affirming in the first p.rson
échapper
entre
lOis nearly
la
parfaite,
Beauzée)
of course is nearly convertible,
d'un e
Il semble donc,
originale et sa "résolution" n'est donc jamais
thèse
met
"résoluble" semble impliquer un plus fort "degré
synonymie"
grosso
il
Ainsi,
the
same
~n
with a
verb
of
of the pr,s,nt of the
indicative"
(pp. 216-217); h. writ.s est "convertible" en 1 say, we say, that
La dernière expression est,
he writ.s.
"plé onasme" .
selon Gregory, un simple
Les modes impératif et optatif sont
"convertibles"
de la même manière et sans trop de problèmes.
Le
mode
résistance.
"the
interrogatif est celui qui présente
Il
y a une étape
supplémentaire,
resolution is still less perfect than in the
(p. 217). A la page suivante, il écrit
361
le
plus
de
et même
aprè s ,
other
moods"
The energy of interrogation, in point of thought,
admits of a more close and perfect combination
with the conception denoted by a verb,
than can
weIl be expressed by any circumlocution;
c. .. )
This,
which is so manifest with respect to the
interrogative mood,
is equally true with respect
to aIl other moods.
(Cette combinaison intime entre l'énergie mentale exprimée par le
mode et la conception dénotée par le verbe deviendra plus
dans un moment) .
l'on
puisse
D'après Gregory, la meilleure approximation que
donner
d'un
l' i mpérAti f
claire
du mode
verbe
interrogatif
d'affirmation
consiste
comme
prendre
à
"dire"
(d'où
nécessité d'une étape supplémentaire dans la résolution)
la
Ainsi,
de la phrase
1) Jules est-il venu?
•
nous passons d'abord à la phrase
2) Dites-moi si Jules est venu,
et finalement à
3) Je vous demande de me dire si Jules est venu.
Gregory analyse
exprimant
auss~
la résolution
ou
l'étonnement
d'énoncés
d'autres
(iii)
exclamatifs
émotions
comme
l'admiration ou la surprise, du genre "Qu'il est cruel, qu'il est
doux
d'être
père" (Diderot),
ajoutée au mode indicatif.
en
exprimé par une
Ainsi,
"que"
"Qu'il fait froid!" se résoud
"Je m'étonne qu'il fasse si froid", etc.
362
particule
le subjonctif,
Enfin,
pour Gregory,
est ambigu (" i t
many words in common language) has different meanings",
Il peut exprimer le souhait,
Sa
la supposition,
mentale
exprimée.
p. 219).
la condition, etc.
résolution se fera donc au moyen de différents
l'énergie
Cl ike
Il est constamment
verbes
selon
utilisé
à
la
suite, et est dans la dépendance, d'un autre verbe à l'indicatif.
Par ailleurs,
"the difference of meaning between the subjunctive
so
and
employed,
that of the indicative
1n
between it and the bare infinitive in others,
it
is
difficult
to ascertain it,
express
it in words"
Gustave
Guillaume
l'indicatif
positive,
(p.
dans
220) .
r•• ps
and
Il
et
sorne
remarque
subjonctif
s'utilisant
(9)
de
impossible
cependant,
est préférable lorsque l'affirmation
le
and
is so minute, that
perhaps
verb.
cases,
que
comme
l'usage
est
to
de
certaine,
préférence
lorsque
l'affirmation est seulement probable, incertaine, ou peu probable
SU1S so.r qu'il viendra"
("Je
versu.s
"Je ne suis pas so.r
qu'il
La troisième des conclusions de Gregory est formulée en
ces
termes
That the grammatical moods of verbs are concise
modes of expressing sorne of those combinations
of thoughts,
which occur most frequently,
and
are most important and striking. (P. 215)
Cette
dit-il,
conclusion est évidente
363
lorsque
l'on compare les modes grammaticaux avec les circonlocutions dans
lesquelles on les résoud. Comme elle est intimement liée aux deux
conclusions suivantes,
les "conclusions"
pré sente
dans
il ne la commente pas davantage. En fait,
3, 4, 5
la
et 6 mettent en relief la rationalité
création
et
l'utilisation
des
modes
grammaticaux.
Voici la quatrième
That the number of grammatical moods is limited
by the same circumstances which seem to limit
the variety, precision, and perfection of language,
in other respects;
and particularly by
the convenience of those who use it, and who in
general will have no more moods to their verbs,
and no more words or inflections of any kind,
than they have absolute occasion for;
and, of
course,
must often employ one mood as they do
one word, or one inflection, in various senses,
that
is,
to express occasionally different
thoughts. (pp. 215-216).
Le
nombre
des modes grammaticaux ne peut
forcément
d'un
nos
~tre
limité par la difficulté représentée
grand nombre
d'inflexions distinctes,
capacités cognitives
comment,
en
infini;
par
il
l'invention
par les limites
effet,
apprendre,
rappeler et utiliser correctement un très grand nombre de
inflexions,
limi té e.
dont
la
plupart
n'auraient
qu'une
de
se
telles
utilité
Il n'est donc pas étonnant que les langues ne
explicitement que les plus fréquentes de nos
est
très
marquent
énergies mentales :
"the most frequent of all combinations of thought with that which
364
is
the
general
interrogation,
meaning
command,
of
a
wish,
verb,
Occ.
such
pensée
226) .
"désagréables".
être, en principe,
même
énergies
paraissent
le plus rapide et
grammaticaux
non seulement qu'il soit très limité,
mode
puisse être
déterminantes
and
regulated by the
utilisé
pour
mais en plus
exprimer
diverses
Les préoccupations quotidiennes des
pour
labour
of
l'établissement
mankind
in
des
peuples
modes
"the
and
contriving,
being
their
chiefly
experience of what they daily had occasion for"
227).
La
cinquième conclusion de Gregory insiste sur
esthétique des modes grammaticaux,
la
pourrait
mais on comprend, en vertu de ce
precision and steadiness in employing such moods,
(p.
le
" ennuyeuses"
Le nombre des modes
trè s élevé;
mentales.
ingenuity
(affirmation,
qui sont plus ou moins équivalentes à leur mode
grammatical caractéristique,
qu'un
de
et c'est surtout pour ces modes de pensée que les
circonlocutions,
sont
importants
moyen de communication le plus simple,
qui précède,
called
etc.) que les modes grammaticaux s'imposent comme
plus efficace;
et
as may be
such
C'est justement pour ces modes
les plus fréquents et les plus
interrogation,
le
(p.
affirmation,
that are expressed by
inflections or variations of the primary verb,
grammatical moods"
as
beauté
l'animation
et à la perfection d'un
et
valeur
qui contribuent grandement
langage,
la force qu'ils donnent à
365
la
par
la
l'expression
à
brièveté,
de
nos
actes de pensée (co.binations of thoughts)
les plus faniliers
et
les plus intéressants, lesquels ne peuvent être exprimés avec les
mêmes avantages
par les
signification
216) ,
Pour
à
circonlocutions
leur mode
grammatical
appuyer ses dires,
des autres ,
par
grande
et d'imprimer avec force dans
De même,
que
l'Rrt d. parler (1675),
disait que
de
l'ame
(cité e
le Père Lamy dans
faute que d'utiliser plusieurs paroles
suffit",
définition
les sentiments profonds dont on est pénétré "
ou
(p,
"L'éloquence est le talent
Gregory aux pages 227-228) ,
Rh'toriqu.,
en
caractéristique
Gregory cite la
d ' Alembert donne de l'éloquence
faire passer avec rapidité ,
équivalentes
"c'est
lorsqu'une
sa
une
seule
Les modes verbaux sont ainsi présentés comme essentiels
à l'éloquence,
quel qu'en soit le genre,
A cet égard,
l'indicatif
(incluant ici le
subjonctif) ,
en dépit du fait qu'il soit par ailleurs l'un des plus importants
et des plus fréquemment utilisés parmi les modes verbaux,
moins
intéressant de
animé et le moins
émotions et passions s'expriment souvent
Cl es
gest es,
le
est le
Al' opposé,
tous,
les
par le langage d'action
ton
de
etc,)
voix,
presqu'aussi rapidement qu'elles sont conçues, Un langage fait de
sons articulés
et
(gra ••• tical language) aussi rapide que la
aussi concis que la langage d'action (n.tural
impossible à réaliser,
pensée
language)
est
mais toute amélioration allant en ce sens
représente un progrès appréciable: " All the moods of verbs, even
366
the
indicative
and
approximations"
the
234 ) .
(p.
simple
subjunctive,
are
Gregory multiplie les
such
exemples
et
citations de grands poètes grecs et latins où les impératifs, les
interrogatifs
et
prépondérante,
simplement
les
et
exclamatifs
remarque
occupent
une
place
que ces poésies deviendraient
tout
insupportables s'il fallait substituer aux modes
les
circonlocutions correspondantes.
Enfin,
la
supériorité
des
d'expression
pour
dernière
modes
conclusion
grammaticaux
de
sur
Gregory
concerne
tout
exprimer la liaison intime
autre
et les
la
moyen
relations
entre les pensées
That grammatical moods of verbs, like other
inflections of words,
express much better
than any succession of words can do,
the
intimate connection and relation of various
thoughts, which are not successive, but simultaneous or coexistent,
and which appear
unnaturally disjointed, and in some measure
altered,
when they are expressed by a
series of words denoting each of them separately and in succession. (P. 216)
Une
langue
possédant
un
système
de
flexions
(nominales
verbales) fait davantage justice à la liaison intime des
pensées
dans l'esprit du locuteur que tout autre procédé grammatical,
particulier
l'ordre
des mots,
qui semble désunir
cette liaison sans pouvoir la traduire adéquatement.
et
en
relâcher
Nous
rencontré ce phénomène plus haut avec le mode interrogatif.
367
ou
avons
Gregory
lui
avoue que pour traiter cette question
faudrait
une
dissertation beaucoup plus
nature de la pensée humaine.
inventions humaines;
à
fond
il
sur
la
élaborée
Les langues sont la plus noble
par leur contribution à la précision,
à la
stabilité des pensées et à l'analyse (deco.position) de la
des pensées qui nous assaillent à tout moment,
"the
chief
dans
impropres
pensées
une
à
certaine
l'expression adéquate des pensées
utilisés
pour les exprimer
selon l'espace (pour l'écrit)
Il
trait
l' "idéisme"
à
contemporains,
is
person
un
who
hypothesis
place;
can
of
que
les
âtre
les
signes
ordonnés
(pour l'oral).
ne
sont
pas
la place qu'elles occupent les unes
ou
"représentationnalisme"
lancer
ses
de
le Nay of ideas décrié par son ami Thomas Reid
self-evident,
of
aspect,
Et il profite de l'occasion pour
par rapport aux autres.
order
ou le temps
doivent
(p.
et sont
alors
est évident pour Gregory que nos pensées
ordonnées selon la position,
"It
moins
sont simultanées dans l'esprit du locuteur,
artificiels
un
reason"
sont t out es imparfaites
mesure et sous au
masse
elles constituent
instrument in the improvement of human
240) . Mai s l es langues humaines
même,
des
that thoughts cannot be arranged
at least this will be
shake off the
ideas,
or
long
images of
368
self-evident
established
things
1n
in
to
the
every
philosophical
the
mind,
as
subservient
to thought"
240-241).
à l'immatérialisme (Berkeley),
Les
(10)
mouvement
Pour les
co •• on
le N.Y of ideas est une voie de garage
Philosoph.rs,
soit
(pp.
Beattie,
conduisant
soit au scepticisme
grammairiens philosophes que l'on peut
(Buffier,
sense
(Hume)
rattacher
Gregory) ne fondent donc
pas
Grammaire Générale sur une "théorie des idées" semblable à
de leurs contemporains.
Les historiens de la
qui
place
font
une
large
"rationalistes" et "empiristes"
moins
un
strapontin
aux
aux
au
la
celle
Grammaire Générale
grammariens
philosophes
ne devraient-ils pas réserver au
"grammairiens
philosophes
du
sens
commun"?
Il y a bien des pensées qui sont ordonnées selon le temps,
et
cette
langage
succession
oral.
ordonné es
the
et
various
Mais
c et
peut être assez bien
représentée
beaucoup de nos pensées ne sont
ordre
relations
n'ont
aucune
pas
le
ainsi
"i s perhaps the l east important of aIl
of
thoughts"
241) .
(p.
propositions mathématiques expriment des pensées
qui
par
relation au temps
et
ces
Ainsi,
les
"c o-exi stant es"
lit 0
pensées,
be
conceived rightly or at aIl, must be conceived at once" (p. 243).
Les
plus
diagrammes et les formules algébriques sont les
appropriés
Il
moyens
les
à cette fin.
arrive donc souvent que nous ayons à la fois
369
un
grand
nombre de pensées diversement reliées les unes aux
pouvons
d'un
vouloir les exprimer toutes ensemble,
seul coup,
autres.
Pour
des
l'atteinte
instruments
premier
"Hence
de ce dernier
adéquats,
objectif,
mal.s pas
the superiority of
241-242) ,
(pp.
dire
les
des
langues
pour
those
l'atteinte
languages
du
which,
admit of great variety
supériorité qui s'exprime
dans la poésie et l'éloquence,
lui Adam Smith
ainsi
pour
faisant appel à l'ordre des mots
having many and distinct inflections,
arrangement I l
Nous
ou encore les analyser les unes à la suite
(comme le français et l'anglais)
sont
autres.
of
surtout
comme l'avait déjà remarqué avant
(11)
Le système des modes verbaux,
commun aux langues anciennes
aussi bien qu'aux langues modernes, fait partie de ces inflexions
"we express the simultaneous combinations of
par lesquelles
interrogation,
thoughts
au
moyen
(p.
242) ;
la même combinaison de pensées, exprimée
d'une circonlocution employant au
moins
deux
("Faites-lei" v.rsu.s "Je vous ordonne de le faire"),
ce qui est conçu
rendue avec la même promptitude;
est
cité
présenté séparément et successivement.
montre
assez
clairement
distinction .odu.s/dictu.•.
wish,
expressed
command, and many others, with the thought or .ccident
by any verb"
the
comment
Le
Gregory
verbes
n'est
plus
simultanément
dernier
passage
concevait
La combinaison de pensées exprimée par
le mode verbal est une combinaison entre une "énergie" C.odu.s)
les
diverses
la
conceptions exprimées par le verbe et
370
les
et
autres
parties de l'énoncé liés par les liens syntaxiques.
Il
Y a enfin un dernier point très
théorie des modes de Gregory
remarquable
dans
il jette les bases de ce que nous
appellerions aujourd'hui une "pragmatique des modes"
il montre,
mis
de
en multipliant les exemples,
En effet,
qu'un mode est
souvent
à la place d'un autre qui exprimerait littéralement le
pensée du locuteur.
d'un
mode
grammatical
Ilmétaphorique"
un
autre,
(manifestement
une
Gregory
allusion
le
ari st oté l ic i enne de la mé taphore comme Iitransport,
d'un nom qui en désigne une autre"
à une
(Poftiqu.., 1457b).
alors .d onnez 111 j
"Etes-vous généreux?
de
dé fini t ion
chose,
Ainsi,
"Si vous @tes généreux, alors donnezl",
lieu de dire
dire
qualifie
la
à
mode
Iitransport ii
ou
Ce genre de "transfert"
à
la
de m@me,
au
on peut
au lieu
d'utiliser l'impératif pour commander, on peut se servir du futur
IITu iras 111
de l'indicatif
ton menaçant
"Iras-tu?".
de ce genre
IINe
pour
"pragmatique"
des
Les
fait-il pas
fait un temps
"Il
l'interrogatif avec un
ou m@me de
,
questions rhétoriques sont aussi
un
superbe
modes rappelle
temps
superbe aujourd'hui?"
auj ourd' hui Il,
par moment le
actes de discours indirects proposé par
Searle
etc.
Cette
traitement des
(12),
développant
les indica t ions cont enues dans "Logic and Conversa t i on" (1975) de
H. P.
Gricej
inférences on
locuteur".
Il
mais Gregory
doit passer
se
contente
n'indique pas clairement par quelles
pour "calculer" la
d'illustrer
371
par
"signification du
des
exemples
ce
transport d'un mode à un autre.
L'essai de Gregory se termine sur quelques considérations à
propos
de
l'origine des langues et la genèse
modes,
afin
hypothè se
surtout
ou
"thé ori e
de mettre en évidence
conjecture de ce genre n'est
des
modes verbaux"
hypothè ses
général es
première,
les
sur
langues,
dépourvues d'inflexions,
Les
à
fruit
les
manifestés,
peuples
d'une
étaient
fort
la
deux
Selon
la
simples,
usage
inflexions,
invention
note l'auteur,
faisant
par
distingue
progressivement,
Ces
partout
qu'aucune
langues.
comme les
furent ajoutées lentement,
monosyllabiques,
fait
des
et pour une large part monosyllabiques.
complexités grammaticales,
etc. ,
Il
des
l'origine,
le
présupposée
de l'auteur.
l'origine
hypothétique
affixes,
aux
humaine
progrè s ne
d'idéogrammes
ou
délibérée
sont
se
comme chez les
de
racines
pas
Chinois
ou
caractères
hiéroglyphiques.
Selon l'autre hypothèse,
furent
words
polysyllabiques,
of
complicated
them
being
meanings,
les langues,
comme les langues
dès
leurs
début s,
amérindiennes,
"the
of
very
like phrases or whole sentences of
ours "
very
long,
and
significant
(p. 248), ces très longs mots exprimant d'un coup un grand nombre
de pensées,
sans séparer le nom du verbe, l'agent et l'accusatif
372
du
verbe,
évolué
en
le mode de l'action,
décomposant ou en
etc.
Ces langues
fractionnant
ces
ensuite
ont
"mots-énoncé s",
réduisant ainsi la taille des mots qui pouvaient recevoir par
suite
de
nouvelles
l'humanité,
articulée,
nette
et
Suivant
cette
n'aurait pas perçu tous les avantages d'une
des parties du discours pour l'aisance de
de
hypothèse,
dans ses premiers efforts pour se donner une
l'usage,
communication.
et pour la clarté
et
la
langue
division
l'apprentissage
précision
de la
<13)
la première hypothèse,
Selon
selon
inflexions.
la
la seconde,
les modes ont
été
ils ont été retenus ou conservés.
.jout4Sj
Aucune
de
ces hypothèses n'est assumée par Gregory, dont le but n'était que
d'examiner
avec
prédécesseurs
plus
de
précision
et
(en particulier Monboddo) ,
des modes verbaux.
***
373
de
rigueur
que
ses
la nature et la valeur
NOTES
(1) Ian Michael (1970, op. cit., p. 427) présente Gregory comme
un professeur de médecine à Edimbourgh.
En anglais,
physician
peut vouloir dire aussi bien "médecin" que "physicien". Il semble
bien que Gregory ait été l'un et l'autre,
car l'en-tête du texte
que nous examinons ici porte en page frontispice la mention
"Fellow of the Royal College of Physicians,
and Professor of
the Theory of Physic in the University of Edinburgh".
(2)
Cf.,
la bibliographie de Charles Porset,
6ra •• atista
philosophans,
in Joly et Stefanini,
1977, p.
81, qui porte la
mention:
"1792 Gregory (J.). Philosophical and Lit.rary Essays.
Edimburgh, 2 vol."
(3)
James Gregory,
"Theory of the Moods of
Verbs" ,
Transactions of th. Royal Soci.ty of Edinburgh, 2, 1790.
in
(4)
Reid tenait en haute estime Gregory,
comme en témoigne la
dédicace de ses Essays on the Intellectual PON.rs of Han
(1785),
Cambridge (Mass.) et Londres, Presses du M.I.T., 1969) i l'ouvrage
est en effet dédié à ses chers amis
(D •• r friends)
Dugald Stewart, et James Gregory ("Professor of the Theory of Physic") i inversement,
Gregory retiendra plusieurs idées de Reid
Coutre
la notion d'opération sociale de l'esprit)
dans sa théorie des
modes, comme en témoigne les passages suivants tirés de l'ouvrage
de Reid :
There are, in aIl languages, modes of speech,
by which men signify their judgment,
or give
their testimonYi
by which they accept or refuse; by which they command, or threaten,
or
supplicate; by which they plight their faith
in promises and contracts. If such operations
were not common to mankind, we should not
find in aIl
languages forms of speech, by
which they are expressed.
AlI languages,
indeed,
have their imperfections; they can never be adequate to aIl the
varieties of human thought...
CP. 54)
(5)
Cf.
1. Michael, op. cit., p. 428; selon Michael, l'auteur de
374
l'article en question dans l'Encyclopa.dia Britannica,
1797, p.
66,
ne se contente pas de reproduire simplement Gregory sur les
questions relatives aux modes;
il insiste davantage que lui sur
les critères morpho-syntaxiques
et lui reproche de faire de
l'infinitif un mode verbal; toutefois, nous verrons plus loin que
ce reproche n'est pas fondé (cf., note suivante).
(6) Il est donc incorrect de reprocher à Gregory d'avoir fait de
l'infinitif un mode,
comme l'affirme l'auteur de l'article
"Grammar" (note précédente) et comme Michael le laisse entendre;
sa position est que l'infinitif n'est pas
(en tout cas pas
toujours) un simple nom verbal,
qu'un verbe ne cesse pas d'être
verbe
lorsqu'il
prend les
terminaisons
de
l'infinitif,
contrairement à ce que soutenait Monboddo; mais l'infinitif n'est
pas un mode pour Gregory,
car il n'exprime aucune énergie
mentale,
propriété commune et essentielle à tous les modes
grammaticaux.
(7) Cf., Thomas Reid, 1785, op. cit., p. 73.
(8) Les intuitions de Gregory semblent ici rejoindre
(en partie
du moins) celles de Searle & Vanderveken, pour qui 3)
implique
illocutoirement 1),
alors que 1) implique illocutoirement 2)
les deux énoncés expriment des actes illocutoires strictement
équivalents (ayant les mêmes conditions de succès); par contre,
1)
n'implique pas illocutoirement 3). Cf.,
par exemple,
D.
Vanderveken,
Les actes d. discours,
Liège-Bruxelles,
Pierre
Mardaga, 1988, p. 152
D'un point de vue logique, le type des énoncés
interrogatifs n'est donc pas aussi
simple que
les types déclaratif et impératif,
comme cela
se montre linguistiquement dans le fait que
tout énoncé interrogatif implique illocutoirement un énoncé impératif dont le marqueur syntaxiquement complexe exprime la force directive dérivée de demande.
Ainsi,
par exemple,
l'énoncé
interrogatif
"Est-ce qu'il neige?"
implique illocutoirement l'énoncé
"S'il vous
plaît, dites-moi s'il neige!".
Paris,
(9)
Gustave Guillaume,
1965, pp. 30 et suiv ..
Champion,
(10) Cf. Lia Formigari,
"Le Nay 0 f i dttas et le langage moral" ,
dans Histoire. Epist4.olo9i •• Lan9a9.,
VII-2 (1985),
pp. 15-33;
en particulier, p. 23.
375
(11)
Cf.,
Adam Smith,
"Considérations sur l'origine et la
formation des langues" (1759), dans ~aria linguistiea, éd. par C.
Porset
(op. eit.),
en particulier à partir de la page 341.
Condillac
(nous
l'avons vu dans la première partie)
insistait
également sur ces avantages des
flexions casuelles pour la
versification.
(12) Cf., John Searle,
"Indirect Speech Acts",
dans Expression
and Heaning, Cambridge, C.U.P., 1979; première parution dans Syntax and Se.anties, Vol. 3, Speech Rets, édit, par P. Cole et J.
Morgan, Academic Press, 1975.
(13)
Michel Bréal,
dans Essai de s'.antique.
Science des
significations (1897),
Genève,
Slatkine Reprints, 1976, p. 357,
rapporte
qu'on a pu calculer que le verbe sanskrit
est
susceptible
de
prendre jusqu'à
891
formes
différentes!
"Heureus ement ,
tout
n'est pas
employé"
aj out e-t-i 1 .
En
comparaison,
dans une langue moins "ancienne", comme le grec, le
verbe
peut prendre jusqu'à 249 formes
(sans compter
les
infinitifs et
les participes).
Bréal signale lui aussi que les
langues amérindiennes (et le basque) ont tendance "à englober la
phrase entière dans le verbe" (ibid.), à l'instar du sanskrit.
***
376
SECTION II
L'APPROCHE REDUCTIONNISTE DES MODES VERBAUX
Dans la théorie des actes de pensée examinée
les
énoncés
non déclaratifs
l'indicatif)
sont
d'exprimer
des
catégorique.
Des
commandement,
également
des
(et les modes
moyens
de
pensée
autres
actes
de
pensée
comme
le
souhait,
exprimés
verbaux
conventionnels
actes
l'étonnement,
par des énoncés
précédemment,
autres
et
que
que
li ttéraux
le
jugement
l'interrogation,
etc. ,
déclaratifs,
le
peuvent
Ê3tre
car
peut
on
déclarer ou affirmer qu'un souhait, une interrogation, etc., "est
en
nous".
verbes,
Mais pour le faire,
expriment
bien
Ces énoncés déclaratifs contenant deux verbes
des jugements (le plus souvent des
"réduit"
jugements.
forme
toutes
à
les
énonciations
à
des
expressions
de
Tous reconnaissaient parmi les opérations de l'esprit
diversité
d'actes de pensée,
une
énonciation,
propositionnel".
chacun
d'expression
caractéristique
admettaient
les
jugements
mais aucun des auteurs examinés jusqu'ici
propos de nous-mêmes)
une
deux
le premier dénotant un acte de pensée, et le second, une
action ou un état.
ne
nous avons alors besoin de
pouvant
littérale;
distinction entre le .odas et le
entre
un
élément
trouver
modal
et
tous
et
dicta.
un
une
d'une
"radical
Ces grammairiens philosophes ne traitent jamais
énoncés non déclaratifs comme des expressions
de jugements.
377
"elliptiques"
Dans l'approche réductionniste des modes verbaux que
abordons maintenant,
analyse,
toutes les énonciations se réduisent, après
à l'expression de jugements, c'est-à-dire à des énoncés
susceptibles d'être vrais ou faux,
quant
nous
au
"fond de pensée".
et qui leur sont
Cette approche
est
équivalents
principalement
défendue (et sera ici illustrée) par Buffier, Beauzée, Condillac,
Beattie
et Destutt de Tracy
Gébelin,
(mais aussi par
et quelques autres)
Restaut,
Court
Les énoncés non déclaratifs
de
sont
(pour la plupart de ces grammairiens) des expressions elliptiques
de jugements,
et le jugement est,
à proprement parler,
car "nos
acte de pensée retenu par ces grammairiens philosophes;
jugements,
écrit
On
Beauzée,
sont les seuls objets de
traduire en termes
pourrait
options de la manière suivante
Du Marsais,
Harris,
ne
être
peuvent
d'autres
ces
deux
(Port-Royal,
Monboddo, Gregory), toutes les énonciations
évaluées en termes de
dimensions
l'oraison"
contemporains
pour les premiers
le seul
conditions
de l'interlocution doivent être
de
vérité;
prises
en
compte, car celui qui pose une question, par exemple, ne veut pas
seulement
affirmer
qu'il
savoir,
veut
il
attend
aUSS1
une
réponse, comme le dit clairement Harris. Pour les seconds, toutes
les énonciations peuvent être,
de conditions de vérité.
Cette
après analyse, évaluées en termes
seconde approche représente,
378
il
me semble, une application plus étroite de la "logique classique "
à la grammaire;
et nous verrons que la notion d'id je
accessoire
(ou simplement d'''accessoire '' ) y joue un rôle de premier plan.
* * *
379
CHAPITRE SIXIEME : BUFFIER
La
nouveau
première partie de la 6ra •• air~ fr.nçois. sur
(1709)
(1)
du jésuite Claude
Buffier
est
un
une
plan
sorte
d'abrégé de Grammaire Générale. Ce philosophe du sens commun
précurseur des philosophes écossais de la fin du siècle,
(2),
fut
un
logicien et un grammairien influent.
Pour lui,
la Grammaire est "l'Art de réduire à
règles le langage ordinaire des hommes" (p.
amas
de
réflexions,
faites
1) ,
certaines
ou encore
& arrangées pour enseigner
"un
& pour
apprendre une langue" (p. 46); et une langue "est la manière dont
une
certaine quantité d'hommes sont insensiblement
convenus,
&
ont acoutumé d'exprimer mutuellement leurs pensées par la parole"
(p.
La perfection d'une langue,
46) .
d' aprè s lui,
consiste 1°
dans l'abondance de ses expressions; 2° dans la netteté ou clarté
avec laquelle elle permet de s'exprimer (sans ambiguïtés);
dans la brièveté de ses expressions.
La
tâche
d'une
grammaire
d'''apprendre à parler comme on parle";
380
particulière
est
donc
elle doit donner les lois
qui
régissent
meilleurs
n'est
sont
fantaisie,
le
le
plus
même Sl. la
souvent
se
le fruit
ré former.
Cour")
du
Or,
hasard
et
les
la
"
(p.
"p art a gé " ;
s'applique aux termes qui sont utilisés de
la
manière par la plupart des locuteurs compétents de la langue
"partie
sal.ne de la Cour"),
varier
d'un
et l'autre aux cas où l'usage
locuteur à un autre.
Buffier
matière de langue au phénomène de la mode
compare
de
de
"raison peut y aVOl.r quelque part.
Buffier distingue l'usage "constant" de l'usage
premier
des
c'est à la grammaire
ses règles et non à l'usage de
usages
celui
écrivains et de "la partie la plus saine de la
pas en accord avec la grammaire,
changer
14)
l'usage et si l'usage (en particulier
l'usage
"La raison peut
même
(la
peut
en
s'y
trouver, ou ne pas s'y trouver, que la mode aura toujours le m@me
empire"
Il affirme que la raison n'a rien à voir
(ibid,,) .
les langues, sinon pour les étudier;
"N'est-il
prescri t
mais plus loin il demande :
pas toujours conforme à la - raison de parler
l'usage?".
avec
comme
le
(N' est-c e pas là, au fond, une appl ica t i on de
la "maxime de stabilité" découverte par Dominicy dans les oeuvres
du grand Arnauld?) .
de
l'usage,
il
Y
Quoi qu'il en soit, en dépit de l'arbitraire
a des observations
dans
la
grammaire
conviennent à toutes les langues; il y a un "ordre naturel"
qui
dans
les langues comme il y en a un dans nos pensées.
Il
Y a,
selon Buffier,
trois espèces de mots
nécessaires dans toutes les langues
381
les noms,
qui
les verbes,
sont
et
les
"modificatifs"
ajoutent
parlons
quelque
aux
(adverbes, prépositions et conjonctions) qui
chose au nom ou au
autres,
verbe
le plus souvent,
d'un
pour dire
énoncé.
Nous
ce
nous
pensons à. propos de quelque chose que nous concevons.
que
Puisque la
structure du jugement est la même partout et pour tous,
il
donc que toutes les langues dignes de ce nom disposent de
permettant l'expression du jugement.
de
supplément' "
modificatifs,
et
les
"le no. &
verb. sont les plus essentielles parties du langage "
"termes
moyens
Mais seuls les noms et
verbes sont vraiment "essentiels" à tout langage
ces catégories d'expression,
faut
(p.
49) .
le
A
Buffier ajoute ce qu'il appelle les
qui se composent de
noms,
dont la principale fonction est
verbes
ou
d'abréger
le
discours.
(Abréger le discours, faire beaucoup avec peu, n'est-ce
pas
instance de notre premier principe de
une
[P.l ,
choix
rationnel
première partie, chapitre premier, section 5], le principe
d'efficience enjoignant de faire le choix du "meilleur" moyen [le
plus
"satisfaisant"
dans les circonstances],
ce
moyen
devant
être aussi peu "coo.teux" que possible?) .
La définition du verbe de Buffier est très proche de
de
celle
Port-Royal
64) .
Il insiste sur
le
fai t que l'affirmation est "essentielle" au verbe (pp. 64 et 75) .
Mais il ne dit pas, comme les grammairiens de Port-Royal, que son
"principal usage" est de signifier l'affirmation;
382
en fait,
pour
Buffier,
il s'agit de son seul usage.
Et il précise que ce
qui
est ou peut être affirmé du sujet,
c'est soit ce qu'il est, soit
ce qu'il fait,
soit une action.
donc soit un état,
bien vu Sahlin (1928)
premiers
et Nuchelmans
grammairiens
(1983),
s'écarter
à
de
Comme l'ont
Buffier est l'un des
la
conception
de
la
proposition de Port-Royal et à favoriser une analyse bipartite en
Sujet-attribut.
Les
modes
conséquence,
souvent
dépendent
ils
arbitraires
arbitraires;
car
temps
du
verbe,
l'usage a introduites"
modes en français
encore
71) .
(p.
que",
différentes
"Les deux modes
L'indicatif,
Le subjonctif, lui,
que
deux
appelle
qu'il
faut
& le
comme à Port-
une
d'un
"avant que",
ne s'emploie qu'en supposant
ou à la suite
"quoique" ,
affirmation
(ou
d'une autre.
jugement),
Le "que"
verbe est le signe d'une
383
d'une
etc. ,
que nous préciserons plus loin)
"dépendant e"
suite
certains
sert à exprimer des jugements catégoriques "indépendants"
contextes
aussi
des
à
en françois sont l'indicatif
autre verbe (à l'indicatif)
("afin
toujours
Buffier ne reconnaft que
71) .
particulièrement
de tout autre.
un
terminaisons
en
& y sont
liindicatif et le subjonctif (qu'il
conjonctif ou subjonctif"
Royal,
souvent,
mais seulement à énoncer
quelquefois "conjonctif")
distinguer
sont
"dépendent de l'usage
par des
(p.
et
ne servent pas
ils
significations particulières;
mêmes
l'usage
de
conjonction
et dans
certains
Il exprime donc
mais
une
affirmation
(un "modificatif") mis à
modification
lui
apportée
la
au
verbe,
comme
le "qui" à la suite d'un nom est le
signe
modification (proposition incidente) apportée au nom.
d'une
(Le pronom
relatif que chez Buffier est donc un "modificatif de verbe") .
La grande innovation dans la théorie des modes de
concerne les formes en -rais,
non
au subjonctif,
Les
formes en -rais
qu'il rattache à
comme Port-Royal
Buffier
l'indicatif,
(et après lui Du
indiquent l'affirmation,
et
Marsais).
s'utilisent
sans
"que" et ne sont pas mises à la suite et dans la dépendance
d'un
autre verbe à l'indicatif.
de
l'indicatif,
incertain".
ait
Buffier fait du conditionnel un temps
dont la fonction serait d'exprimer
un
"temps
Buffier est donc l'un des premiers grammairiens
sérieusement
contribué
"c ondi t i onnel-t emps"
contemporains
comme
que
l'élaboration
à
l'on
Gustave
d'une
trouve
chez
des
Guillaume
(cf.
les
linguistique de 9ustave 9uillau •• ,
1948-1949,
théorie
qui
du
linguistes
Leçons
de
p. 135 et suiv.).
Il appartiendra toutefois à Girard (1747) d'en faire,
le premier,
un mode à part.
Buffier ne reconnatt pas de mode impératif en français, car
ses
terminaisons ne se distinguent pas de celles de
ou du subjonctif.
"l'impératif
(Guillaume [1971,
indicatif"
et
384
p.
l'indicatif
237] distingue de
"l'impératif
m~me
subj onct if") .
Relativement
au
d'abréviation
plutôt qu'un verbe;
sens,
"c'est
un
terme
de
supplément
et quand je dis fait.s
ou
cela,
ces mots suppléent à ceux-ci, .a volont. ou .on avis est que vous
fassiez cela."
nous
CP,
74) ,
Les impératifs marquent "la volonté que
avons qu ' un autre fasse certaine chose;
lui commandons,
parce que nous
le lui conseillons ou l'en prions.
Ainsi, venez
signifie Je vo«s ordonne ou je vo«s conseille ou
vo«s prie ou je vo«s exhorte de .e venir tro«ver"
"Dites-vous
cela?" supplée à "Je vo«s de.ande si vous dites cela " ,
réponses
aux
supplément" ;
à
"J. vo«s de.ande quand vous
et
"non"
sont des
et " Quand
viendrez " ,
questions sont aussi très souvent des
"oui"
je
Cp, 87),
Il en va de mÉ3me des phrases interrogatives
vi endrez-vous?" ,
le
"termes
abréviations
pour
Les
de
des
propositions entières,
Les interjections sont également des "termes de
supplément"
qui suppléent soit à un mot ou groupe de mots, soit à des phrases
entières,
pour exprimer la douleur,
" quelque
autre
mouvement
le mépris, l'étonnement, ou
l'âme" .
de
Enfin,
les
verbes
impersonnels sont encore présentés comme des abréviations; ainsi ,
, ,I 1
gr É31 e"
=
" La
gr~le
tombe",
nécessité exige", etc,
385
"Il faut"
=
"Le
devoir
ou
la
Seuls
l'indicatif
grammaire de Buffier,
et le
subjonctif
reçoivent,
dans
la
le statut de mode. Tous les verbes servent
ainsi à marquer des jugements,
tantôt catégoriques, autonomes et
directs, tantôt dépendants et obliques. Pour les autres modes, et
pour
les
énoncés
interjections) ,
et Du Marsais,
non
déclaratifs
(interrogations
et
Buffier n'hésite pas, contrairement à Port-Royal
à recour1r aux
explications traditionnelles
par
l'ellipse. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisque son approche, nous
l'avons vu,
nos
est réductionniste, et si on doit montrer que toutes
énonciations
faire
qu'en
supplément" .
expriment bien des jugements,
on ne
explicitant ce qui est abrégé par
en
le
"termes
de
que
nos
énonciations n'expriment pas toujours des jugements,
et que
les
différents
des
destinées
Il
les
peut
types
à
va bien sÜr autrement si on admet
syntaxiques d'énoncé ne sont
abréger le
discours.
Enfin,
pas
les
formes
réflexions
de
Buffier sur le conditionnel seront plus tard reprises par Restaut
deux
du
conditionnel un temps de l'indicatif se rapportant au futur),
et
ces
Buffier
et
Restaut -- auront sans doute pavé la voie à la reconnaissance
du
(1730)
et
réflexions
conditionnel
en
Destutt
français
de
Tracy (1803)
théoriques
(qui
-- du moins
font
celles
tous
de
(autrement nommé "suppositif") comme un mode à
dans
les Vrais principes de
(1747) de l'abbé Girard.
386
la
langue
part
française
Buffier
distingue
avec grand soin les
contextes
subjonctif s'emploie de préférence à l'indicatif.
où
le
Nous avons
vu
qu'il s'emploie à la suite de certaines conjonctions
("afin que",
"avant que", "quoique", bien que", etc.); il mentionne de plus un
grand nombre de verbes qui engendrent des contextes intensionnels
et qui appellent le subjonctif. On doit en effet l'employer
Après les verbes qui signifient quelque mouvement de l'âme;
comme je v~ux,
je d'sire,
je co •• and., je d4f.ns, je prie, je pro.ets,
je crains, je dout., &c.,
ou après les
impersonnels, il faut, il est ~ propos, i l est
difficile,
ou ceux qui ont même signification. .. (P. 227).
Les verbes d'attitudes propositionnelles (modalités
-- et,
en général, psychologiques, les verbes illocutoires (pour
les "modalités illocutoires")
est
épistémiques
n'cessaire,
etc.)
et les "verbes modaux"
appellent
donc,
le
plus
Cil faut, il
souvent,
le
subjonctif plutôt que l'indicatif. Quand ces verbes ont un nom ou
pronom
pour
régime,
on met l'infinitif au lieu
"Je vous commande d'agir", et non
lorsqu'ils
subjonctif
sont
(e_g_
employé s
après
régime (._g_
à
"Je vous commande que
Il
par
interrogation",
"Je ne crois pas que vous
rapporte qu'il l'ait vu",
même,
subjonctif
Lorsque les verbes sont précédés de ne ou de si,
vous agissiez")
ou
du
on
met
"S'il
mentiez",
IIEst-i l certain que cela soi t? I l )
le
De
•
sauf lorsqu'il a un pronom
pour
"Il •• semble que vous avez peur", par opposition
"Ils embl e que vous ayez peur") .
De même encore
après
relatif qui précédé d'un superlatif ou d'un "nom négatif" (e_g_
387
le
"Le ./pilleur parti qui soit",
"Le plus beau qui soit",
"HuI que
je sache") .
L'infinitif et le participe, comme l'impératif, ne sont pas
L'infinitif ne marque pas l'affirmation (qui
non plus des modes.
est
essentielle
au
verbe);
Buffier en
fait
un
simple
"nom
substantif". Même chose pour le participe, dont il fait, comme la
plupart des grammairiens,
un "nom adjectif"
(à
tout le moins les
grammairiens qui n'excluaient pas encore les adjectifs du domaine
des
substantifs,
grammairiens
comme
anglais
le feront plus tard Harris
après
lui
grammairiens français après lui)
***
388
et
Condillac
et
les
et
les
NOTES
(1)
Claude Buffier, Sr •••• ire françoise sur un plan nouveau,
Paris,
chez Nicholas Le Clerc,
Michel Brunet,
Leconte &
Montalant, 1709.
(2)
Emile Bréhier (Histoire de 1. philosophie,
II, XVII--XVIIIsiècles,
Paris,
PUF,
1930 et 1938;
1983 pour la dernière et
présente édition),
réserve une courte section
(pp.
293-295)
à
Buffier sous le titre:
"La philosophie du sens commun " ,
où il
écrit
" Cette oeuvre n'a guère été mise en évidence qu'à la fin
du siècle, lorsque Reid et les philosophes écossais montrèrent en
lui un précurseur de leur propre philosophie du sens commun:
la
traduction anglaise du Tr.it4 des pre.itres v'rit's
(1717),
qui
parut en 1780,
les accusait m~me formellement
d'avoir plagié
Buffier" (p.
293). Toutefois, Bréhier ne mentionne pas le fameux
Cours de sciences sur des principes nouveaux et si.ples, pour
for.er le 1.n9.ge, l'esprit et le coeur dans l'usage ordin.ire de
la vie,
Paris,
chez G. Cavelier et P.-F. Giffart,
1732,
où
Buffier développe son analyse bipartite de la proposition. A ce
sujet, Nuchelmans (1983), pp. 90 et 182; cf.,
aussi pp.
67-68,
comme critique de Descartes;
et pp. 80-81 et 83, pour sa
remarquable interprétation des propositions relatives "explicatives" .
Nuchelmans fait voir,
en effet,
comment Buffier fait
intervenir,
à
la manière de Grice
("Logic and Conversation "
[1975]),
ou de Benoit de Cornulier (cf.,
Effet d. sens, Paris,
Editions de Minuit,
1985), des maximes conversationnelles pour
conserver à l'analyse logique la plus grande simplicité possible.
Pour les Messieurs,
en effet,
la fausseté
d'une relative
"explicative" ne rend pas toujours la proposition totale fausse;
comme "Alexandre,
qui n'était pas fils de Philippe, vainquit
Darius";
mais pour Buffier,
cette phrase s'analyse comme une
conjonction de deux propositions : "Alexandre n'était pas le fils
de Philippe" & "Alexandre vainquit Darius".
Comme la
première
est fausse,
la proposition totale l'est aussi. Mais ce serait
"une impolitesse ou une injustice dans le commerce de la vie
civile" de contredire le locuteur et de tenir pour fausse son
é nonciation!
Notons toutefois que les Messieurs mentionnent
certains contextes où la fausseté de l'incidente affecte la
389
fausseté de la proposition principale, comme dans "Alexandre, qui
n'était pas fils de Philippe,
était petit-fils d'Amintas " j dans
ce cas, parce que "l'attribut de la proposition principale
( ...
ayant ... )
rapport à la propos i t i on inc ident e,
"la faus s eté de
la proposition incidente (...
rend ... ) fausse
la proposition
principale" (Arnauld & Nicole,
L. logiqu.e,
ou. l'~rt dit pftnsftr,
op. cit, p. 171.).
***
390
CHAPITRE SEPTIEME: NICOLAS BEAUZEE
Dans sa Gr •••• ir. g'n'r.l.,
~l~.ents
ou .xposition
du l.ng.ge (1767),
n~cess.ires
l'encyclopédiste Beauzée
(le célèbre successeur du non moins célèbre Du Marsais)
longuement
Royal
la conception du
pour
verbe des
finalement développer une
sans rappeller celle de Du Marsais
grammairiens
critique
de
conception qui
<1>:
d.s
r.isonn~.
Port-
n'est pas
"les verbes sont des mots
qui expriment des êtres indéterminés, en les désignant par l'idée
précise
de
(Gr •••• ir~
attribut"
nouveau
l'existence
ici,
ce
intellectuelle
g~n~r.le,
sont
les
d'''existence intellectuelle",
dé signent
les
êtres
idé es
indéterminés qui sont
dé signent,
des
eux,
etc,
relation
Ce
402) ,
p,
d' "êtres
Les verbes,
des "êtres indé terminé Sil
indéterminés qui marchent,
à
un
qui
est
indé terminé s"
comme les
comme "blanc" désigne
,
blancs,
conçois dans mon
"marche",
les
tous
~tres
Par contre, les noms et pronoms
êtres
esprit;
et
adjectifs,
"déterminés" ,
L'''existence
c'est l'existence qu'a un sujet en tant que
intellectuelle",
le
Tome 1,
avec
ainsi,
un cercle-carré
n'a
je
pas
d'existence réelle, mais il a une "existence intellectuelle" dans
mon esprit lorsque j'affirme
<::z >
d' i mp 0 s s i b le"
conçue
cette existence
intellectuelle
en relation avec un attribut qui la qualifie de telle
telle manière,
sujet
Enfin,
"Un cercle-carré est quelque chose
avec
La
p~rception
relation
de l'existence intellectuelle
à un attribut
391
n'est
rien
d'autre,
est
ou
d'un
pour
Beauzée, que ce que les logiciens appellent "jugement".
Le caractère distinctif
de
l'existence
attribut.
Il
du verbe est donc d'exprimer l'idée
intellectuelle
n'y
d'un sujet avec
a pas de discours sans
relation
proposition,
à
un
pas
de
proposition qui n'exprime un jugement, et comme un jugement n'est
pas
autre chose que la perception de l'existence
d'un sujet avec relation à un attribut,
intellectuelle
il n'y a pas non plus de
proposition sans verbe CSra ••• ir. g4n4r.l.,
Livre II,
chap. IV,
p. 395). Plus loin, il écrit
Mais puisque les Verbes sont d'une nécessité
absolue pour exprimer nos jugements,
qui sont
nos principales pensées & les seules dont la
communication soit nécessaire;
il n'est pas
possible d'admettre des langues sans Verbes,
à moins de dire que ce sont des
langues avec
lesquelles on ne sauroit exprimer ses pensées,
avec lesquelles on ne sauroit parler. Cp. 423)
Dans l'article "Proposition" de l'Encyclop'die, Beauzée s'en
prend
à
la
4nonci.tion
distinction
<::s )
de Du
Marsais
entre
Voici comment il résume la
proposition
perspective
adopte
Nous parlons pour transmettre aux autres hommes
nos connoissances,
& nos connoissances ne sont
autre chose que la perception de l'existence
intellectuelle des
êtres,
sous telle ou telle
relation, à telle ou telle modification.
Si un
être a véritablement en soi la relation sous
laquelle il existe dans notre esprit,
nous en
392
et
qu'il
avons une connoissance vraie;
s'il n'a pas en
soi la relation sous
laquelle il existe dans
notre esprit, la connoissance que nous en avons
est fausse;
mais vraie ou fausse,
cette connoissance est un jugement, & l'expression de ce
jugement est une proposition. (P. 585).
(Passons
sur
ce
que
peut
avoir
"connaissance fausse";
d'ailleurs,
(Livre
p.
II,
chap. IV,
394)
de
paradoxal
l ' i dé e
8r •••• ire
dans sa
d'un e
g'n'r.le
il parle plutôt d'un
"jugement
faux") .
Nous ne parlons que pour transmettre nos
connaissances
informer les autres des perceptions de notre esprit;
l'esprit
être
perçoit
ou considère l'existence
avec telle relation à telle
de
distinguer
convenir
proposition
qu'une
Il n'y a donc pas lieu
"Ainsi,
et
d'actes
La
(ibid.)
est
tot.l.
proposition déclarative est donc pour
de
la
parole doit produire
une
adopte
chap.
une
VI,
p.
analyse
207) .
A la suite de
bipartite de la
393
en
être
pour
Du Marsais,
proposition
la
et "tout
l'expression d'un jugement intérieur" (8r •••• irl1 g4n4r.ll1,
III,
dire
Beauzée
proposition,
le
jugl1 •• nt"
d'un
seule unité de communication dans les langues humaines,
acte
~tre
& je conclus qu'il faut
l'expression
de
conclut-il, il faut
qu'il n'y a en effet qu'un jugement qui puisse
type ou l'objet d'une proposition,
d'un
c'est toujours,
différents types de propositions
pensée comme le faisait Du Marsais.
que
intellectuelle
modification,
semble-t-il, sous la forme d'un jugement.
et dè s
ou
Livre
Beauzée
sujet
et
attribut;
suj et,
dans
la proposition "Dieu est juste",
"Dieu" est
le
et "est juste", l'attribut; mais il rejette l'idée de son
prédécesseur
qui
énonciations
exprimant
l'esprit".
acceptait,
Pour
des
appuyer
côté
à
et
Arnauld
sa
et
particulières de l'esprit"
les "énonciations"
ou
propositions,
"c ons idé rat i ons
conception,
"meilleurs Logiciens ou Métaphysiciens",
Malebranche,
des
Nicole.
des
part icul iè res
il
en
de
appelle
aux
nommément s'Gravesande,
Les
(4)
"c on si dé rat i on s
de Du Marsais qui sont exprimées
par
"propositions indirectes" (ou "obliques")
que
ne sont, pour Beauzée,
diverses
maniè res
d'envisager
l'existence intellectuelle d'un être avec relation à un attribut,
donc diverses manières d'envisager un jugement.
L'expression totale d'un jugement peut se faire au moyen de
plusieurs
moyen
idées
des
(ibid.) ;
se
mots ordonnés selon les règles de la syntaxe,
et
propose
subordonné
peu importe que
directement
d'une
principalement,
l'existence
telle
que
accessoires
de
le
jugement
faire
y
aura
c'est
toujours
ou
connaître,
un jugement
intellectuelle d'un sujet,
(ibid.).
394
dès
sous telle
"& l'expression totale,
direct, soit du jugement indirect
"au
attachées"
"soit celui que l'on
manière quelconque à celui que
modification";
proposition"
l'usage
ou
qu'il
l'on
qu'il
soit
envisage
énonce
relation,
soit du
à
jugement
& subordonné, est également une
Beauzée
est d'avis que la Grammaire n'a rien à
considérer les propositions modales,
exclusives,
discrétives,
etc.
gagner
conditionnelles, relatives,
exceptives,
comparatives, inceptives,
"Si ces différens aspects peuvent fournir à la logique
moyens de discuter la vérité du fond,
peuvent
à la bonne heure;
être d'aucune utilité dans la grammaire,
renoncer" (ibid.,
p.
591) .
des
ils
& elle y
ne
doit
Le grammairien devra toutefois
tenir compte à un moment ou l'autre,
des conjonctions,
à
en particulier au
qui introduisent des subordonnées
en
chapitre
exclusives,
exceptives, etc.
"La forme grammaticale de la
proposition,
consiste dans les inflexions particulières,
respectif
des
différentes
parties
Par rapport à la forme,
(ibid.) .
distinguer
ou
elle
est
composé e"
le grammairien doit
analytique du jugement,
"elliptique";
Beauzée,
& dans l'arrangement
différentes espèces de propositions.
l'expression
"pl eine"
dont
selon
pleine,
cependant
Relativement
une proposition peut
"lorsqu'elle
à
être
comprend
explicitement tous les mots nécessaires à l'expression analytique
de
la
pensée" (ibid.).
Elle est
elliptique,
"lorsqu'elle
renferme pas tous les mots nécessaires à l'expression
de la pensée" (ibid.).
En fait, ajoute Beauzée,
analytique
les expressions
"pleine" et "elliptique" se disent plutôt de la phrase que de
proposition
qu'elle
exprime,
puisque ces
395
ne
"accidents"
la
tombent
moins
sur
les
propositions
choses
peuvent
manière
de
les
dire.
aussi varier selon la succession de
succession
parties,
que sur la
que leur impose l'ordre
Les
leurs
analytique
(ell es
peuvent Ê3tre directes ou encore inverses ou "hyperbatiques"). Les
propositions
dépend
peuvent enfin varier selon le sens particulier
de la disposition des parties de
peuvent
Ê3tre
(Tout ef oi s,
la
"expositives"
alors
proposition;
ou
dans sa théorie des modes,
Beauzée parle encore
i mpé rat if' ') .
quand
elle est l'expression propre du jugement actuel
le
qui
prononce"
proposition est
(ibid. ,
interrogative,
Beauzée
int.rrog.tiv.,
quand
p.
592).
simplement
Quant
est l'expression d'un
lequel est incertain celui qui la prononce,
le
sujet
ou sur l'attribut,
la
à
de
expositiv.
de
celui
proposition
"La proposition
la définit ainsi
elle
elles
"interrogatives".
, , sen s
"La
qui
est
jugement
sur
soit qu'il doute sur
soit qu'il soit incertain
sur
De
nature de la relation du sujet à l'attribut" (ibid.).
la
cette
définition découle une sorte de classification des questions; les
interrogations portent soit sur le sujet
la
terre?"),
soit
sur l'attribut
l'Eglise sur le culte des saints?"),
du sujet à l'attribut
exemples
générale)
Logie
sont
que
[1947])
une
celle de Beauzée) .
il,
("Quelle est la
soit enfin sur la
nous verrons plus
Reichenbach a proposé
loin
(El ••• nts
et
de
relation
(Les
(Conclusion
of
Sy.bolie
classification des questions très semblable à
Mais la proposition interrogative,
n'intéresse le grammairien que par occasion,
doctrine
doctrine
("Dieu veut-il la mort du pécheur?").
de Beauzée;
H.
("Qui a créé le ciel
grammaticale
étant
constitué
396
par
ajoute-t-
le coeur de la
l'analyse
de
la
proposition expositive
Tout ce qu'enseigne la grammaire est finalement
relatif à la proposition expositive dont elle
envisage sur-tout la composition
s'il y a
quelques remarques particulières sur la proposition interrogative, j'en ai fait le détail en
son lieu (ibid.),
Beauzée considère en effet les propositions interrogatives
des
phrases
directement
elliptiques,
"puisque les mots
l'interrogation
y sont
qui
comme
exprimeroient
(ibid. ,
sous-entendus"
p.
591) ,
Dans l'article "Interrogatif"
précise
quelque
peu
le
proposition interrogative
l'Encyclop'die,
de
"sens"
particulier
Beauzé e
associé
"Une proposition est
à
la
interro~.tiv.,
lorsqu'elle indique de la part de celui qui parle,
une
question
plutôt qu'une assertion", Il n'y a pas, pour l'encyclopédiste, de
mots
proprement
interrogatifs,
en particulier
pronoms interrogatifs ("combien",
ces
mots
les
soi-disant
"pourquoi", "quel", etc,), car
assertions
peuvent figurer dans des
sans
aucunement
changer de sens, comme dans "Je sais combien coQ.te ce livre", "Je
sais
etc,
pourquoi il ne viendra pas",
marques
auxquelles
on
reconnaît
Quelles sont
qu'une
donc
proposition
interrogative? Beauzée les ramène à trois catégories
les
est
1) dans la
langue parlée, le ton de la voix ou les circonstances du discours
sont les indicateurs du sens interrogatif; dans la langue écrite,
c'est le point d'interrogation; 2)
397
l'ordre des mots, c'est-à-dire
l'inversion
simpl es)
du
pronom
personnel et du verbe
ou du
pronom
et
composé s)
toute-fois,
inversion
ne
de
l ' auxiliaire
(dans
temps
les
(dans
temps
les
lorsque le verbe est au subjonctif, cette
marque pas une
interrogation,
"mais
une
simple
hypothèse, ou un désir dont l'énonciation explicite est supprimée
par ellipse",
(comme "Vinssiez-vous à bout de votre dessein " qui
se
" Je
met
pour
dessein",
suppose que vous vinssiez
avec
des
interrogation,
verbes
l'indicatif,
point
une
mais une assertion ("en vain formerions-nous
les
sont
interrogatifs
l'antécédent,
verbe
à
en
auss~
3) enfin, les prétendus
fait
le
signe
qui
sous-entendu,
s'il étoit énoncé".
devient,
n'indiquent
d'une
exprimeroit
Ainsi,
une fois l'ellipse comblée,
pronoms
ellipse
"c et an té cé dent est le complément
et
l'interrogation
livre?"
votre
etc.). Quelquefois, ces inversions,
les plus vastes projets", etc.)
d ' un
de
ou "Puissiez-vous être content!" pour "Je souhaite que
vous puissiez être content",
même
bout
à
de
grammatical
directement
"Combien
coQ.te
ce
, 'Apprenez-moi
le
prix que coûte ce livre", où "prix" est l'antécédent en question,
complément d'objet du verbe "apprendre",
en
général,
retrouver
chez
quel est l'antécédent qui doit être
Gregory)
détermine,
suppléé
Notez que le verbe qui
une phrase "pleine",
"directement"
Le contexte
pour
exprime
l'interrogation est un verbe à l'impératif
(Nous verrons plus loin que l'impératif
(comme
est
mode "direct", contrairement au subjonctif et à l'optatif).
398
un
Beauzée procède à une critique en règle de la conception du
verbe
de Port-Royal.
Royal
avaient
1 ' idée
de
Il prétend que les grammairiens
entrevu sa conception du verbe
l'affirmation;
distinctement,
ma1s
ils
affirme-t-il,
intellectuelle,
en
n'ont
l' idé e
de
Port-
s'arr~tant
pas
de
vu
à
assez
l'existence
et leur conception du jugement ne lui semble pas
des plus justes.
À la conception du verbe des Messieurs, Beauzée
adresse cinq remarques critiques.
S1 l'affirmation est
Premièrement,
parle,
un
acte
de celui qui
et si le verbe est un mot déclinable sujet aux lois de la
concordance relativement au sujet auquel on le rapporte,
alors le .st
affirmAtion
première?
p.tr«s
dans
.st .ffir•• ns
puisqu'il est
Beauzée en
Il
c'est qu'il
mon
marquer
à la troisième personne,
conclut que
peut se rapporter à moi,
peut-il
comment
et non à la
est
[s] i quelque chose dans
exprime l'existence
d'une
troisième personne dans mon antandement; ce qui rend en effet mon
jugement,
confirme ce que j'ai avancé de la
Oc
nature du verbe"
(ibid., p. 397).
La
seconde
remarque
d'affirmation.
Àrnauld
l'affirmation
du
particulier
(le
et
locuteur
verbe .tre)
porte
Lancelot
doit
encore
ont
être
tort
exprimée
L'affirmation est
399
notion
la
sur
de
penser
par
que
mot
un
opposé e
à
la
négation,
certes;
grammatical"
la
l'affir •• tion
est
chaque
mal.s
notion
la
Beauzée
propose
d'affirmation
(ibid.,
destruction"
et
simple position de
& que la nlgation en est,
mot,
p. 398).
d'étendre
"dans
avance l'idée
la
"que
signification
en quelque
le
manière,
de
la
Ainsi, l'affirmation se manifeste
simplement dans l'acte même de la parole; on n'a donc pas besoin,
dans
aucune langue,
l'affirmation.
non doctus;
sensible
.udio: non audio, etc.). Par
"si tout mot est affirmatif par sa
l'.ffir.ation
rendre
Par contre, on a besoin d'un tel mot pour marquer
la négation (doctus:
conséquent,
d'un mot particulier pour
nature,
comment
peut-elle être le caractère distinctif du
Verbe?"
(ibid.) .
Beauzée reproche ensuite à la définition du verbe de
Royal
("un
mot
l'affirmation")
de
restrictions.
dont
le
princip.l
us.g.
est
de
Port-
signifier
d'engendrer un trop grand nombre d'exceptions et
En outre,
cette définition exclut
les
modes
autres que l'indicatif alors qu'une définition adéquate du
verbe
devrait tenir compte de toutes les
formes verbales
modes, sans exception, ont été, dans tous les temps
les langues cultivées,
"Tous
les
& dans toutes
réputés appartenir au Verbe & en être des
parties nécessaires" (ibid., pp. 399-400). Cela vaut également de
l'infinitif et du participe; les participes étant assimilés à des
"noms adjectifs",
et les infinitifs à des noms substantifs, sauf
lorsqu'ils retiennent l'affirmation ...
400
Aux yeux de Beauzée, tant
d ' exceptions
rendent
suspecte
la
définition
des
Messieurs.
Beauzée, contrairement à la plupart des grammairiens philosophes,
traite
est
l'infinitif et le participe comme des formes verbales; il
par là plus près de la tradition grammaticale qu'il
Cpp.
399-400)
système
et des grammaires scolaires,
des modes,
substantifs,
et
même si,
dans
son
classe
des
adjectifs.
Les
il rapporte les infinitifs à la
les
participes
infinitifs et les participes,
à
celle
des
invoque
sans cesser d'être verbe,
font le
même effet dans la phrase que les substantifs et les adjectifs.
Beauzée trouve encore
défectueuse la
définition de
Royal, parce que l'affirmation peut être signifiée par
autres
espèces de
mots,
Ilaffirmation" ,
comme
"affirmer", "affirmativement",
Port-
plusieurs
"affirmatif",
"oui"., etc. Beauzée sait bien que
les auteurs qu'il critique distinguaient l'affirmation conçue
l'affirmation
produit.
Cactus
significatus/actus
cette
dernière étant caractéristique du verbe.
c'est
là
"se payer des mots",
et il estime que
de
exercitus),
Mais
le
pour
besoin
recourir à cette distinction pour rectifier leur définition
une preuve que cette définition est au moins louche"
(ibid.,
lui,
de
"est
p.
400) .
Enfin,
parce
cette définition souffre encore d'un défaut logique
qu'elle n'énonce que la
"différence
401
spécifique"
(l' idé e
d'affirmation)
sans
mentionner le
"genre
prochain".
Dans
définition de Beauzée,
le verbe appartient à la même classe
les
expriment,
adjectifs
qui
eux
aussi,
des
la
que
"@tres
indéterminés"; cette classe (l'union des verbes
et des adjectifs)
,
constitue le genre prochain.
soumis
Les adjectifs comme les verbes sont
aux lois de la concordance en syntaxe qui exigent
soient unis aux sujets auxquels
on les applique, et c'est par là
qu'ils perdent leur "indétermination".
ce
qui
distingue
l'existence
Cette
attribut.
les verbes des
intellectuelle
conviennent
idé e
qu'ils
adjectifs,
sujet
d'un
doit @tre
La différence spécifique,
c'est
avec
relation
"la source des
exclusivement à l'espèce" (ibid.,
l' idé e
à
de
un
propriétés qui
p.
404)
et
il
aj oute
On verra en effet, quand il sera question de
syntaxe, que c'est sur ce fondement que porte la distinction des modes, qui, en multipliant les usages du Verbe dans le discours,
justifient de plus en plus le nom que lui
ont donné par excellence les grecs & les romains,
& que nous lui avons conservé nousm@mes (ibid., p. 404).
(Pour
les grammairiens gréco-latins comme pour les
philosophes,
le
verbe
est en effet
"le
mot
grammairiens
par excellence",
l'''âme du discours").
Beauzé e
suit encore la tradition en distinguant
"substantif" des verbes "adjectifs";
402
le
verbe
il préfère toutefois parler
du
verbe
"abstrait"
renfermant
dans
et des
leur
"concrets",
signification,
l'existence
intellectuelle,
déterminé,
qui
n'est
substant i f ou abstrai t"
verbes
"l'idée
point
en
plus
de
accessoire
comprise
dans
ces
derniers
l'idée
d'un
celle
de
attribut
du
Verbe
Ci bi d., p. 407). Les verbes "concret s" se
décomposent, suivant la tradition, en verbe
abstrait + participe
présent.
Le système des modes de Beauzée est exposé dans sa Sr •••• ir.
g4n4ral.
et
dans l'article "Mode" de
l'Encyclop'di.
Les
(:5)
modes sont soit personn.ls, soit i.p.rsonn.ls. Seuls les premiers
servent
à
former
jugements.
respectivement,
adjectifs.
(indica tif,
optatif) .
impersonnels,
Les
appartiennent,
des
des propositions,
Les
modes
impératif,
Enfin,
et
donc
infinitif
à
exprimer
et
participe,
à la classe des noms et à
personnels se
conditionnel)
des
divisent
en
celle
dir.cts
et obliqu.s (subjonctif et
les modes se divisent encore en modes purs ou
fondamentaux
(indicatif,
(impératif,
suppositif
contrairement aux mixtes,
infinitif
et
et
subjonctif)
et
.ixtes
modes
purs,
participe)
les
n'ajoutent aucune idée accessoire à la
signification "formelle" ou "spécifique" du verbe.
Les modes directs servent à former la proposition princip.l.
que
l'on
veut
exprimer.
L'indicatif
403
exprime
purement
et
simplement l'existence intellectuelle d'un sujet avec relation
un attribut;
" formelle"
l'impératif le fait en ajoutant à la
ou
"spécifique"
du verbe l'idée
volonté de celui qui parle;
en
ajoutant l'idée accessoire d'une
subjonctif
"jugement
qu'il
est
un
mode oblique
accessoire"
ne sert à
et
former,
comme
sorte d'accusatif.
parce
qu'il
de
préalable.
n'exprime
qu'une
que
signification
accessoire;
préservent
noms dans les
les
cas
parce
proposition
complète,
d'ailleurs
obliques
mê!me,
particulière.
jugement)
Cette
flexions casuelles,
en
y
analogie
ajoutant
une
la
idée
modale
(qui exprime
idée
entre les modes
noms,
une
les verbes porteurs d'une flexion
la signification du verbe à l'indicatif
un
les
préservent
exprimée par le nominatif en y ajoutant
de
Le
qu'un
et
n'est qu'une partie d'une proposition
Beauzée compare
la
suppositif),
modales des verbes et les flexions casuelles des
observant
alors
supposition
le plus souvent,
qui
flexions
(ou
" subordonné au principal",
incid.nt.,
une
signification
accessoire
et le conditionnel
à
accessoire
verbaux
et
les
que nous avons rencontrée chez Périzonius et
entrevue dans la 9r •••• ir. de Port-Royal et chez Du Marsais, nous
la retrouverons encore chez Destutt de Tracy.
Les modes purs ont un caractère plus "fondamental" que
autres modes;
verbe;
ils sont "plus nécessairement liés à la nature
puisqu'on
les
trouve dans toutes les
accordé au verbe des changements de formes."
404
langues
qui
les
du
ont
(9r ••• aire g'n'rale,
Livre III, chap.
le
même
cas,
pour les
n'ont
pas
tandi s que
n'ont
conditionnel,
Les
modes
l'ajout
pas
mixtes
dit Beauzé e,
p.
subjonctif,
344);
le
ou
"est tronqué
l' hébreu et
latin
se distinguent donc les uns
de
n'a
pas
de
etc.
d'une idée accessoire au jugement principal exprimé
par
Dans l'article "Mode" de
concernant
ont
les modes mixtes
plusieurs
un .od. interrogatif,
donc
non
la
même
à
possible
par
etc.".
Les
tous
les
pratiquement
l'exception
Beauzé e
espèce,
un .od. concessif,
la capacité d'exprimer
déclaratifs,
l'Enc'lclop~ditt,
"il auroit été
.odtts de
autres
des
le
par
exemple,
énoncé s
(ibid.,
d'optatif
autres
d'introduire
modes
conditionnel,
peu de langues ont un optatif comme le grec,
l'énonciation.
ajoute,
de
de
l' impé rat if,
partout de diverses manières"
suédois
Les modes mixtes ne sont pas dans
car plusieurs langues ayant des flexions verbales
modes
subj onct if,
VI, p. 343).
peut-être
des
interjections.
nous devons
Avant d'examiner brièvement les modes un à un,
rappeler rapidement la
et
théorie de la
en particulier sa conception des
signification de
inflexions
Beauzée,
morphologiques,
afin de déterminer quelle partie de la signification "totale"
verbe est affectée ou modifiée par les modes.
d'un
mot est sa "signification totale";
La
du
signification
celle-ci se
divise
en
signification "objective" et signification "spécifique", ces deux
types de signification se divisant à leur tour en idée principale
405
et
idé e acc es s oire .
La signification objective d'un mot est
le
contenu sémantique (idée principale) qu'il partage avec
d'autres
mots
"amour" ,
de différentes
espèces,
"aimer",
comme
"amitié", "amicalement", "amical", etc.
mots,
~.,
La racine commune de ces
est "le type de l'idée objective" de tous ces mots,
est celle de ce sentiment affectueux qui lie
bi envei llanc e"
diverses
"ami",
(9ra •• aire
inflexions
Livre
hommes
III,
"aspect
particulier
par la
Les
346) .
p.
que reçoit cette racine ajoutent
d'un
l' idé e
objective
g~n~rale,
les
qui
qui
l' idé e
à
fait
la
signification formelle ou spécifique de chaque mot et en vertu de
quoi
est un verbe,
ai.~r
un
a.ic~l
concret,
~.iti~
un nom abstrait,
& a.icale.ttnt
adjectif,
signification spécifique (ou formelle)
présente
sa
signification
(d'une
parlants
un
un adverbe".
objective
à
nominale,
l'esprit
verbale,
des
suj et s
adjectivale,
la signification spécifique
les mots de cette espèce;
l' idé e
La
est la manière dont le mot
celle d'une classe particulière de mots et est la même
tous
nom
etc.). Cette significati"on est "spécifique" car elle
adverbiale,
est
manière
a.i
fondamentale
et
expression
représentant la fonction
cette idée est susceptible
syntaxique
d'être
modifiée
pour
est
d'une
par
différents "sens accidentels" (idées accessoires) marqués par les
flexions pour le genre,
et
le mode.
objective
L'ajout d'un sens accidentel à une expression
selon
cependant,
et
le nombre, le cas, la personne, le temps
pas
Bartlett
seulement
<.)
la
modifier
signification
la
signification
formelle
exemple, dans le cas des marques pour le genre et le nombre)
406
peut
(par
Les modifications de la signification objective
s'expriment
adverbiales
etc.) .
habituellement par des adverbes ou
("aimer peu",
"aimer beaucoup",
des
d'un
mot
expressions
"aimer tendrement",
Il n'en va pas de même pour les modes verbaux
il est évident
que ce ne sont pas des
modifications de cette espèce qui caractérisent ce qu'on appelle les .odes des verbes, autrement chaque verbe auroit ses .0des propres, parce qu'un attribut n'est
pas susceptible des mêmes modifications
qui peuvent convenir à un autre
ce qui
caractérise nos .odes n'appartient nullement à l'objet de la signification du verbe,
c'est à la forme,
à la manière dont
tous les verbes signifient.
Ce qui constitue les .odes,
ce sont les
divers aspects sous lesquels la signification formelle du verbe peut être envisagée
dans la phrase. (Art. "Mode" de l'Encyclop4die) .
Plus que tout autre sens accidentel des verbes,
" semblent
moins
aux
remarque
tenir de plus près
vues de celui qui
s.
l'intentionnalité
Auroux,
du
les
aux vues de la
(art.
parle"
modes
sujet parlant
Grammaire,
(Gr •••• ire g'n'rale, Livre III, p. 206).
407
Comme
le
davantage
à
cit.)
"un système de temps qui lui
***
du
("Actes de pensée
op.
modes
ou
" Mode") .
tiennent
linguistiques dans la Grammaire Générale",
chaque mode détermine
les
et
j
est
actes
de plus,
propre"
Dans
sa 6ra •• aire
g~n~rale,
chaque mode pour lui-même,
du français.
le
fait
Beauzée
examine
longuement
mais en se limitant surtout aux modes
Nous savons déjà que l'indicatif se caractérise par
qu'il
exprime
purement
et
directement
l'existence
intellectuelle d'un sujet avec relation à un attribut. A ce mode,
le
verbe
est
fondamentale"
ajoutent
verbe.
une
utilisé selon
(ibid.,
p.
sa
208)
signification
"essencielle
&
tous les autres modes personnels
idée accessoire à la signification
spécifique
du
L'indicatif se distingue de ces autres modes "mixtes"
en
admettant toute la variété des temps verbaux. C'est aussi un mode
direct,
car il est destiné à l'expression immédiate de la pensée
(jugement) principale que l'on se propose de
pourquoi il est,
vérité ,
.ptus
par excellence,
comme l ' appelait
sci~ntiis,
manifester.
le mode de la science et de la
Scaliger au XVI- siècle
solus pater
C'est
v~rit.tis)
(sol us
.odus
.
***
L'impératif énonce directement l'existence
d'un
sujet
signification
volonté
211) .
ne
avec
relation
spécifique
à
du
un
verbe
attribut
"l'idée
en
intellectuelle
ajoutant
à
la
de
la
(ibid.,
p.
accessoire
de celui qui parle ou qui est censé parler"
Ce mode n'a pas de première personne du singulier, car "on
se commande pas proprement à
avant lui Arnauld et Lancelot.
soi-m~mell,
comme l'avaient
Il n'a pas non plus de
408
dit
troisième
personne;
nous
subjonctif
employons pour cela les temps
("qu'il lise",
, 'qu' i l a i t
lu"),
correspondants du
et alors,
nécessairement une ellipse (" [je veux] qu'il lise",
qu' i l a i t
lu' ') .
Lorsqu'il traite du
subjonctif,
il
y
a
" [j e dé sir e ]
Beauzé e,
par
prolepse, prévient une objection disant que
ces suppléments font disparoître le sens
impératif,
que la forme usuelle montre
nettement;
donc ils ne rendent pas une
juste raison de la phrase. Il me semble
au contraire que
c'est marquer bien
clairement le sens impératif, que de dire
j~
veux,
j . d'sir.,
j . conseill~,
&c.
puisque c'est expliquer positivement la
volonté de celui qui parle ou qui est
censé parler, en quoi consiste proprement
les en s i mpé rat if. (1 b id., p. 252).
Contrairement
aux
autres
modes
personnels,
l'impératif,
c'est
français, n'est pas marqué par des flexions particulières;
plutôt
suppression
la
des pronoms personnels
de
la
deuxième
personne du singulier et des deux premières personnes du
qui
est la
suffit
Beauzée
pluriel
impératif",
"forme caractéristique du sens
"pour constituer un Mode particulier"
(ibid. ,
et
p.
s'en prend aux grammairiens (comme l'Abbé Régnier)
abusés par la grammaire latine,
en
ont voulu retrouver en
qui
212) .
qui,
français
un futur au mode impératif ("tu liras", "il lira", "nous lirons",
etc.) .
arrive
Ce
futur,
que
nous
en fait,
utilisions
est celui de l'indicatif,
le
futur
de
c'est le plus souvent par figur.
commander,
l'indicatif
s'il
pour
("par énergie ou par
euphémi sme")
on s'abstient de la forme impérative par énergie,
quand l'autorité de celui qui parle est
si grande, ou quand la justice ou la nécessité
409
et
Ott>
ap :J.1JJns t1,nb
l'indiquer pour en attendre l'éxécution & pour
affirmer qu'elle aura lieu". (Ibid., p. 213).
On s'abstient de la forme impérative par euphémisme,
ou afin d'adoucir,
par un principe
de civilité,
l'impression de l'autorité réelle, ou afin d'éviter,
par un principe d'équité, le ton impérieux qui ne peut convenir à un
homme qui prie. (Ibid., p. 214).
Dans l'article "Impératif" de l'Encyclop'ditt, Beauzée signale que
si
l'on
c'est
peut quelquefois mettre l'indicatif
en
partie
"directs"
parce
(qui expriment
que
le
ces
deux
pour
modes
l'impératif,
sont
jugement principal
des
modes
(ou forment la
proposition principale) que l'on se propose de communiquer.
Si la langue française n'a pas,
comme la latine,
de
futur
pour l'impératif, elle a cependant, c 'omme la grecque, un prétéri t
("Ayez lu
renvoie
ce
livre à mon retour!").
forcément
l'action commandée,
peut
~tre
Même
à quelque chose qui n'est
si
le
pas
commandement
encore
fait,
qui est postérieure au moment où l'on parle,
envisagée comme passée,
doit suivre l'acte de parole.
ou antérieure à une époque qui
Ainsi, .yez lu exprime l'action de
lire comme pas sé e rela t i vement à une époque posté r i eure à
l'acte
de parole.
L'impératif peut exprimer,
commandement,
un
dé sir,
une
411
selon
les
permission,
circonstances,
un
conseil,
un
une
exhortation, une prière, un avertissement, ou un consentement. Il
est
curieux
que
cependant
Beauzé e,
impératives à la troisième personne,
l'ellipse;
il ne dit jamais,
sauf
pour
à
par exemple,
alors qu'il dit clairement
propos
ellipse
des
suppléments
que "Lisezl" est une
expriment
etc.] que vous
personne,
justifier le subjonctif du
aj outé s
verbe),
"clairement le
qu'il
et
y
que
exprime
sens impératif".
directement l'existence intellectuelle
avec relation à un attribut;
sujet
avec
relation
jugements
à
s ' expriment
"expositives"
un attribut
des
d'être
Beauzée écrit
propositions,
des
vous
un
est
littéralement
sans que nous COHPREHIOHS,
dans
vraies
ou
"En effet,
~URIEZ
énonciations
conditionnel (suppositif)
jugement,
il
est
l'une
jugement
" prédication" ,
bien,
Beauzé e
comme
fausses.
Di~u
raison,
EST
de
s.
't~rnel,
au subjonctif
mais pour
équivaut
comme l'affirme Nuchelmans
l'écrit
Dans
jugemens".
une
cela est moins évident.
"jugement"
(1983,
Auroux à propos de
la
ou
d'un
phrase
De deux
large
du
pratiquement
à
pp. 96-97), ou
conception
"(tJout énoncé complet possède une valeur de
412
les
RETIRE-toi, sont
complettes
facile d'en convenir;
laquelle
et
propositions
ou bien Beauzée a une conception très
dans
sujet
soit une énonciation compl'te
impérative comme "Retire-toi!",
choses
d'un
jugement
des
Qu'une phrase dont le verbe est à l'indicatif,
au
mode
or, l'existence intellectuelle d'un
susceptibles
l'article "Mode",
a
les
L'impératif est pour lui un mode "direct", c'est-à-dire, un
qui
à
(nous l'avons vu plus haut)
impératifs à la troisième
(pour
formes
n'ait aucunement recours
forme elliptique équivalente à "Je veux [ordonne,
lisiez",
les
de
vérité "
("Act es
de
pensé e
op.
Gé né ra le" ,
et actes
cit ,) ,
linguistiques
dans
la
Grammaire
et dans ce cas, les phrases impératives,
comme les interrogatives, sont elliptiques ou possèdent forcément
des
équivalents
Reichenbach) ,
et
plus
Cette seconde
conforme
philosophes
par
"expositifs"
à
ce
(ou
que
la
tradition
des
logiciens
"Les modalités,
ne sont pour lui que des déterminations
mode
dirait
et
laquelle se rattache explicitement Beauzée) entend
(à
du jugement porteur de vérité" (ibid.),
que
comme
interprétation me paraft préférable
"jugement" et "proposition",
Auroux,
"cognitifs"
"direct" ,
exprime
écrit
encore
supplémentaires
Si l'impératif, en tant
directement
le
jugement
ou
la
proposition principale que l'on se propose de manifester, il faut
bien
que
jugement
ce
correspondante)
soit
(ou
proposition
la
implicitement
"contenu"
expositive
dans
la
forme
impérative, et qu'il soit possible de le rendre explicite par les
procédures habituelles de "résolution",
Et si l'impératif ajoute
spécifique du verbe
"l'idée accessoire de la
à la signification
volonté de celui qui parle", cet ajout devrait pouvoir s'analyser
(s e dé c ompos er)
forme d'une
sous la
"expositive",
proposition
Antoine Court de Gébelin, qui s'inspire largement de Beauzée dans
sa théorie des modes,
réduction
n'hésitera
pas,
lui,
à
faire
cette
"l'Impératif, écrit-il, n'est qu'une forme elliptique
substituée à une phrase composée de
ri en de pl us"
d'effectuer
l'hyperphrase
(/fonde Pri.i ti f,
la
résolution
"Je
veux"
deux
1774, p, 409
de la
phrase
(ou "J'ordonne",
Verbes,
(7'»),
& qui ne dit
Si nous t ent ons
impérative
"Lisez!",
" Je dé sir e" ,
etc ,) ,
exprimant directement "la volonté de celui qui parle ou est censé
413
parler " ,
exprime-t-elle
incidente?
alors
une
proposition
principale
l'hyperphrase exprime directement un ajout
Si
signification spécifique du verbe à l'indicatif,
une
proposition
proposition
mais le
dans
incidente
constituant
une
à
on peut y
partie
mode
" oblique" et le jugement principal
la
lisiez") ,
verbe de la clause suivant l'hyperphrase apparaît
un
que
alors
l'on
propose de faire connattre n'est plus exprimé "directement".
Auroux
note que chez Beauzée,
détruit la modalité" (ibid.),
"la restitution de
la
vo~r
de
expositive obtenue ("[J'ordonne] que vous
ou
se
M.
l'hyperphrase
et qu'en substituant
"l'indicatif
à l'impératif 'on fait disparattre le sens accessoire impératif'"
(Auroux
citant
Beauzé e) .
l'encyclopédiste,
II[l]a
Il
conclut
marque de la modalité c'est
pas l'hyperphrase ll et qu'il n'y a pas,
explicite.
que
a~ns~
l'ellipse,
de performatif
chez lui,
Les Ilvues de celui qui parle ll
chez
(art. IIMode ll ) autre que
le jugement ne trouvent donc à s'exprimer que par l'effacement ou
l'ellipse
de
l'hyperphrase qui
signifierait
les
directement.
Pourtant, dans le passage cité plus haut, Beauzée affirme que les
hyperphrases Ilje veux ll ,
clairement
le
sens
11
j e dé sir e 1 l ,
incidentes
introduites
assimilées
qui,
par
Par
impératif.
sl.iotiqa. d.s Encyclopldist.s,
p.
chez Port-Royal,
Ilque ll ) ,
Ilje
comme
conseille ll ,
ailleurs,
marquent
Auroux
(La
95) note que les propositions
modifient la
Ilje
soutiens
copule
que .. II
par Beauzée aux relatives introduites par le
Ilqui ll et ne sont donc pas rattachées aux verbes,
(celles
ma~s
sont
relatif
plutôt
au
sujet ou à l'attribut de la proposition, ce qui semble bloquer la
résolution.
Il semble donc que les positions de Beauzée,
414
en. ce
concerne l'impératif, manquent quelque peu de clarté ...
***
Le conditionnel ou " suppositif"
Girard)
mixte.
est,
j~
p.
au même titre que l'impératif,
Il est direct,
proposition
car
Il
spécifique
est
du
supposition
c~
un mode direct
et
"il peut constituer par lui-même
la
livre." (6ra •• ~ire
mixte,
verbe,
car
il
l'idée
g4n4ral~,
ajoute
accessoire
"il n'énonce l'existence que
supposition particulière
j~
l'Abbé
principale ou l'expression immédiate de la pensée
lirois volontiers
225).
(comme l'appelait
à
la
Livre
III,
signification
d'hypothèse
et
dépendamment
je lirois volontiers cet
de
d'une
ouvrag~,
si
l'avois." (Ibid.).
Beauzée discute abondamment les errements des
grammairiens
qui
l'ont précédé à propos de ce mode qui ne se trouve que
les
langues
modernes et pour lequel la
grammaire
dans
gréco-latine
n'est d'aucune utilité. Il y a d'abord ceux qui, comme Buffier et
Restaut,
rapportent
les temps du conditionnel à l'indicatif
les décrivent comme des "temps incertains",
Destutt
de Tracy qui les décrit,
"imparfaits
entre
"un
des temps à venir".
Mode
qui
exprime
415
et
comme le fera encore
dans sa 6ra •• ~ir~,
Beauzée voit là une
l'existence
d'une
comme
des
confusion
manière
conditionnelle,
avec
un
autre
absolue" (Gr •••• ir. g',,4r.leo,
qui
l'exprime
d'une
Livre III, p. 225). L'indicatif et
le conditionnel sont deux modes personnels directs,
sans doute pour lui la source de la confusion,
trouvant
dans
l'idée
manière
accessoire
ajoutée
et c'est
là
la distinction se
au
verbe
par
le
suppositif, un mode mixte, l'indicatif étant un mode pur.
D'autres grammairiens rapportent les temps du
conditionnel
au subjonctif (nommément l'Abbé Regnier et La
Touche) .
par exemple, décrivait
"premier futur" du
subjonctif",
du
"je ferais"
comme le
et "j'aurais fait" comme le "second futur
subjonctif.
Cette opinion,
selon Beauzé e,
p.
semblent
pour
n'ont
227) .
convenl.r
Parce
que
"je ferais"
et
"j'eusse
fait"
pas imaginé que notre langue puisse avoir
que la langue latine.
franç oi s e"
fait"
ces
,
Ild' une
Ilj' aurais
aussi bien que "je fisse" et
rendre le latin "facere. 11 et "feciss •• II
composé"
provient
application gauche de la Grammaire latine à la langue
(ibid. ,
Regnier,
grammairiens
d'autres
modes
C'est pourtant là, pour Beauzée, confondre
un mode direct et conditionnel avec un mode oblique et absolu; et
il ajoute
"il n'est pas possible qu'un seul
& unique mot d'une
autre
langue réponde à deux significations si différentes
elles
dans
la
n8tre,
à moins qu'on ne
absolument barbare & informe"
Beauzée
explique
suppose
cette
entre
langue
(ibid., pp. 226-227).
ainsi
la
416
genèse
du
conditionnel
en
il
français
était possible,
en latin,
elliptique en employant le subjonctif,
esse. (Ovide),
erat
ita
français,
d'utiliser
comme si
un
posse.,
sanior
si Cres
la phrase "pleine" correspondante étant
ut] posse.,
Cres est ita ut] esse.
tour
sanior;
mais
l'usage ne nous permet pas de dire elliptiquement
en
"si
je pusse, je fusse plus sage", et nous devons alors avoir recours
soit
"l'ennuyeuse circonlocution du tour analytique"
à
chose étoit de manière que je pusse,
("si
la chose est de manière que
je fusse plus sage"), soit à la formation d'un mode nouveau
goat de la brièveté,
notre choix;
& nous disons par le Mode Suppositif, je
Suppositif,
p.
(ibid.,
s~rois
La nécessité ayant une fois établi ce
l'analogie
230).
"le
éclairé par celui de la précision, a décidé
sage si je pouvais.
du
la
lui a accordé
tous
plus
temps
les
autres .. "
Tous les temps du suppositif sont
indéfinis,
c'est-à-dire, ne tiennent à aucune époque particulière et peuvent
être rapportés tantôt à l'une, tantôt à l'autre.
Ain si, da n S i l j e
me serais révolté si je m'en étais senti la force",
"serais" est
employé comme un prétérit,
tandis que dans "je partirais
si j'en avais les moyens",
il est plutôt employé comme un
demain
temps
futur, etc.
***
Le
subjonctif
"présente la proposition
comme incidente & subordonnée à une autre"
417
qui
en
(ibid., p. 241)
résulte
Mais
contrairement aux trois modes précédents,
le subj onct i f ' 'ne peut
constituer par lui-même la proposition principale ou l'expression
i mmé dia t e
oblique.
de
1 a pen sée ."
Il s'agit
(1 b id.) .
C'est aussi un mode mixte,
fondamentale
du
verbe
il
donc
"puisqu'à la
ajoate
l'idée
peuvent
("Achetez
subordonné es
livre
constituer des
que
je
lirais
subjonctif
ne
peut
plus
jamais,
propositions
volontiers",
lui,
constituer
principale que l'on se propose d'exprimer;
sert à former
laquelle
d'une
incidentes
et
"Vous
tenez
le
etc.)
mais
le
la
proposition
la proposition
qu'il
"est nécessairement subordonnée à une autre,
laquelle elle est incidente,
à
signification
L'indicatif et le
le livre que j'ai lu",
le
mode
accessoire
proposition incidente et subordonnée" (ibid.)
suppositif
d'un
dans
sous laquelle elle est comprise,
elle est jointe par un mot
conjonctif"
(ibid.,
&
p.
249) .
Cette conjonction est déterminative et exige un antécédent
que
modifie
(ou
détermine)
subjonctive (ibid., p. 250).
au
subjonctif
que
les
la
proposition
incidente
ou
Cette conjonction est si nécessaire
grammairiens
qui
ont
plut8t
choisi
d'appeler ce mode "conjonctif" n'étaient pas, selon Beauzée, sans
avoir de bonnes raisons
Partout où l'on trouve le Subjonctif, il y a,
ou il faut suppléer une conjonction déterminative,
qui puisse attacher la proposition
incidente caractérisée par ce Mode,
à un antécédent dépendant d'une proposition principale.
En latin, c'est la conjonction ut;
en
418
françois,
c'est que;
& chaque langue a la
sienne exclusivement destinée à cette sorte
de service,
nonobstant
les assertions des
grammairiens,
qui en indiquent ordinairement
plusieurs autres comme régissant le Subjonctif. (ibid., p. 253).
(Nous
verrons
développera
plus loin (chap.
un
théorie de la conjonction que qui
germe de t out es 1 es autres",
Comme
6r~
veniez d'arriver",
de
en
Tracy
fait
"le
•• ~i rit, p. 145).
les temps du suppositif,
également (pour la plupart)
vous
dixième] que Destutt
indéfinis.
ceux du
Dans
Il
subjonctif
sont
je ne croi s pas que
"veniez" est utilisé comme un
présent,
alors que dans "je ne croirai pas que vous veniez d'arriver",
s'agit plutôt d'un futur;
vinssiez
d'arriver",
mais dans "je ne croyais pas que
nous
avons
Beauzée appelle "défini antérieur".
ici affaire à
un
il
vous
temps
que
Il ajoute cependant que
m~me
dans ce dernier cas, l'indétermination est possible et qu'au fond
tous
les
temps
du subjonctif
peuvent
~tre
considérés
comme
indé finis.
***
L'optatif n'est pas traité dans la
n'en
6r~ •• ~ir.
est question que brièvement et en passant dans
g'n'r~IIt;
la
il
section
consacrée au suppositif, car l'optatif grec peut quelquefois être
rendu
en
franç ai s
par
le
suppositif.
419
Mais
on
trouve
dans
l'Encyclop~die
doute
un bref article signé "N.E.R.M." (le "N." est sans
pour "Nicolas") qui lui est consacré.
mode personnel
& oblique,
d'un souhait".
qui renferme en soi l'idée
être
est
un
accessoire
Il dit aussi qu'''[u]ne proposition optative,
celle qui énonce un souhait, un désir vif".
donc
"L'optatif
est
Une proposition peut
optative sans que le verbe soit marqué par
ce
mode,
lorsqu'elle est précédée de la formule "Fasse le Ciel" ou "Plat à
Dieu" (en latin Utina.). Comme le subjonctif, il s'agit d'un mode
oblique
qui ne sert qu'à former des propositions
subordonné es,
et qui ne sont qu'une
partie
incidentes
de la
et
proposition
principale. Mais, ajoute l'auteur, ce mode est "doublement mixte,
puisqu'il ajoute à la signification totale du subjonctif,
(cf. aussi l'art.
l' idé e
"Mode") ,
en plus d'y
ajouter l'idée accessoire (qu'il a en commun avec le
subj onct i f)
accessoire d'un souhait"
d'une proposition incidente et subordonnée.
***
L'article "Interjection" de l'Encyclop4ditt (signé B.E.R.M.)
débute par une suite de citations empruntées aux Obsttrvations sur
les langues pri.itives du Président Charles de
Brosses.
Beauzée
insiste, comme l'Abbé Regnier et de Brosses avant lui, et Destutt
de Tracy après lui,
interjections
par
la
nature,
sur le caractère "naturel" et "primitif" des
"Les interjections sont des expressions
& qui tiennent à la
420
constitution
dictées
physique
de
l'organe de la parole". Elles peuvent exprimer, selon le cas, des
sentiments de douleur,
de joie,
essentiellement indéclinables,
d'admiration,
etc.
Elles sont
et parce qu'elles constituent
en
quelque sorte le langage du coeur plutôt que celui de l'esprit et
que
la grammaire ne s'occupe que de ce dernier,
des
diverses espèces d'interjections "est absolument inutile
la
distinction
au
but de la grammaire".
***
Puisque les modes impersonnels (infinitif et participe)
servent
aucunement
intéressent
suffit,
guère
à
l.Cl.
former
des
propositions,
et ce que nous en avons
pour l'essentiel,
ils
dit
ne
ne
nous
plus
haut
à faire voir la place qu'ils occupent
dans le système des modes de Beauzée.
***
421
NOTES
(1)
On se rappelle que pour Du Marsais,
"Le verbe est
le
signe
de l'existence réelle ou imaginée du sujet de
la
proposition,
auquel
est
liée cette existence et tout
le
reste ... ";
"et tout
le reste",
c'est-à-dire,
un attribut
particulier,
et
l'action
de l'esprit
ou
l'énonciation.
L'existence réelle ou imaginée est devenue,
chez Beauzée,
l'existence intellectuelle.
Sahlin (op,
cit.,
1928, p.
311),
écrit
"Beauzée consacre tout l'article l de son chapitre sur le
verbe à développer la thé ori e de Du Marsai s ... " . En dépit de
différences majeures que nous marquerons plus loin,
la filiation
paraît évidente.
(2) Nuchelmans (op.
cit., 1983, p.
95) rapproche l'existence
intellectuelle de Beauzée de l'esse obiective des médiévaux
"Beauzée takes existence in the sense of esse obiective, that is,
as the existence which the objects of acts of thinking have in
the understanding as long as they are conceived of.
On his view,
the personal ending of a finite verb points to a person or a
thing that exists only in the weak sense of being actually
conceived of as that which is the subject of the attribute
denoted by the verb as such".
(3)
Pour un examen détaillé de cette controverse entre les deux
grammairiens encyclopédistes, cf. Auroux, op. cit., 1979, pp. 92
et suiv..
Beauzée,
en s'écartant de la théorie classique des
actes
de pensée,
refuse d'admettre que la vérité
d'une
proposition dépende d'un acte de l'esprit qui la mette en rapport
avec la réalité.
Il n'y a plus pour lui de distinction entre
l'acte de pensée,
et l'objet "immédiat" de cet acte,
c'est-àdire entre le .odus et le dictu..
Les incidentes introduites par
le conjonctif qu. ne sont plus rattachées à la copule; elles sont
plutôt,
selon Auroux,
assimilées aux relatives introduites par
"qui". Auroux signale
(p.
95)
que cette solution est plus
"faible" que celle de Port-R'oyal et Du Marsais,
et qu'elle
conduit à des difficultés.
(4)
Le
fait que Beauzée en appelle
aux
logiciens
et
métaphysiciens pour sa conception du jugement me paraît aller à
l'encontre de l'interprétation proposée par Nuchelmans;
celui-ci
écrit
"It is clear that Beauzée tended to give the word
juge.ent a broader sense than it normally had.
In his usage, the
word applies indifferently to aIl the various views that the mind
422
can take of a predicative conception of a
subject and an
attribute that is the common object of aIl those attitudes is
viewed in pure form by a judgment in the narrow sense, which is
expressed by a sentence with an indicative verb,
while the other
views, which ~re associated with the non-indicative moods, mix
the consideration of the predicative conception with various
other ideas.
By broadening the meaning of juge •• nt in this way
Beauzée succeeded in reconciling the logicians's view that a
proposition expresses a judgment with the grammarians' conception
of a proposition as any group of words dominated by a
finite
verb,
whether indica t ive or not I l .
Pourtant,
lorsque Beauzé e
introduit
les termes jug~.ent et proposition,
c'est toujours
relativement à des "connaissances",
qu'elles soient "vraies ou
fausses " , et la théorie du jugement qu'il reprend des plus grands
" logiciens et métaphysiciens" (s'Gravesande,
Àrnauld et Nicole,
Malebranche) ne plaide pas beaucoup en faveur de l'interprétation
de Nuchelmans.
J'utilise ces deux sources,
mais surtout la Sr •••• ire
(Paris, Bardou, 1767) qui donne un exposé très complet
de la théorie des modes;
notez que Beauzée signe habituellement
ses articles de l'Encyclop'die par les lettres "B.E.R.M.",
sans
doute pour "Beauzée,
Ecole Royale Militaire";
mais on trouve
aussi quelquefois "E.R.M.B.", ou "N.E.R.M".
(5)
g'n'r.I~
(6) Cf. Barrie E. Bartlett, B•• uz'~'s Sr •••• ir~ S'n'rale. Theory
and Hethodology, Mouton, 1975, pp. 51 et suiv ..
(7) Àntoine Court de Gébelim,
Hond. pri.itif, .nalys' et co.par'
I~ .ond• • od~rn~,
consid'r4 d.ns l'histoir~ n.tur.II~ de la
paroI.; ou Sr •••• ire Univ~rs.II~ ~t co.p.r4, Paris, chez Boudet,
Valleyre, Veuve Duchesne, Saugrain, Ruault, 1774, p. 409.
.v~c
***
423
CHAPITRE HUITIEME
L'intérêt
CONDILLAC
que présente pour notre
enquête
les
théories
logico-grammaticales de Condillac tient surtout au fait
qu'elles
offrent,
selon l'expression de M. Auroux, "un embryon de théorie
( 1 )
i 11 ocut oire"
Nous l'avons vu au chapitre premier
première partie,
l'affirmation,
de
la
pour lui, réside davantage dans
la prononciation des mots que dans l'esprit du locuteur; affirmer
est
donc
une action que nous ne pouvons accomplir
qu'avec
(ou avec des gest es dans les Ilpropos i t ions gest iculé es Il
mots
langage d'action),
semble
que
(Sr •••• ire,
Dictionn.ire
nous
p.
du
ou par la prononciation (ou l'énonciation) de
en particulier les
certains mots,
des
ne
puissions
458) .
Mais
des synony.es
(2)
verbes
pas
car sans verbe,
prononcer
surtout,
un
"il
jugement ll
nous trouvons dans
son
des analyses d'un grand nombre de
verbes illocutoires. Quant à la théorie des modes que l'on trouve
dans sa Sr •••• ir. (1775),
elle prend moins de
trois pages et se
limite aux modes du français.
Si
nous
rangeons Condillac
parmi
les
théories "réductionnistes" des modes d'énoncé,
parce qu'il affirme à plusieurs reprises
défenseurs
c'est avant
des
tout
(comme Beauzée avant lui
un
que
"tout
jugement ou une suite de jugemens.
Or,
un jugement exprimé avec
Destutt
de
424
discours
est
Tracy après lui),
et
des mots est ce qu'on nomme proposition.
Tout discours est
une proposition ou une suite de propositions. "
p.
donc
(Gra •• aire, l, ix,
450). Les seules espèces de propositions qu'il distingue sont
subordonnjes et
les propositions principales,
Les
incidentes.
propositions principales expriment le jugement principal que l'on
se propose d'exprimer et ces propositions se caractérisent par le
fait
qu'elles
font,
elles
à
proposition principale est,
latins,
des
auxquelles
qui
se
un
"sens
selon l'expression des
une oratio perfecta.
propositions
seules,
fini";
une
grammairiens
Les propositions subordonnées sont
rapportent
elles sont "subordonnées";
subordonnées n'est pas un sens fini;
à
d'autres
propositions
le sens des
propositions
"il est suspendu,
attendre la proposition principale" (ibid.,
p.
451) ;
et
fait
elles
ne
font que développer les propositions principales auxquelles elles
sont subordonnées,
emp l 0 yé
II,
(i b id. ,
xxvi i, p. 506). Les propos i t ions inc ident es
non à d'autres propositions,
se rapportent,
une expression;
deux
et c'est souvent ·à cela que le subj onct i f est
comme dans la Gr ••• aire de
il Y a,
types d ' incidentes;
et
ne
que
font
déterminé d'une expression.
animal qui a si peu de consistance,
sont
dans
le
sens
déjà
bien
"L'ortie de mer est un
qu'il fond entre les
mains "
article "Proposition" du Dictionnair, des
(exemple de Condillac,
synony.,s) ,
"L'ortie de mer est un animal"
principale,
" qui
a
et
tandis que les autres sont
développer
Ainsi,
à
Port-Royal,
les unes sont déterminatives
nécessaires pour faire un sens fini,
explicatives
mais à un mot ou
si
peu
de
est
consistance"
la
proposition
est
l'incidente
modifiant le mot "animal", et "qu'il fond entre les mains" est la
425
subordonné e .
Par "espèces de proposition", on voit que condillac
n ' entend pas la même chose qu'un Harris qui,
tradition
aristotélicienne,
discours".
se situant dans
différents
distinguait
"genres de
Les propositions peuvent également être "simples"
"c omposé es" ;
simples,
lorsqu'elles
qu'un
n'ont
la
sujet
ou
et
un
attribut;
composé es,
lorsqu'elles sont l'expression abrégée
de
plusieurs
jugements,
comme
la
"Jules
et
Ursule
allèrent
à
campagne" .
On ne trouve pas,
pensé e
relativement
6ra •• aire
philosophes qui s'en
grammairiens
l'interrogation,
de théorie des actes de
l'interprétation
à
la
Dans
déclaratifs.
chez Condillac,
de
des
Port-Royal
inspirent,
la concession, etc.,
1e
énoncés
non
et
les
chez
commandement,
sont des actes de pensée;
chez Condillac, ce sont d'abord et avant tout, à ce qu'il semble,
des
actes
linguistiques
certaines phrases.
Dans l'esprit,
lesquelles nous percevons,
disconvenancej
l'énonciation
accomplis par
tout
le
de phrases.
est
convenance
action
d~action
de
ou
une
par
accomplie
cadre
Ce qui s'explique
en partie par le fait que tout langage dérive pour
langage
moyen
une
de
entre
Condillac déborderait ainsi le
des théories idéationnelles du langage.
être
"prononciation"
il n'y a que des idées
en jugeant,
reste
la
peutlui
du
le langage .st d'abord action avant d'être un
représenter
la
pensée.
Pour
Condillac
Wittgenstein qui faisait sien le mot de Goethe
426
comme
pour
"Au commencement
était l'action"
<3'.
C'est peut-@tre aussi pourquoi il fut,
qu'aucun autre grammairien philosophe,
des actes que
les
le
analyses
sensible
langage permet d'accomplir,
que
nous
trouvons
dans
à
plus
la diversité
comme
le
montre
Dictionn.ire
le
des
synony.es.
Nous exposerons,
dans l'ordre,
la théorie
du
jugement,
celle du verbe, celle des modes, et enfin les analyses des verbes
illocutoires du
Dictionn.ire des synony •• s.
***
l'Ess.i
Dans
(1746),
Condillac
sur l'origine
soutient
des
connoissances
encore la thèse
Locke
laquelle il y a deux
sources à toutes
sensAtion
qui
fournit
réflexion
sur les opérations de notre esprit que les
"occasionnent"
(1754) ,
il
nous
en
nous.
Mais
nos
nos
de
suivant
connaissances
"premières
dans le
hu •• ines
Tr.it4
la
pensées",
des
et
la
sensations
sensations
radicalise le sensualisme de Locke et avance
l'idée
que toutes les pensées et les opérations de notre esprit ne
sont
que des sensAtions trAnsform'.s : "Le jugement, la réflexion, les
dé sirs,
les
passions,
transforme différemment"
ouvrage",
p.
222) .
Les
etc. ,
ne sont que la sensation
(Trait4 des sens.tions,
qui
"Dessein de cet
opérations de l'esprit naissent de
d'abord,
sensation dans l'ordre suivant
427
se
nous conna1ssons
la
les
corps par les sensations qu'ils font sur nous et les
comme
représentant
les corps,
leçons
pr~li.inair,s,
se nomment
"sensations
id4,s"
(Pr~cis
des
Ensuite vient l'attention,
qui
suppose que l'on dirige les organes du corps sur un objet et
que
409)
p.
l'on remarque plus particulièrement la sensation que fait en nous
cet objet, excluant les autres sensations qui peuvent se faire en
nous au même moment;
fait
remarquer
412) .
l'attention est donc "une sensation qui
et qui fait disparoître les autres"
(i bi d.
,
Lorsque nous donnons simultanément notre attention à
objets,
que
nous les remarquons en même temps et à
de tout autre objet,
nous les comparons;
attention"
(sensations)
chos es) .
donnée
ou absentes
à deux
deux
la "comparaison
idées
de
p.
l'exclusion
donc que l'attention donnée à deux choses" (ibid.)
"double
se
n'est
elle est une
choses
présentes
(souvenirs des sensations faites par ces
Vient ensuite le jugement,
qui naît de la comparaison,
car
en comparant deux objets,
les
mêmes sensations ou des sensations
nous voyons qu'ils font sur
différentes,
nous
qu'ils
se
ressemblent ou qu'ils diffèrent, et c'est là juger: "Nos jugemens
ne
découvrent donc dans les objets que des ressemblances ou
différences,
rtHl R)Ci on
nous
des égalités ou des inégalités"
(ibid., p. 413). La
n'est qu'une suite de comparaisons,
faisons
sur
diverses choses
pour
des
de jugements
mieux
les
que
connaître.
Lorsque l'attention se porte sur le souvenir d'un objet absent et
le
représente
comme présent,
ou qu'elle rassemble en
objet diverses qualités appartenant à divers objets,
s'appelle
imagination.
Enfin,
le
raisonnem.nt
seul
l'attention
n'est
chaîne de jugements qui dépendent les uns des autres.
428
un
qu'une
Toutes ces
opérations
qui
relèvent de l'entendement naissent
donc
de
la
sensation.
Si l'entendement est la faculté regroupant les
qui
naissent
regroupant
les
opérations qui naissent du
comme l'attention,
sensation
d'un
privation.
de
le
continu,
malaise,
d'une
une
besoin.
faculté
Le
besoin,
plus particulièrement
inquiétude
l'objet dont on est privé,
d'sir.
consécutive
et c'est là
Lorsque le désir est très
on l'appelle passion.
est privé,
alors
est une sensation,
est
la
à
une
Cette sensation désagréable détermine nos facultés
s'occuper
appelle
la ' volonté
l'attention,
de
opérations
vif,
celui-ci
Enfin,
qu'on
intense
et
Si, au désir de la chose dont on
on ajoute le jugement "je l'obtiendrai",
l'espér~nce.
ce
à
on engendre
si à ce dernier jugement on substitue
"je ne dois point trouver d'obstacle, rien ne peut me
résister", le désir s'appelle alors volont •.
C'est par des cris et des gestes que les
ont communiqué
passions.
Ils
communiquer.
premiers
hommes
spontanément leurs besoins et leurs sentiments ou
ont
sans le savoir avant
communiqué
de
savoir
Quand ils eurent compris le profit qu'ils pouvaient
tirer des signes artificiels, ceux-ci devinrent non seulement des
instruments
permettant
l'expression
et
la
communication
des
pensées (aussi bien celles qui naissent de l'attention que celles
qui
naissent
du
besoin),
mais
429
un
moyen
indispensable
pour
l'analyse et la formation même des pensées.
signes artificiels que
considérer
un
rapport
(6ra •• aire, l,
dire
iv,
p.
avec art"
"faits
C'est de l'usage des
"nous vient le pouvoir d'affirmer
dans
les
437)
idées
que
nous
ou
de
comparons "
Les signes "artificiels", c'est-à"choisis"
et
pour
l'''analyse''
et
la
communication des pensées, ont en effet ceci d'avantageux sur les
"naturels"
signes
peuvent
être
, 'n a t ur e l s " ,
reproduits
quelque
pour
utilisés
au
le développement de
librement,
contraire,
sorte,
leur
comme
cause,
pas
parce qu'ils
ou utilisés à volonté,
la
fumée
reproduire qu'une simulation est possible -- crier
d'avoir
qu'ils
(Les
signes
toujours
être
signifient,
le
feu,
en
ou
c'est dans la mesure où l'on peut les
l'interjection la douleur;
semblant
pensée
volont •.
à
peuvent
ne
la
pouvoir
Ce
mal).
~ie!
d'utiliser
et faire
des
artificiels librement deviendra vite ·la clef de tous les
signes
progrès
de notre savoir.
Mais il y a plus. Lorsque je perçois qu'un arbre est grand,
j'aperçois
le
rapport
de
gr~nd
immédiate qui s'offre à moi;
sont
une
seule et même
et
arbre
dans
dans les
grand
opé ra t i on
et arbr.,
idées que je compare
perception
dans ce cas perception et jugement
dans
l'esprit,
toutefois sous deux points de vue différents.
le rapport entre
la
considérée
Lorsque j'envisage
non dans la perception,
et qui me
représentent un
mais
grand
arbre comme existant hors de moi, la convenance de ces deux idées
430
est
alors
jugement
représentée
devient
permettent
de
la
indépendamment
de
affirmation.
Les
alors
ma
perception;
signes
de considérer les idées séparément et
perception
en
rendant
possible
la
le
artificiels
indépendamment
décomposition
(ou
l'analyse) des pensées dont toutes les parties sont simultanément
présentes dans
l'arbre
et
de
sensations
rapports,
l'esprit du locuteur tout comme la
a
sa
aussi
m~me
grandeur.
la
Ainsi,
faculté
de
tout
perception de
animal
juger,
qui
a
des
d'apercevoir
des
si les animaux "ne prononcent pas, comme nous, des
jugemens" (S,. •••• i,.~, p. 438). Le jugement et l'affirm.ation (d'un
jugement)
chez
doivent donc
Frege
~tre
("Recherches
distingués l'un
de
logiques",
"La
1-
l'autre,
comme
pensé e")
la
"reconntilisstilnce de la vérité d'une proposition -- le jugement" de
la "mtilnifesttiltion de ce jugement -- l'affirmation"
dans Ec,.its
Il
logiqu~s
y
philosophiqu~s,
Seuil, 1971).
a un parallélisme assez étroit
"Puisqu'une
proposition
jugement,
~t
elle
doit
~tre
proposition
175-176
(pp.
est
entre
jugement
l'expression
composée de trois mots;
et
d'un
en sorte
que
deux soient les signes des deux idées que l'on compare, et que le
troisième soit le signe de l'opération de l'esprit,
lorsque nous
jugeons du rapport de ces deux idées" (S,. •••• i,.., p. 452)
une proposition est
p.
d'un
450) ,
et
(ibid. ,
"un jugement exprimé avec des mots"
"[t]oute proposition est
verbe et d'un attribut"
(ibid.),
431
Ainsi,
composée d'un sujet,
le verbe étant
le
signe
d'une
par
opération de l'esprit.
des
propositions dans le discours,
différence
jugement
453) .
deux
Mais si les jugements
remarquable
ne
au
niveau de
leur
se compose pas comme une
a
toutefois
composition
proposition"
Un jugement est toujours simple;
idées que nous comparons.
il Y
s'expriment
une
"un
(ibid. ,
p.
il ne se compose que
de
Une proposition,
au
contraire,
peut être composée, "lorsqu'elle renferme plusieurs jugemens dans
son
(ibid.) ,
expr e s sion"
plusieurs
suj ets
décomposer
en
"structure
d'autres
ou
plusieurs
plusieurs
profonde"
de
types
c'est-à-dire,
de
lorsqu'elle
attributs;
propositions
l'énoncé.
propositions,
op. cit., p. 178).
peut
rendant
Condillac
comme
conjonctives et disjonctives.
hypothétiques,
on
contient
alors
la
explicite
la
discute
pas
ne
les
propositions
(Nuchelmans, 1983,
Il utilise aussi quelquefois le terme
phrase
lorsqu'il considère la proposition sur le plan grammatical plutôt
que
sur
le
plan logique.
raporte qu'à la vérité"
la
phrase du grammairien
stile" (ibid.).
La proposition du
logicien
"ne
se
(Dictionnaire des synony.es) , tandis que
"ne se raporte qu'à la
Mais pour lui,
correction
du
les équations, les propositions
et les jugements sont fondamentalement la même chose (Nuchelmans,
1983, op. cit., p. 179).
***
On trouve deux genèses différentes des
verbes
(ou,
plus
précisément, du verbe substantif) dans l'oeuvre de Condillac. Les
432
deux principaux
l'Ess.i
textes
portant sur le
verbe se
trouvent
sur l'origine des connoissances hu.aines de 1746
Sra •• aire de 1775, et Pariente
(4),
dans
et
en comparant ces deux textes,
a pu montrer que la genèse de cette partie du discours n'est
la
même dans les deux cas.
verbe
d'avec
.tre
Dans
est tardive;
les adjectifs,
l'Ess.i ... ,
elle résulte d'une
l'apparition
lente
comme
le verbe .tre,
premier,
ensuite
et
ce
des
conjuguer.
sont les verbes adjectifs
pensées"
du
de
Dans
"l'âme du discours", "est présenté
, introdui t s dans l es langues'
l'expression
pas
séparation
alors que le verbe substantif servait
terminaison aux adjectifs leur permettant de se
la Sr •••• ire,
la
(p.
(Pariente,
467)
citant
qui
se
afin
la
sont
d'abréger
Sr •••• ir.
de
Ce qui distingue le plus fortement la théorie du verbe
de
Condillac, op. cit. p. 258).
Condillac
des
théories
antérieures,
c'est
la
nature
de
l'opération qui s'accomplit par le verbe dans le discours; car le
verbe
n'est
pas
seulement signe d'une
opération
de
l'esprit
(jugement), en plus il "prononce l'attribut du sujet" (Sra •• aire,
p.
Le verbe "prononce", c'est-à-dire, il rend une pensée
453) .
distincte
et
Dictionn.ire
seul ement
articuler,
publique
(Pariente,
des synony •• s,
un
renvoi
selon
distinctement
les
aux
op.
à l'entrée "Prononcer",
entré es
le Dictionnaire de
différences;
433
et
"Articuler"
Condillac,
on dit qu'on
(Dans
260)
cit.,
on
le
trouve
"Déclamer";
c'est
prononce
marquer
un
mot
lorsqu'on le profère en articulant; déclamer s'oppose à la fois à
réciter et à prononcer
on déclame "avec plus d'action" qu'on ne
récite, et on peut réciter bas et en silence alors qu'on prononce
"haut et en public") .
Da n s I ' Es s ~ i . ..
II,
(I I ,
vi i i) ,
le jugement est défini,
comme c'est souvent le cas dans la tradition,
et la négation;
le
mot
"est "
convenance;
révèle
aprè s l es avoir comparé es
nions
de lier deux idées
Ainsi,
l'affirmation.
dans
rapport
caractère
réside
est
de
ce
mot
entre
deux
le
que
sensations
nous
les deux idées issues de
est
nous
comparons
se
représente le rapport entre
comme
existant indépendamment de notre perception,
(Sr~ •• ~ir.
,
Ile'
l ,
de
est
xiii,
encore
p.
rapport
affirmer
456)
434
marquer
que
ces
le
dans
la
perception;
sensations
choses
entre
ce
verbe
apercevons
qu'on
l'attribut,
appelle
Dans la Sra •• aire,
compare
les
un
marquer
qu'on
lorsqu'on
un
avons
mot) d' .tre
jugement n'est encore qu'une simple
n'est pas seulement apercevoir
idées
prononciation du
Lorsque
leur
deux
pour
ce
davantage dans la
l'esprit du locuteur.
perception,
(l e
(Essai . .. , II, l, ix, p. 85).
l'affirmation
que
le
perçu
Dans les deux cas nous
"Voi là à quoi répond celui
manière
affir.er.
avoir
c'est le verbe .tr. qui est employé
l'affirmation
Cette
et
lorsque la comparaison des
non-convenance.
Et
jugement.
l'affirmation
nous affirmons lorsque nous lions deux idées par
nous
leur
par
et
représentées
alors
le
rapport
juger
sujet
et
existe"
"Voilà donc le jugement, qui,
après avoir été une simple perception,
cette
devient
affirmation;
affirmation emporte que l'attribut existe dans
et
sujet"
le
(ibid.). Le Dictionnaire des synony.es, au mot Juge.ent, donne la
"Perception d'un raport,
définition suivante
en
affirmant
perception
ou
en niant"
(p.
350) .
et qu'on exprime
le
Si
jugement
le jugement comme affirmation sont une
et
m@me opération,
le premier,
malgré tout,
comme
seule
et
précède nettement
le
second.
En fin de compte,
pas
l'affirmation
modes) ,
mais
sujet";
voilà
le propre du verbe est de
(comme nous le verrons dans
plutôt
"la co-existence de
la
marquer,
non
théorie
des
l'attribut
dans
pourquoi il a été "choisi" pour "prononcer"
le
tous
nos jugements. Une proposition est affirmative si elle affirme la
co-existence de l'attribut dans le sujet,
et négative,
si
elle
affirme que l'attribut ne co-existe pas dans le sujet. Les verbes
sont
bien
sûr,
comme
dans
la
tradition,
susceptibles
de
modifications pour marquer les personnes, les temps et les modes,
en plus des autres modifications adverbiales.
Notons enfin que Condillac distingue clairement
~tr~
le
comme "notion grammaticale" et comme "notion lexicale"
Il ne faut pas confondre le verbe substantif avec
le verbe .tr., pris dans le sens d'~xist~r. Quand
435
verbe
(~)
on dit qu'une chose existe,
on veut dire qu'elle
est réellement existante.
En pareil cas, on peut
se servir du verbe .tre,
et on dira fort bien:
Corneille ~toit du te.ps de Racine, c'est-à-dire,
existait.
Mais quand je dis,
Corneille est poëte,
il ne
s'agit pas d'une existence réelle,
puisque Corneille n'existe plus;
et cependant, cette proposition est aussi vraie que du vivant de Corneille : peut-être l'est-elle plus encore.
La co-existence de Corneille et de po~te n'est donc qu'une vue de l'esprit,
qui ne songe point si Corneille vit ou ne vit pas, mais qui voit Corneille
et po.te comme deux idées co-existantes.
(6r •• -
*.aire,
**
p. 457).
***
La
co-existence
de l'attribut avec le
sujet
peut
être
"envisagée" de différentes manières
Mais si j'affirme cette co-existence, lorsque je
dis, vous .tes tranquille;
je ne l'affirme plus
lorsque je dis, sois tranquille, je voudrais que
vous fussiez tranquille.
Les verbes prennent
donc encore différentes formes, suivant la manière dont nous envisageons cette co-existence. Ce
sont ces formes qu'on appelle .odes, mot synonyme de •• nitre.
(ibid., pp. 467-468).
Tous
les
temps
de l'indicatif
"affirment la
l'attribut avec le sujet" (ibid.,
donc
p.
471)
co-existence
"L'affirmation est
l'accessoire qui caractérise le mode indicatif"
(p.
472) .
L'affirmation n'est plus ici qu'un "accessoire" qui distingue
mode des autres modes où elle "disparoît".
de
Dans le
un
Dictionnaire
des synony.es, le mot "accessoire" est entré en tant qu'adjectif,
comme dans "idée accessoire";
mais
436
Condillac précise que
Il
[c] e
mot
s'employe
souvent
avec
ellipse,
c'est-à-dire,
sans
son
substantif". L'utilise-t-il dans sa théorie des modes d'une façon
elliptique pour "idée accessoire",
à la manière de Beauzée qu'il
a lu attentivement et invoque à quelques reprises
dans sa théorie
des temps)?
dans sa théorie des temps,
fait prendre au verbe,
(6)
C'est en tout cas ce qu'il fait
affirmant que
ajoute quelque
qu'il
Beauzée,
en va de même
dans 1 e suj et
p.
les
l' indica tif est un mode "pur"
i dé e a c ces soi r e .
verbe"
pour
"[c]haque
forme qu'on
idée accessoire à
principale dont il est le signe" (ibid.,
croire
(en particulier
469) ;
modes.
tout porte à
Cependant,
pour
auquel ne s' aj out e aucune
L'affirmation de la co-existence de
l'attribut
"n'est donc pas partie intégrante de l'essence
(Pariente,
op.
c it. ,
p.
262) .
Celle-ci
et l'affirmation n'est qu'une manière de
comme Beauzé e,
du
consisterait
seulement à marquer la co-existence de l'attribut dans le
ne dit pas,
l' idé e
l'envisager.
sujet,
Condillac
que le sens indicatif d'un verbe est
plus fondamental que les autres.
Voyons
ce qu'il advient de cette co-existence
lorsque
verbe est à l'impératif
Mais s~ au lieu de dire tu f.is,
vous faites,
je dis, f.is, fait.s,
l'affirmation disparaît,
et la co-existence de l'attribut avec le sujet,
n'est plus énoncée que comme pouvant
ou devant
Cet accesêtre une suite de mon commandement.
a fait donner à
saire,
substitué au premier,
cette forme le nom de .ode i.p4,.atif. (S,. •••• i"', p. 472).
437
le
Si
les verbes "prononcent" tous nos
jugements,
ils
prononcent
également, semble-t-il, nos commandements, et bien d'autres actes
de parole. Si, comme l'affirme la Sra ••• ire, tout discours est un
jugement
ou
une
suite
de
jugements
(exprimé s
par
des
propositions), les commandements en sont-ils une espèce qui ne se
distingue
du
jugement
l'énonciation?
l'impératif
Le
que
sur
commandement
le
plan
est
du
discours
l'accessoire
du
p.
472) .
"Je
se
que
jugements
verbe
catégoriques,
à
où
l'impératif
la
prononce
être
ébauche
de
explicite
dans
"l'affirmation
De
disparoît",
toute
discours
n'est
semble que non,
1982)
soulignent
rend
l'attribut
traite
manière,
à
et celle-ci paraît
act es de pensé e,
une
serait
mais Condillac n'est pas du tout
jugement exprimé par le discours.
des
qui
La proposition exprimée par l'impératif
modales.
sujet
comme
l'indicatif
cette question et sa Logique ne
sur
propositions
thé ori e
nous avons ici
les modalités affectant la co-existence de
alors une proposition "modale";
explicite
le
"comme pouvant ou devant
"réduction" de l'impératif à
le sujet.
non
Dans le passage cité plus
cette co-existence est présentée
une suite de mon commandement";
à
pourrait-il
co-existence de l'attribut dans
ne soit plus présentée comme actuelle?
haut,
des
à
fais
Si le verbe
l'indicatif prononce des jugements catégoriques,
le
de
verbe
comme l'affirmation l'est de l'indicatif;
affirme,
ou
des
l'impératif,
constitutive
du
Doit-on voir là un retour à la
une entorse au
qu'un jugement ou une
suite
car les commentateurs (Auroux,
clairement le fossé qui
438
pas
principe
de
que
le
jugements?
Il
1986,
sépare
Pariente,
Condillac
de
Port-Royal;
sont
pas
selon
rien
(A ur 0 ux, 1 986,
0
opération
p • ci t . ) .
Si le
l'esprit
de
l'affirmation
qui
acte
Beauzé e,
de
ne
mais des actes de
au contenu représentatif de
entre deux sensations ou
simple
l ' affirmation et le commandement
des actes de pensée,
n'ajoute[ntJ
une
Auroux,
deux idées,
pensée.
est
résultant de la
n'est pas
traite
jugement
il
jamais
cela,
comme
la
la
" qui
perception "
bien
un acte ou
simple comparaison
m~me
n'en va pas de
(tout comme
Malgré
langage
ne
prononciation)
Condillac,
elliptiques
tout
de
un
comme
phrases
les
impératives.
Les temps de l'impératif sont tous,
vral.s
futurs".
pour
Condillac ,
"Fais!" paratt au présent "parce que
"de
celui
qui
commande, semble vouloir que la chose se fasse à l'instant même " ,
mais
"on
comme
commandement" ,
ne
peut
obéir
que
postérieurement
s'agit bien d'un futur.
il
au
C'est pourquoi
nous
commandons souvent avec le futur de l'indicatif. Il en va de même
pour "Ayez fait!"; "Ayez fait, quand j'arriverai!" est équivalent
à
"Vous
aurez fait quand j'arriverai".
commandement
qu'il
positif",
permet
exprimé
pas
l'indicatif
par
exprime
d'appeler"
aurait
un
exprimé par l'impératif.
modifiée
une
le futur
de
Condillac note
l'indicatif
Le
(ibid.)
degré de
puissance
ou
supérieur
Notons enfin qu'une phrase
439
à
du
ne
par
celui
impérative
commandement,
et alors l'objet
interdiction,
on
exprimé
commandement
le
"plus
est
"une volonté pl us abs 01 ue dont
par une négation n'exprime plus un
défense
que
verbe
mais
le
précède
"Ne le faites pas!".
"J, f.is affirme,
mais
fais commande,
l'affirmation n'est pas positive,
elle est conditionnelle
affirme aussi;
j , ferois
comme dans
l'indicatif,
je ferois, si j1avois le te.ps.
Cette
condition est l'accessoire d'un mode que l'on nomme conditionnel"
(ibid.) .
Le
verbe
au
mode
affirmation conditionnelle.
temps
les
présents,
du
conditionnel
A la suite de Beauzée,
conditionnel sont
passé s
ou
prononce
futurs
"indéfinis"
"suivant
les
et
donc
une
il note
que
peuvent
circonstances
être
du
discours". Il remarque aUSS1 que si l'usage préfère "viendrait" à
"viendra"
c'est
dans "Je l'attends,
il m'a promis
que "l'exécution de ce qu'on promet,
qu'il
viendrait",
dépend
toujours
quelque conditions exprimées ou supposées" (ibid.).
dit
rien
de
Condillac ne
des conditions dont dépend l'exécution de ce
qui
est
constituer
des
commandé ..
L'indicatif
et
le conditionnel
peuvent
propositions principales. Mais dans les propositions subordonnées
où
le
verbe
est
"indéterminé "
et
au
subjonctif,
le
"c et te indé termina t i on est
constitue le mode qu'on nomme su.bjonctif."
rapports
rapport
d'antériorité,
temps
est
l'accessoire
qui
(ibid.,
au
p.
473). Les
d'actualité et de postériorité dans
440
le
subjonctif dépendent davantage des circonstances du discours
des
idées
accessoires
différentes
formes
distinguer
les
proposition
associées aux formes
du
subjonctif
qu'à
temps,
sont
du
verbe
mo~ns
subordonnée au verbe de la
" les
dest iné es
la subordination du
verbe
proposition
que
de
à
la
principale "
(ibid., p. 473). Au chapitre des conjonctions, Condillac explique
la
règle suivant
subordonnée
laquelle le choix du mode
doit se faire
de
la
lorsque le verbe de
proposition
la
principale
"affirme positivement et avec certitude", celui de la proposition
subordonnée
principale
être à l'indicatif;
doit
"exprime
quelque
doute,
mais si le
quelque
verbe
crainte,
de
la
quelque
incertitude" (ibid.,
p. 498), le subjonctif est préférable; nous
disons, par exemple,
"Je sais qu'il
qu'il soit surpris " .
~st
surpris",
et
" Je doute
Il en va de même pour les conjonctions qui
laissent dans l'esprit incertitude et "suspension", comme pou.rvu.,
afin,
avant, etc.,
qui appellent le subjonctif.
Le
l'infinitif
verbe
à
"est
dépoui llé
accessoires qu'il avoit dans les autres modes";
de
en
tous
les
conséquence,
"il ne peut plus être qu'un substantif, qui exprime une action ou
un état" (ibid.,
mensonge
l'on
p.
474)
est un crime".
retrouve
en
"Mentir est un crime" se dit pour "Le
Les participes sont des adjectifs
décomposant
soustraction du verbe substantif.
441
les
verbes
adjectifs
que
par
Les
interjections sont des éléments
d'action et à celui des sons articulés.
rapides,
la
langage
Ce sont "des expressions
n'a rien à remarquer sur ces espèces
au sentiment à les proférer à
L'~rt
au
équivalentes quelquefois à des phrases entières";
"grammaire
c'est
communs
d"crire
propos"
de
(ibid. ,
mais
mots
p.
499)
(p. 573) revient brièvement sur les exclamations,
mais sans rien ajouter à ce que dit la 6ra __ aire. Le Dictionnaire
au mot "acclamation", nous dit qu'il s'agit d'une
Il
j oi e qui se témoigne par des cri s. lJi Vtt est le mot qui en parei l
cas est dans la bouche du peuple".
Quant aux phrases interrogatives,
pas
d'indications
sur
il n'y a
la manière de les
pratiquement
interpréter
dans
la
Dans la 6ra __ aire (p. 492), on
apprend que "Où allez-vous?" est une phrase elliptique; la phrase
pleine
"Quel est le lieu auquel
serait
lieu
vous
allez?".
Condillac ajoute que dans un tel exemple, on voit "que l'adjectif
où est équivalent à un conjonctif suivi de son substantif,
une
proposition qui le pourroit précéder.
(je souligne)
Malheureusement,
"supprimé e"
proposition
directement
l'acte
interrogative.
L'~rt
et
accompli
d"crire
S1
par
servirait
l'énonciation
à
supprime "
mais qu'on
il ne dit pas quelle est
elle
et
cette
exprimer
à
d'une
phrase
(p. 573) traite de l'interrogation,
mais comme figure de rhétorique (comme le fera encore
442
Fontanier)
et non comme mode d'énoncé
l'expression
propre
aux
sentimens;
reproches",
l'adjectif
tour
des
qui
marque
elle parott
~tre
Dictionn_ir~
Le
"Interrogatif",
(" l nt err oga t i on ")
par
"L'interrogation contribue encore à
le tour
d~s
plus
synony.~s,
dit simplement qu'il "[s]e dit
une
interrogation";
l'article
nous dit qu'il s'agit d'une
celui qui a l'autorité,
vérité d'un autre,
le
d'un
suivant
"[dJemande
ou qui se l'arroge,
ou pour juger de son savoir l l
,
à
faite
pour tirer
la
et renvoie
le
lecteur à l'article "Demander",
*
***
*
Le
Dictionn.ir~
d'analyses
impressionnant
d~s
de
synony.~s
verbes
contient
un
illocutoires,
nombre
Mais
analyses sont encore bien rudimentaires en comparaison de
que
l'on trouve aujourd'hui dans les théories de
signifient
acte linguistique que l'analyse vise à identifier sans
l'aspect "performatif" en est absent
Condillac
l'ajout
distingue
d'une
sincéri té,
mode
celles
l'énonciation;
ces verbes ne sont appréhendés que par le fait qu'ils
un
des
condition
(Auroux,
apparenté s
verbes
préparatoire,
d'une condition sur le contenu
d'accomplissement,
d'une
ces
plus;
1986), Par contre,
(' 1
d'une
synonymes I l )
par
condition
de
propositionnel,
intention perlocutoire
ou
degré de puissance à l'un quelconque de ces verbes qui paraît
plus
simple
et
le moins
"chargé
443
d' idé es
accessoires l l
,
d'un
d'un
le
Nous
présentons ici la plupart de ces verbes en insistant sur ceux qui
nous paraissent les plus importants,
indiquant ici et là ce
qui
distingue des verbes synonymes en utilisant la terminologie de la
théorie des actes de discours, à la manière de Vanderveken (1988,
chap. VI);
ma1S
quelquefois,
souvent
illocutoire
nous
qui
le
nous
nous reconstruisons le verbe en entier,
contentons
d'indiquer
distingue du précédent.
On
la
composante
ne
devra
pas
s'étonner de trouver des verbes qui ne sont plus en usage ou dont
la signification a changé considérablement; le Dictionn.ir. a été
rédigé à Paris entre 1756 et 1767.
Nous suivrons le plus souvent
l'ordre alphabétique du Dictionn.ire .
"On ab.ndonnll ce qu'on a parce qu'on ne s'en met
peine;
pas
en
on renonce a une chose qui a été chère ou qui doit l'@tre
ou à une chose à laquelle on a des droits"
abandonner
+
condition
préparatoire
4) .
(p.
et/ou
[Renoncer
condition
sur
=
le
contenu propositionnel] .
~bdiqa.r
se dit surtout d'un prince;
alors
qu'un particulier s. d'.lIt d'une
tient
donc
à
~bjarllr
où l'on
une condition
sur
le
un
charge.
contenu
prince
[La
abdique,
différence
prop.].
consiste à "[r]enoncer solennellement à une erreur
étoit sur la religion,
c'est-à-dire, à une hérésie" (p.
444
renier est son synonyme,
7) ;
part
on
notre
ren~e
ma~s
il ne se prend qu'en mauvaise
par crainte, on abjure en suivant les lumières de
raison.
différence
[La
tiendrait
un
à
mode
d'accomplissement et/ou à une condition de sincérité]
~bolir
et
son
abolit
a pour synonymes abroger, annuler, casser,
sens général est
"mettre une chose
on abroge une loi,
une coutume,
hors d'usage";
on annule un
testament, une procédure, on casstl un arr@t"
se
distinguent
donc
à chaque fois par
an~antir,
(ibid.).
une
"On
acte,
un
[Ces verbes
condition
sur
le
contenu propositionnel] .
~ffir.er
a en général le sens
donne comme synonymes les
Condillac
, , d ire
mots
qu'un ch 0 s e
pr4tendre,
est" ;
soutenir,
~ffir.er.
C'est dire une chose parce qu'on la
croit; pr4tendrtl c'est la dire parce qu'on veut
qu'elle soit crue; soutenir,
c'est la défendre
contre ceux qui la nient; assurer, c'est la dire à des personnes sur la confiance desquelles
on pense devoir compter, attestttr c'est rendre
témoignage d'une vérité à
ceux qui sont intéressés à la connoitre, cttrtifier, c'est .ssurttr
une chose a (sic)
des personnes qui en étoient
prévenues sans en être surs, confir.er,
c'est
en donner une nouvelle assurance a
(sic)
des
personnes qui la croyoient déjà.
Garantir un fait, une nouvelle, c'est l'assurer en s'en rendant garant,
en répondant de sa
vérité,
c'est dire je vous
l'assure,
prenez
vous en à moi, si vous êtes trompé. (P. 30).
[Prétendre,
c'est
donc
affirmer +
445
intention
perlocutoire
de
convaincre; soutenir, c'est affirmer + condition préparatoire que
l'allocutaire
a
affirmer
condition
+
déjà
nié
ce
qu'on
préparatoire
l'allocutaire en soit convaincu;
d'accomplissement
Cl' allocutaire
(en
veut
affirme;
est
c'est
utile
que
attester, c'est affirmer + mode
+
témoignant)
connaître
qu'il
assurer,
le
condition
contenu
préparatoire
propositionnel) ;
certifier,
c'est assurer + condition préparatoire (l'allocutaire
n'est
sG.r
pas
condition
et veut
savoir) ;
confirmer,
préparatoire (l'allocutaire
savait
c'est
assurer
déjà);
+
garantir,
c'est assurer + mode d'accomplissement (en se portant garant)],
Condillac précise plus loin Cp, 141)
que l'on " con fir.fI
ce qui a été assuré, on ratifi.
un acte,
traité, lorsqu'on aprouve ce qu'un autre a fait en notre nom 11
Condillac
distingue
l'affirmation par une intention perlocutoire
on
dit qu'une chose est,
qu'on le pense;
et on veut seulement
,
CP, 60)
llest plus fort 11 qu'affir •• tionj
,
celle-ci
de
llPar l' .ffir.ation
faire
par l'assflrtion on dit qu'elle est,
que les autres en soient convaincus 11
un
connoître
et on
veut
Condillac souligne
ainsi
[asserter
=
affirmer + intention perlocutoire + degré de puissance (+1)],
c'est llprévenir quelqu'un sur quelque chose, afin
qu'il écarte, qu'il éloigne les accidens qu'il doit craindre 11 Cp,
446
74) .
Condillac distingue l'aveu de la confession par le fait que
le
premier peut ne pas être volontaire (tirer des aveux
torture) tandis que la seconde l'est toujours.
par
la
c'est
Confesser,
"faire une confession".
c'est [t]rouver bon qu'une chose se
Rpprouver,
qu'elle soit faite"
(p.
coupable d'une faute,
53) .
ou
Recuser, c'est "déclarer quelqu'un
d'un crime,
d'une négligence,
l'accusation "se fait à un tiers;
19) ;
fasse,
etc."
(p.
le reproche se fait à la
personne même que l'on blame"; "On taxe quelqu'un, lorsqu'on veut
faire
retomber
sur lui une faute,
un crJ.me
dont
il
pourroit
n'être pas coupable".
c'est "faire un blasphème".
Le commandement se distingue de l'''ordre'', du "décret",
l'''injonction''
et de la
"jussion" .
de
Tous ces termes renvoient à
"l'exercice de l' autori té du supérieur sur l'inférieur" (p. 132).
Le
commandement
s'étend
également à
tous
ceux
lesquels
sur
s'exerce l'autorité d'une personne, tandis que les ordres varient
selon les inférieurs;
mais
il
donne
composent.
Le
supérieur
arrête
un général a le commandement de son armée,
différents ordres aux différents
décret
"est
une
résolution
ce qui sera fait dans tel
corps
par
ou
tel
préceptes sont des ordres qui ne visent personne en
447
qui
la
laquelle
un
cas".
Les
particulier;
à
chacun
de
juger
s'il
doit
suivre
ou
non
le
L'injonction "est un ordre émanant d'un tribunal",
"émane du souverain",
ordonne
exerce
et la jussion
Si un parlement résiste aux ordres du roi,
on le contraint par des
"avoir l'autorité",
précepte,
Co •• ander,
"lettres de jussion",
"Celui qui co •• ande a l'autorité,
l'autorité,
qui
celui
c'est
celui qui
prescrit
détermine
exactement quels sont ses ordres,
il marque ce qu'on doit faire,
et
on
les
limites
commande
à
dans lesquelles
doit
ceux qui sont présents,
se
renfermer",
"on mande à celui
qui
On
est
absent; ainsi, .ander c'est proprement envoyer un ordre",
"On co ••• t
la conduite d'une affaire à quelqu'un, lorsqu'on
lui en laisse le soin, On le co ••• t
désigne pour la suivre,
réfléchi,
on
On la lui confi"
qu'on
voit
ent iè rement sur lui,"
à un entreprise lorsqu'on le
peut sans
lorsqu'après y
inquiétude
s'en
avoir
reposer
CP, 133),
Cons.ill.r, c'est "[d]onner un conseil",
Cons,ntir,
144) ,
c'est "permettre qu'une chose se
fasse",
cP,
Cont,st.r, c'est simplement "[a]voir une contestation", la
contestation étant une "contradiction entre des personnes qui ont
sentiments
des intérêts ou des
"faire
un
personnes
autres"
Cp,
contrat",
s'engagent
151) ,
contraires" ,
Contract,r,
un contrat étant "l'acte
réciproquement
Contr,dire,
les
unes
c'est
par
lequel
des
à
l'égard
des
c'est "[dl ire le contraire de ce
448
qu'un
autre
a
"[p]rendre
dit ou de
avec
ce
quelqu'un
qu'on
les
a
mêmes
dit".
Convenir,
sentimens,
c'est
les
mêmes
résolutions, les mêmes partis, y venir pour ainsi dire ensemble".
(P.
"Convier se peut dire lorsqu'il s'agit de prier à une
153).
fête,
inviter
et
lorsqu'il s'agit de toute
convie par l'attrait du plaisir,
chose.
On
on invite par des raisons,
par
des prières ou par les plaisirs qu'on promet".
inviter
faire une chose en employant tous
à
croit
propre
à
d'accomplissement]
déterminer".
"c'est
moyens
inviter
qu'on
mode
+
"Solliciter est invitt#r quelqu'un à faire une
chose dont il craint de se mêler ou qui peut
danger".
Exhorter,
les
=
[Exhorter
autre
l'exposer à quelque
(On exhorte au bien, on sollicite au mal).
inviter + condition préparatoire] .
[Solliciter
=
"On incite par l'instruction,
par l'exemple". Et "rt#co ••• ndtlr c'est tlxhorttlr quelqu'un à donner
particulièrement ses soins à une affaire,
intérêts".
=
[Recommander
à une personne,
exhorter + condition sur
le
à ses
contenu
propositionnel] .
L'article
en
ce
qu'il distingue un grand nombre
"On
apparenté s .
pas bien" (p.
de
"Désapprouver" est particulièrement intéressant
=
peine
critique
trouve
il exprime en plus du
mécontentement
désapprouver + condition de sincérité]
[condamner
en
i 11 ocut oires
197), mais celui qui "improuve" ne se contente pas
qu'on trouve mal,
une
verbes
d'saprouvt# (et on i.prouvtt) ce qu'on ne
juger défavorablement,
[improuver
de
lorsqu'on
=
bl~mer
+
mode
bl~me
décernant
d'accomplissement].
montrant ce qu'il y a de bien ou de
449
en
mal
dans
"On
une
chose.
NI prend
On
faute,
en avertissant quelqu'un qu'il
trouv~
ou qu'il a un défaut. On
lorsque
~
fait
a
une
redire à ce qu'il a fait
sans le blâmer en tout on le reprend en quelque
chose."
On corrige quelqu'un "en lui aprenant les moyens d'etre mieux
faire mieux,
de
ou en l'y obligeant par des
censure en conda.nant ses moeurs."
=
reprocher
R'pri.ander quelqu'un,
+ condition sur le contenu
Reprocher,
d' acc ompl i s sement] .
reproche"
(p. 492), et
.~n.c~r,
c'est
simplement
"faire des menaces"
(p.
197)
le
c'est
[Réprimander
propositionnel
+
mode
"faire
un
(p. 379). "On
longuement et avec peu
'pilogue lorsqu'on censure à tout propos,
de fondement"
On
chatimens.
lui reprocher ses torts et le menacer de punitions.
ou
c'est "[c]ondamner aux peines
D•• n"r,
éternelles" (p. 172).
D'cl.rer, c'est "[f]aire connoître ce qui est ignoré, ou ce
On d'cl.re sa volonté,
qu'on suppose n'être pas assez connu.
qu'on est déterminé à faire,
qu'on
a
fait
soi-même.
ce qu'on veut qui soit fait,
d'cl.r~r,
178) .
d'cl.r~
on
quelque action. On d'cl.re la guerre,
d'cl.r, ses complices" (p.
toujours
Ainsi ce mot est
D'couvrir,
ce
ou ce
relatif
ses péchés.
à
On
à la différence de
est relatif aussi bien aux pensées qu'aux actions
(ou à
tout ce qu'on pouvait tenir caché). D'nonc.r, c'est déclarer à un
juge
qu'une
l'auteur
personne a accompli une action
[Dénoncer
propositionnel
=
déclarer
+
condition
+ condition préparatoire] .
c'est d'couvrir un secret.
Protester,
450
dont
sur
on
le
R'v'ler (ou
cherchait
contenu
'venter)
c'est d'cl.rer hautement
ou
avec
serment
contre une chose
mode d'accomplissement +
[+
condition sur le contenu propositionnel]
c'est
Conseiller,
comme
"[d]onner
dissuader,
un
conseil"
Cp,
consiste à détourner
144 ) ,
quelqu'un
d'une entreprise; "mais celui qui déconseille donne seulement son
conseil,
et
celui qui dissuad. détermine à le faire "
[+ intention
perlocutoire],
vivement "l'esprit,
D'crier quelqu'un,
les moeurs de quelqu'un"
décr'ditt# en faisant tomber son crédit " ,
Cp,
179)
c'est critiquer
Cp, 180), et "on le
"On dédit quelqu'un en
retirant la parole qu'il a donnée pour nous, en disant qu'on veut
le contraire de ce qu'il a dit,
On le contredit en soutenant une
proposition qui combat directement ce qu'il a avancé, On le dédit
sur
ce qu'il a promis,
porte"
Cp,
181)
on le contredit sur les
[condition
Employé pronominalement,
par
le
fait
témoignant
qu'on
le
sur
le
contenu
jugemens
qu'il
propositionnel],
s. d'dire se distingue de se contredire
se dédit
en
connaissance
contraire de ce qu'on a
dit",
de
cause,
alors
"en
qu'on
se
contredit "en avançant des jugemens tout-à-fait opposés, et on le
fait
parce qu'on ne sait pas ce que l'on
" fa ire
un
dé fi"
Cp,
183) ;
c ' est
dit",
un dé fi est une
"[i]nvitation
laquelle nous proposons à une personne de faire une
chose,
en lui faisant sentir que nous pensons qu'elle n'est pas
de
faire
signifie
quelqu'un,
aussi
souvent
bien que nous.
provoquer
un
C'est pourquoi
combat"
c'est le faire descendre
ou d'un rang.
451
Cp,
faire
182) ,
honteusement d ' une
par
mais
capable
un
dé fi
D'grilder
dignit é
a
De •• nder
pour synonymes insister
[sur
une
demande],
interrogation,
postuler,
interroger,
questionner,
et requ'rir.
"On de.ande en adressant la parole pour obtenir une
réponse,
mot,
un bienfait,
faire
une
une grace,
une dette,
toute chose en un
qu'il est au pouvoir d'un autre de nous accorder"
Cp. 188).
On insiste lorsqu'on demande avec instance et sans cesse
ce qu'on obtienne ce que l'on veut
elle
est
autorité
instruite";
de
préparatoire]
la
[mode d'accomplissement].
la vérité d'une personne,
interroge pour tirer
l'interrogation
part
de
jusqu'à
celui
ou pour juger si
présuppose une
qui
la
"On
certaine
[condition
fait
"On qUflstionne en faisant plusieurs de •• ndes
curiosité
et dans le dessein de
"demander
à être admis dans un
s' instruire " .
couvent I l
Postuler,
par
c'est
Ile'
,
est
faire une demande à un tribunal I l .
c'est
donne
à
qu'elle
Il
rd] onner un dément i
Il
Cp.
189) ;
une personne en l'accusant de dire le contraire
sait
vrai I l
[démentir
=
quelqu'un,
c'est lui
retirer
être
accuser
"on
le
de
ce
condition
+
préparatoire] .
DI.ettre
destituer,
"D'poser
c'est
la
lui enlever pour
cause
une
de
charge;
malversation;
ne se dit que des destitutions faites par une
ecclésiastique" [condition préparatoire] .
452
le
autorité
" ne pas
convenir
d'un fait,
d'une dette,
sommes apelés en justice" (p.
plus
et en général de ce que
190)
c'est
compter sur une chose que l'on s'étoit promise"
c'est
D~roger,
convention,
"annuler
par
une
une loi précédente"
nous
nouvelle
"ne
194) .
(p.
disposition;
(pp. 195-196). Un
d~saveu
"acte par lequel on déclare qu'on n'a pas dit ou fait une
une
est un
chose,
ou que nous n'y avons pas autorisé celui qui l'a dite ou faite en
D~savou,r,
notre nom"
(p.
ce
a dit ou fait,
qu'on
198) .
nous" [désavouer
ou
fait
=
quelque
1 ocut eur) ]
c'est donc "faire un désaveu de
de ce qu'un autre a dit ou
nier + condition préparatoire
chose
qui
a
un
certain
"On d4silvoutl aus s i quelqu'un,
fait
(quelque a
rapport
avec
pour
dit
le
lorsqu'on ne veut pas
le reconnoître pour ce qu'il est par raport à nous".
On
l'idée
dlttlr.in.
"le sens d'un mot
qu'on y attache"
connoître
faisant
par
(p.
205) ;
une
qualité
en
"on
marquant
d~finit
qui
exactement
une chose en
renferme
la
toutes
les
tout
les
engagement' ,
(p.
autres".
c'est
volontés
d'un autre,
"[f]aire voeu de
suivre
et renoncer à tout autre
en
207) .
Disculptlr
quelqu'un,
c'est
c omml. s la faut e dont il est accusé"
faire
(p.
"voir qu'il
n'a
pas
214); excus,r quelqu'un,
c'est reconnattre la faute qu'il a faite en prouvant qu'il mérite
d'@tre pardonné;
et on le justifie "en montrant que ce qu'on lui
453
reproche comme une faute,
fait
que
ce
qu'il a
n'en est pas une,
da
faire".
Disgracier,
quelqu'un la faveur qu'on lui avait accordée"
Dispenser, c'est
ou que même il
c'est
n'a
ôter
"à
(ibid.).
"accorder une dispense ou une
exemption",
c'est-à-dire, "une permission par laquelle on est soustrait à une
loi" (ibid.).
Enjoindre,
comme accordtrr
nous demande"
et
c'est "faire une inj onct ion"
octroyer,
et
(p.
17),
se
dit
"octroyer"
signifie
(p. 247).
"faire une
grace
mais "exaucer" se dit surtout
d'un supérieur
qui
Ex.u.c~r,
accorde
qu'on
de
Dieu,
une
grâce
[condition sur le contenu propositionnel] .
Exig~r,
l' @tre"
c'est "[d]emander une chose due,
[demander + condition
(p. 268)
c'est "[d]demander l'aumone"
le
contenu
(p.
308)
larmes" (p. 325)
Infor.~r
j
[demander +
préparatoire].
/IIendier,
[demander + condition
c'est
propositionnel].
ou qu'on suppose
"demander
sur
avec
mode d'accomplissement].
consiste à "faire connoître une chose telle qu'elle
est" (p. 336). Inj u.ri er ,
offensantes" (p.
c'est "[d]ire des injures,
des paroles
337) .
Innocenter, c'est "[d]éclarer innocente une personne accusée
d'un crime"
(p. 338)
j
[déclarer + condition préparatoire] .
454
"On insinue
lui
à quelqu'un ce qu'il doit faire,
lorsqu'on le
fait entendre adroitement et en prenant des détours.
lui suggere,
l'y
le
lorsqu'on lui en donne l'idée ouvertement, et qu'on
détermine
par des raisons ou par la confiance qu'on
inspiré e"
(p.
maJ.s
peut suggérer une idée sans en avoir formé
on
On
339) ;
lui
pour insinuer, il faut en avoir le dessein,
le
projet.
Instiguer,
c'est "solliciter secretement une personne à nuire
une
(p.
autre"
a
Insulter,
340) .
c'est "faire une insul te l'
à
(p.
341)
"On nous interdit les choses qui en elles-mêmes ne sont pas
mauvaises,
avions"
(p.
lorsqu'on
terme
cela
et
342) .
nous
de loi"
se fait en nous ôtant le droit que
"On
d~fend
nous
ce qui
est
mal
nous
en
"Prohiber
ordonne de ne le pas faire".
y
soi,
est
un
(quelque chose est prohibé par les ordonnances
de
l'Eglise ou de l'Etat); "un supérieur interdit, lorsqu'il empêche
un
homme
d'exercer
les fonctions de
sa
charge,
lorsqu'il interdit pour un tems marqué" [suspendre
il
=
susp~nd,
interdire
+
mode d'accomplissement] .
Jurer,
un
jure.ent,
promettre avec serment,
c'est "[a]ffirmer,
un
juron.
Sacrer
imprécations, ou en blasphemant"
d'accomplissement].
c'est
jur~r
(p. 351).
(Condillac, on le voit,
[Sacrer
455
=
des
jurer + mode
met ensemble l'usage
assertif et l'usage engageant du verbe jurer).
"[d]onner sa malédiction à quelqu'un,
faisant
en
faire
Hiludire,
ou faire des
c'est
imprécations
contre lui" (p.
375) .
c'est "faire des médisances" Cp.
377) .
Henacer,
étant
une "parole ou action par laquelle on
c'est "faire des menaces"
Cp.
379) ,
fait
une menace
craindre,
ou
l'on veut faire craindre sa colère".
"On cr1.e .erci à celui qu'on a offensé,
point
d'user de toute sa supériorité,
demande
merc1.
grâce avec instance et
=
demander
+
c'est-à-dire,
s oumi s sion "
mode
et qui est sur le
Cp.
d'accomplissement
qu'on
382) ;
+
lui
[cri er
condi tion
préparatoire] .
"On nj. une proposition,
il
sembloit qu'on devoit tomber d'accord,
un crime,
est
on disconvient d'un principe dont
un dépet. On refuse une chose qui est demandée
offerte.
durement.
On
r.broue
une
personne,
lorsqu ' on
la
ou qui
refuse
lorsqu'on
Le peuple dit regoul.r.
la
r.brou. avec assez de force, pour la faire désister de ce qu'elle
a avancé, pour lui en donner de la honte. On la r •• b.re lorsqu'on
repousse fortement les attaques,
et qu'on prend l'offensive avec
supériorité" (p. 402).
c'est "[d]onner un nom à une chose,
qu'elle a";
act e" Cp.
d~no ••• r,
ou dire celui
c'est nommer quelqu'un par son nom dans un
404) .
456
Objecter, c'est "faire une objection"
(p. 407).
Obliger, c'est "faire contracter à quelqu'un une obligation,
ce qui signifie, suivant les circonstances, lui faire une loi, ou
une nécessi té de se conduire d'une certaine manière"
Pardonner,
c'est "[a]ccorder le pardon à
(p. 408).
quelqu'un"
(p.
421) .
"On pr'voit ce qu'on voit d'avance, on le pr'dit lorsqu'on
l'annonce à ceux qui ne l'auroient pas pr'vu,
lorsqu'on
le
pr4dit en vertu d'une inspiration
divine,
on
le
conjecture, lorsqu'on ne l'assure pas, et qu'on en juge seulement
sur des vraisemblances" (p. 458).
"On prie pour demander
comme une grâce" ;
une chose qu'on ne peut obtenir que
[condition préparatoire] .
demande avec soumission";
"On suplie, si on la
[mode d'accomplissement] ;
si on la demande au nom de ce qu'il y a de
plus
"on conjure,
cher,
de
plus
respectable. On interctde, quand on prie auprès de quelqu'un pour
un
autre.
On
invoque,
lorsqu'on
apelle
à
son
secours
des
lorsqu'on invoque
puissances supérieures" (ibid.)
celui sur le secours duquel on croit devoir compter".
c'est "[a]ssurer par un acte ou par un discours
qu'on fera une chose"
(p.
463) .
457
(Promettre serait
donc,
selon
cette définition,
un acte de type assertif puisque c'est le
de l'acte dénoté par "assurer"
"On
permettent
prouve
une
sont évidentes.
... ).
chose en
pas d'en douter.
cas
donnant
des
raisons
qui
On la dl.ontre lorsque les
On persuade quelqu'un,
ne
ra1sons
lorsqu'aux preuves qu'on
donne,
on joint des motifs capables de lui faire desirer que les
choses
soient
telles qu'on lui dit.
On le
l'entraîne par le seul poids des raisons"
convainc
lorsqu'on
Cp. 465).
c'est "faire un remerciement"
Cp.
485) .
"On retracte ce qu'on a di t, en 1 e dé savouant ou en avouant
qu'on
a eu tort de le dire.
déclarant nul,
On rlvoque ce qu'on a fait,
en
le
en déclarant qu'on ne veut plus ce qu'on a voulu"
Cp. 497). "On rlvoque un ambassadeur,
en lui 6tant ses pouvoirs,
on 1 e rap.ll. en lui ordonnant de revenir"
c ' est ' , fa ire un sa 1 ut,
CP. 499).
une révérence,
ou quelque
506) .
compliment équivalent" Cp.
T4.oign.r se distingue a1nS1 de dlposer
"on d'pose
en
déclarant un fait en justice. On le tl.oigne en le dlposant comme
en ayant été le témoin"
c'est
Cp.
193) .
"[b]lâmer quelqu'un en public".
458
se distingue de louer de la façon suivante
"On
vante une personne pour lui procurer l'estime des autres, ou pour
lui donner de la réputation.
On la loue, pour témoigner l'estime
qu'on fait d'elle,
ou pour lui aplaudir"
dire
bien des gens et leur
beaucoup
quaI i té s ... " ;
ce
qu'ils
de
"signifie
attribuer
de
louer "c'est aprouver avec une sorte
ont dit ou ce qu'ils
hautement
"louer
Cp. 551); vanter "c'est
quelqu'un,
quelqu'un
louer
ont
fait".
à
d'admiration
c'est
Pr'coniser,
et plus qu'il ne
par-tout,
grandes
mé ri te" ;
tout
propos
prtJntlr
et
avec
affectation" (ibid.).
(Jouer
"L'idée
chos e
voue
se
distingue de d'vouer,
commune
d'dier
à tous ces mots est l'offre
pour marquer s on amour ou s on respect"
à
qu'on
Cp.
fait
563)
Dieu et au public lorsqu'on s'engage à donner
d'une
"On
tous
se
ses
momens à l'un ou à l'autre, et on voue une chose à Dieu lorsqu'on
la lui offre en sacrifice.
se donne entièrement,
que les siens.
Dieu;
mais
l'invocation
On se d'voue à une personne à qui
de sorte qu'on n'a plus d'autres
On d'die une église à un Saint,
d'dier
d'un
c'est
Saint.
proprement
Ainsi
d'exclusion, qui n'est pas dans D'dier".
***
459
intér~ts
on la consacre à
consacrer
consacrer
on
à
emporte
Dieu
sous
une
idée
NOTES
(1) S.
Auroux,
"Actes de pensée et actes linguistiques dans la
Grammaire Générale", op. cit.; par là Àuroux laisse entendre, non
sans raison, qu'il y a, avec Condillac en Grammaire Générale,
un
déplacement des actes de pensée vers les actes
linguistiques,
accomplis par la prononciation
(ou l'énonciation) de mots ou de
phrases.
Mais la théorie des actes illocutoires reconnatt
nous avons eu l'occasion de le faire remarquer
qu'il y a des
actes illocutoires qui sont des actes de pensée.
(2)
Toutes
les références renvoient à
l'édition des O,uvr,s
phi1osophiqu,s d, Condi11.c de G. Le Roy, que nous avons utilisée
tout au long de ce travail;
nous avons,
comme toujours,
laissé
l'orthographe inchangée.
(3)
Cf .
L.
Wittgenstein,
De 1.
1976,
le paragraphe 402;
Gallimard,
229 et 422.
C,rtitude
(1969),
Pari s,
voir aussi les paragraphes
(4)
J.-C.
Pariente,
"Sur la théorie du verbe chez Condillac",
dans J.
Sgard (dir.) Condi11.c ,t 1,s prob1t •• s du 1ang.g"
op.
cit •.
(5) Cf.
E.
Benveniste,
'''Etre' et 'avoir' dans leurs fonctions
linguistiques",
chap.
XVI des
Prob1t.,s de
1 inguistique
g~n~r.1"
op. cit., p. 188. Comme notion lexicale, .tre a pour
valeur "avoir existence",
"se trouver dans la réalité",
et elle
s'oppose à la notion grammaticale dont la fonction est celle de
la copule.
Auroux et l . Ros i er ,
"Les s ourc es
(6)
Selon Àuroux (c f.
S.
dans
historiques de la conception des deux types de relatives",
"Condillac a travaillé avec
L.ngages, no. 88, déc. 1987, p. 22)
la 6r •••• ir' de Beauzée sous les yeux".
***
460
CHAPITRE NEUVIEME
James Beattie (1735-1803)
co •• on sense philosophers
etc.
Professeur
l'Université
de
Essay
Campbell
on
critiquant
est généralement rangé parmi
avec
Reid,
philosophie
d'Aberdeen,
il
Gregory,
morale
fut
et
Dugald-Stewart,
de
à
avec, entre autres,
Reid, et
(l'auteur de Philosophy of Rhetoric).
Avec son
Tru.th
(1770) ,
le
scepticisme
il s'est fait
de
David
un
de
logique
fameuse
d'Aberdeen,
membre
les
la
Philosophical Society
George
JAMES BEATTIE
ennemi
Hume;
célèbre
celui-ci
en
rédigea
l'''Avertissement''
(édition de 1777) justement pour faire
Ir Reid et à ce sot bigot de Beattie"
connu
pour
en
poé si e;
comme
ses
un
travaux en morale
Grammaire Universelle,
"disciple
effectivement
très
direct
souvent
de
"une réponse complète
Beattie fut surtout
(1)
et plus encore
(2)
on le
Harris"
présente
(3)
(ainsi que
son
mais nous verrons qu'il s'écarte
sa
quelquefois
qu'il
ami
par
mentionne
Monboddo)
reprenant de lui sa division des parties du discours et les
qu'il leur donne;
au
en
noms
sensiblement
de Harris dans sa théorie des modes verbaux.
The
parties;
(
la première a pour titre :
461
....
)
se
compose
"Of the Origin and
de
deux
General
Nature of Speech",
et la seconde,
"Of Universal Grammar".
à
la seule qui nous intéresse :
La première partie est surtout consacrée
des questions de phonétique et de phonologie,
thèse
de
biblique
l'origine divine du langage en accord
du
Paradis
Terrestre ("our first
received it by immediate inspiration",
Babel.
Dans
la
[1790]
Science
ouvrage de 1783),
mais
en
et présente
section II du chap.
(qui
résume les
p.
avec
parents
101)
Ides
le
récit
must
have
et de la Tour de
Ele.ents
principaux
la
of
résultats
Horal
de
son
il reprend la théorie de l'inspiration divine,
y ajoutant quelques bémols qui rappelent
la
cinquième
Partie du Discours de la .4thode de Descartes
Man is the only animal that can speak.
For
speech implies the arrangement and separation of our thoughts;
and this is the work
of reason and reflection. Articulated sounds
resembling speech may be uttered by parrots,
by ravens, and even by machines; but this is
not speech, because it
implies neither reflection, nor reason,
nor any separation of
because,
in a word,
of successive thoughtj
the machine or parrot does not,
and cannot,
understand the meaning of what it is thus
made to utter. (Ele.ents ... , pp. 13-14).
Et plus loin
Hence Artificial Signs have been universally
adopted, which der ive their meaning from human contrivance... (p. 16).
La seconde partie de la Theory of
a
de
peuvent
L~ngu.ge
commun à toutes les langues,
résider
dans les sons ou le
s'occupe de ce qu'il y
et ces éléments
matériel
des
communs
mots,
seulement dans leur signification et leur usage (p. 125).
462
ne
ma1S
À
la suite de Harris et Monboddo,
pronoms
dans
la classe des
Beattie met les noms
"substantifs",
et
les
participes et verbes dans celle des Ilattributifs".
et
adjectifs,
Les
premiers
servent à désigner les personnes et les choses dont nous parlons;
les seconds, les qualités, caractères et opérations des personnes
et des choses.
participes
dé notent
modifications
grammairiens
part
Les adjectifs dénotent de simples
temporelles.
qui
entière
auss1
des
qualités,
Beattie
qualités;
mais
appartient
avec
donc
font des participes une partie du
plutôt qu'une forme verbale.
complexe que le participe;
Le
verbe
des
à
ces
discours
est
et peut former,
lorsque joint à un
nom,
un
un
moment du temps et une assertion
an
énoncé
complet, une proposition. Le verbe dénote ainsi trois choses
attribut,
lie
(présent, passé ou futur), ma1S
en plus il renferme une assertion ou affirmation (co.prehends
assertion)
à
plus
lui aussi exprime un attribut et
cet attribut à un moment du temps
les
(affirmation
un
ou
négation). Voyons maintenant brièvement la théorie de l'esprit et
du jugement qui sous-tend cette conception du verbe.
We are endowed, not only with senses to perceive,
and with memory ta retain;
but also with reason
and judgment, whereby we attend to things,
and
compare them together,
so as to perceive their
characters and mutual relations.
Thus l not only
perceive the men whom l see to-day,
and re.e.ber
those l saw yesterday;
but also
for. judg.ents
concerning them:
and those judgments l express,
when l say, that one is strong, another weak; one
tall, another short, one young, another old;
one
good, another bad; one wise, another foolish, &c.
463
(Pp. 184-185).
Les
trois
sage ",
mots qui composent l'énoncé complet
constitue
l'expression
retire le verbe .st,
"Salomon
totale d'une pensée;
nous n'avons plus un énoncé,
on
en
car c ' est
la
fonction de ce mot d'affirmer la sagesse de Salomon,
sage"
( ou " sage Salomon " ) n'est pas un énoncé
n'accepte
donc pas,
validité
comme la plupart de ses
des phrases nominales;
si
est
et "Salomon
complet.
Beattie
contemporains,
la fonction assertive du
la
verbe
est ainsi définie relativement au plan morphologique (plutôt
syntaxique) .
que
Par suite, on peut dire que
it is the nature of a verb, first, to express
an affirmation;
and secondly, to form,
when
united with a noun and a quality,
a complete
sentence. (P. 185).
Plus loin (p. 191), il définit encore le verbe
A word, necessary in every sentence, and signifying affirmation.
A
strictement parler,
le seul verbe qui soit nécessaire est
verbe appelé par les Romains "substantif",
les
Grecs
(pour
commodité
paraissent
la
l'indicatif
d'existence",
et c'est
mais mieux nommé
seulement
"abréger le discours") que
les
par
par
autres
leur
verbes
A
la
n'aurions besoin que du verbe d'existence dans
sa
indispensables
nous
limite,
forme
"verbe
le
plus pure,
présent,
à
l'expression
des
à la troisième personne
mais
l'expression de nos
464
pensées.
du
singulier
pensées
de
serait
alors
souvent
éternelles") .
(sauf
(dénotant des attributs)
nombre
permettant
alambiqué e
pour
les
"vérité s
C'est pourquoi le verbe d'existence s'est
aux participes
certain
trè s
de
d'inflexions
et
(nombre,
s'est
chargé
personne,
en
plusieurs.
Finalement,
d'un
temps,
dire élégamment en un mot ce qu'on
maladroitement
combiné
mode)
devrait
le verbe
dire
est
ainsi
dé fini
A word, necessary in every sentence,
signifying
the affir.ation of some attribute, together with
the designation of ti.e, nu.ber and person.
(P.
198) .
Beattie
met
en
relation les
énoncés
complets
de
la
grammaire comprenant un substantif, un adjectif et un verbe, avec
les propositions de la logique comprenant une chose (sujet),
qualité
la
une
(prédicat) et une affirmation ou une négation marquée par
copule.
Il Y a affirmation lorsque le
prédicat
et négation lorsqu'il ne
convient
pas,
car
nier
mais toute proposition implique qu'il y a affirmation,
qu'une chose est,
is
c'est affirmer qu'elle n'est pas
to
affir. that it
is
not).
"convient"
La
(to deny that
copule
des
propositions négatives est cependant complexe; elle se compose du
verbe
et d'une particule de négation ("La pauvreté n'est pas
crime") .
465
un
Il Y a différents
peu importe la classe
types
à
d'énoncé s;
laquelle
même qu'un seul
il appartient,
mot,
peut faire le
même effet qu'une proposition complète exprimant une affirmation.
Cela vaut même des articles et des conjonctions,
prendre matériellement;
les
"Quelle
est
la
ou
nonobstant
ainsi,
conjonction
on
c'est-à-dire
"Cependant" ,
peut
la
Une
question comme
plus
usitée
simplement
répondre
"Cependant est des deux conjonctions
adversatives celle qui est la plus usitée".
articles) .
de
en réponse à la question
adversative
cependant?",
à condition
préposition
(Même chose pour les
peut tenir lieu de
réponse
à
une
"Est-ce que Locke vient avant ou après Hobbes?".
Réponse: "Après" (c'est-à-dire
"Locke vient après Hobbes"); et
ainsi
parties
suite pour les autres
de
remarque qu'une interjection,
un
énoncé
complet,
comme
du
discours.
Beattie
dans certains contextes, vaut pour
"Hé las!"
pour
"Je
sui s
dé sol é " .
Lorsqu'un mot isolé est utilisé pour faire une réponse à ce genre
de
questions,
comblé e,
nous
il y a toujours ellipse et lorsque
toujours
retrouvons
un
verbe
celle-ci
marquant
est
une
affirmation.
Le verbe est donc
et
qui
"un
mot nécessaire dans
signifie l'affirmation".
tout
Beattie ne dit pas,
énoncé
comme les
grammairiens de Port-Royal, que signifier l'affirmation n'est que
le
principal
usage de ce
mot;
il s'en tient plutet à la seule
affirmation. Par conséquent, tous les énoncés dont le verbe n'est
pas à
l'indicatif
devront se résoudre par l'indicatif.
466
Beattie
établit
une
d'''énoncés
étroite
simples"
relation
entre
les
(si.ple sentences) ,
et
différents
types
les
modes
divers
verbaux :
Every sentence contains a verb expressed or
understood;
and that verb must be in one or
other of those forms , which Grammarians calI
.oods.
Now every mood has a particular meaning,
and gives a peculiar character of the
sentence;
and, therefore,
simple sentences
may be divided into as many sorts,
as there
are supposed to be moods in a verb. (P. 189)
On
doit
donc pouvoir retrouver une affirmation
énoncés
complets,
à l'indicatif.
négatifs)
is
good,
y
compris
He
is
not good .
Une phrase dont
Nheth~r
is
to.e unknoNn.
qu'il
pas
est
appelle
(or
modaux
in
Il en va de même
his
comme
Th.t he
pour
les
comme Is he good?, et impératives, comme
qui se résolvent,
respectivement,
desire to be infor.ed, Nhether he be good,
it is .y entreaty,
his
potentiel
To be good is
contiennent également une affirmation
phrases interrogatives ,
au
se résoud, après
Les phrases optatives,
good is Nh.t 1 Nish for.
Be thou good.' ,
verbe
ou He ought to be good, exprime
ou To be good is his duty.
#fay he be good,
le
comme He
qui est rendu en anglais par des verbes
des propositions ou affirmations
be
n'est
That he is good
Le mode
auxiliaires dans He .ay be good,
should
verbe
he be good,
une phrase déclarative
et
aussi
le
les
servent bien sûr à exprimer des affirmations ,
en
goodness)
dont
tous
Les énoncés simples à l ' indicatif (affirmatifs ou
subjonctif, comme 1 knoN not
analyse,
ceux
dans
.Y
et It is .y co •• and ou
that thou shoulds be good.
467
par It is
(Les exemples sont
tous de Beattie) .
Peu importe le mode du verbe, tous les énoncés
simples expriment donc,
après analyse, des affirmations. Quant à
l'infinitif, il a davantage la nature d'un nom abstrait que celle
d'un
verbe,
puisqu'il
n'exprime
aucune
affirmation
et
est
dépourvu de toute considération de nombre et de personne.
Les modes font connattre nos idées en y ajoutant
chose
qui
l ocut eur ,
tient du tempérament,
des dispositions
quelque
d'esprit
ce quelque chose modifiant l'affirmation exprimée
du
par
le verbe :
In speaking, we not only convey our thoughts to
others; but also give intimation of those peculiar affections,
or mental energies,
by which
we are determined to think and speak. Hence the
origin of Nodes or Noods in verbs.
They are
supposed to make known our ideas,
with something also of the intention, or temper of mind,
with which we conceive and utter them. CP. 259)
Les modes sont une source d'élégance par la
brièveté
et
l'énergie
avec lesquelles ils permettent d'exprimer
nos
idées.
Comme
système
une
autre,
le
Beattie
tente
des modes varie d'une
langue
à
s'en tient à une explication générale de leur nature
et
essentiels
au
d'établir
dans
quelle
mesure
langage.
468
ils
sont
Pour affirmer positivement ce qui est conçu comme
passé ou futur,
on utilise le mode indicatif ou
présent,
d~clar.tifi
c'est
le mode de la science et de l'histoire, et il est nécessaire dans
toutes les langues.
mode potentiel sert aussi à exprimer
Le
mais
modifiée;
volonté,
le
pouvoir,
le devoir,
etc. ,
la
possibilité,
durst,
He should h.ve acted otherwise,
n'est
pas
au
liberté,
la
1 •• Y write, 1 .ight h.ve
1 could live on vegetables,
essentiel
la
sont de telles modifications surtout
exprimées par des verbes auxiliaires
been consulted,
une affirmation,
langage;
particulière ni en grec ni en latin,
1 would spe.k if
etc.
il
n'a
Le mode
pas
1
potentiel
d'inflexion
et on peut le résoudre
par
l'indicatif et le subjonctif.
Si ce qui est signifié n'est pas affirmé
absolument,
mais
on
fait
seulement relativement à un autre verbe dont il dépend,
usage du subjonctif, aussi appelé quelquefois conjonctif. Ce mode
n'est pas bien marqué en anglais; l'absence du
du singulier (if h. go),
dans
whether
à la troisième
la forme infinitive du verbe
he b. alive,
marques de ce mode.
s
1 know not,
sont
les
.tre,
be
principales
Le subjonctif est, avec l'indicatif, le seul
autre mode jugé nécessaire par Beattie; l'indicatif exprimant des
affirmations
absolues,
et
le
469
subjonctif,
des
affirmations
relatives,
dépendantes ou conditionnelles. Tous les autres modes
peuvent être résolus par ces deux là. On se rappelle que Buffier,
un
précurseur de la philosophie du sens commun,
avis.
Mais
même,
à
la rigueur,
langues
certes
Le
Beattie
Ci 1
en
reconnaî:t un peu plus loin
pas.
mais les inconvénients
qu'on
pourrait
même
que
certaines
Nous
perdrions
seraient
mode optatif est marqué par des inflexions
grec,
du
se passer du subjonctif et
mentionne l' hébreu) n'en ont
élégance,
était
minimes.
particulières
en
et il est supposé exprimer un souhait ou un désir Cis said
to express a Nish or desire) ;
ma1s même en grec, un souhait peut
être
exprimé par d'autres modes et souvent ne peut être
exprimé
seul
par ce mode sans l'aide d'auxiliaires.
conclut
Beattie en
que ce mode est superflu,
même en grec; et comme on ne le trouve
dans aucune autre langue,
il ne peut être essentiel au
Il
exprime
souvent
la
signification
du
potentiel
langage.
ou
du
elliptique
de
s'exprimer qui implique une "affirmation absolue" exprimable
par
subjonctif.
Le
mode
l'indicatif,
i.p'ratif
n'est
qu'une
façon
quoique moins brièvement et moins énergiquement. Il
n'est donc pas essentiel lui non plus.
L'infinitif
not) ,
n'est pas un mode Ca .ood
it
car il n'exprime aucune intention ou énergie
470
certainly
is
mentale,
en
particulier
l'affirmation
qui
est un
caractère
verbe. Bien qu'il ne soit pas une forme verbale,
néanmoins la fondation de tout le système verbal
lequel
Il
s~élève
est
un
lequel
no. verbal ou le no. du
l'infinitif est
(le terrain
verbe
comme
sur
disaient
les
il exprime abstraitement un attribut
sur
se grefferont toute la variété des morphèmes
marquer les modes,
d'un
du
un édifice n'en fait pas partie souligne Beattie) .
grammairiens;
anc~ens
essentiel
substantif
destinés
à
les temps, les personnes, etc. Il s'agit donc
abstrait;
a~ns~
Scire
tuu.
nihil
est
est
équivalent à Scientia tua nihil est.
Beattie
manifestement
modes
s'en
Harris)
prend
certains
à
auteurs
qui ont voulu multiplier
le
en incluant un mode interrogatif et un mode
lequel
se
divise à son tour en "déprécatif"
L'interrogatif
réquisitif,
d'obtenir
exprimerai t
le
I.e dé sir
désir d'être assisté,
quelque
chose
d'un
commandement à un inférieur.
et
nombre
en
i mpé rat if.
verbale;
le déprécatif,
et
des
" r équisitif",
d'information
supérieur,
vise
(i l
le
le
dé sir
l'impératif,
Mais le déprécatif ne diffère
le
pas
dans ses formes de l'impératif et l'interrogatif n'est pas marqué
par
des
flexions
l'intonation,
latin
(ne)
progresser
sans
lui
ou
verbales,
encore
ma~s
par
l'ordre
par l'ajout d'une particule
Cette multiplication des modes,
l'art grammatical,
ajouter
des
au lieu
le rend plus confus et
grand-chose.
Beattie
estime
ou
comme
en
de
faire
difficile
préférable
réduire leur nombre le plus possible (deux ou trois)
471
mots
de
et de rendre
les autres par l'usage d'auxiliaires.
Les interjections sont moins les signes des pensées que des
sentiments
( p.
314) .
Ce
n'est
pas
une
partie
du
discours
nécessaire, car on peut la remplacer par d'autres mots ou par une
phrase entière
les
(Rl~s!
interjections
= 1
~.
sarry) .
sont des cris de
Beattie rejette l'idée que
la
nature
compréhensibles
partout et pour tous; car, si on fait exception de quelques mots,
tels Rh!, Oh!, etc., les interjections diffèrent grandement d'une
langue
Elles servent non seulement à exprimer
à une autre.
émotions vives
(joie,
surprise,
douleur,
etc.) ,
mais aussi
des
à
proférer des imprécations et des blasphèmes. Beattie note m@me en
passant
qu'on blasphémait beaucoup sous le règne de Charles
et
que sa Majesté
(p.
319).
"Queen Elizabeth was addicted
***
472
to
II,
swearing" !
NOTES
(1)
C'est l'expression utilisée par Hume dans une lettre à
son
éditeur W. Strahan lui demandant d'insérer l'''Avertissement'' dans
les exemplaires restant en librairie; l'''Avertissement'' fut joint
dans l'édition de 1777.
Un extrait de la lettre est cité dans la
traduction française de l'Enqu.te ••• , Paris, Aubier, 1947, p. 37,
note 1.
(2) James Beattie, EIe.ents of #foraI Science (1790), re1mpression
en fac s imi lé
(avec une introduct i on de R.
Irvine),
Scholars
Facsimiles & Reprints,
Delmar,
New York,
1976.
Dans son
"Introduct i on" ,
Irvine pré sent e ains i
notre aut eur
"James
Beattie, poet,
critic, popularizer of Thomas Reid common sense
philosophy,
and a professor of moral philosophy, was a major
contributor to Enlightenment thought in Scotland"
(p. vi);
il
ajoute que sa poésie était connue à travers toute l'Europe.
(3)
C'est ainsi que le présente A.
Joly,
dans "Temps et verbe
dans les grammaires anglaises de l'époque classiques",
Histoire.
Epist4.010gie.
Langag., VII-2 (1985), p. 122. Cependant, Irvine,
dans son "Introduction" aux EIe.ents of /foraI Science,
cite un
passage de la correspondance de Beattie (une lettre datée du 17
décembre 1779) où il écrit,
à propos d'un traité
de grammaire
qu'il prépare: "1 have drawn a good deal of information from Mr.
Harris's H.r •• s, and Lord Monboddo on 'Language'; but my plan and
my sentiments differ in many particulars from both"
(pp. viivi ii) .
(4) J'utilise la seconde édition de 1788, parue à Londres, selon
la réimpression en facsimilé de 1973, Ann Arbor (Michigan), par
University Microfilms.
***
473
CHAPITRE DIXIEME : DESTUTT DE TRACY
(1803)
Le premier tome,
(1)
théorie
de
l'esprit
de Condillac,
de
le
second
tome
des
El'.ens
parus en quatre tomes à Paris chez Courcier de 1801 à
d'Id~ologi.
1815
est
dans
est
Idêologie propre.ent dit.,
la
lignée
de
Locke,
et
une
surtout
que Destutt considère comme le véritable fondateur
l'idéologie ("le fondateur de la science que nous
Id'ologie propre •• nt dit., Tome l, p. 214)
est une Logi qu.. ,
et le quatrième,
étudions",
Le troisième tome
(2).
un Trait' de la volontê et de
ses effets.
D'après Aarsleff ("Wilhelm von Humboldt and the Linguistic
Thought
of
linguistiques
Destutt
qui
the
French
des
Idéologues,
est
(::s> ) ,
Id'ologu..s "
et
les
particulièrement
théories
celles
de
mouvement,
incontestablement
auraient exercé une certaine influence sur von Humboldt alors que
celui-ci
résidait
Humboldt
Idéologues,
eut
à
Paris vers la fin
effectivement
mais
il
nous
de
nombreux
paraît
exagéré
un principe de "relativité linguistique"
474
des
(4).
années
contacts
de leur
1790;
von
avec
les
attribuer
Si l'Idéologie est la science des idées,
la Grammaire
la "continuation" de cette science (6ra •• aire,
p.
"t out
idé es,
discours
connaissance
est
la manifestation de
parfaite
nos
de ces idées qui peut
"t out
système de signes est un langage",
langage,
tout
émission
Grammaire
de
discours"
(ibid.) .
de signes est
Destutt sera
1); parce que
seule
découvrir la véritable organisation du discours"
c'est
faire
21).
Comme
emploi
d'un
<l5>
discours"
"l'analyse de toutes les
L'ld~olo9ie
propre.ent dite
la
nous
(p.
et "tout
un
est
la
espèces de
s'occupe
l'origine et de la formation de nos idées,
de
de
l'expression de nos idées dans le discours.
Destutt
intelligence
je
puis
réduit à deux le nombre des opérations
C'est notre existence toute entière"
sentir" Cp.
condillacienne
22)
entre nos idé es"
une
autre"
notre
"Sentir et juger, voilà toute notre intelligence:
dire voilà tout notre être,
tradition
de
j
(ibid.) ,
23) ,
que
(pp.
du sensualisme,
plus précisément,
Cp.
tout ce que
21-22) .
"juger
nous
sommes.
Mais dans
c'est
"c'est sentir des
la
encore
rapports
c'est "sentir qu'une idée en renferme
l'idée
que
nous
avons
d'un
être
quelconque renferme une qualité, une propriété, une circonstance;
la faculté de juger est "la faculté spéciale de sentir entre
idée
et une autre le rilpport du. contenilnt ilU. contenu."
(p.
une
24) .
Àvoir une idé e,
c'est sentir, avoir une perception; juger, c'est
distinguer
propriété,
une
une circonstance
475
particulière
dans
cette perception.
Cette faculté,
depuis Port-Royal,
très grande importance pour la Grammaire Générale,
"car c'est
à
et c'est
à
elle surtout que se rapporte l'artifice du discours;
manifester
ses
résultats
uniquement destiné"
(p.
qu'il
est
est d'une
principalement,
sinon
22). Destutt, après Condillac, réaffirme
en effet le principe voulant que "[1] 'essence du discours est
d'être composé de propositions, d'énoncés de jugemens. Ce sont là
ses vrais élémens immédiats;
les
é lémens ,
et ce que l'on appelle improprement
les parties du discours,
ce sont
réellement
les
élémens, les parties de la proposition" (pp. 33-34, aussi p. 29).
Mais les langages articulés,
dans leur évolution, "ont été
si travaillés, si tourmentés, si sophistiqués; ils ont revêtu des
formes si variées,
S1
syncopées,
S1
détournées, que l'on a peine
à reconnaitre, à travers tant de déguisemens, en quoi consiste la
expression
véritable
un
parfois
moment
déguisements,
les
siècles,
"pour
rendre
de la pensée" (p.
de
réflexion
pour
36-37) .
Il
retrouver,
instruments
l'expression de la pensée plus
donc
sous
ces
Àu cours des
l'expression d'un jugement complet.
peuples ont forgé les
faut
indispensables
complète
et
plus
fac i l e"
(p. 67). Le nombre de nos perc ept ions, idé es et jugement s
excède
de
beaucoup le nombre des moyens linguistiques
dispose
pour
signes"
que
les exprimer.
En c onsé quenc e,
les
sont les langues ne sont efficaces et
Il
dont
on
systèmes
de
viables
que
dans la mesure où ils permettent de faire beaucoup avec peu.
Pas
476
étonnant,
remarque
l' idé 01 ogue,
qu'une bonne partie de ce
nous exprimons demeure sous-entendue (cf.,
les
mots
pp.
43 et 117),
qui reviennent le plus souvent dans le
discours
indéclinables, comme les conjonctions et les prépositions)
presque toujours,
que
que
que
(les
soient
dans toutes les langues,des monosyllabes, et
les mots déclinables aient la capacité d'exprimer
significations,
comme
l'attribut,
temps,
le
les
verbes,
qui
le
nombre,
la
plusieurs
peuvent
exprimer
personne,
la
voix,
l'existence et le jugement, et les noms, qui peuvent exprimer, en
plus de leur signification principale,
le nombre, le genre et le
cas.
Tous nos discours expriment
souvent
sous
asymétrie
une
forme elliptique.
l' idé 01 ogue
pour
opérations de notre esprit.
ou
"Je veux",
cette volonté,
donc
entre le
des
Il y
jugements, quoique
a
jugement
intéressante
et
nous exprimons le jugement que cette
~st
en nous.
etc. ;
les
autres
"Je souffre",
Lorsque nous disons
souffrance,
Pour exprimer un désir, un souhait,
un doute, etc., il suffit de le nommer en disant
souhaite",
une
"Je veux", "Je
mais pour exprimer un jugement, cela ne suffit
Pour
pas.
exprimer un jugement, il faut énoncer le sujet, l'attribut, et le
signe de l'affirmation (p.
Si on dispose de ces signes, on
26) .
peut alors exprimer tous les autres actes de pensée simplement en
affirmant
diverses
qu'on les a
(cf.
p.
25)
Nos idé es
que les objets qu'elles représentent;
477
sont
il faut
aussi
donc
à
chaque
fois
des signes différents pour
l'opération
qui
consiste à
juger est
les
représenter.
toujours
Mais
m~me,
la
peu
importe les idées que le jugement unit; un seul signe suffit donc
à marquer tous nos jugements.
C'est le verbe qui marque l'affirmation,
qui est le
qu ' une idée est sentie comme comprise dans une autre;
c'est "la forme du verbe"
@tre
grand",
"La
mal.s
verbe,
jugement,
d~finis
pas
un
expression d'un
verbe
doit
sens
le
jugement.
Pour
l'un
fois
un
exprimer
un
des
modes
Le verbe est nécessaire dans
c'est lui qui détermine le sens
proposition dans laquelle il entre.
déterminer
" Pierre
il Y a chaque
porter la marque de
Cc' est-à-dire personnels) .
toutes les propositions;
ou plutôt,
Cp. 27), car dans les phrases
pèche que je tiens",
signe
d'une
de
la
Les différentes manières
de
proposition
ont
été
marquées
par
différents modes. Pour établir la "véritable valeur de toutes les
possibles",
propositions
formes
différentes
44) .
Pour
montrer
il
suffit
Cque le verbe)
que
tout
donc
d'examiner
est capable de
discours
est
rev@tir"
l'expression
jugement, Destutt doit montrer, à la manière de Beattie,
conditionnel,
modes indicatif,
interrogatif,
et
dubitatif, .
subjonctif,
servent
jugements.
478
tous
"les
Cp.
d'un
que les
optatif, impératif,
à
exprimer
des
Pour
l'indicatif,
il n'y a pas de
doute
t out es
les
phrases dont le verbe (exprimé ou sous-entendu) est à l'indicatif
expriment bien des jugements.
on
l'a
souvent appelé
C'est pourquoi, nous dit
"mode énonciatif"
Même des phrases comme "Je veux",
etc. ,
des énoncés de
sont
exprimer
"Vous
jugements,
propositions incidentes,
un
est
conditionnel
"il
l'est
jugement
"mode judicatif".
souffrez", "Il désire",
quoiqu'elles
des sentiments et non des jugements;
que ces sentiments sont dans un sujet.
bon"
ou
elles
(ou suppositif)
paraissent
signifient
Cela est encore vrai
comme "L'homme qui est bon";
dont "qui"
Destutt,
est
le
des
"qui
sujet.
est
Le
mode
exprime lui aussi un jugement,
mais
dans une forme qui fait attendre
quelque
condition,
supposition,
ou restriction, qui modifiera l'attribut et en fera
partie"
46) .
(p.
Ainsi,
dans une phrase conditionnelle
"Cette opération serait bonne si elle était so.re" ,
que
dans l'idée de cette op4ration est renfermée
bonne
s'il
a stiret'"
y
(ibid.) ;
conditionnellement la seconde.
mode
la
première
"je
comme
prononce
l ' i dé e
idée
d' • t re
renferme
Nous reviendrons plus loin sur ce
que Destutt considère comme un temps de l'indicatif
plutôt
que comme un mode proprement à part, comme Girard et Beauzée.
Le mode
dans
jugement;
"Il faut que je sois entendu", "je sois entendu" exprime un
jugement,
vrai".
subjonctif sert lui aussi à exprimer un
comme
"Dans
, 'c el a est vr ai' ,
les deux cas,
le que
479
cela
est
qui précède marque que
ces
dans
"Je pense que
phrases
dépendent
première
encore
d'une
autre
("je sois entendu"),
phrase.
Seulement,
on a jugé à propos de
par une nuance dans la forme du verbe,
certaines occasions, c'est l'usage en français"
dans
la
l'indiquer
parce
que,
dans
(pp. 46-47)
Nous
verrons plus loin que le subjonctif n'est qu'un cas
"oblique" du
mode indicatif.
Les phrases optatives,
vous m'avez dit!",
que
"Que n'ai-je fait
expriment encore des
(respect i vement)
jugements;
la m@me chose que
"Je
vivement de n'avoir pas fait ce que vous m'aviez dit",
affligé
de ne pouvoir vous suivre",
vous réussissiez".
malgré
pour Destutt,
elles
regrette
"Je
suis
"Je souhaite ardemment
Il Y a donc toujours expression de
que le forme en soit changée.
d'un mode verbal,
ce que
"Que ne puis-je vous suivre!", "Fasse le ciel
vous réussissiez!",
signifient
comme
jugement,
Il ne s'agit pas
mais d'une "locution
que
vraiment
abrégée" .
"Faites cecil", "Allez làl", expriment la m@me chose que "Je veux
( 0
u j e dé sir e) qu e vou s fa s sie z c e ci" ,
l a, " .
"J'énonce
l ' i dé e de
.0
i ,
que
je sens,
désirer, etc., etc.
mode optatif,
dans les idées qui
"Je veux que vous
composent
alliez
actuellement
je remarque celle de vouloir,
celle de
C'est encore un jugement" (p. 48).
Comme le
le prétendu mode impératif .n'est qu'une
abrégée" .
480
"locution
Même traitement en ce qui a trait au mode
"Rv"z-vous fini?
interrogatif
veulent dire je vous demande,
.tes-vous prt-t?
je désire savoir si, etc. , etc. Ce sont autant de jugemens portés
sur moi -même que je vous exprime"
(p. 48). I l s ' agi t donc enc ore ,
non pas d'un véritable mode verbal,
ma~s
d'une locution abrégée,
d'un " terme de supplément " comme l ' aurait dit Buffier.
De tous les grammairiens dont nous avons traité
Destutt
est le
dubitatif.
seul à ma
connaissance
qui
jusqu'ici,
envisage
un
mode
Il introduit d'ailleurs ce mode sur un ton dubitatif
"Je ne crois pas que l'on doive faire un mode particulier de
ces
tournures
de phrases,
pas
essayer?
Mais si l'on veut, peu importe.
oSflr.is-jfl observ"r?
ne pourrait-on
Par leur forme,
elles
sont interrogatives, et rentrent dans ce que nous venons de dire "
(ibid.).
ne sais",
Ces phrases signifient la même chose que " je doute " , "j e
"je crois pouvoir",
etc.
Ce sont donc,
encore,
des
locutions abrégées mises pour des expressions de jugements.
Lorsque
le
verbe est au mode participe,
expression de jugement;
il
n'y
a
pas
le verbe à ce mode est un adjectif, mais
cette forme, nous le verrons plus loin, est "sa forme essentielle
et fondamentale"
c'est
(p.
49) .
un substantif
verbe lui-même" (ibid.)
L'infinitif n'est pas un mode verbal;
"[c]'est le nom par lequel on désigne
l'infinitif ne forme donc pas,
481
le
lui non
plus,
de proposition. Nous voyons donc, par ce qui précède, qu'à
chaque fois que le verbe est à un mode défini,
il y a expression
d'un jugement.
Si
les interjections ont un caractère marginal
grammairiens philosophes antérieurs,
dans
la
théorie
discours
ne
sont
de Destutt.
A l'origine,
70) .
(p.
"Toutes les
seul
etc." (p. 32).
content,
m~me
ne
du
sont
un seul geste
je
veux
ou je vous demande secours
ou je
souffre,
ou
un
je
SUl.S
Le langage d'action ne distingue aucune
des idées qui composent ces propositions.
le
et
"un seul geste dit
je vous appelle,
dit
centrales
parties
celles-là,
avec le langage d'action,
ou je vous montre cela,
crl.
autres
les
et à la ré s oudre dans ses é lémens"
exprime une proposition entière
cela,
elles deviennent
que des fragmens de
destinées qu'à la décomposer,
pour
Les interjections
ont
effet. Destutt entend par interjections non seulement les
"interjections
proprement dites",
mais
"tous les mots qui
forment à eux seuls une proposition toute entière"
69) ,
(p.
le cas d'adverbes ou de particules comme oui et
et
non.
Les
interjections "renferment implicitement un sujet et un verbe
qui
c'est
s'y trouvent confondus" (ibid.);
isolé es
dans
syntaxe
et
le discours,
ne
ne donnent lieu à
peuvent avoir
Lorsqu'on
sépare
confondu,
elle devient par là
l'interjection,
d'une
par suite, elles sont forcément
nl.
aucune
conjugaison
nl.
interjection le sujet
m~me
l'exclamation,
482
un verbe
le
cri
qui
règle
de
déclinaison.
s'y
trouve
"Quand je dis ouf,
ouf,
signifie
la
proposition
entière j'4touffe.
Dès que je dis je
signifie plus que l'attribut Itouffe"
(p.
81).
ouf,
ouf
C'est ainsi
ne
que
furent trouvés les verbes.
Examinons de plus près la nature du verbe,
le Ilverbe d'existence"
l'énoncé
d'un
jugement;
et
en
Toute
proposition est
consiste à
sentir
qu'une idée existe dans notre esprit et qu'une autre idée
existe
dans
qu'une
celle-là"
proposition
(p.
51) .
Par
conséquent,
renferme deux signes
existante par elle-même,
comme
"tout jugement
particulier
"l'un représentant une
idée
et l'autre représentant une autre
idée
n'existant que dans la première.
élémens
nécessaires
du
faut
il
discours"
C'est-là
(pp.
sfrrement
51-52).
deux
Rappelons - le,
Destutt est un partisan d'une analyse bipartite de la proposition
en
Sujet-Attribut
(l'attribut
renfermant
essentiellement
le
verbe). Les noms représentent des idées qui ont dans l'esprit une
existence
absolue
et indépendante,
peu importe que
les
êtres
représentés aient une existence réelle et positive , ou fictive et
imaginaire;
Olt ous l es autres é lémens du di sc ours ne repré sent ent
que des idées relatives à celles-là,
comme
(p.
et ne les représentent
existantes dans les sujets auxquels elles
52).
483
se
que
rapportent "
Au premier abord,
bons
candidats
pour
il semble que les adjectifs
former
la
seconde
indispensables à l'expression complète d'un
repré sente
isolément
une
et
idée,
non
classe
Cp.
des "attributs complets",
plus cette notion d'existence"
55) .
de
jugement,
existante
indépendamment de toute autre
faisant partie d'un sujet"
pas
comme
soient
par
idé e,
signes
puisqu'il
elle-même,
"mais
comme
Mais les adjectifs ne
car les adjectifs
de
sont
" ne renferment
Cp. 56).
Car pour signifier complètement qu'une idée
est renfermée dans une autre, il faut auparavant signifier qu'elle est, qu'elle existe. Or, c'est-là une propriété dont, par une abstraction singulière,
tous nos adjectifs se trouvent dépouillés,
et qu'il faut
qu'ils recouvrent pour redevenir des attributs complets. (Ibid.).
Le seul adjectif qui renferme cette idée d'existence est 4tant ou
existant. Pour qu'un adjectif devienne un "attribut complet", ou,
dit
autrement,
pour
qu'il devienne un
verbe,
il
Un
verbe
renfermer implicitement l'adjectif Itant.
rien d'autre qu'un
"les
adjectifs proprement dits sont des verbes mutilés,
seuls attributs complets,
repré sentent
complètement
une
donc
n'est donc
adjectif renfermant l'adjectif Itant.
verbes sont des adj ect ifs ent i ers"
"les
devra
Ainsi,
et
Cp. 57). Les verbes sont ains i
c'est-à-dire les seuls mots
qui
idée comme
une
existante
dans
autre. Voilà pourquoi il n'y a pas de proposition sans verbe"
65). A la rigueur, l'adjectif 4tant est
seul attribut",
les
m~me
(p.
"le seul verbe et le
puisque tous les verbes le contiennent; il n'y a
484
donc pas de proposition sans cet adjectif,
lorsque celui-ci
est
utilisé dans un mode défini.
L'idée d'existence est donc nécessaire pour faire un verbe
et
tout
verbe la renferme.
puissent
avoir des
existantes
qui
modes,
parce
il faut premièrement
positive,
ou conditionnelle,
avant tout exister"
(p,
58) ,
seuls
qu'''il n'y a
puissent avoir des modes;
certaine manière,
manière
On comprend que
les
verbes
que les
choses
car pour
~tre,
être
d'une
Pour exister d'une
ou su.bordonnée,
il
faut
Et parce que l' "idé e de duré e est
aussi un mode de l'idée d'existence", il n'y a que les verbes qui
puissent aV01r des temps.
Il semble bien que pour
seuls les modes indicatif,
conditionnel et subjonctif
des
modalités
subordonné e) ,
servent
d'existence
et
(positive,
que tous les
autres
souhaite que
Il
ou "Je regrette que
"Je désire que vous fassiez"
désire savoir si,
(dubitatif) ,
On
,"
voit
qu'avec
présumés
jugements qu'ils expriment commencent par J..
loin
chez Destutt,
toujours
dont
demande",
serait
équivalent à "Je perçois
vert",
Parce
tous
(sais,
à
toujours et nécessairement contenu dans toute
485
les
du
est
propositions
vois) que cet arbre
propos
"Je
Nuchelmans va plus
L'énoncé "Cet arbre est
"préambule"
"Je
Je ne sais ... "
modes,
y compris pour les
le verbe est à l'indicatif.
le
"Je
le sujet ultime de toute proposition
le locuteur lui-même,
que
définis
nous-m~mes
"Je doute",
ces
modes
" (optatif); "Je veux",
(impératif);
" (interrogatif) ;
expriment
conditionnelle,
présumés
à former des propositions à propos de
l' idé ologue,
locuteur
proposition,
vert"
est
est
nous
ne
sentons jamais le besoin de l'exprimer explicitement.
On
se
rapproche ainsi fortement de l'''hypothèse performative".
Dans la théorie des modes verbaux que présente
Destutt au
chapitre " Des Déclinaisons des Verbes", il entreprend de faire un
grand
peut
ménage dans les dénominations
avoir
trois
substantif,
substantif
"états"
adjectif,
ou
et
(infinitif)
ne
traditionnelles.
"fonctions"
attribut.
peut
il
Le
avoir
verbe
de
Le
verbe
peut
@tre
l'état
à
suj et;
mais
de
"son
expression n'est ni définie ni indéfinie; la preuve en est, qu'il
peut
lui -même @tre le suj et d'une phras e"
état,
le
181) ;
dans
cet
verbe est susceptible de toutes les modifications
qui
forment les "déclinaisons" (genre,
(p.
nombre, cas) des substantifs.
Dans l'état d'adjectif, le verbe doit "marquer les nombres et les
cas,
et il doit avoir les trois genres
s'accorder avec les substantifs,
(pp.
178-179) .
Enfin,
et cela,
circ onstanc es"
dans toutes les
lorsque
le
verbe
pour pouvoir
est
dans
l'état
d'attribut, "il faut qu'il exprime le rapport de concordance avec
son suj et"
(p. 179);
rarement les genres
dans cet état, il ne marque jamais les cas,
(comme en hébreu et en suédois),
nombre et les personnes.
toujours
les
temps.
le verbe
Dans ces trois états,
Compte
tenu
de
ces
toujours le
trois
marque
"états"
ou
"fonctions" des verbes,
et parce que les anciennes dénominations
des modes ("infinitif",
" par tic i p e", "dé fin i ", " i n dé fin i ", etc. )
ne
lui
paraissent
pas plausibles,
486
il
estime
que
ces
trois
fonctions
du
existence,
et
substilntif,
Reste
verbe
que
sont
"des
modes
ces modes seraient
.od;e · adj;ectif,
maintenant
bien
très-bien
et .ode attributif"
déterminer
à
distincts
les
de
son
nommés,
(pp,
181-182) ,
subdivisions
du
mode
attributif,
Les prétendus
dubitatif
modes optatif,
interrogatif,
"ne s ont que des 1 ocut ions ab ré gé es,
impératif
dans lesquelles,
lorsqu'on remplit les ellipses,
on ne retrouve toujours que
modes indicatif,
et subjonctif" (p,
conditionnel,
reste donc plus qu'à examiner les modes
et
subj onctif
l'attributif)
d'attribut
(qui
Dans
sont
ces
indicatif,
dernières
trois derniers,
182) ,
I l ne
conditionnel
sous-divisions
le verbe
les
a
le
de
rôle
"il signifie également que l'idée qu'il exprime est
comprise dans un sujet"
cette
les
et
idée
dans
absolument";
d'incertitude",
autre verbe",
celle
le
(ibid.), Dans l'indicatif, l'existence de
du sujet
conditionnel
et le subjonctif,
est
ajoute
dite
au
"positivement
verbe
"une
"une idé e de dépendance
De cela, Destutt tire deux conclusions
1° que le mode conditionnel n'est qu'une nuance,
un usage particulier du mode indicatif,
nuance
qui est plutôt un changement de temps qu'un changement de mode;
car le conditionnel a toujours
quelque chose de futur,
ou du moins d'éventuel,
puisque ce qu'il énonce doit être,
mais ne sera
que quand une telle chose aura lieu,
2°, Que le mode subjonctif est absolument le mode
indicatif à un cas oblique, précisément comme Petri
est le même nom que Petrus,
en y
ajoutant
seulement l'idée de dépendre d'un autre nom,
Car
quand je dis, je suis, je sois, je dis exactement
487
et
idée
d'un
la même chose,
à cela près que,
dans le second
cas, j'exprime que ce jugement dépend d'un autre.
(pp. 182-183).
En fin de compte, le
pas
de
vra1S modes du verbe;
part icul iè re,
font
"conditionnel et le subjonctif ne sont donc
tous
mais l'un
est
une
et l'autre un cas oblique du mode
trois
partie
du
mode
attributif"
circonstance
indicatif.
(pp.
Ils
183-184 ) .
L'indicatif ne semble se distinguer aucunement de ce que
Destutt
appelle le mode attributif.
Mentionnons en terminant la très intéressante théorie
des
conjonctions avancée par Destutt. D'après lui, la conjonction que
~tr(1
"est proprement la conjonction unique, comme le verbe
verbe
unique"
"d'exprimer
la
(p.
132) .
La signification propre
liaison d'un verbe avec un
propos i t i on avec une autre l l Ci bi d .) .
entre
le
que
deviennent
autre
de
co...
corr.ctif,
supposition qu ••••
que
la
phrases;
des
conjonction
il
par là même
conjonction.
Ainsi, la
il
que" ;
et
si
signifie
revient au moins
(p.
131)
une
fois
"dans
énoncés comme arguments et composant un
nouvel
dans
la
ces
prenant
énoncé.
La
façon est
Destutt pense qu'elle s'est introduite dans le langage
488
faut
On voit
ces conjonctions sont clairement des foncteurs
seule conjonction qui ne puisse être analysée de cette
que;
d'une
Tous les mots dans lesquels
faut conclur. qu•••• "
qu.
est
que
verbe,
conjonction .ais signifie
ajout.r
est le
sur
le modèle des prépositionsj
expressions
(comme de
propositions,
cette
première
comme
mais au lieu de lier des noms ou des
dans "le livre de Pierre") ,
elle lie
dans "Je vois qu.e vous êtes là",
conjonction trouvée,
l'ajout de diverses idées accessoires,
***
489
les autres
Une
suivirent
des
fois
par
NOTES
(1)
J'utilise l'édition parue à Paris en 1970 à
la Librairie
Philosophique J.
Vrin,
qui reproduit telle quelle l'édition de
1817 chez Courcier. L'Idéologie propre.ent dite est d'abord parue
en 1801 sous le titre:
Projet d1élé.ens dlIdéologie à
llusage
des Ecoles centrales de la République française,
toujours chez
Courcier.
(2)
L'idéologue souligne toutefois que Condillac n'a jamais
donné à sa doctrine une forme achevée et un exposé définitif;
au
lieu de cela,
on trouve divers exposés de sa doctrine, rédigés à
différents
moments
selon
différentes
préoccupations,
épistémologique, grammaticale, logique.
(3) Dans Fro. Locke to Saussure.
Essays on the Study of Language
and Intellectual History,
Minneapolis, Univ. of Minnesota Press,
1982,
pp. 335-355; ce texte est d'abord paru en français dans La
6ra •• aire général..
Des Modistes aux Idéologues, éd. par À. Joly
et J. Stéfanini, Presses de l'Université de Lille, 1977, pp. 217241.
Le texte anglais est une version révisée.
(4)
Àarsleff écri t
"The central doctrine both in their
philosophy
(celle des Idéologues) and in Humboldt's is the socalled principle of linguistic relativity with its associate
doctrines
of the ultimate subjectivity of speech and its social
nature"
(p.
335).
Les Idéologues,
en particulier Destutt de
Tracy,
et plusieurs autres
se situant dans ce que Àarsleff
appelle "la Tradition de Condillac" n'admettaient sarement pas le
principe de relativité linguistique;
nous l'avons vu au chapitre
premier de la première partie,
le philosophe classique qui s'en
rapprochait
le plus est Maupertuis,
qui ne fut approuvé
ni par
Turgot, ni par Condillac,
ni par Maine de Biran (pourtant proche
des Idéologues). L'assertion de Àarsleff me paratt donc exagérée.
(5) Condillac disai t déjà,
dans sa 6ra •• aire (p. 443),
que "le
du langage est dans chaque homme qui sait parler".
La
distinction langage
(système de signes)/discours
(emploi de
signe)
esquissée
par Destutt nous
semble
anticiper
les
distinctions
contemporaines
langue/parole
(de
Saussure) ,
langue/discours (Guillaume), et compétence/performance (Chomsky);
ceci dit,
bien sar,
en faisant
abstraction des nuances et de
toute la prudence qui s'imposent lorsqu'on discute et compare ces
oppositions.
syst~me
490
(6)
Le t ext e pré sentant l'argument
est 1 e suivant
"pour
exprimer une sensation,
un sentiment,
un désir,
simples ou
complexes,
actuels ou passés, il suffit de les nommer, soit avec
un seul signe,
soit par le moyen de plusieurs réunis ... Pour nos
jugemens au contraire,
cela ne suffit pas. Quand nous aurions un
signe
particulier uniquement destiné
à
représenter
l'acte
intellectuel qui consiste à juger, nous répéterions éternellement
ce signe qu'il ne signifierait rien.
Il marquerait que nous
jugeons,
mais
il ~e dirait pas ce que nous
jugeons;
il
n'indiquerait
jamais de quelles idées il est question.
Il faut
donc,
pour exprimer un jugement, énoncer les deux idées dont
l'une contient l'autre,
plus l'acte de l'esprit qui aperçoit ce
rapport". (Pp. 25-26).
***
491
TROISIEHE
P~RTIE
:
CONCLUSION GENERALE
LA
SEMANTIQUE IDEATIONNELLE DES MODES D'ENONCE:
L'HISTOIRE
DES
THEORIES
DE
L'ENONCIATION
SA PLACE
ET
SON
DANS
ADEQUATION
EMPIRIQUE
La catégorie du mode verbal est un véritable nid de
dans
la Grammaire Générale.
elle renvoie à la morphologie,
la
pragmatique,
aléthiques,
Elle
A la croisée de plusieurs
à
la syntaxe,
la rhétorique,
à
de
entretient
plus des
au traitement
liens
avec
chemins,
à la sémantique, à
des
modalités
du
locuteur.
actes de parole et aux attitudes
aux
guêpes
d'autres
catégories
verbales, comme celles d'aspect et de temps. Nous tenterons, dans
cette
conclusion
capital
d'idées
verbaux
dans
qu'occupent
relativement
mentionnées
chemin
Grammaire Générale,
deux
approches
certaines
plus haut.
parcouru
l'adossant
Ensuite,
à
de mettre un peu
d'ordre
que nous a fourni notre enquête sur
la
les
générale,
dans
des
que
nous
la
de
le
travail,
en
première.
toucherons quelques mots du traitement des
492
statut
rapidement
à l'occasion aux résultats obtenus dans la
nous
modes
catégories
et
ce
le
di st ingué es
avons
mesurons
partie
les
précisant
disciplines
Mais d'abord,
la deuxième
en
dans
modes
chez les comparatistes,
puis chez les linguistes et
contemporains.
en
critères
Enfin,
d'adéquation
ressortir
les
con s i dé ra n t
empirique,
dé fauts
les plus
un
nous
philosophes
certain
nombre
essaierons
importants
de
de
la
de
faire
sémantique
idéationnelle des modes d'énoncé.
***
Nous avons présenté,
partie)
de
la
section
(deuxième
un premier groupe de grammairiens philosophes partisans
théorie
pensée.
dans la première
des modes verbaux
comme
marqueurs
d'actes
de
Cette théorie du langage s'appuie sur une philosophie de
l'esprit où les "actions de l'esprit", les "mouvements de l'âme",
ou
les
"énergies mentales"
directement
et
s'expriment ou
littéralement
caractéristiques.
par
des
peuvent
s'exprimer
flexions
verbales
Ces actes de pensées sont les mêmes partout et
pour tous, et tous ces actes affectent, chacun à leur manière, le
mode
(ou
de prédication des énoncés qui les expriment.
l'affirmation),
le
commandement,
le
Le
souhait
(ou
désir), la prière, l'interrogation, les émotions vives
par
les
interjections
diversement,
souhait,
Que
et
les
comme le dit Searle
(et de l'existence)
parle.
et
le
les
exclamations) ,
(1)
émotions
vérité
dont
on
non catégorique),
le
"actes
de
vives puissent être
493
"posent"
la question de la
(catégorique ou
simple
(exprimées
etc. ,
de l'attribut vis-à-vis de l'objet
jugement
jugement
des
pensé e"
au sens strict,
commandement,
actes
on le comprend aisément;
l'interrogation,
la
prière,
mais pour
et bien
d'autres
du même genre qui ne peuvent être accomplis par des
"solitaires", cela est moins évident.
le
êtres
Mais nous avons vu comment
James Gregory,
avec sa notion d'''opération sociale de l'esprit",
avait
la théorie des actes de
enrichi
des aspects sociaux de ces actes;
effet,
des
ces opérations impliquent,
communication.
expriment les divers actes de pensée
déclaratifs
l'action
Gregory)
commençant
(ceux de Port-Royal,
énoncés
pensée
énoncés qui
une
hyperphrase
dénotant
mais les grammairiens
Du Marsais,
dont
Harris, Monboddo,
ne traitent jamais les énoncés non déclaratifs
modes autres que l'indicatif)
ces
Les
sont tous équivalents à des
par
accomplie par le locuteur;
nous parlons
en
croyances à propos de l'existence d'autres personnes
impliquées dans le procès de la
énoncés
pensée pour tenir compte
(ou
les
comme des énoncés elliptiques,
expriment simplement et directement
autres que le jugement catégorique.
Les
des
et
actes
de
définitions
du
verbe données par ces grammairiens font surtout appel à la notion
d'existence, et lorsque l'affirmation est invoquée, comme à PortRoyal,
n'est
on en fait le
jamais
limité
"principal usage"
à cet usage.
Il
du verbe,
y
a
donc,
et
celui-ci
dans
cette
approche, une réelle autonomie du discours non déclaratif.
Dans
les
seconde section,
théories
"ré duct i onni st es"
exposé es
dans
tous les énoncés expriment des jugements.
494
la
Nous
avons toutefois rencontré,
philosophes,
quelques
particulier
chez
clairement
que
dans ce second groupe de grammairiens
résistances à cette
Beauzé e
tout
et
interprétation,
Condillac.
discours exprime des
Beauzé e
en
affirme
jugements
et
rien
d'autre, mais nous avons noté quelques ambiguïtés dans sa théorie
de l'impératif;
le verbe,
à
l'impératif se distingue du verbe à
l'indicatif en ajoutant à l'idée de l'existence intellectuelle du
sujet avec relation à un attribut l'idée accessoire de la volonté
de celui qui parle ou est censé parler. Et jamais Beauzée n'offre
d'équivalent "expositif" des énoncés impératifs, sauf dans le cas
des énoncés impératifs (utilisant le subjonctif)
à la
troi s ième
personne du singulier ou du pluriel; mais pour ceux à la deuxième
personne
du
n'explique
singulier,
et les deux premières
pas en quoi ils expriment des
du
pluriel,
"jugements".
il
Quant
à
Condillac, il semble s'écarter sensiblement du cadre des théories
idéationnelles et s'avancer,
vers
une
des actes de
parole.
Pour
est une suite de propositions exprimant
discours
qui
théorie
plus qu'aucun autre à
affirment
l'attribut
dans
l'affirmation
accessoire
la
le
(ou
coexistence
suj et.
Mais
la
à
lui
l'impératif
époque,
tout
aussi
des
jugements
non-c oexi st enc e)
dans sa théorie
n'est que l'''accessoire''
"disparaît"
son
des
modes,
de l'indicatif et
pour
faire
de
cette
place
au
commandement. Lui non plus ne "réduit" pas les énoncés impératifs
à des
ra1son
phrases déclaratives.
que
Aussi,
ce n'est peut-être pas sans
Nuchelmans voit chez Beauzée une extension
"proposition" ;
accordé aux termes "jugement" et
va-t-il de même chez Condillac.
du
sens
et peut-être en
Mais il Y a un certain nombre de
495
ral.sons qui
nous paraissent démentir
cette
interprétation.
théorie du jugement de ces grammairiens est clairement
aux
logiciens,
véri té
et
grammaticale,
ne
fausseté;
renVOl.e
la
pas
proposition,
et seulement les jugements,
forcément à la vérité
eux,
présentent
et
dé fin i s sen t
réductionniste
la
entité
et
à
la
les jugements,
s'expriment dans le discours par
propositions. Quoi qu'il en soit,
Tracy,
à
comme
fausseté, mais Beauzée et Condillac sont formels
de
emprunté e
et le jugement renvoie à la connaissance,
la
à
La
d~s
les Buffier, Beattie et Destutt
sans
équivoque
le verbe
en
une
approche
insistant
sur
sa
fonction assertive. Mais là aussi les modes affectent directement
l'affirmation,
modifient le rapport de l'attribut au
sujet,
en
ajoutant quelque chose à l'acte de juger à la base de toutes
nos
énonciations.
non
Toutefois,
dans cette approche,
le discours
déclaratif n'a pas de véritable autonomie.
Dans la première partie de notre travail nous avons insisté
sur le postulat de l'universalité de la pensée et sur le principe
de
rationalité appliqué à la formation des langues et à
l'usage
normal de la parole. Nous avons pu constater à plusieurs reprises
que les actes de pensée (pour le premier groupe de
ou le jugement et les idées accessoires
mêmes
partout
de rationalité,
dans
et
que
l'expression
pour tous;
les
(pour le second)
sont les
et en ce qui concerne le principe
modes verbaux
des pensées
grammairiens)
(qui
496
permettent une économie
autrement
devraient
être
exprimées par d' "ennuyeuses circonlocutions")
et augmentent aussi
l'efficacité de la communication en donnant plus
plus
d'élégance à l'expression des pensées.
modes
(leur
économie
et
leur
deux grandes
modes
d'élégance,
La
une
telle
leur
valeur
grammairiens illustrant les
économie
et
Mais si
sont
une
les
source
pourquoi les trouve-t-on partout en si petit nombre?
raison en fut donnée
des
et
approches que nous avons distinguées.
permettent
et
La rationalité des
simplicité)
esthétique furent confirmées par les
d'''énergie''
flexions
conjugaison,
(Gregory, Beattie)
verbales
complique
une multiplication
d'autant
le
système
de
provoque une inflation des formes linguistiques, et
rend plus difficile l'apprentissage aussi bien que l'usage de
la
langue.
de
Il est "préférable",
maintenir
linguistiques et
toute
la
variété
"mode verbal"
de diversifier les
des
"mouvements de l'âme".
"opérations
de
le
nombre
moyens
des
d'exprimer
l'esprit"
et
des
Gregory étendit à cette fin la notion de
pour inclure dans les "modes grammaticaux" l'ordre
l'intonation,
mots,
plus "efficace",
un niveau de complexité acceptable
à
formes
des
plus simple,
et
même
les
(performatifs)
verbes
signifiant per .odu. conceptus l'acte de pensée du locuteurj
tous
ces
moyens
linguistiques
concourent à
l'expression
d'une diversité d'actes ou de
C'est
qu'évolue
ainsi
marqueurs
"opérations
la
d'actes de penséej
théorie
des
la
"modes
modes
même
de
sociales de l'esprit"
de Gregory,
fin
pensée".
verbaux
elle comprend à la fin,
tous
car
avec
les
comme
les
actes
illocutoires, des actes perlocutoires et d'autres dispositions ou
modes
de
pensée dont la plupart ne sont pas
497
exprimés
bien
qu'ils
puissent
approche
l'être -- par des
parait
plus
aristotélicienne,
marques
conforme à la
qui
distingue
spécifiques.
tradition
les
énoncés
de
la
Cette
logique
susceptibles
vérité et de fausseté des autres "genres de discours".
de
Il semble
bien que les langues naturelles aient eu effectivement tendance à
ne marquer explicitement
(par des flexions verbales ou autrement)
que les marqueurs de force illocutoire les moins
plus un indicateur de
dire,
modifié
par diverses
d'accomplissement,
propositionnel,
pui s sanc e) ,
force illocutoire est
effectivement
omp 1 ex e
complexe
condition
moins
Y
il
marqué par
un
de
a
comme ajouter un
mode
sincérité ou
de
Sil
(c'est-à-
une condition préparatoire ou sur le
une
et
opé rat ion s ,
Ile
chances
un
pour
syntaxique
mode
contenu
degré
qu'il
ou une
de
soit
flexion
verbale, qui sont des marqueurs d'un type assez simple. Les modes
verbaux marqueraient donc,
les plus simples,
jour
à
rationalistes,
les actes de pensée
les plus fréquents et les plus importants pour
La théorie de la rationalité que nous
la vie en société.
mise
pour la plupart,
(premiè re
part i e)
et
qui
est
avons
commune
aux empiristes et aux philosophes du sens
et
permet ainsi d'expliquer pourquoi il y a des modes,
aux
commun
pourquoi
leur nombre est partout restreint.
Pour
Beauzé e
indiquant
et
le
second groupe de
Condillac) ,
l'interprétant
direct
les divers modes du verbe sont des
"consignifiées"
par
le
verbe,
498
(en
grammairiens
des
des
idées
valeurs
particulier
morphèmes
accessoires
aj outé es
à
un
jugement;
ces idées accessoires déterminent divers modes et sont
le plus souvent équivalentes à une hyperphrase qui, placée devant
la clause propositionnelle, compose une phrase déclarative.
Tous
les énoncés non déclaratifs pourraient être distinctement marqués
par
des
morphèmes exprimant de telles
idées
accessoires.
modes verbaux permettent ainsi la même économie que les
Les
flexions
temporelles et casuelles.
Reprenons brièvement, un à un, le traitement des principaux
modes verbaux dans la Grammaire Générale. L'indicatif est partout
présenté comme le mode le plus fondamental,
langage;
toujours
signifie
il
existence "positive", réelle ou
verbe à l'indicatif est sa
Royal,
même
Beauzé e) ;
pas
flexion
un
un
"signification
que
les
autres
catégorique,
fondamentale"
nous l'avons
flexions
par
qu'en
Ce n'est
une
La signification du
le caractérisant plutôt
verbale pour les modes.
l'indicatif
jugement
"imaginée".
les Messieurs,
mode,
le plus nécessaire au
vu,
CPort-
n'en font
l'absence
de
s'opposant
à
apparaissent
comme
des
"modes". Dans l'approche réductionniste, ce trait est encore plus
marqué;
d'abord
parce
que
tous
les
énoncés
expriment
jugements et que c'est à l'indicatif qu'il revient d'exprimer
jugement sous sa forme la plus pure;
autres
jugement
ne
font
qu'ajouter
présent
dans
tous
modes
accesso1res
les
le
ensuite, parce que tous les
des
idées
énoncés.
Cet
a le plus souvent pour conséquence de
499
des
accessoires
ajout
au
d' idé es
suspendre
le
caractère
positif
"disparaître"
sC1ence
et
et
c atégorique
l'affirmati on )
de
l'histoire;
du
jugement
L'indicatif
( ou
de
est le mode
il admet le plus
grand
de
la
nombre
de
divisions temporelles et ses temps sont tous " définis"
à
une
époque déterminé e) .
Même s'ils furent
diversité
des types syntaxiques,
accordent
malgré
tout
un
les
certain
faire
attentifs
grammairiens
privilège
( relatifs
à
la
philosophes
à
l'indicatif,
conformément à la tradition logique qui a toujours eu tendance
marginaliser les énoncés non déclaratifs
de Austin) .
(la descriptive
à
fallacy
Dans la Gra •• aire g4n4rale et raisonn4e, qui accorde
pourtant une certaine autonomie au discours non
déclaratif,
"principal" usage du verbe est celui qu'il a à l'indicatif;
le
tous
les autres sont des usages "secondaires " .
Le traitement du subjonctif,
avec la Grammaire Générale.
me semble - t-il,
a
Il n'est plus interprété
progressé
(sauf en de
rares occasions) comme exprimant une attitude du locuteur,
comme
le
comme
doute,
marquant
sont
mais plutôt,
la subordination.
toujours
l'indicatif
lui
seul
surtout à partir de Du
subordonnés
Les jugements qu'il sert à
à d'autres
jugements
(et quelquefois le conditionnel).
un
"sens
"indéterminati on "
son t i n dé fin i s .
qui
Marsais,
complet" ;
il
est
marqué
exprimer
exprimés
Il ne fait pas à
d'une
se manifeste dans le fait que
certaine
ses
Les grammairiens philosophes remarquent
temps
souvent
que le choix du subjonctif de préférence à l'indicatif tient
500
par
non
seulement
au
conjonctions
à
la
fait
qu'il
vient
la
à
de
certaines
(afin que, pourvu que, avant que, etc.),
mais aussi
suite de certains verbes qui
"commandent"
parce qu'ils expriment une incertitude,
ou
une faible probabilité.
[1929]
et
suite
les
Leçons
le
une simple
subjonctif
éventualité,
Gustave Guillaume (Te.ps
de
li ngui sti ques
l
et
[1971] )
verbe
précisera
l'explication anticipée par les grammairiens philosophes
axe
où
plus
le possible et le certain constitue les
deux
sur un
extrêmes,
on se déplace vers le possible (via le probable) ,
subjonctif
devient
nécessaire.
On dira
"Je suis
plus
sQ.r
qu' il
viendra", ou même "Il est probable qu'il viendra", mais pas
est possible qu'il viendra",
propositions
principales
etc.
ne
connues
à ce principe
qu'il vienne"
pas
"visée"
du
lorsqu'ils ne constituent
pas
un milieu "transparent" (Guillaume),
préférence à l'indicatif.
"Il
Ainsi, lorsque les verbes des
permettent
locuteur atteignant la "réalité",
une
le subjonctif s'emploie
Il Y a toutefois des exceptions
"J'espère qu'il viendra" vs "Je
Quoi qu'il en soit,
de
bien
crains
pourquoi l'indicatif dans le premier cas,
subjonctif dans le second?
le
et le
les grammairiens
philosophes, après les errements de la tradition qui lui attribue
une valeur psychologique distinctive
inclut
(en français)
meilleure
(doute,
les formes en -rais,
compréhension
du subjonctif;
incertitude)
son t arr i vé s
d'abord en
à
une
isolant
le
conditionnel
pour
temps
de
l'indicatif,
ensuite en cernant plus précisément sa fonction
de
en
faire
un mode à part
subordination, enfin en recensant
ou
et y
un
(comme chez Buffier) bon nombre
de contextes où il s'utilise de préférence à l'indicatif
501
(verbes
volitifs,
de crainte, etc., propositions adverbiales introduites
par que, sans que, bien que, pour que,
etc.) .
philosophes
langues
savaient
que
certaines
subjonctif (hébreu, suédois)
lui
Buffier
ne
mais deux
grammairiens
n'ont
et en conséquence,
pas jugé nécessaire au langage;
commun"
Les
pas
ce mode n'était
"grammairiens du sens
attribuent un statut presqu'égal
l'indicatif
à
reconnaît que ces deux modes en français
(tous
autres n'étant que des "termes de supplément"),
et Beattie
de
"résolvent"
même
parce
que tous les autres
l'indicatif et le subjonctif.
plus reconnue par Gregory;
jugement
(lorsque
("qu'il vienne!")
souhait, etc.
est
"résolution"
par
subjonctif fut de
l'indicatif) ,
de
fait
en effet, exprime tantôt un
Il s'agit enfin d'un mode
par là,
tantôt
un
ordre
des
qui n'exprime que
et l'usage qu'on en
modes autres que
clairement le caractère
"oblique",
des
ou d'un
jugements
le subjonctif, plus que tout autre mode,
"moyen de syntaxe"
un
L'ambiguïté du
de l'indicatif,
"accessoires";
se
les
ou encore une concession, une supposition, un
(2)
, 'c a s ob l i qu e "
précédé
modes
ce mode,
de
l'indicatif
"intensionnel"
fait
pour
la
fait
ressortir
des modalités
(attitudes
propositionnelles et modalités illocutoires)
impliquées dans
ces
modes.
Le
Générale
progrès le plus spectaculaire
sur
conditionnel
n'avaient
pour
la
théorie
(ou
des
modes
suppositif).
Les
concerne
sans
grammairiens
ce mode aucun modèle dans
502
en
accompli
la
Grammaire
doute
le
classiques
grammaire
gréco-
latine.
On
Marsai s)
le rapporta d'abord au
ou à l'indicatif
un mode à part
entière
subjonctif
(Buffier, Restaut)
(Girard,
Beauzé e ) .
associé à l'idée accessoire d'hypothèse,
d'exprimer
c h argé
grammairiens
un
jugement
philosophes
( Port-Royal,
avant
de supposition
Destutt
par exemple,
du
Guillaume (1971,
de
d ' autres
o nt
tout comme les
135
p.
est
Tracy )
distingue le conditionnel-mode ( " Vous
conditionnel-temps ou "futur hypothétique"
et
Mais
clairement aperçu l'aspect " temporel" de ce mode,
linguistes contemporains.
d'en faire
Le conditionnel est
" c onditionnel".
( Buffier,
Du
et suiv, ) ,
réussiriez ")
("Je savais
qu'il
viendrait") qui s'oppose au "futur catégorique"; le conditionnelmode
"porte une surcharge d'hypothèse"
l'indicatif
Cp.
135) ,
surcharge
dont Beauzée
compte par sa notion d'idée accessoire.
s'en
voyaient
souvient,
dans
le
l'indicatif, un "temps incertain "
temps à venir"
(Destutt)
(:s )
traitements
Ce
temps.
contemporains
mode,
voulait
Buffier et
conditionnel
rendre
Destutt,
un
temps
on
de
CBuffier), ou un "imparfait des
On trouve donc encore,
d'idées sur les modes,
capital
absente dans le futur de
des conceptions
dans notre
anticipant
du conditionnel comme mode
et
qui n'existe que dans un nombre restreint
les
comme
de
langues, ne peut être considéré comme nécessaire au langage.
Le mode potentiel n'est discuté que par
anglais.
Ce
mode
les
ne concerne pas la morphologie
grammairiens
verbale
mais
l'usage des "auxiliaires modaux" en anglais. C'est Thomas Linacre
503
qui
introduisit
anglaise,
et
(à la Renaissance) ce mode
dans
la
grammaire
poussa même l'audace jusqu'à reconnaître
potentiel dans la langue grecque.
un
mode
Ce mode sert à exprimer, selon
Beattie,
des affirmations "modifiées" par la considération
pouvoir,
d'une possibilité, d'une liberté, d'une volonté ou d'un
devoir.
Ce
mode n'est pas non plus nécessaire au
langage.
linguistes
contemporains
auxiliaires
comme "pouvoir" et "devoir" et ceux-ci ne
traités
comme
un
mode
appellent
verbal
d'un
Les
"modaux"
mais
plutôt
les
sous
sont
le
pas
titre
"modalité" (cf. Ducrot et Todorov, 1972, pp. 393 et suiv.)
Les principaux modes considérés jusqu'ici sont des
de l'affirmation"
tous expriment des jugements,
"modes
catégoriques,
subordonnés ou dépendants, "conditionnés", ou enfin
"modalisés".
le subjonctif et le
conditionnel
Destutt
sont
dira que l'indicatif,
des
modes exprimant des modalités
conditionnelle) ,
subordonné e,
alors
d'existence
que tous les autres
"définis" servent à former des propositions que fait le
à
propos
de
lui-même.
Les modes que
(positive,
nous
allons
modes
locuteur
maintenant
considérer sont les "modes de la volonté" qui mettent en cause le
plus
le
souvent les positions du locuteur et de l'allocutaire
procès
de la communication
plutôt
l'attribution d'une valeur de vérité.
504
que
les
conditions
dans
de
L'i.p~ratif
est traité assez
différemment
dans la théorie
des actes de pensée et dans les théories réductionnistes. Pour le
premier
groupe
directement
de grammairiens,
l'impératif
exprime
toujours
un acte de la volonté particulier et indépendant
du
jugement, soit le commandement, la prière, ou la concession selon
le cas.
Pour le second groupe,
dégui sé ;
on le considère soit comme un "terme de supplément"
l'impératif exprime un jugement
une phrase elliptique (Buffier, Beattie, Destutt),
jugement
chargé
indiquant
la
son affirmation.
celle
soit comme un
d'une idée accessoire marquée par
volonté
du
sujet
parlant
tout
un
en
suspendant
(et
autres
comme celle de Stenius s'inspirant de Wittgenstein),
l'énonciation
illocutoire
littérale
(acte
de
d'un
énoncé
pensée)
distinct
de
les énoncés impératifs par
obtiennent
d'effacement"
profonde
à
il
les
emprunte
propre;
l'indicatif,
et quelquefois au subjonctif,
la
"transformation
une
le
en
plus
structure
suppression
des
différentes
de
souvent
à
C'est surtout par
distingue
de
"déduit" pratiquement les modes de
la
pronoms personnels qu'il
Port-Royal
n'a pas
pour certains verbes
comme .tre, avoir, savoir, pouvoir et vouloir.
des
acte
générativistes
dans de nombreuses langues,
terminaison
volonté
un
Les deux groupes de grammairiens sont parfaitement
(4)
l'indicatif.
à
théories,
l'assertion;
partir d'une phrase déclarative
conscients que ce mode,
la
.odo
associant à
impératif
seconde approche se compare davantage à celle des
qui
morphème
La première approche correspond grosso
de la théorie des actes de discours
ou
"manières de vouloir"
sos
se
ou
d'envisager
l'objet
de
concessif
la volonté pour en obtenir
et
l'impératif,
concessif ne sont pas
les
division
de
cela même
"marqués "
langues modernes.
(requi si ti ve )
et
trois
l'optatif,
si
l'optatif
et
en français et en général
Harris englobait dans le mode de
l'impératif et le
déprécatif
le
le
dans
demande
(precative) ,
cette
étant commandée par le statut respectif du locuteur
l'allo c utaire,
ou par la responsabilité de
l ' ajustement
et
du
monde et de l'énonciation.
L'interrogatif
est souvent considéré comme mode
grammairiens philosophes,
correspond .
de
le
comme
les
même si aucune flexion verbale ne
lui
Les peuples auraient pu, s'ils avaient jugé à propos
faire,
pour
par
créer des flexions verbales
n'importe quel autre mode.
souhait ou un désir de connaître,
certaines informations.
Ce
pour
l'interrogatif
mode
marquerait
de recevoir
Beauzé e,
de
l'allocutaire
et surtout Gregory,
note de la complexité de l'interrogatif
<:5>,
un
prennent
qui ne se laisse pas
" résoudre" aussi facilement que les autres modes par l'indicatif.
D'un
énoncé
interrogatif,
on
passe
d'abord
à
un
énoncé
à
l'impératif dont le verbe principal est un verbe de parole (c omme
dire
ou
apprendr~,
un énoncé déclaratif
verbe de parole de
etc.); puis, de cet énoncé, on arrive enfin à
commençant par "Je demande" et contenant le
l'énoncé précédent à l'infinitif suivi
clause propositionnelle.
506
d'une
L'optatif,
comme mode verbal, n'existe (à ma connaissance)
qu'en grec. Mais le latin et les langues modernes ont des phrases
optatives équivalentes
(Utina. + subjonctif,
+ subjonctif,
"Plût à Dieu"
"Fasse le ciel"
ou
"Que n'ai - je davantage de chanc es au
jeu!", etc.), qui sont résolues par l'indicatif et le subjonctif.
Ces
nom,
phrases expriment des souhaits,
et
ce mode,
comme le mode grec du
comme le subjonctif,
produit que de "simples énonciations"
Enfin,
considérées
interjections
les
comme
des modes
émotions vives.
interjections
naturelles",
"oblique";
il
ne
(Du Marsais) .
et
excla.ations,
sans
(sauf pour Gregory qui en
"mode grammatical" parmi d'autres),
d'exprimer certains
est
même
sont malgré tout des
"mouvements de l'âme",
en
être
fait
un
moyens
particulier
des
Pour bon nombre de grammairiens philosophes, les
(~h.'
une
,
~ie.',
Hill as.' ,
suite de notre
etc.)
sont
des
"voix
"conformation naturelle";
on
peut les énoncer sans aucune intention de communication. Certains
grammairiens philosophes en font,
grammaire latine,
ce
statut
entière.
pour
qui
comme dans la
une partie du discours;
d'autres lui refusent
parce qu'elles équivalent souvent à
Mais il y a des grammairiens,
les
na t ur e Il es" ,
interjections
ne
sont
tradition de la
une
proposition
en particulier
pas
de
simples
Beattie,
"voix
car elles varient d'une langue à une autre. Destutt
507
de
Tracy
insiste
interjections
plus
expriment
que tout autre
sur
le
fait
des propositions entières
que
et
les
comptent
parmi les formes d'expressions linguistiques les plus primitives,
les
parties
n'étant
du
que
des
exclamations
grammaire;
etc.) ,
discours les plus importantes
fragments
sont
ces
des
(Vive les Roi!
différence
des
et
verbe)
interjections.
souvent traitées
phrases
la
à
plus
tardifs
(nom
en
rhétorique
~tes
Que vous
interjections
monosyllabes), ont un contenu plus explicite,
Les
qu'en
belle!,
(souvent
des
bien qu'il ne soit
pas toujours équivalent à une proposition entière (quelquefois un
simple acte de reférence) .
Ce sont là les principaux modes traités dans les grammaires
générales.
Il n'y a guère d'autres modes pris en compte par
les
grammairiens philosophes, à l'exception du dubitatif chez Destutt
de
Tracy;
et
(roumain?,
on
gilyak,
l'''expérience
promissif
ne
trouve
etc.) ,
indirecte") ,
rien
sur
les
(en
"évidentiel"
injonctif et
(comme mode syntaxique en
modes
turc,
hortatif
coréen),
présomptif
pour
(rus s e) ,
etc.
Les
le
modes
impersonnels,
dans la mesure où ils ne servent pas à former
des
propositions
(considéré es
peu
d'intérêt
brièvement,
pour
grammaticalement) ,
sont
notre enquête et nous ne les avons
surtout
pour
montrer
classiques les opposaient aux modes
508
comment
, 'dé fin i
Sil.
les
de
traités
que
grammairiens
D'après Julien (1979,
op. cit.,
p. 471),
ce qu'il y a de
nouveau dans la théorie des modes verbaux à partir de Port-Royal,
c'est une "pragmatique du mode". Il entend par là "l'insertion du
mode
dans
théorie
une théorie des actes de parole".
a
eu
quelques prédécesseurs à
la
Et même
Renaissance
Scaliger), c'est seulement avec Port-Royal que
fois
si
cette
(comme
"pour la premiè re
une théorie générale des actes de parole condescend
à
des
exemples, et surtout à des exemples tenant compte de la diversité
des langues"
de
(ibid., p. 472).
Toutefois, cette théorie des actes
parole est soucieuse de limiter la multiplication
par
une
constante
s igni fi er"
avec
confrontation
des
diverses
la morphologie des langues,
des
"manières
car ce
n'est
seulement ces diverses manières de signifier qui font les
mais
aussi
Messieurs.
modes
les inflexions,
comme l'expliquent
de
pas
modes,
clairement
les
Mais ce "frein morphologique" à la multiplication des
n'empêche pas les grammairiens philosophes
d'envisager
un certain nombre de modes possibles qui ne sont
priori
modes
a
marqués
par aucun morphème dans aucune des langues qu'ils connaissaient.
Dans cette sémantique idéationnelle des modes d'énoncé, les
énoncés
composé s
non déclaratifs correspondent à des énoncés
ou syntaxiquement complexes contenant
intensionnels"
(6)
des
déclaratifs
, , opé rat e ur s
(verbes ou c onj onct ions). On peut le voir dans
la théorie des propositions incidentes de Port-Royal où certaines
509
incidentes complexifient le verbe d'un énoncé
l'attribut),
que,
comme Je soutiens que,
Je souhaite que,
ordonne,
pas,
souhaite,
etc. )
ayant
la
que,
J'ordonne
etc. Celui ou celle qui soutient (suppose,
etc.) que P,
ne soutient pas
valeur de vérité
(ou ne suppose
que
P.
propositions
L'interprétation
qui fait des modes verbaux autres que l'indicatif
"opérateurs non assertoriques",
modes de l'affirmation
pour
-rais
Je suppose
également et indifféremment toutes les
même
Dominicy,
(et non le sujet ou
les
affirmations,
(le subjonctif,
Messieurs)
tandis
nous apparaît donc
que
(ou
modes de
"manières de vouloir",
différentes
des
les
comprenant les formes en
suspendent
les
fondé e;
de
la
"modifient")
volonté
des
expriment
ces deux sortes de
modes se
répartissant selon les deux directions d'ajustement fondamentales
entre le langage et le monde. Rappelons-nous que pour Du Marsais,
les
toutes
sont
propositions dont le verbe n'est pas
des propositions "obliques" ou de
simples
Le phénomène de l'intensionalité des modalités
des
modèle
de
l'oblicit. dans les
théories réductionnistes,
discours
fut
i 11 ocut oires)
modalités
des
idées
saisi,
flexions
l'indicatif
à
"énonciations".
(et en particulier
semble-t-il,
casuelles.
sur
Dans
le
les
les modes verbaux introduisent dans le
accessoires qui
altèrent
pareillement
la
"signification spécifique" du verbe, c'est-à-dire l'existence (ou
la
coexistence)
positive
(Beauzé e,
encore l'affirmation (Buffier, Beattie)
***
510
Condillac,
Destutt)
ou
Comment les modes
ils
analysés par les
( et les énoncés non déclaratifs)
comparatistes,
les
linguistes et philosophes contemporains?
structuralistes,
Ont-ils retenu
chose de la Grammaire Générale et qu'y ont-ils ajouté?
pas l'intention de
ma~s
seulement
connus
de
furentles
quelque
Je
n'ai
répondre à ces questions de façon exhaustive,
de
sé l ect i onner
chaque
mouvement
quelques
important
représentants
pour
bien
discuter
trè s
Psychologie,
ihre
brièvement leurs conceptions.
Steinthal
Prinzipien und ihr
(6ra •• ati k,
~erhaltnis
Logik
und
zueinander,
1855)
insiste sur les
logique et grammaire ,
entre
la
"La
pl us
différences
entre
logique
la proposition grammaticale
et
division
logique
du
jugement
en affir.ation et en n4gation.
<7')
distinction"
De
subjonctif (Conjunctiv) ,
aucunement aux modalités
problématique,
peuvent
être
rendues
"~a.'
qualité
La grammaire ne connatt pas cette
les
modes
les
(indicatif,
verbaux
correspondent
(assertorique,
trois modalités
par
mais un
du
l'indicatif.
d'après lui au jugement apodictique,
4cris.'
important e
la
(kantiennes) du jugement
forme aucunement un jugement,
Satz).
selon
optatif et impératif) ne
apodictique) ;
toutes
correspond
même
s'opère
proposition
bien
simple énoncé
jugement
L'impératif
qu'il
ne
(nur einen
ne sont pas des jugements, mais sont pourtant
des énoncés nécessaires"
<e),
peut-être parce que seul un énoncé
511
"nécessaire" peut rendre le caractère d'obligation catégorique de
l'impératif.
CSatzarten) de
la
grammaire ne correspondent pas non plus à différentes espèces
de
jugements
logiques .
et
"narratifs"
CErzahl-Satz ) n'appartiennent pas à la logique,
Steinthal
Les différentes espèces d'énoncé
en
CZ/IJecksatze )
Les
invoquant Aristote.
und
ou
jugement,
est
Les
et
les
énoncés
faux,
comme
sorte
particulière
car la liaison d'une fin avec un fait ou une
des jugements;
"mais dans
la
mesure
lui-même,
de la personne et de l'état de choses,
il ne contient,
la
de
la
où
indépendamment
comme le
et par suite aucun jugement"
classification des énoncés,
être
personne
et elle échoit à
l'énoncé téléologique est considéré en
Dans
Mais dans
"té lé 01 ogiques" peuvent né anmoins
souhait, ni vérité ou fausseté,
afin
énoncés optatifs et impératifs
ils n'expriment aucune
habituelle
note
"té lé 0 logiques "
c onjonctions,
un simple énoncé déclaratif (Russage) ,
catégorie
optatifs
Befehl-Satze) ne sont ni vrais ni faux.
la mesure où les énoncés
vrais
impératifs,
-- impliquant certaines
que, en vue de, etc. -- ,
(Hunsch-
énoncés
les grammairiens
du
(9)
XIX·
siècle, contrairement à ceux des Lumières, commencent à faire une
place
aux énoncés téléologiques et causaux,
et Josef
(le "grammairien philosophe" du Cercle de Vienne) ,
tradition dans sa classification des types d'énoncé
Hermann Paul
dé fini t
Schachter
sUl.vra cette
(10)
(Principles of the History of Language)
l'énoncé en des termes qui ne diffèrent pas beaucoup
512
( 11 )
de
ceux
des
sentence
the
grammairiens philosophes du siècle
1.S the linguistic expression or symbol,
combination
effected
means
précédent
of several ideas or groups of
1.n the mind of the speaker;
denoting
ideas
has
and at the same
contemporains,
explications
(p.
Paul
ayant
111).
Toutefois,
n'est pas très enthousiaste
recours à l'ellipse et
tout énoncé doit contenir un verbe "fini"
personnel) ;
"Moi, un menteur?"
fait acceptable.
l' idé e
des
que
est à ses yeux une phrase tout à
Nous disposons de divers moyens pour
l'ordre des mots,
in
linguistes
vis-à-vis
dénonce
the
(c'est-à-dire à un mode
linguistiquement des combinaisons d'idées
mots,
ideas
comme les
that
been
time
of reproducing the same combination of the same
the mind of hearer"
"The
exprimer
la juxtaposition des
l'emphase, le contour accentuel -- pour
les phrases assertives et interrogatives --, le temps, les "motsliaisons"
(link-~ords)
verbes auxiliaires,
idé es;
les
conjonctions
et
et les inflexions. Les phrases assertives se
comme expression de la connexion
dé fini s sent
deux
comme les prépositions,
phrases
de
demande
(ou séparation)
(sentences
of
de
de.and)
expriment les requêtes, les commandements, les interdictions, les
conseils,
et
avertissements,
C'est le ton de la voix qui
désapprobations.
quelle
utilisés
doivent
optative
nuance
par
de
est
être
signification doit
le locuteur.
parfois
encouragements, concessions, prières,
s'ajouter
énoncée
Les énoncé s
à
cette
influence sur la réalisation du souhait;
Paul,
attachée
impliquant
liste
en espérant que
doit
aux
mots
un
souhait
lorsqu'une
phrase
l'énonciation
dans ce
cas,
l'expression du souhait équivaut à une demande.
513
indiquer
aura
une
souligne
On
peut
être tenté de considérer les énoncés assertifs
comme
les
seuls
énoncés "normaux"; mais, insiste l'auteur, les énoncés de demande
sont
aussi
assertifs.
énoncés
anciens,
Les
de
sinon
plus
anciens,
que
les
premières paroles des enfants sont
demande
et on trouve fréquemment
de
énoncés
souvent
tels
des
énoncés
dépouvus de verbe
Rttention! R gauche! Tout le .onde à bord! En
voiture.'
etc. ,
Ru feu!,
etc.
Le même mot anglais, Fire!, peut
être, selon les circonstances, un cri d'alarme ou un commandement
donné
classe
comme
autres
la guerre ou à un
à
peloton
d'énoncé est celle des
les
interrogations.
grammariens philosophes,
formes d'interrogation,
d'exécution.
et
les
La
Paul
yes/no
troisième
distingue,
des
questions
d' aprè s lui,
la
principale
marque de l'interrogation réside, semble-t-il, dans l'intonation.
Les
énoncé s
l'admiration.
assertifs,
exclamatifs
Ils
expriment
empruntent
souvent les
impératifs ou interrogatifs.
statut des énoncés impersonnels
etc.) ,
souvent
(" l l
la
surprise
formes
des
énoncé s
Paul discute aussi
faut ..
Il
"Il
Ei"st.ig.,,/
même l'infinitif
peut servir à donner
des
le
grê le.. "
et prend note du fait qu'en allemand (et quelques
langues) ,
ou
autres
ordres
("En voiture!") criait le chef de gare en Allemagne.
Otto Jespersen (La Philosophie de la gra •• aire,
1924)
<12>
se situe à mi-chemin entre la tradition comparatiste et celle
la
linguistique post-saussurienne
point
de
<13>.
Son examen prend
départ les cinq modes de la tradition
de
pour
grammaticale
indicatif, subjonctif, impératif, infinitif et participe. "Il est
514
pourtant évident,
même
catégorie
écrit-il, que l ' on ne peut pas réunir dans une
les infinitifs,
les participes
formes auxquelles on donne le nom de modes"
plupart
des
titre de
grammairiens philosophes,
"modes"
propositions.
Pour
qu'a
(p.
447)
il préfère
lui,
Comme
la
réserver
le
des
différentes
mais plutôt
le locuteur à l'égard du contenu de
autres
former
les modes n ' expriment pas
Dans le cas du subjonctif cependant,
(ibid.) .
les
aux formes verbales qui servent à
relations entre le sujet et le prédicat,
attitudes
et
"certaines
la
phrase"
il admet que
son
emploi n'est pas déterminé uniquement par l'attitude du locuteur,
mal.S
"par
la nature de la proposition et par
l'uni t au nexus principal dont elle dépend"
pour que l'on puisse parler de
locuteur apparaisse
est
un
la
relation
(ibid.).
Toutefois,
" mode", il faut que l'attitude du
"dans la forme même du verbe".
mode de la volonté,
"mais seulement
L'impératif
et c'est là un
dans la mesure où le locuteur entend
point essentiel
qui
par là
influer sur le comportement de celui à qui il s'adresse; dans les
autres
cas,
en
d'autres moyens"
la volonté du
effet,
(p.
448) .
la
impératif
à
locuteur
peut
l'indicatif,
"At t ent i on! ")
s'exprimer
de
bien
Mais
d'autres
et même le participe
la
volonté
façons,
(IJorgesehen.'
du
par
=
Les impératifs expriment aussi la permission, et
"Oignez vilain il vous poindra,
même quelquefois "la condition"
poignez vilain il vous oindra"
vous poindra,
par
"aller du commandement le plus
prière la plus humble".
l'infinitif,
s'exprime
L'impératif sert avant tout à donner
mais ceux-ci peuvent
des ordres,
locuteur
etc ... ) .
(=
si vous oignez vilain, alors il
Jespersen critique les théories qui font
515
de
l'indicatif un
mode qui présente un fait comme
réel,
parce
qu'en employant la phrase "Deux fois trois font sept", on énonce,
avec
l'indicatif,
"s'il
pour
est
tout
malade.
indiquer
le contraire d'un fait
l'indicatif
"
un fait
réel.
réelle de l'existence imaginaire,
et
n'est pas non plus
(Toutefois,
philosophes distinguaient souvent,
réel;
les
utilisé
grammairiens
nous l'avons vu,
l'existence
pour tenir compte du
fictif ou des prédications ayant pour objets des
dans
discours
Le
fig_enta).
subjonctif, pour la plupart de ses emplois, peut être caractérisé
comme
'" le mode de la réserve' par opposition à une
que l'on pourrait dire 'catégorique'"
ne
caractérise
pas tous les emplois
(p. 454). Mais la "réserve"
du
subjonctif,
utilise parfois "pour des choses 'catégoriquement'
irréelles"
j'étais
encore
(ibid.)
riche") ,
"pour
(en aIl.
H~re
l'on
en fr.
èirconstances,
des choses 'catégoriquement'
que
imaginaires ou
ich doch reich!
en d'autres
et
affirmation
on
ré elles"
"Si
l'utilise
("J e
suis
heureux que tus oi s venu"). Le subj onct i f est en fait susc ept ibl e
extrêmement
d'emplois
si
véri té
dans
les
langues
indo-
en conséquence, "[o]n se rapproche beaucoup plus de
europé ennes;
la
différents
l'on considère l'indicatif comme
le
mode
qu'on
emploie lorqu'aucune raison ne milite en faveur d'une autre forme
et
le
subjonctif
employer
l'autre"
dans
(pp.
tendances
europé ennes"
comme celui que l'on peut ou
des
circonstances qui
454-455) .
qui
sont
varient
Il y a néanmoins
communes
à
(p. 455)
516
toutes
que
d'une
l'on
doit
langue
à
"un certain nombre de
les
langues
indo-
On emploie généralement l'indicatif dans les
relatives et dans les propositions introduites par des conjonctions de lieu et de temps
comme où, quand, pendant que, sauf pourtant,
dans certaines langues, lorsqu'on veut indiquer une idée d'intention ou que la proposition exprime la pensée de quelqu'un d'autre
que celui qui parle ou qui écrit.
Dans les
conditionnelles,
le subjonctif s'impose le
plus souvent s'il y a une idée d ' impossibilité,
comme par exemple dans les propositions qui rejettent une condition ou qui expriment une condition contraire à la réalité, bien que même dans ce cas on ait tendance en anglais à ne pas employer le subjonctif. (Pp. 455-456).
Jespersen donne au passage quelques indications intéressantes sur
l'histoire
XIX -
du
mode dans la grammaire
siècle (Jespersen écri t,
allemande.
Au
début
en 1924, "voici plus d'un siècle")
des grammairiens allemands tentèrent d'organiser les modes en
système
Wolff,
cohérent en prenant les théories de Wolff puis de
dans son
possibilité,
la
donne
'modal i té s' ,
trois
né ces s i té"
(p.
"possibilité
parlait
ontologie,
"trois
de
nécessité et la contingence,
456) .
Ainsi,
objective"
"possibilité subjective",
nécessité objective
la
le
du
Kant.
modalités,
alors
que
la
Kant
et
la
on aurait fait correspondre à
la
possibilité,
"conjonctif"
l'''optatif''j
l'existence
un
(subjonctif) ,
de la même manière,
à
la
"la
qui correspond aux verbes adjectivaux en
-teos du grec -- et la nécessité subjective -- ou 'impératif'. Il
y a peu d'intérêt,
théories".
ajoute l'auteur, à examiner l'histoire de ces
(Ibid.)
517
Jespersen s'emploie
pour sa part à
distinguer les
"modes
notionnels qui comportent un élément de volonté" de ceux qui n'en
comportent aucun, Parmi les premiers on retrouve: L'ordre ("Vasy! ") ,
la contrainte ("Il faut qu'il y aille"), l'obligation ("Il
devrait y aller,
Nous devons y aller"),
bien y aller") ,
("Allons-y") ,
promesse
le conseil
la prière ("Vas-y, s'il te plaît")
("J'irai,
ça
sera
fait") ,
le
encore
aller") ,
vivant!),
notionnels
nous
avons
"souhait
né ces s i té
riche") ,
la
quatre") ,
probabilité
probablement"),
puisse
("Deux
y
le doute ("Il est peut-être
Cette
pensé e" ,
laisse de c8té,
de son propre aveu,
d'autres
utilisations"
Il conclut donc
sÜr
,
nombre de
des
font
formes
effectivement dans une langue"
Gregory
"modes",
verbales
(p, 458),
518
~tre
(" Il
est
"Il
le
riche"),
la
("S'il était riche"), et la
par moment celle que fait
relativement
deux
l'affirmation
rappelle
grand
et
volonté,
("Il est probablement riche",
("Bien qu'il soit riche") ,
un
de
la nécessité intuitive ("Il doit
("Il sait parler"), l'irréel
concession
trouver
("Si seulement il
("Pour qu'il
logique
pour dépenser autant d'argent"),
capacité
la
réal i sabl e"
(qui ne comportent aucun élément
1a
nécessairement
saura
veux"),
(Les exemples sont tous de Jespersen), Pour les autres
modes
riche
et l'intention
devras
l'exhortation
la permission ("Tu peux y aller si tu
("Pourvu qu'il soit encore vivant!"), le regret
était
("Tu
de
énumération,
de ses
"modes
un grand
suffit,
quitter
le
l'on
de
nombre
"Il
que
qui
pour
terrain
rencontre
Chez
changé
les comparatistes,
considérablement.
thé ori es
des
faits
langues)
changent et
sont des
"organismes"
influence
langue
Même
i dé a t ion n e 11 es,
description
de
s~
contexte
on
concepts
les
épistémologique
demeure dans le cadre
(de
langue
s'enrichissent.
utilisés
diverses
L'idée que
mo~ns
philosophes,
l'ellipse,
comme
ont aussi contribué grandement à
"aprioriste"
que
de
langues
celle
d'une
façonner
des
jugement et de la volonté,
la
a priori
rupture du
.le
L'approche est
grammairiens
en témoignent le refus des explications
le peu de considérations
grammatical"
la
familles
-- et l'idée de "forme interne"
nouveau visage des sciences du langage au XIX-.
beaucoup
des
pour
les
a
(introduite par Schleicher et Becker)
du darwinisme?
(Humboldt)
le
sur la
par
nature du
"parallélisme logico-
et l'autonomie croissante de la linguistique vis-à-
vis de la logique. Par ailleurs, le souci de la confrontation des
diverses familles de langue et cel~i de la description
rendent
grammaire
de plus en plus suspecte la valeur des catégories de
gréco-latine
et
franç ai s e pour
langues autres qu'indo-européennes.
of Languag. (1867)
( 14)
la
description
Dans Language and the
de W. D. Whitney,
l'histoire du verbe indo-européen,
Whitney étant d'examiner la
genèse des
de vue la morphologie verbale.
519
la
des
Study
par exemple, les modes
ne sont invoqués que deux ou trois fois et uniquement en
avec
génétique
le principal
rapport
souci
de
modes sans jamais perdre
Pour
et
le
verbe
g4n4rale,
classe
R. Jakobson ("Les embrayeurs, les catégories verbales
russe"
des
mode
dans les
Essais
de
linguistique
est une catégorie appartenant
c'est-à-dire,
e.brayeurs,
impliquent
des
à
expressions
de
(1~)
"Le mode caractérise la relation entre
l'énoncé
et
ses
protagonistes
par
la
qui
une référence au procès de l'énonciation et/ou à
protagonistes
procès
le
1963) ,
(1957),
référence
ses
le
aux
protagonistes du procès de l'énonciation: dans la formulation de
cette
Vinogradov,
catégorie
'reflète
la
conception
qu'a
le
locuteur du caractère de la relation entre l'action et son acteur
ou son but'"
183) .
Le mode est dans la même classe que les
personnes grammaticales,
les temps et le "testimonial" (discours
indirect) ;
(p.
plus
précisément,
classe des "connecteurs"
pour
notre
qualité
logique
l'énonciation)
une
langue
affirmatif,
195) .
mode est un embrayeur
le statut,
Cp.
du
182) .
particulière,
pré sompt if,
appelle,
suivant
l'énoncé
et
non
Jakobson illustre cette catégorie
notant
la
la
c'est-à-dire, tIc e qui dé fini t
(de
procès"
de
L'autre catégorie importante
propos est celle que Jakobson
terminologie de Whorf,
la
(p.
le
qu'''en
gilyak,
les
de
sur
statuts
négatif, interrogatif, et interrogatif-
négatif sont exprimés par des formes verbales spéciales" (ibid.).
Le
statut s'exprime assez souvent sur le plan syntaxique
en russe,
statut
cf.
p.
correspond
aujourd'hui
"modes
186),
ainsi,
et non sur le plan
grosso
d'énoncé"
ou
520
.odo,
"types
à
(comme
morphologique.
ce
qu'on
Le
appelle
syntaxiques",
par
opposition
verbale.
aux
On
divise
philosophes
verbal".
modes
aux
distingue
c:onditionnel,
produire,
ainsi
traitaient
Quant
Jakobson
verbaux qui relèvent
qui
un
verbaux
mode
signale
(p.
188) ;
L'injonctif
mode
se
participation
dans
"des
procè s
est
procès de
morphologie
grammairiens
catégorie
du
grammaire
"mode
russe,
Cl' indicatif) ,
qui
un
pourraient
sans qu'ils
se
et un injonc:tif,
187)
aussi
la
les
la
marqué
divise encore en
au
que
non
procès de l'énoncé
ce
ce
du sujet parlant,
effectivement produits" (p.
"que le ( ..
deux
sous l'uni té de la
modes
l'avis
de
en
de
se
soient
qui signale
.. ) est imposé au protagoni st e"
en
opposition
hortatif,
l'énoncé",
et
l'indicatif.
à
qui
en
signale
"une
impératif,
qui
"réclame une participation au procès de l'énoncé": "à l'impératif
le destinataire est toujours impliqué, qu'il soit au singulier ou
au
pluriel et qu'il y ait ou non participation
tandis
que
destinateur"
l'hortatif
(ibid.).
implique
le
du
destinateur,
destinataire
et/ou
le
De "toutes les formes verbales, l'infini tif
est celle qui véhicule l'information grammaticale minimale. Il ne
dit rien n1 sur le protagoniste du procès de l'énoncé,
ni sur la
relation de ce procès aux autres procès de l'énoncé ou au
de l'énonciation.
nombre,
entrer
L'infinitif exclut la personne,
l'ordre et le temps"
dans
la
théorie des
(p.
191) .
modes
aux autres modes
(cf.
l'idée
Julien,
le genre,
Le structuralisme
d'opposition
signification d'un mode n'est pas dans son emploi,
opposition
procès
1979,
le
fait
la
mais dans son
p.
13)
< 16)
,
•
l'opposition marqué/non marqué en particulier devient importante,
mais
nous avons vu qu'elle l'était également à
521
Port-Royal,
qui
sépare nettement l'indicatif des autres modes,
élève de Saussure,
cara c térisait l'indicatif
toute addition au thème
(Principes de gra •• aire
la
c atégorie
dé c l a rat ifs
(1
Chez
et A. Meillet, un
du
temporel "
g~n~rale,
mode,
ni
Quant
(17)
1928)
du
"par l'absence
à
L.
Hjelmslev
il ne discute même
reste
les
de
énoncés
pas
non
a > •
les
philosophes
(avant
le
Wittgenstein
"seconde
manière"), plus précisément chez les empiristes logiques
(Russell
et Reichenbach) ,
la discussion tourne souvent autour de la barre
d'assertion
"barre de jugement",
(ou
" expressif"
caractère
Signification et
v~rit~
des
(1940)
énoncés
(19),
Urteilsstrich)
non
et sur le
déclaratifs.
Dans
Russell présente la " phrase "
en ces termes
Qu'est-ce qu'une phrase?
Il se pourrait que ce
fût un mot isolé, mais, ordinairement, c'est un
certain nombre de mots disposés ensemble selon
les lois de la syntaxe;
et ce qui la distingue
c'est qu'elle exprime quelque chose qui par sa
nature est une affirmation, un refus,
un impératif, un désir ou une question. De notre point
de vue,
ce qui est plus remarquable concernant
une phrase c'est que nous pouvons comprendre ce
qu'elle exprime, si nous connaissons la signication des divers mots qui la composent et
les
rè gl es de la syntaxe. (P. 20).
Et plu s loi n
optatives,
pouvons
(p.
40)
"Les phrases peuvent être interrogatives,
exclamatives ou impératives, voire indicatives.
nous
borner au cours de presque tout le
522
reste
de
Nous
nos
discussions
aux
indicatives car ce sont les seules
qui
soient
vraies ou fausses". Toute énonciation a un aspect "subjectif", et
un autre "objectif"
"Dans toute assertion il faut séparer deux
aspects. Côté subjectif, l'assertion exprime un état du locuteur;
côté
objectif,
réussit
quand
elle
prétend
c'est
vrai"
"indiquer" un "fait"
30) .
(p.
Les
et
"fins"
elle
y
auxquelles
répondent les énoncés non déclaratifs et les modes se déterminent
simplement de la manière suivante
Le langage répond à une triple finalité
1)
indiquer des
faits;
2) expri.er l'état du
locuteur;
3) alt~rer l'état de l'auditeur.
Cette triple finalité n'est pas toujours réunie.
Si, solitaire,
je m'écorche le doigt
et que je dis "aie!",
seul (2)
intervient.
Des énoncés impératifs, interrogatifs et optatifs comportent (2) et (3),
mais pas (I).
Des mensonges comportent (3)
et en un sens
(I), mais pas (2). Des exclamations poussées
dans la solitude, ou sans préoccupation d'un
auditeur,
comportent CI) et
(2),
mais pas
(3).
Des mot s i s olé s peuvent c omport er t outes les trois.
Ainsi, S1 je découvre un cadavre dans la rue et que je m'écrie
"A
l'assassin!" (p. 225)
La "fonction expressive" et/ou l'intention perlocutoire d'altérer
l'état
du
locuteur
seraient donc
caractéristiques
des
modes
autres que l'indicatif, et des énoncés non déclaratifs.
Reichenbach insiste lui aussi sur le caractère "expressif "
des
modes
Conversational
dans
le
fameux
chapitre
VII
("Analysis
Language") des Ele.ents af Sy.balie
523
Lagie
of
(20)
Les signes sont soit " dé no ta tif S i.l ,
premiers
signes
répondent
Il
soi t
Il
expres s ifs" ;
à la fonction "cognitive"
expres s ifs I l
sont
des
qui
termes
"capacité pragmatique" ( prag.atic capacity)
combination an instrument of the speaker.
they do not say it;
they are,
their instrumental funct i on"
la
langage.
agissent
selon une
Because they do
"cognitive"
"expressifs") .
entre la
signification "émotive"
la
L'usage
cognitif/expressif
que
fait
of
On reconnaît l'allusion à
chère aux néopositivistes,
et
this,
merely expressive
distinction de Wittgenstein entre .ontrer et dire,
distinction,
Les
"They make the sign
therefore,
(p. 336).
du
seuls les
rappelle l'opposition
de
actus
à
la
signification
(celle
Reichenbach
et
des
termes
l'opposition
exercituslactus
significatus des médiévaux (reprise par Port-Royal qui fait de la
l ocut eur) ,
copule le signe de l'affirmation accomplie par le
la
signifier
et
distinction entre signifier per .odu. affectus
ou
per .odu. conceptus.
Le premier groupe de termes pragmatiques est constitué
par
et
les
le signe d'assertion de Frege
mots oui et non.
verbe,
et
(ou "barre de jugement"),
Le signe d'assertion n'est pas la copule ou le
mais le "point final"
(period sign) dans le langage écrit
langue
l'intonation descendante (falling inflection) dans la
parlé e.
Russell avait utilisé le
signe d'assertion
Il
indiquer
qu'une proposition pest assertée ("I--
pourrait
aussi bien adopter la convention qu'une formule
sur
ligne
une
séparée est par
524
là
assertée.
p"),
La
pour
l --"
mais
raison
on
écrite
pour
laquelle Reichenbach considère le signe d'assertion comme un mode
pragmatique (prag.atic .ood) tient au fait que l'expression qu'il
compose ne peut être
authentique)
j
niée
( comme peut l'être toute
proposition
tout ce qu'on peut écrire, c'est ceci
1) 1-- pj
on ne peut écrire
2) 1-- p.
Dans
la syntaxe logique de Reichenbach,
dépourvue de sens
dire,
affirmer
2)
(.eaningless expression)
qu'on
est
une
ce serait, pour ainsi
j
"1-- p"
n'affirme pas.
expression
n'exprime
donc
pas une proposition, contrairement à son "corrélat cognitif "
que
l'auteur formule ainsi
3) ass(Je,
et qui, lui, peut être nié
"Je
, p'),
n'asserte
pas que
Les
p".
expressions qui contiennent un signe pragmatique ne sont pas
des
propositions
the
fact
"They are not true or false,
that
they
cannot
be
negated.
They
constructed by the help of propositions.
pragmatique
expression
est
as
Il
lS
are
(p.
d'assertion, en un .ode assertif.
assertif"
ne
sont
fonctions
de
vérité
et
Les expressions
525
Seule
la
Un
énoncé
dans le cas
pas susceptibles d'être
binaires.
instruments
337)
un opérateur qui transforme un
dans un .ode prag.atique,
shown by
signe
en
du
une
signe
"dans un mode
combinées
conjonction
par
les
a
un
équivalent
11
j
pragmatique
ux ta po si t ion" .
correctif
transforme
négation
a
dans le mot non qui,
pragmatique
sens
La
( prag.atic
après
cette
l'assertion
analogue)
dans
toutefois
son
la
simple
équivalent
lorsqu'il est employé dans
d'une
phrase
un
déclarative,
assertion en une assertion de la
négation
de
groupe
de
l'assertion première.
Les
"termes assertifs" constituent le premier
signes pragmatiques.
Les modes des verbes constituent le
groupe.
fait entrer dans la catégorie du
seuls
Reichenbach
"modes
de
l'affirmation"
indicatif,
second
mode
subjonctif
les
et
conditionnel
While the period sign and the words 'yes' and
'no' constitute the first group within this
subclass,
the second group is given by the
moods of verbs : the indicative, the subjunctive, and the conditional. Of these,
the indicative expresses assertion,
whereas the
subjunctive and conditional express either
absence of assertion or the assertion that
the clause is false, i.e.,
the assertion of
the negation of the clause. (P. 338).
Le
indicatif est donc bien lui aussi
mode
(plus précisément,
assertif) .
would
have
conséquent
"mode
assertif"
il compose une expression prise dans un
Dans la phrase anglaise
helped
un
you" ,
(conditionnel)
"If he were your friend, he
l'antécédent
(subjonctif)
et
sont tous les deux niés par leur
526
mode
le
mode
respectif.
Reichenbach
l'indicatif
et du subjonctif (qui s'emploient
note
pour l'autre indifféremment);
nié e,
aussi
en anglais,
la fausseté
de
affinités
quelquefois
de
l'un
lorsque la clause est
l'antécédent est suffisamment marquée
on utilise l'indicatif.
si,
Il mentionne aussi l'existence
d'un mode particulier en turc destiné à
"a
les
on a tendance à conserver le subjonctif, mais en français,
parce que
par
lui
mood
marquer
la probabilité,
expressing that the truth of the sentence is
weIl
establ i shed"
-.ish
(21 )
(ibid.) ,
Reichenbach
pragmatiques
les
interrogatifs,
indiqué
inclut
dans
termes
int~rrogatifs,
les
d'interrogation,
mode
adverbes
ce
second
le
groupe
comme
d'interrogation
s'ajoute
auxquels
par
l'ordre
none
morphème
de
termes
les
et
pronoms
le
des
too
point
mots.
Les
questions sont des expressions dans un mode pragmatique (le
.ode
interrogatif) ,
expriment
un
l'auditeur.
souhaite
par
puisqu'elles
désir
Leurs
du
ne
peuvent
locuteur
être
d'obtenir
nié es.
une
corrélats cognitifs sont de la
connaître la réponse à cette question".
elle-même,
classification
réponse
expri ••
des
ce
désir,
questions
que
elle ne
présente
le
forme
dit
pas)
Reichenbach
we have three kinds of questions,
we ask for an argument,
a function,
527
"Je
quest i on,
La
est
"Since the
term will be in one of the three main categories of
object language,
de
(La
pratiquement la même que celle présentée par Beauzée
missing
Elles
the
according as
or a logical term"
(p . 340).
(Chez Beauzé e,
les questions portaient soit sur le
sujet,
soit
sur l'attribut, soit sur le rapport entre le sujet et l'attribut,
c'est-à-dire sur l'assertion qui constitue,
principal
"terme
logique"
demandé
pour Reichenbach
par
une
question)
questions portant sur un argument sont de la forme
("Quel est le x qui est tel que ... ?") .
des fonctions,
comme
sont de la forme
maison" ,
termes
=
et "C"
logiques
[f
(xd
qu'on appelle les
(où
C(f)] "
~yes~/~no~
maison?",
"votre
=
Le plus important des
peut être l'objet
dernière sorte est l'assertion.
(x)"
Les questions portant sur
le prédicat "couleur")
qui
Les
"(?x) f
"Quelle est la couleur de votre
"(? f )
le
d'une
question
de
la
Ces questions correspondent à ce
q«estions;
elles sont simplement de
la forme "? p".
Le troisième groupe de signes pragmatiques est
celui
des
comprenant le mode verbal impératif, certains
verbes
modaux (comme "devoir", sho«ld, shall),
à la troisième
forme
"! p "
impératif
Une expression
(où "!" marque le commandement)
et
fassiez pli.
son corrélat cognitif est
est
dans
"Je désire
une
"! p ").
permission.
de la
un
mode
que
vous
Ces expressions ne peuvent non plus être niées
ne peut écrire
exprimant
personne ("Qu'il parte! ") .
et le subjonctif
(on
Dans le même groupe il y a les termes
"Permission"
a deux significations;
selon la première, quelque chose est permis lorsqu'il y a absence
de commandement contraire;
selon la seconde,
528
une permission est
une
invitation
faire
à
quelque chose
suivant
en
sa
propre
décision ("Vous pouvez fumez. Faites comme vous l'entendez!"). La
.ay
permission est souvent exprimée par des verbes modaux (comme
en anglais)
et Reichenbach dit que le mode optatif était
utilisé
cette
à
fin,
bien que l'optatif
souvent
à ses yeux une
soit
catégorie superflue dans les modes.
La quatrième classe de termes pragmatiques est
termes
comme
excla •• tifs,
emotional
because
outl et
of
interjections,
the speaker.
They
are
n ' est
car
douleur",
pas
é qu i val en t
cette
"Aie!11 ne le peut.
en
"used
it "
(p.
à
"J'ai
signification
dernière phrase peut être niée
des
as
expressive
they perform this outlet but do not say
" Aie! "
alors
an
terms
343) .
une
que
"Aie! Il est plutôt "un signe indexical pour la
douleur ll
(p.
ressent
une douleur.
(cf.,
les
celle
344)
Si quelqu'un crie IIAie!ll,
nous savons qu'il
"Aie! Il signifie donc per
.odu.
affectus
Nuchelmans, 1988)
travaux de Wittgenstein (1953)
Les
largement
contribué,
on
le
sait,
à
(1962)
et Austin
remettre
en
ont
question
l'opposition signification cognitive/signification émotive et ses
conséquences
méthodologiques.
Les
529
philosophes
du
"courant
logique",
souvent motivés par un souci épistémologique,
avaient
jusque là construit la compétence du locuteur comme une
à
déterminer
déclaratifs
les
conditions
de
véri té
des
capacité
seuls
énoncés
Mais la diversité et l'importance des jeux de
(22)
langage mises en évidence par Wittgenstein et les philosophes
"courant ordinaire"
la
compétence
opposition
imposa une conception beaucoup plus large de
linguistique.
Austin,
"constatif"/"performatif",
illocutoire
un
constituant
de la
énoncés des langues naturelles.
finalement
pris
fait
en dépassant
sa
propre
fait
la
force
a
de
signification
de
et cause pour une théorie
(1971),
C'est ainsi,
John
(1984b)
Lyons
traitent
syntactic .oods)
Les
R.
que
des
R.
usages
p.
et
Zaefferer
.oods
tandis
énoncés
9). Les modes d'énoncé classifient
(cf.
que
les
ou
les
Davidson,
(indirectement) les
actes de discours lorsque les énonciations sont littérales;
lorsqu'il
y
signification
a
écart
entre
de l'énoncé,
signification
ou
illocutoire.
classifient des actes illocutoires
que l'on peut faire des
de
Huddleston
(sentence
modes syntaxiques classifient des énoncés,
divers
les
philosophes
en rapport avec la notion de force
illocutoires
actes
D.
Hausser (1980)
tous des modes d'énoncés
forces
1976,
par exemple,
(1977),
tous
Les linguistes contemporains ont
discours qui fut un temps le lot quasi exclusif des
du langage.
du
du
le mode de l'énoncé
locuteur
n'indique
mal.s
et
plus
l'acte il1ocutoire principal accompli par le locuteur. La théorie
des actes de discours est aujourd'hui conçue comme un
une
"Grammaire
Uni versell e"
(au
complément
sens
indispensable
à
Montague)
"langage idéal" de la Grammaire Universelle
le
530
de
doit
en
effet
être
illocutoires
assez
riche
possibles
et
i Il 0 c ut 0 ire" de t
0
pour
représenter
toutes
ainsi
les
le
forces
"potentiel
u sIe s é non c é s, dé c 1 a rat ifs et non dé c 1 a rat ifs ,
(cf., Searle
dans quelque langue que ce soit
p.
nommer
& Vanderveken, 1985,
8).
Les
linguistes
contemporains
distinguent
contrairement aux grammairiens philosophes,
(celui des .odes
d~4nonc4)
le plan
tous,
syntaxique
du plan morphologique (celui des .odes
Ces deux plans ne sont pas clairement distingués dans
la
Grammaire
modes d'énoncé
Générale.
Les modes verbaux (possibles)
(possibles)
sont,
pour ainsi dire,
et
les
en bijection :
il n'y a pas de modes verbaux interrogatif, dubitatif, concessif,
déprécatif, ou minatif,
les
peuples auraient pu en décider
puisque les modes verbaux et les
Peu importe,
autrement.
d'énoncé
ma~s
(ou modes syntaxiques) assument la même
modes
fonction;
ils
peuvent donc être traités sous la même rubrique. Les grammairiens
philosophes
mode
dans
(pas
sont sensibles aux critères morphologiques
une
langue
particulière
sans
une
de
inflexion
caractéristique correspondante); mais dans le cadre d'une théorie
g4n4rale
i dé a t ion ne Il e
fonction
ou
du
sens,
des modes qui se situe au niveau de
ce qui
compte,
"manières" ou "formes de nos pensées"
"modes de pensé e"
(Gregory),
les "modes grammaticaux"
qui
ce
sont
les
la
diverses
(Port-Royal), ou les divers
dépassent largement en
nombre
( syntaxiques ou verbaux). C'est pourquoi
531
les mêmes modes grammaticaux peuvent exprimer différents actes de
pensé e
et
(Gregory) ;
même
c'est
donner
lieu
le contexte,
locuteur et de l'allocutaire,
des
à
usages
l'intonation,
etc.,
par tel ou tel mode.
la
situation
du
qui déterminent en général
quel acte de pensée (ou quelle idée accessoire)
"marqué "
limé taphoriques Il
est effectivement
Il n'est donc pas surprenant
que
plusieurs commentateurs (Julien [1979], Dominicy [1984], Pariente
[1985], Auroux [1986])
aient vu dans la
Grammaire Générale
une
"pragmatique générale".
***
Quels critères d'adéquation une théorie des modes (verbaux
et
syntaxiques)
théorie
devrait-elle
idéationnelle
des
raisonnablement
modes
que
nous
satisfaire?
avons
tenté
La
de
reconstruire les satisfait-elle, et dans quelle mesure?
Dietmar
Zaefferer ("Theorien der Satzmodi", 1984a)
donne
une liste de critères que nous prendrons comme point de départ en
retenant
les
principaux.
Ces
critères
formulent
problèmes qu'une théorie adéquate devrait résoudre.
différents
Une
adéquate des modes d'énoncé d'une langue naturelle L doit,
Zaefferer
<2:5)
532
théorie
selon
CA 1)
sous-catégoriser les énoncés complets (selbst~ntigen )
de L selon les modes d'énoncé de L,
c'est-à-dire,
définir extensionnellement chaque mode d'énoncé
de L
comme sous-ensemble de l'ensemble des énoncés de L.
Elle doit, par suite, tenir compte des phénomènes suivants
CA 1.1) les relations structurelles
("transformations ")
entre les énoncés de L ayant différents modesj
CA 1.2)
les relations structurelles entre les énoncés de L
ayant différents modes et leurs clauses enchâssées
(eingebetteten Entsprechungen) (s'il y a lieu) j
CA 1.3) les rapports syntaxiques entre de telles clauses
enchâssées
(s'il y a lieu)
et les structures enchâssantesj
CA 1.4)
les règles de distribution
(Vorko •• ensbeschrankundes modes d'énoncé ou indicateurs de force illocutoire pour des expressions comme les particules
de négation, particules modales, adverbes d'énoncé,
etc ..
gen)
Une théorie adéquate des modes doit, de plus
CA 2) définir pour chaque mode d'énoncé M de L la signification structurelle de M de telle manière qu'elle
corresponde convenablement à la signification intuitive de Mj
Cette théorie devra tenir compte des phénomènes suivants
CA 2.1)
les ambiguïtés éventuelles des modes de Lj
CA 2.2)
les propriétés logiques des modes de L, de même que
les relations logiques entre eUXj
533
Tous
CA 2.3)
la relation de signification entre les modes de L
et leurs clauses enchâssées (s'il y a lieu);
CA 2.4)
le fait que la signification de telles clauses enchâssées co-détermine la signification des structures enchâssantes.
ces critères valent pour une théorie des modes
une langue particulière.
des
Comme on peut le voir,
critères d'ordre syntaxique,
d'ordre
sémantique.
Zuber (1983,
p. 3)
à
les CA 1 ... sont
et l es CA 2 ... ,
Zaefferer en ajoute un,
attachée
qu'il
des
cri tè res
reprend
de
et qui s'applique cette fois-ci à une théorie
universelle des modes
CA 3)
Une théorie universelle des modes d'énoncé
doit
rendre compte du nombre et de l'identité des modes
d'énoncé possibles.
S. Lappin (1982, p. 559) donne pour sa part deux conditions
d'adéquation que devrait satisfaire une théorie des modes
(i)
Une théorie des modes doit donner une explication systématique et unifiée de la manière suivant laquelle le
mode d'un énoncé " interagit avec le composant véri-conditionnel de sa signification de façon à
fournir une
interprétation complète de l'énoncé;
(ii)
La théorie doit exhiber ce qui est particulier dans la
manière par laquelle chaque mode détermine l'interprétation des énoncés dans lesquels il figure.
(Ma traduction) .
534
On peut trouver encore d'autres critères ,
questions,
Heaning
chez Vanderveken (1988,
and
recoupent
Speech Rets,
plus
pp.
sous formes
8-9 et 38-39;
à paraître en 1989 chez
ou moins les
précédents.
En
et
sémantiques
discours,
comme
introduites
qui
particulier,
une
par la théorie
l'analyticité,
véri-conditionnelles
et
la cohérence
illocutoires,
diverses
des
et
et
dans
C.U.P.)
théorie des modes grammaticaux devrait tenir compte des
notions
de
actes
de
l'implication
caractériser
structure logique de l'ensemble des force illocutoires.
la
Voyons
maintenant dans quelle mesure la théorie idéationnelle des
modes
d'énoncé satisfait ces différents critères.
En ce qui concerne CÀ l,
les grammairiens philosophes sont
pour une large part redevables à la tradition aristotélicienne et
à
sa classification des énoncés.
peut varier d'un grammairien à un autre,
importants
partout
reconnus.
identifiés
ponctuation,
ma1s les types les plus
Les
traits
syntaxiques,
morphologiques
qui
permettent
deI es
dé fin i r
(modes
verbaux,
ordre
des
affixes,
etc.) ,
mais
sont
mots,
Renaissance) .
peut
Àussi,
attendre
intonation,
jamais
leur approche n'est
les définitions des types syntaxiques
des
grammairiens
philosophes
la précision et la rigueur formelle qu'on
535
et
clairement
syntaxique ou morphologique (comme les ramusiens de
purement
d'avoir
d'énoncé
(déclaratif, impératif, interrogatif, exclamatif) sont
phonologiques
l'on
types
Le nombre des
sont
peut
la
que
loin
trouver
chez
un
Montague
suffisaient
(pour
largement
pour
sommaire et intuitive.
reste
le
type
les
déclaratif),
besoins
Reichenbach
traditionnelle"
d'une
elles
classification
La Grammaire Générale classique, comme du
la logique à la même époque,
formelles.
ma1.s
pour
ne sont pas des
critiquait
son
usage
justement
d'une
entreprises
la
"grammaire
logique
vétust e
et
impuissante à résoudre certains problèmes liés à la formalisation
du
"langage
conversationnel".
philosophes
ne
langage objet
guère
le
(c f.,
travail
syntaxique
progrè s
distinguaient
de
la
Auroux,
de
Ajoutons que
pas non plus
1979,
p.
et
Grammaire Générale
( en
est
beaucoup
le
91)
formalisation,
enregi stré s)
les
m01.ns
grammairiens
métalangage
du
ce qui ne facilite
que
la
dépit
composante
des
dé ve l oppé e
quelques
que
sa
composante sémantique.
Pour ce qui est de CA 1.1, les seules relations syntaxiques
entre
les modes envisagées dans la Grammaire Générale
classique
concernent les rapports entre les énoncés non déclaratifs et
énoncés
déclaratifs
et
renvoient en
traditionnelle de "résolution"
procédure n'est pas,
général
à
la
d'Apollonius Dyscole.
me semble-t-il,
fait appel au sens, à la synonymie.
536
les
procédure
Mais cette
purement syntaxique;
elle
Une remarque analogue s'impose dans le cas de CA 1.2 et
1. 3.
La composante syntaxique de la Grammaire Générale est
peu développée pour satisfaire pleinement ces
indique
bien
comment
les
flexions
critères.
verbales
CA
trop
Beauzé e
modifient
la
signification "spécifique" du verbe, mais la
"morpho-sémant ique"
de Beauzée demeure intuitive en comparaison,
par exemple,
celle de H.-H. Lieb
<24>
Dans le cas de CA 1.4, on trouve bien, ici et là,
remarques pertinentes dans la Grammaire Générale,
sur
les
particules
de
négation
et
des verbes relativement aux impératifs
nombre
de
ces
philosophes
la
position
marqueur
avec
remarques
demeure
les
quelques
en particulier
compléments
d'objet
(interdictions) ;
mais le
1 imi té .
Les
grammairiens
ne discutent pratiquement pas de l'occurrence et
de ce que nous pouvons
de force illocutoire",
appeler
c'est-à-dire des
locutions adverbiales comme s'il te pla1t,
des interjections comme Hélas.'
"modificateurs
(cf. ,
adverbes
de
de
ou
franche.ent , etc., ou
Vanderveken, 1988, pp. 23-
24) .
la
Grammaire
Chaque mode se voit
attribuer
Dans le cas des critères d'ordre sémantique,
Générale
une
de
s'en tire un peu mleux.
signification typique qui correspond intuitivement
ses principaux usages littéraux (CA 2 et le critère
537
à
celle
(i i)
de
Lappin) .
Les
principales
( en
Mais
grammairiens philosophes signalent clairement
ambiguïtés pouvant survenir dans l'usage
particulier
pour le subjonctif et
l'impératif )
des
modes
( CA
2,1 ) ,
l' é tude des propri é t é s logiques des modes et des
l ogiques
entre modes
( CA 2.2 ) n'a pas beaucoup
sans
dé faut,
mais
parce que dans le c adre d'une théorie idéationnelle
comme celle de la Grammaire Générale,
modes
relati o ns
progressé,
doute parce que les instruments l ogiques faisaient
surtout
le s
d'une
manière
syntaxiques
satisfaisante
lorsque
le but est
les
mots
ont été associés aux opérations de
des
atteint
ou
traits
l'esprit
qu'ils
sont censés exprimer,
Les
relations
de signification entre les
modes
et
c lauses propositionnelles
(CA 2,3 et CA 2.4 et le critère ( i )
Lappin)
dans la
se
traduisent,
Grammaire
par
Générale,
relations entre les propositions incidentes affectant les
les
de
les
verbes
ou l'affirmation ("Je soutiens que", "Je suppose que", etc, ) , que
nous avons mises sur le même pied que les modes,
l'énoncé
seraient
(la "matière d'un jugement possible")
"déterminat ives Il
plutôt
j
"J'ordonne que S
équivalent à "S ( est +
plo
est
plo
,
ces
Il
Le
qu.e
s'analyse
"Je
"Je donne un ordre qui est
538
serait
tout comme "Je suppose que S
est équivalent à "S ( est + supp,) P",
supposition qui est
(elles
soit pro
dans ces cas-là comme signifiant " une chose qui est"
une
de
incidentes
qu' "explicatives"
affectent la valeur de vérité )
ordre)
et le reste
fais
I l
etc.
Le
comme dan s l' analy s e "para taxique"
qu.e,
de
Davids on,
tient à la fois le rôle d'un pronom et d'une conjonction.
Enfin,
est
le dernier critère mentionné par
largement satisfait par la Grammaire
Zaefferer (CA
Générale,
qui
3)
tente,
comme on l'a vu à quelques reprises, de réduire et d'expliquer le
nombre
et la nature des modes en les rapportant aux
facultés de l'esprit,
judicative,
principales
volitive et émotive.
Mais la
structure logique de l'ensemble des actes de pensée n'est
jamais
rigoureusement
points
fondamentaux
dé fini e,
alors
que
c'est
un
des
de la théorie des actes de discours qui
donne
une
définition récursive de l'ensemble des forces illocutoires.
Somme
prisonniers
néanmoins
l'étude
toute,
d'un
sérieuse
ne
philosophes
à
des
ébranler;
familles
commencera
malgré
de
leur
langues
qu'avec le déclin
autres
de
la
progresse
faiblesse de la logique qu'ils
resté s
qu'ils
bonne
Générale qui n'a pu alors réajuster ses concepts
plus,
sont
cadre (la grammaire gréco-latine)
contribué
europé ennes
les grammairiens
la
volonté,
qu'indoGrammaire
thé oriques .
utilisaient,
a
philosophes ont proposé des analyses des
539
pu
Mais en dépit
de ces contraintes et limitations inévitables pour l'époque,
grammairiens
De
laquelle
beaucoup moins que la Grammaire à cette époque,
être un frein au progrès de la Grammaire Générale.
ont
faits
les
de
langue qui
anticipent parfois les nôtres d'une façon
mais comme l'écrit S.
Àuroux
étonnante;
"Jusqu'à ce qu'on s'intéresse
à
l'énonciation, les théories de Port-Royal étaient plus puissantes
que celles dont on disposait"
<2:5)
ce n'est donc peut-être
pas
si étonnant après tout ...
Les
modes
grammaticaux,
dans
la
Grammaire
Générale,
marquent les forces illocutoires les plus importantes et les plus
fréquemment utilisées;
ils déterminent si l'usage littéral
énoncé doit compter comme
expression
de
souhait,
affirmation,
etc.
Mais le mode ne
géné raI,
une
exemple,
il n'indique pas si une
une
force d'un caractère
prédiction
ou
un reportage,
impérative exprime une concession,
une
d'une
prière.
question,
d'ajustement;
complexe;
en
par
affirmation est un témoignage,
ou
s~
l'usage
d'une
phrase
un ordre, un commandement, ou
et par le fait même
sa
direction
mais ils laissent indéterminés certains paramètres
illocutoires
(le mode d'accomplissement du but
conditions
préparatoires,
propositionnel
discuter
pas,
Les modes déterminent avant tout le but illocutoire
énonciation littérale,
sincéri té)
commandement,
marque
relativement
d'un
et
le
les
degré
de
conditions
puissance
illocutoire,
sur
des
le
les
cont enu
conditions
de
Ce qui n'empêche pas les grammairiens philosophes de
à
l'occasion
de
ces
autres
paramètres,
l'identification est renvoyée au contexte d'énonciation,
d'aborder des
questions
relatives
540
à la
pragmatique des
dont
et même
modes
(comme l'a fait Gregory).
constitue
peut,
donc
La
théorie générale des modes verbaux
un véritable embryon de théorie
en dépit de ses lacunes et limites,
illocutoire
être considérée comme
le digne ancêtre des théories actuelles de l'énonciation.
***
541
et
NOTES
0 ) John Searle,
Speech Rcts,
Cambridge,
C. U. P., p. 122
"the
illocutionary force
indicating device operates
on a
neutral
predicate expression to determine a certain mode in which the
question of the truth of the predicate expression is raised visà-vis the object referred to by the subject
expression".
L'acte
de référence est un acte "autonome"
(a
separate speech act )
relativement à l'acte illocutoire (la force ne l'affecte pas),
contrairement à l'acte de prédication qui n'est pas autonome et
est
directement
affecté
par
la
force
illocutoire
de
l'énonciation.
(2)
C'est en fait l'opposition indicatif-subjonctif,
davantage
que le subjonctif lui-même (qui marque la subordination), qui est
ambiguë;
par exemple,
l'opposition de "Il vient"
et "Qu'il
vienne!" n'est pas du même ordre que l'opposition entre "Je
cherche une maison qui a un jardin" et "Je cherche une maison qui
ait un jardin".
La première opposition dépend de la position du
locuteur et de
la direction d'ajustement
(assertion-ordre),
tandis que la seconde dépend des quantificateurs utilisés et ne
marque pas différentes forces illocutoires. L'usage du subjonctif
relativement à
la quantification ne fut pas
examiné par les
grammariens
philosophes;
les choses
eussent peut-être
été
différentes s'ils avaient disposé d'une autre "logique" .
(3)
Il
est remarquable que Destutt
appelle
les
temps
conditionnels des "imparfaits des temps à venir"
(Sra •• aire,
p.
210);
Guillaume
0971,
p.
139),
en comparant
"J'aimais""J 'aimerais ";
"Tu aimais"-"Tu aimerais",
etc.,
conclut que
"[1] 'imparfait,
c'est le futur
hypothétique moins le -r- du
futur: j'ai.e(r)ais
> j'ai.(e)ais > j'ai.ais".
(4)
Cf.,
par exemple,
Th~orie
globale des
descriptions
linguistiques ,
de Katz et Postal,
Paris,
Mame,
1973 (pour
la
traduction),
en particulier pp.
119-120
"On fait l'hypothèse
que ces phrases impératives ([5] "Go home!", [7] "Eat the meat! ")
sont dérivées d'IS (indic ateurs syntagmatiques)
sous-jacents aux
phrases déclaratives du type
[9] You will go ho.e
[10] You
will eat the .eat.. .
etc.
par une transformation qui efface le
constituant auxiliaire et supprime optionnellement
le syntagme
nominal sujet." Voir aussi J.J. Katz, La philosophie du langage,
Paris,
Payot,
1971 (1966 pour l'original anglais chez Harper &
Row) ,
pp.
118-119. Selon J.R. Ross, "On Declarative Sentences",
542
dans Readings in English Transfor.ational Gra •• ar, éd.
par R.A.
Jacobs
et P.S. Rosenbaum,
Walthan (Mass. ) ,
Ginn & Co.,
197 0 ,
c'est
un
performatif
abstrait qui
est
effacé
par
la
transformation.
(5 ) Cf., Vanderveken , 1988, op. cit.,
p.
152.
( 6) Cf.,
R.
Zuber,
Non-Declarative Sentences,
Amsterdam , J ohn
Benjamins Publishing Company,
1983,
p.
7 : "The intensi o nality
( or opacity ) of t he operator making up the c omplex e xpression 1S
manifested by the
imp o ssibility of replacing the
argument
expression of the c omplex expression by a semantically equi v alent
argument
expression without inducing a change in the semanti c
v alue of the whole expression."
(7 )
H.
Steinthal,
Gra •• atik,
Logik und Psychologie,
ihre
Prinzipien und ihr ~erhaltnis zueinander,
Hildesheim, Georg Olms
Verlagsbuchhandlung,
1968 ( reproduction de l'édition de 1855)
"Die wichtigste logische Eintheilung der Urtheile ist die nach
der Qualitât
in b e j a h e n d e und v e r n e i n end e.
Die Grammatik kennt diesen Unterschied nicht" (p. 175 ) .
p.
176
"Geh .'
schreib.'
sind keine Urtheile, aber
( 8) Ibid.,
doch nothwendig Sâtze".
Selon Jespersen ( 1924 ) , des grammairiens
allemands du début du XIX- siècle ont tenté de systématiser les
modes en les associant aux modalités Wolffiennes et Kantiennes et
dans ce cadre,
l'impératif correspondrait à
la "nécessité
subjective".
( 9)
Ibid.,
p.
178
"insofern aber der Zwecksatz an sich
betrachtet wird,
abgelëst von der Person oder Thatsache, enthâlt
er, wie der Wunsch, weder Wahres oder Falsches, ist folglich kein
Urtheil".
(10)
Josef Schâchter (1935) Prolego.ena to a Critical Gra •• ar,
(Prolego.ena zu einer kritischen Gra •• atik,
trad.
angl.
de F.
Foulkes, avec l'introd. de l'éditeur Moritz Schlick,
Dordrecht,
Reidel,
1973,
Part Two,
chap.
III
"Kinds
of Sentences".
Schâchter analyse les phrases
(élémentaires)
"indicatives" ,
"subjonctives", "causales" ( avec parce que), les énoncés à propos
des fins et des motifs,
les phrases interrogatives, dubitatives,
impératives,
optatives,
les conseils
(advices) , les phrases
négatives,
existentielles
( Il
y a
... ),
et relationnelles
( suivant le théorie des relations de Russell),
qu'il fait suivre
d'une théorie de la copule.
( 11 ) Hermann Paul,
Principles of the History of Language
543
( trad .
angl.
des Prinzipien der Sprachgeschichte,
selon la seconde
édition de 1890),
College Park (Maryland),
McGrath Publishing
Company, 1970, chap. VI.
( 12 ) Otto Jespersen,
La Philosophie de la gra •• aire ( trad fr. de
The
Philosophy of Gra •• ar,
Londres,
George Allen & Unwin Ltd,
1924),
Paris,
Ed.
de Minuit,
1971, chap.
XXIII. Jespersen
présente aussi,
chap.
XXII, une classification des énoncés qui
s'inspire largement
de celle de Brugmannj
nous n'avons pu
consulter l'oeuvre de Brugmann sur ce point.
(13 ) Cf., Paul Laurendeau,
"Jespersen et l'imposture des parties
du discours",
dans Histoire.
Epist~.ologie.
Langage,
VIII-I
(1986), p.
142
"L'idée que l'on se fait
spontanément du
linguiste
Jespersen est celle d'un précurseur
des
idées
fondamentales de la linguistique contemporaine.
Or en réalité ce
grammairien ter.ine,
épistémologiquement parlant
s'entend,
le
XIX- siècle bien plus qu'il n'annonce le XX_II.
( 14)
W.
D.
Whitney,
Language and the Study of Language,
réimpression selon la 6~·m- édition de 1901, New York, AMS Press,
1971, pp.
268 et sui v.; par exempl e
"Moods were added by
degrees : a conjunctive,
having for its sign a
union-vowel,
a,
interposed betweem root and endings,
and bearing perhaps a
symbolical meaningj
and an optative,
of which the sign is i or
ia in the same position, best explained as a verbal root, meaning
, wish, des ire'.
From this optative descends the "subjunctive" of
aIl the Germanic dialects" (p. 268).
(15) R,
Jakobson, "Les embrayeurs, les catégories verbales et le
verbe russe", chap. 9 des Essais de linguistique g~n~rale, Paris,
Editions de Minuit, 1963.
(16)
Cette idée d'opposition a
transformé
radicalement
les
théories idéationnelles du langage; si les idées ou concepts sont
toujours les significations des mots dans le structuralisme,
les
significations ne se déterminent plus isolément,
mais dans
les
oppositions mutuelles entre les termes concurrents qui s'alignent
sur le même paradigme (axe de sélection)
"En réalité,
l'idée
appelle,
non une forme,
mais tout un système latent,
grâce
auquel
on obtient les oppositions nécessaires à la constitution
du signe.
Celui-ci n'aurait par lui-même aucune signification
propre"
(de Saussure, Cours de linguistique g~n~rale,
op. cit.,
p. 179).
(17) A.
Meillet,
indo-europ~ennes
Introduction ~ l'~tude co.parative des langues
University of Alabama Press,
1964, p.
( 1903),
223.
544
(18)
Louis Hjelmslev,
Principes de gra •• aire g~n~rale,
1. r édition, 1928, 2 ~.~- édition, 1968, Copenhague, Kommissionnaer
Munksgaardj
l'auteur affirme dès le départ que "[l]a grammaire
générale est une science nouvelle.
Elle n'a encore ni principe
constant ni méthode assurée.
Une théorie grammaticale est encore
inexistante". ..
(p.
3).
Plus
loin,
il par l e des lois de la
logique aristotélicienne c omme de lois "impératives";
elles
"sont
semblables aux lois
sociales en ce
qu'elles
sont
impératives" (pp.
19-20) ,
et réclame une "logique descriptive "
(plutôt qu' "impérative",
"normative" et a priori ) qui serait une
partie de la psychologie.
"Les faits grammaticaux sont des faits
psychologiques" (p. 25); "[l]a grammaire étant par définition une
branche de
la psychologie" (p.
26).
Dans le Chap . III
"La
catégorie grammaticale",
il
explique que le verbe est une
"catégorie fonctionnelle",
ou plutôt "un groupe de catégories
d'une variété quasi infinie" (pp.
205-206).
Dans
l'énumération
qu'il donne des "sous-catégories",
on retrouve "les verbes
d'affirmation absolue et d'affirmation conditionnelle" (p.
206),
à côté des verbes actifs,
passifs,
causatifs,
désidératifs,
intensifs, itératifs, fréquentatifs, momentanés, verbes négatifs,
impossibles,
verbes d'état,
verbes potentiels, relatifs, verbes
de spontanéité,
de simultanéité,
de proximité,
d'éloignement,
verbes indiquant la direction de l'action,
etc.,
etc.
L'auteur
ajoute que ces catégories ne sont pas toutes réalisées dans tous
les états de langue.
Plus loin encore il prend sérieusement
ses
distances
vis-à-vis
de
la
"grammaire
traditionnelle",
applaudissant
les critiques que lui adressait Meillet
sur "la
place donnée par la grammaire traditionnelle à l'impératif,
dans
le système du verbe.
L'impératif est au fond,
du moins dans
quelques
langues,
la forme essentielle du verbe;
le système
traditionnel ne lui donne donc pas la place qui lui revient.
A
notre connaissance,
le grammairien danois Peder Syv est le seul
qui ait placé l'impératif en t~te du système du verbe. Le système
de la grammaire traditionnelle a été trop fort pour qu'il ait pu
avoir des successeurs" (p.
249).
Mentionnons tout de m~me que
Leibniz,
Court de Gébelin et quelques autres à l'âge classique
étaient d'avis que l'impératif des verbes devait ~tre la forme
la plus primitive du verbe,
parce que l'impératif du verbe est
presque partout monosyllabique et il constitue de ce fait
le
radical sur lequel
se grefferont
les morphèmes des autres
flexions verbales.
Il prend encore ses distances vis-à-vis de la
méthodologie traditionnelle en critiquant Brugmann (pp. 309-310),
parce celui-ci
"voit la différence essentielle entre le verbe
fini et le verbe infini dans la flexion personnelle.
Cela semble
~tre un résultat typique de sa méthode,
qui consiste à se borner
aux anciennes langues du groupe indo-europé en"
(p.
309); page
suivante
"[m]ais ce qui rend impossible d'adopter le critérium
de Brugmann,
c'est qu'il y a quantité
de langues non-indoeuropéennes
où le nom ordinaire se pr~te à
une flexion de
personne" (Hjelmslev mentionne le finno-ougrien) .
545
(19)
B.
Russell,
Signification et v~rit~
(1940),
Paris,
Flammarion,
1969
(trad.
fr.
de Rn Inquiry into Heaning and
Truth) .
( 20)
Hans Reichenbach,
Ele.ents of Sy.bolic Logic
(1947),
New
York,
The Free Press,
1966;
section 57
"Logical terms in a
pragmatic capacity".Voir aussi W. E. McMahon, Hans Reichenbach's
Philosophy of Gra •• ar, . La Haye-Paris, Mouton, 1976; pp. 216-223
pour l'analyse des "termes pragmatiques" de Reichenbach.
McMahon
présente Reichenbach comme un " universal gra •• arian " dans le sens
traditionnel de l'expression.
Il aurait renouvelé la Grammaire
Universelle en adoptant une nouvelle logique qui reconnaît
l'existence des relations,
et en faisant usage de la notion
russellienne de "fonction propositionnelle"
et de la distinction
frégéenne fonction/argument,
qui aurait manqué
grandement à la
Grammaire Générale classique.
(21) Cf.,
D.I. Slobin et A.A. Aksu, "Tense, Aspect, and Modality
l.n the Use of the Turkish Evidential",
dans
Tense-Rspect :
Between Se.antics & Prag.atics,
éd.
par Paul J.
Hopper,
Amsterdam/Philadelphie,
John Benjamins Company, 1982; les formes
en -.ish seraient avant tout destinées à marquer l'expérience
indirecte,
par opposition aux
formes
en - di
qui
marquent
l'expérience directe;
ainsi,
"Kemal gel -di"
("Kémal
est
venu") signifie que le locuteur a rencontré Kémal "en chair et en
os" (expérience directe), tandis que "Kemal gel -mish" (également
"Kémal est venu") signifie que le locuteur a inféré la venue de
Kémal à partir de certains signes,
ou qu'on lui a
rapporté
la
venue de Kémal (expérience indirecte);
dans certains cas,
les
formes
en - .ish s'emploient aussi pour marquer la surprise.
L'interprétation de Reichenbach se justifie dans la mesure où
l'expérie"n ce indirecte n'est jamais "certaine" et n'est souvent
que "probable" .
(22)
On ne doit cependant pas né gl iger l es
"dé clara t ions
programmatiques";
ainsi,
même si Montague s'est limité à
la
reconstruction de fragments déclaratifs de l'anglais comme les
philosophes du courant logique dont il s'inspire largement,
il
signale néanmoins,
dans
"The Proper Treatment of Quantification
in Ordinary English"
(cf ., R. Montague, For.al Philosophy, éd.
par R.
Thomason, New Haven, Yale University Press, 1974, p. 248,
note
3)
que les conditions de vérité
et
d'implication
(entail.ent)
sont inappropriées pour les énoncés
impératifs et
interrogatifs et qu'il faudrait les remplacer par des conditions
de "satisfaction" ( fulfil.ent conditions ) et une caractérisation
du contenu sémantique d'une réponse correcte.
Zaefferer & G.
Grewendorf,
"Theorien der Satzmodi",
(23)
D.
Wunderlich et A.
von
article du manuel Se.antik édité par D.
manuscrit daté de juin 1984.
J'ai traduit du mieux que
Stechow;
546
j'aie pu les critères recensés par Zaefferer.
(24)
Cf .,
par exemple,
Hans-Heinrich Lieb,
"Principles of
Semantics",
dans Syntax and Se.antics (vol.
10), Academic Press
Inc.,
1979,
pp.
353-378;
en particulier la section 2 sur les
"significations morphologiques". L'approche de Lieb demeure assez
tradi tionnelle ("perhaps shockingly SOli - - p.
359), en proposant
une conception psychologique des significations morphologiques,
mais
elle s'en écarte en utilisant les ressources de la théorie
des modèles à la manière de Montague .
(25)
S.
Auroux,
"L'histoire de la linguistique",
fran ç ai s e , déc. 1980, p. 9.
***
547
dans
Langu.e
BIBLIOGRAPHIE
Aarsleff,
(1967):
The Study of Language in England,
1860, Princeton, Princeton U. Press.
H.
1780-
(1970) : "The History of Linguistics and Professor
Chomsky", dans Language , XLVI, pp. 570-585;
aussi
dans Fro. Locke to Saussure.
(1974): "The Tradition of Condillac : The Problem of
the Origin of Language in the Eighteenth Century
and the Debate in the Berlin Academy before Herder",
dans Dell Hymes (dir.)
Studies in the History of
Linguistics.
Traditions and Paradigms,
Bloomington
et Londres,
Indiana University Press,
1974; aussi
dans Fro. Locke to Saussure.
(1977):
"Wilhelm von Humboldt and the Linguistic
Thought of the French Id4010gues " , d'abord en
français dans Joly et Stéfanini
(1977),
puis
repris en anglais dans Fro. Locke to Saussure.
(1982) : Fro. Locke to Saussure,
Minnesota Press.
Agassi,
J.
(19 63):
Minneapolis, U. of
TONards a Historiography of Science, La Haye,
Mouton.
Aksu,
A.A.
(1975)
Science in flux,
(1981)
Science and Society, Dordrecht, Reidel.
Dordrecht, Reidel.
et Slobin, D.l. (1982): "Tense, Aspect, and Modality
in the Use of the Turkish Evidential",
dans TenseRspect:
BetNeen Se.antics & Prag.atics,
éd. par
P.J.
Hopper, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins
Publishing Company, pp. 187-200.
548
Alston, W.
(1964):
The Philosophy of Language, Englewood Cliffs,
Prentice-Hall.
Andresen,
J.T. (1978): "François Thurot and the First History of
Grammar", in Historiographia linguistica, V:1/2.
Aristote
De l' Interprétati on,
Paris, Vrin.
(1966):
Tricot,
Poétique,
Lettres.
(1971):
Arnauld,
trad.
et notes
de
J.
(trad. de Hardy), Paris, Les Belles
A.
et
Lancelot,
C.
(1660):
Gra •• aire générale et
raisonnée,
éd.
critique de H.
Brekle,
impression en
facsimilé de la troisième édition de
1676,
StuttgartBad Cannstatt, chez Friedrich Frommann, 1966.
et Nicole,
P.
(1662):
La Logique ou l'art de penser,
Paris, Flammarion, 1970.
Augustin
Auroux,
(1964)
S.
Les Confessions,
Paris, Garnier-Flammarion.
(1973):
L'Encyclopédie.
"Gra •• aire" et "Langue" au
siècle, Paris, Marne.
X~III'
(1973):
"Le
rationalisme empiriste",
XII/3, pp. 475-505.
(1979)
La Sé.iotique des Encyclopédistes,
(1980):
"L'histoire
françai se, dé c ..
(1985)
chap.
dans
de la
Dialogue,
Paris, Payot.
linguistique",
in
Langue
"Le temps verbal dans la Grammaire Générale",
1 de Innovation et systè.e, manuscrit.
(1986): "Act es de pensé e et act es l ingui st iques dans la
Grammaire
Générale",
1n Histoire.
Episté.ologie.
Langage, VIII:2.
(1987)
"Le rationalisme et l'analyse
549
linguistique",
Cahiers d'épisté.ologie,
UQAM, no. 8710.
et Rosier,
I.
conception
(1987):
"Les sources historiques de la
des deux types de relatives",
dans
Langages, no. 88, déc. 1987.
Austin,
(1962) : How to Do Things
Clarendon Press.
J.L.
Bartlett,
B.E.
with
Uords,
Oxford,
( !975): Beauzée's Gra •• aire Générale. Theoryand
La Haye,
Mouton.
Methodology,
(1980):
"Les rapports entre la structure profonde et
l'énoncé au XVIII- siècle", Langages, déc. 1980.
Beattie, J.
(1783): The Theory of Language, Londres, re ~mpression
en facsimilé, Menston, Scolar Press, 1968.
(1790):
Ele.ents of Moral Sciences,
reproduction en
facsimilé
avec une "Introduction" de James Irvine,
Scholars Facsimiles &t Reprints,
Delmar,
New York,
1976.
Beauzé e,
N.
(1767): Gra •• aire générale , ou Exposition raisonnée
des éléments nécessaires du Langage pour servir de
fondement
à
l'étude de toutes les langues, 2 vols.,
Paris, Bardou.
art. "Proposition", dans l'Encyclopédie (voir plus bas
Diderot & D'Alembert)
art. "Mode" ;
art. "Indicatif";
art. "Impéra tif" ;
art. "Optatif";
art. "Interjection";
art. "Interrogatif";
art. "Préposition";
art. "Synonyme";
550
art. "Langue";
art. "Grammaire";
et
Marmontel,
et al., art.
Benveniste, E. (1966):
Gallimard.
Bergheaud,
P.
Berkeley,
art. "Traduction".
' 'Mé t h ode" .
Probl~.es
de linguistique générale,
Paris,
(1979): "De James Harri s à John Horne Tooke", dans
Historiographia linguistica, VI:1, pp. 15-45.
G.
( 1710 ) : Traité sur les Principes de la connaissance
trad.
et notes de A.
Leroy, Paris, Aubier,
éd. Montaigne, 1969.
hu.aine,
Black, M.
B1aug,
(1962): "Metaphor", dans !fodel sand Ifetaphors,
Cornell University Press, 1962.
Ithaca .
(1975 ) : "Kuhn versus Lakatos,
or Paradigms versus
Research Programmes in the History of Economics" ,
Historyof Political
Econo.y,
7,
pp.
399-419;
aussi dans Paradig.s & Revolutions, éd. par G.
Gutting,
Notre Dame,
University of Notre Dame
Pres s, 1980.
M.
Bouveresse, J. (1978): "La linguistique cartésienne: Grandeur et
décadence d'un mythe", dans Critique, fasc. 384.
Bréal,
M.
Bréhier, E.
de
sé.antique.
Science
des
(1897) :
Essai
significations, Genève, Slatkine Reprints, 1976.
(1930 et 1938): Histoire de la philosophie, II/XVII-XVIII- siècles, Paris, PUF, 1981 (nouvelle édition ) .
Brosses,
le Président Charles de (1765):
Buffier,
C.
(1709): Gra •• aire
françoise sur un plan nouveau,
Paris,
chez Nicholas Le Clerc, Michel Brunet, Leconte
Traité de la for.ation
.échanique des langues et des principes physiques de
l'éty.ologie, Paris, chez Saillant.
551
& Montalant.
(1732) : Cours de sciences sur des principes nouveaux et
si.ples, Paris, chez G. Cavelier et P.-F. Giffart.
Burnett,
J .
(Lord
Monboddo),
(1773-1792) : Of the Origin and
6 vols. [1773, vol. Ij
II], Menston, Scolar Press, 1967.
Progress of Language , Edinburgh,
1774, vol.
Bursill-Hall,
G.L.
(1971):
Speculative Gra •• ar of the Ifiddle
The Doctrine of partes orationis
of the
Modistae, La Haye-Paris, éd. Mouton.
~ges.
Cassirer,
E.
(1923): La Philosophie des for.es sy.boliques, Tome
l, Paris, Ed. de Minuit, 1972.
(1932):
La Philosophie des Lu.i.res, Paris, Fayard,
(trad. P. Quillet), 1970.
Chaunu,
(1971):
La civilisation de
Paris, Flammarion, 1982.
P.
--------- et M. Arrivé
------
des
Lu.i.res,
J.-C. (1968): Histoire de la syntaxe. Naissance de la
notion de complément dans
la grammaire française
(1530-1750), Genève, Droz.
Chevalier,
Chomsky,
l~Europe
N.
(1970)
La Gra •• aire, Paris, Klincksieck.
(1966): Cartesian Linguistics . A Chapter in the
History of Rationalist Thought,
New York et Londres,
Harper & Rowj
La linguistique cart~sienne,
suivi de
La Hature for.elle du langage, trad. de N. Delanoë et
D. Sperber, Paris, Seuil, 1969.
(1965): ~spects de la th~orie syntaxique, Paris, Edit.
du Seui l, 1971 (pour la trad. fr.).
Chouillet,
J . (1976): "Descartes et le problème de l'origine des
langues au XVIII- siècle", IV.
Condillac
(1947-1951) : Oeuvres philosophiques,
Tome XXXIII du
Corpus général des philosophes
français,
en trois
552
vols., texte établi et présenté par G. Le Roy, Paris,
P.U.F . .
(1746) :
Essai
sur
Il ori gi ne des
connoi ssances
hu.aines, Tome l des Oeuvres philosophiques (1947);
(1749): Trai t~ des systt.es, Tome l des Oeuvres . .. ,
(1947) ;
--------
(1754)
Trait~
des sensations, Tome l
(1755)
Trait~
des ani.aux, Tome l
(1947);
(1775)
Pr~cis
(1775)
Gra •• aire, Tome l
(1775)
De llart
(1775)
De llart de raisonner, Tome l
(1775)
De llart de penser, Tome l
(1775)
des leçons
dl~crire,
(1947);
pr~li.inaires,
Tome l
(1947);
(1947);
Tome l
Cours dlhistoire
(1947);
(1947);
(1947);
Histoire ancienne, Tome II
(1948) ;
Cornulier,
(1780)
La logique, Tome II
(1798)
La langue des calculs, Tome II
(1951)
Dictionnaire des synony.es, Tome III.
B.
de (1985)
Minuit.
(1948);
Effets de sens,
Court de Gébel in,
(1948);
Paris,
Editions
de
À.
(1774): Honde pri.i ti f, anal ys~ et co.par~
avec le .onde .oderne,
consid~r~ dans llhistoire naturelle de la parole,
ou Gra •• aire Universelle et
co.parative,
Paris,
chez Boudet,
Valleyre,
Veuve
553
Duchesne, Saugrain Ruault.
Cordemoy,
G.
de
(1666):
Discours physique de
la
parole,
ln
Oeuvres philosophiques,
éd.
critique par P. Clair et
F. Girbal, Paris, P.U.F., 1968.
Davidson,
D.
(1976):
"Moods and Performances",
in A. Margalit
(éd.), Heaning and Use, Dordrecht, Reidel, pp. 9-20.
(1967):
"The Logical Form of Action Sentences", dans
Rescher
(dir.)
The Logic of Decision and Iktion,
Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
(1969):
"On Saying Tha t" ,
1969), pp. 130-146.
D'Alembert, J. L.
dans Synth,se,
19 (1968-
: "Eloge de Du Marsais", dans les Oeuvres de Du
Paris, Imprimerie Pougin, 1797.
Marsais,
Descartes,
R.
(163 7): Discours de la .éthode, Introd.
de E. Gilson, Paris, Vrin, 1966.
(1641)
1974.
Méditations
(164 4):
Principes
philosophiques de
.étaphysiques,
et notes
Paris,
P.U.F.,
in
III,
Oeuvres
de
Philosophie,
Descartes,
Tome
Garnier
Frères, Paris, 1973.
(1649):
1969.
Les passions de
l~~.e,
Paris,
Gallimard,
(1701):
R.gles pour la direction de l~esprit,
dans
les Oeuvres philosophiques de Descartes,
Paris,
Garnier Frères, 1963.
Destutt de Tracy,
A.
(1803):
Idéologie propre.ent dite, Tome 1
des Elé.ens d~Idéologie, Paris, Vrin, 1970.
(1803): Gra ••• ire, Tome 2
Paris, Vrin, 1970.
554
des
Elé.ens
d~Idéologie,
Diderot,
D.
(1751): "Lettre sur les sourds et muets à l'usage de
ceux qui
entendent et qui parlent",
dans
les
Oeuvres co.plètes de Diderot ,
éd. par J. Assézat,
Paris,
Garnier Frères,
1875 ( Kraus Reprint Ltd,
Nendeln, Liechtenstein, 1966.
et d'Alembert
(1751):
Encyclop~die,
ou Dictionnaire
raisonnée des sciences,
des arts et des métiers;
édition conforme à
celle de Pellet in quarto ,
à
Berne
et
Lausanne,
chez
Les
Sociétés
Typographiques,
1780.
Tous les articles utilisés
proviennent de cette édition.
Je n'ai pas indiqué
la pagination pour les passages cités,
puisqu'elle
change d'une édition à l'autre,
les passages cités
pouvant
être aisément retrouvés dans
quelque
édition que ce soit.
(1751)
art. "Encyclopédie", dans
(Anonyme), l'art. "Raison" de l'
Dik,
c.
S.
Donzé,
Droixhe,
Encyclop~die.
(1973):
"Sorne Remarks
on the Notion
'Universal
Semantics' I l ,
dans
Logic,
Hethodology,
and
Philosophy of Science,
éd.
par Suppes,
Henkin,
Joja, Moisil, Amsterdam, North-Holland.
M.
Dominicy,
l'Encyclop~die.
(1984) : La Naissance de la
Bruxelles, Pierre Mardaga.
(1967):
La Gra •• aire g~n~rale et
Royal, Berne, Francke.
R.
D.
Duchesneau,
gra •• aire
raisonn~e
.oderne,
de Port-
(1978):
La linguistique et l'appel de l'histoire,
(1600-1800), Genève-Paris, Librairie Droz.
F.
(1973):
L'e.piris.e de Locke, La Haye, Martinus
Nijhoff.
(1982) : La Physiologie des Lu.ières. Empirisme,
modèles et théories. La Haye, Martinus Nijhoff.
Ducrot, O. et Todorov, T. (1972): Dictionnaire encyclop~dique des
sciences du langage, Paris, Editions du Seuil.
555
Du Marsais,
C.C. (1730):
Trait~ des Tropes,
Commerc e, 1977.
Paris, Ed. Nouveau
(1729): Les v~ritables principes de la gra •• aire, ou,
Houvellegra •• aire raisonn~e pour apprendre la langue
latine,
dans
les Oeuvres de Du Marsais,
Paris,
Imprimerie Pougin, Tome I, 1797.
(1769): Logique et Principes de Gra •• aire, Paris, éd.
par Etienne-François Drouet
(oeuvres publiées à
titre posthume).
(1797) : Oeuvres
Pougin.
de
Du
Marsais,
Paris,
Imprimerie
Frag.ents sur le causes de la
parole,
dans Varia
linguistica de C. Porset, Bordeaux, Ducros, 1970.
"Lettre d'une jeune demoiselle à l'auteur des Vrais
principes de la langue françoise",
dans les Oeuvres
de Du Marsais, Tome III, Paris, Pougin, 1797.
---------
art. "Construction"
---------
art. "Accident";
---------
art. "Adjectif";
---------
art. "Conjonctif";
---------
art. "Conjugaison;
---------
art. "Déclinaison" ;
---------
art. "Enallage";
---------
art. "Fini".
Elster, J.
Feyerabend,
(1979)
P.K.
Ulysses and
(1984):
de
th~
l'Encyclop~die;
Sirens. Cambridge: C.U.P ..
"Philosophy
of Science
2001",
dans
Methodology, Hetaphysics and the History of Science,
éd. par R. Cohen et M. Wartofsky, Dordrecht, Reidel,
1984.
556
Flora,
V.
(1980): "Existe-t-il un mode présomptif en roumain?",
in Langage et psycho.~canique du langage
(pour Roch
Valin), éd. par A. Joly et W. Hirtle, Lille, Presses
de l'U. de Lille.
Fontanier, P.
( 1830)
1977 .
Formigari, L.
(1985): "Le way of ideas et le langage moral", dans
Histoire. Epist~.ologie. Langage , VII-2.
Foucault, M.
(1966)
Les figures du discours , Paris, Flammarion,
Les .ots et les choses, Paris, Gallimard.
(1967):
"La grammaire
Langages, 7, pp. 7-15.
Frege,
G.
(1960)
Port-Royal",
~~rit~
et
H~thode,
Paris, Seuil, 1976.
G.
(1747):
Les ~~ritables Principes de la langue
françoise, ou la parole réduite en méthode conformément
aux loix de l'usage,
en seize discours,
(avec une
"Introduction" de P. Swiggers), Genève, Droz, 1982.
Greenberg,
J.H.
(1963)
"Sorne Universals of Grammar with
Particular Reference to the Order of Meaningful
Elements",
dans Universals of Language,
(éd . par
J.H.
Greenberg,
Cambridge (Mass.), M.I.T. Press;
2- édition: 1966.
J.
(1790): Theory 0 f the Ifoods
0 f
~erbs ,
dans les
Transactions of the Royal Society of Edinburgh.
H.P.
(1975): "Logic and Conversation", in P. Cole et J.L.
Morgan
(éd.),
Syntax and Se.antics,
vol.
3,
Academic Press.
Gregory,
Grice,
de
(1879-1925) : Ecrits logiques et philosophiques, Paris,
Editions du Seuil, trad. fr., C. Imbert, 1971.
Gadamer, G.
Girard .
générale
Grimsley,
R.
(dir.) (1971):
Sur l" Ori gi ne du langage , Genève,
Droz, avec une "Introduction" de Grimsley.
557
Guillaume, G.
(1929)
Te.ps et verbe,
Leçons de linguistique de Gustave Guillau.e
(1971):
1948-1949,
Laval.
Harnois,
G.
Paris, Champion, 1965.
Québec,
Les
Presses
de
:
l'Université
(1929): Les théories du langage en France, de 1660 à
Société d'Edition "Les Belles Lettres".
1821, Paris,
Harris,
J.
Harsanyi,
(1751):
Her.ès, ou Recherches philosophiques sur la
grammaire universelle,
trad.
et Remarques de F.
Thurot (1796),
éd.
par A,
Joly avec une Introd.,
Genève-Paris, Droz, 1972.
(1976):
"Advances
Behavior",
dans
J.C.
Behavior,
and
in
Understanding
Rational
Essays
on Ethics,
Social
Scientific
Explanation,
Dordrecht/Boston, Reidel.
Hasard,
P.
La crise de la conscience européenne,
(1961):
1715,
2,
(première
Gallimard, 1969.
R.
Hausser,
Heidegger,
édi t.
Arthème
1680-
Fayard),
R.
(1980):
"Surface Compositionality and
Semantics of Mood",
dans Speech Ikt Theory
Prag.atics, Dordrecht, Reidel.
M.
(1952):
the
and
Paris,
Introduction à la .étaphysique,
Gallimard, 1967.
Herder,
Traité sur l'origine de la langue,
(1770):
J.G.
Paris,
Aubier-Montaigne, 1977.
Hjelmslev,
Huddleston,
L.
R.
Principes de gra •• aire générale, seconde
édition, Copenhague, Kommissionaer : Munksgaard,
1968,
(1928):
D.
(1971):
The
Sentence in
Hritten
English,
Cambridge, C.U.P ..
Hume,
D.
(1748) :
trad.
1947.
Montaigne,
Enqultte sur l' entende.ent
Leroy, Paris, Aubier, Editions
558
hu.ai n,
A.
Husserl,
Hymes,
E.
D.
Imbert,
(1974 ) : Studies in the History of Linguistics.
Traditi o ns and Paradigms,
Bloomington et Londres, Indiana University Press.
C.
Jakobson,
(1982 ) : "Port-Royal et la géométrie des modalités
subjectives",
dans Le te.ps de la r4flexion, III,
pp. 307-335.
R.
Jaucourt, L.
Jespersen,
Joly,
(1901):
Recherches
logiques,
Tome Second,
"La
différence entre les significations indépendantes
et les significations dépendantes, et l'idée de la
grammaire pure
( trad, fr.
de H. Elie ) ,
Paris,
P.U.F. , 1962.
A.
(1963):
Essais de linguistique
Editions de Minuit.
(Chevalier de),
O.
g4n4rale,
Paris,
art. "Langage " de l'Encyclop4die.
( 1924): La Philosophie de la gra •• aire, Paris, Ed .
de Minuit,
1971 (trad.
fr. de The Philosophy of
6ra •• ar,
Londres,
George Allen & Unwin Ltd,
1924) .
(1977):
La 6ra •• aire g4n4rale. Des
et Stefanini,
J.
Modistes aux Idéologues,
Lille,
Presses U.
de
Lille.
(1972): "Introduction" au
Droz.
Her.~s
de J. Harris,
Genève,
(1970):
"Introduction" au Tableau des progr~s de la
science gra •• aticale de F. Thurot, Bordeaux, Ducros.
(1976): "James Harris et la problématique des parties
du discours", dans History of Linguistic Thought and
Conte.porary Linguistics, H. Parret (dir. ) , New York
et Berlin, W. de Gruyter, 1976, pp. 410-430.
(1985):
" Temps et verbe dans les grammaires anglaises
de l'époque classique",
Histoire,
Epist4.ologie.
Langage, Tome 7, fasc. II, pp. 107-131 .
559
Juliard, P.
Julien,
(1970) : Philosophies of Language in Eighteenth-Century France, La Haye-Paris, Mouton.
J.
(1979): Recherches sur l' histoire de la
.ode
verbal
d'Rristote
â
cat~gorie
Port-Royal ,
doctorat,
Université
de Paris VIII,
direction de J.-C. Chevalier, juin 1979.
Thèse
sous
du
de
la
(1985) : "Mode verbal et diath~sis chez Àpo11onius
Dyscole",
dans Histoire.
Epist~.ologie. Langage,
VII-1.
Kant,
E.
Kasher,
(1786) : "Conjectures sur les débuts de l'histoire
humaine",
dans Kant,
La philosophie de
l'histoire,
Paris,
Editions Gonthier
(1947 pour les Editions
Montaigne) .
À.
(1976) :
Language
"Conversational Maxims and Rationality", in
in Focus ,
éd. par Kasher,
Dordrecht,
Reidel.
Katz,
J.J.
et
Postal,
P.M.
(1964):
Th~orie
globale des
descriptions
linguistiques
(trad.
fr.
de Rn
Integrated
Theory of Linguistic
Descriptions,
M.I.T Press), Paris, Marne, 1973.
(1966):
La Philosophie du langage ,
Paris, Payot,
1971
( The
Philosophy of Language,
New York,
Harper & Row Publishers, 1966).
Kenny,
À.
(1972)
"Descartes on the Will",
dans R.J.
Butler
(éd.) Cartesian Studies, Oxford, Blackwell, 1972.
Koyré, À.
(19 66): Etudes d'histoire de la pens~e scientifique,
Paris,
Gallimard,
1973 (P.U.F.
pour l'édition de
1966.
Kuhn,
(1962) : La structure des r~volutions scientifiques ,
Paris,
Flammarion,
1972;
trad.
fr.
d'après la
seconde édition de 1970,
Univsersity of Chicago
Press.
T.
560
Lakatos,
1.
(1978):
Phi losophical Papers, éd. par J. Worrall et
G. Currie, Camb r idge, C.U.P ..
R.
Lakoff,
(1976):
"La grammaire générale et raisonnée, ou la
grammaire de Port-Royal",
dans History
of
Linguistic Thought and Conte.porary Linguistics ,
éd. par H. Parr et , 1976.
Lamy,
B.
3- édit ., 1675 pour la 1· .... - )
La Rh~torique,
ou l'art de parler , Paris, chez André Pralard.
(1688;
C.
Lancelot,
Lappin,
S.
(1644) : Nouvelle
.~thode pour apprendre facile.ent
et en peu de te.ps la langue latine, Paris.
(1982): "On the Pragmatics of Mood", dans Linguistics
and Philosophy, Vol. 4, no. 4, pp. 559-578.
Laurendeau,
P.
(1986): "Jespersen et l'imposture des parties du
discours",
dans
Histoire.
Epist~.ologie.
Langage, VIII-l, pp . 141-155.
Le
P.
(1978):
Goffic,
"L'assertion dans la Gra •• aire et
la
Port-Royal",
dans
Strat~gies
Lyon, Presses Universitaires de
Lyon, pp. 235-24 4.
Logique de
discursives,
Leibniz,
G.W.
(1765) : Nouveaux essais sur l'entende.ent hu.ain,
Paris, Garnier-Flammarion, 1966.
(1710) :
Essais de
Flammarion, 1969.
Lewis,
Li bé ra,
Lieb,
D.
A.
H.-H.
Th~odic~e,
Paris,
Garnier-
Davidson et G.
(1972):
"General Semantics",
in D.
Language ,
Harman
(éd.),
Se.antics of Natural
Dordrecht, Reidel.
de, et Ros i e r, I. (1 986): " In t en t ion des i gn i fie r et
engendrement du discours chez Roger Bacon",
dans
Histoire. Epist~.ologie. Langage, VIII-2.
(1979):
"Principles of Semanti cs", dans Syntax and
Se.antics , vol . 10, Academic Press Inc., 1979.
561
Locke,
J.
( 1690)
Rn Essay Concerning Hu.an Understanding, New
York, Dover Publications, Inc., Vol II, 1959.
(1977)
Lyons, J .
Se.antics , 2 vols., Cambridge, C.U.P ..
Maine de Biran (1815) : "Note sur les Réflexions de Maupertuis et
Turgot au sujet de l'origine des langues", in Sur
l'Origine du langage , éd . par R. Grimsley, 1971.
Malebranche,
Martinet,
N.
(1674) : De la recherche de la véri té, Tome Ides
Oeuvres
co.pl.tes,
Paris,
Librairie
Philosophique J. Vrin, 1972.
(1960) : Elé.ents de linguistique générale, Paris,
Àrmand Colin.
À.
(1985):
Colin.
Syntaxe générale,
Paris, Coll. U, Àrmand
Maupertuis,
P.L. Moreau de (1748) : Réflexions philosophiques sur
l'origine des langues et la signification des .ots,
in ~aria linguistica, éd. par C. Porset,
Bordeaux,
éd. Ducros, 1970; aussi dans Grimsley (é d.), 1971.
----------
(1754):
Dissertation sur les différents .oyens dont
les ho •• es se sont servis pour expri.er leurs idées ,
dans ~aria linguistica de C. Porset, 1970.
McMahon, W. E.
(1976): Hans Reichenbach 's Philosophy of Gra •• ar,
La Haye-Paris, Mouton.
Meillet,
(1903):
Introduction à l'étude co.parative des
langues indo-européennes,
University of Àlabama
Pr e s s, 1964.
À.
Merleau-Ponty,
Michael,
1.
M.
(1953 et 1960):
"Sur la Phénoménologie du
langage",
in Eloge de la Phi losophie,
et autres
essais, Paris, Gallimard.
(1970) : English Gra •• atical Categories
Tradition to 1800, Cambridge, C.U.P ..
562
and
the
Montague,
R.
(1974):
For.al
Phi 1 osophy.
Sel ect ed Papers of
Richard Montague,
éd. par R. H. Thomason,
New
Haven, Yale University Press.
Morris,
C.W.
(1938): "Foundations of the Theory of Signs", dans
Encyclopedia of Unified Science , Vol.
l,
no. 2,
Chicago, 1938.
Mounin,
G.
(1963):
Les probll!.es théoriques de la
Paris, Gallimard.
Nuchelmans,
G.
traduction ,
(1973):
Theories of Propositions. Ancient and
Medieval Conceptions of the Bearers of Truth and
Falsety, Amsterdam, North-Holland.
(1983): Judg.ent and Proposition. From Descartes to
Kant, Amsterdam, North-Holland.
(1988):
"The Distinction Iktus exercitus/lktus
significatus in Medieval Semantics",
dans Heaning
and Inference in Medieval Philosophy, éd. par N.
Kretzmann, Kluwer Academic Publishers, 1988.
Ockham,
W.
of
Padley,
G.A.
(1985)
Gra •• atical Theories in Hestern Europe
1500-1700 , Cambridge, C.U.P ..
C.
Panaccio,
Theory of Ter.s,
Part l of the Su •• a
logicae,
trad.
angl.
de M. Loux, Notre Dame
(Ind.), Notre Dame Press, 1974.
Ockha.~s
..
(1987):
"Nominalisme occamiste et nominalisme
contemporain", Dialogue, XXVI, pp. 281-297.
J.-C.
(1985):
L~~nalyse du langage à Port-Royal. Six
études logico-grammaticales, Paris, Ed. de Minuit.
Pariente,
(1982) : "Sur la théorie du verbe chez Condillac", dans
Sgard (dir.), pp. 257-274.
Parret,
H.
(éd . ),
(1976):
History of Linguistic Thought and
Conte.porary Linguistics, Berlin, de Gruyter.
563
Paul,
H.
(1890) : Principles of the History of Language,
College
Park (Maryland),
McGrath Publishing Company,
1970
(trad.
selon la seconde édition des Prinzipien der
Sprachgeschichte ) .
Platon,
Popper,
(1969)
K.R.
Porset, C.
Le Sophiste , Paris, Garnier Frères.
(1967): "The Rationality Principle", dans Popper's
Selections,
éd .
par D.
Miller,
Princeton
University Press, 1985; d'abord paru en français
sous le titre:
"La rationalité et le statut du
principe de rationalité",
dans Les
fonde.ents
philosophiques des syst~.es écono.iques, éd. par
E.M. Classen, Paris, Payot, 1967.
(éd.),
(1970)
~aria
linguistica , Bordeaux, Ducros.
"Grammatista philosophans",
(bibliographie commentée)
in Joly et Stéfanini, 1977; cette bibliographie recence 1° des sources bibliographiques,
2° des anthologies, recueils et morceaux choisis,
3°
les travaux
historiques d'ensemble,
de F.
Thurot (1796)
jusqu'à
U. Ricken (1976),
puis les textes et commentaires des
des grammairiens philosophes de 1660 à 1818.
(1980): "Notes sur le mécanisme et le matérialisme du
Pré s ident de Bros s es", Langages, dé c. 1980.
Quine,
W.V.O .
(1960):
Press.
Uord« Object, Cambridge (Mass.), M.I.T.
(1970):
Philosophy of Logic,
(N.J.), Prentice Hall Inc ..
Englewood
Quintillien (1954):
Institution oratoire,
Tome l,
Bornecque, Paris, Garnier Frères.
A.
Robinet,
Rawls,
J.
Le Langage
Klincksieck.
(1978):
"
l'tige
Il Theory of Justice,
Belknap Press of Harvard.
(1971) :
564
trad.
classique,
Cliffs
de H.
Paris ,
Cambridge (Mass.), The
F.
Récanati,
(1982): "Déclaratif/non déclaratif", Langages, no.
67 (sept. 1982).
Reichenbach, H.
Reid,
T.
(1947): Ele.ents of Sy.bolic Logic, New York, The
Free Press, 1966.
(1785):
Essays on
the 1ntellectuaI Powers of Han,
Cambridge
(Mass.) et Londres,
Presses du M. 1. T.,
1969.
Restaut,
P.
D.
Richards,
(1730):
Principaux
généraux et raisonnés de
gra •• aire françoise, Paris, chez Jean Desaint.
(1971):
R Theory of Reasons for
Rction,
la
Oxford,
O. U .P ..
Ricoeur, P.
U.
Ricken,
(1975)
La Hêtaphore vive, Ed. du Seuil, Paris.
(1978):
Gra •• aire
et
philosophie
au
si~cle
des
Controverse sur l'ordre naturel et la
clarté du français,
Villeneuve-d'Ascq,
Université
de Lille III.
Lu.i~res
(1976) : "Die Kontroverse Du Marsais und Beauzée gegen
Batteux,
Condillac und Diderot -- Ein Kapitel des
Auseinandersetzung
zwischen
Sensualismus
und
Rationalismus
in
der
Sprachdiskussion
der
Aufklarung", dans Parr et , 1976.
Rosier, 1.
(1983): La gra •• aire spéculatice des Ifodistes , Presses
Universitaires de Lille.
---------
(1984):
"Grammaire,
logique,
sémantique,
deux
positions opposées au XVIII- siècle : Roger Bacon
et
les Modi st es" ,
Hi stoi re.
Epi sté.oI ogi e.
Langage, Tome 6, fasc. 1. 1984.
Ross,
(1970): "On Declarative Sentences", dans Readings in
English Transfor.ationaI Gra •• ar,
éd. par R.A.
Jacobs et P.S. Rosenbaum, Waltham (Mass.), Ginn &
Co ..
J.R.
565
J.J.
Rousseau,
B.
Russell,
Sahlin,
(1754 ) :
Discours sur l'origine de
l'in~galit~
par.i
les ho •• es ( avec Du Contrat social
et
le
Discours sur les sciences et les arts ),
Paris,
Union Générale d'Edition, 1963.
(1940) : Signification et v~rit~, (trad. fr. par P.
Devaux de Rn Inguiry into Meaning and Truth ,
Harmondsworth, Middlesex,
1940 ) ,
Paris,
Flammarion, 1969.
G.
C~sar
( 1928):
l'~volution
Chesneau Du Harsais et son rOle dans
de
la gra •• aire g~n~rale,
Paris,
P. U.F ..
Sapir,
E.
(1921):
Le langage.
Introduction à l'étude
parole, Paris, Payot, 1967.
Saussure,
F.
J.
Schachter,
Schreyer,
Searle,
de (1915): Cours de linguistique
Payot, 1922.
R.
J.
(1935) : Prolego.ena to
Dordrecht, Reidel, 1973.
a
de
g~n~rale,
Critical
la
Paris,
Gra •• ar,
"Condillac, Mandeville, and the Origin of
Language 11 , in Historiographia 1 inguistica, V: 1/2.
(1978):
(1969)
Speech Rets, Cambridge, C.U.P.
(1979): Expression and Heaning. Studies in the Theory
of Speech Acts, Cambridge, C.U.P ..
(1983): Intention.lity. An Essay in the Philosophy of
Mind, Cambridge, C.U.P ..
et Vanderveken, D. (1985): Foundations of Illocutionary
Logic, Cambridge, C.U.P ..
Sgard,
Shapere,
(éd.), (1982): Condillac et les
Genève et Paris, Slatkine.
J.
D.
(1966)
probl~.es
du langage,
11Meaning and Scientific Change 11 , dans Colony
566
R.
(dir . ), Hind and Cos.os, Pittsburgh, Pittsburgh
University Press,
pp.
41-85;
aussi dans Shapere,
Reason and the Search
for KnoHledge,
Dordrecht,
Reidel, 1984, pp. 58-101.
& Sons,
Simon,
H.
(1957)
Inc.
Smith,
A.
(1759): "Considérations sur l'origine et la formation
des langues", dans <laria linguistica,
édit. par C.
Pors et, 1970.
Hodels of Han,
New York, John Wiley
Sté fanini ,
J.
(1977): "De la grammaire aristotélicienne", dans
A. Joly et J. Stéfanini (dir.), La 6ra •• aire
générale. Des Modistes aux Idéologues, 1977.
Steinthal,
H.
(1855):
Gra •• atik,
Logik und Psychologie,
ihre
Prinzipien
und ihr
<lerhaltnis
zueinander,
Hildesheim,
Georg Olms
Verlagsbuchhandlung,
1968.
Stenius,
E.
Swiggers,
Thurot,
(1967): "Moods and Language Game",
pp. 254-274.
Synthese , 17,
(1982) : "Introduction" aux <Irais principes de
langue française, Genève, Droz.
P.
F.
~n
la
(1796):
"Remarques" à sa Traduction de Her.ts,
ou
Recherches
philosophiques
sur
la
grammaire
universelle, de J. Harris, éd. par A. Joly, Genève,
Droz, 1972.
(1796) : Tableau des progr~s de la science gra •• aticale
éd.
par A.
Joly,
(Discours préliminaire à Her.~s),
Bordeaux, éd. Ducros, 1970.
Turgot,
A.-R.
(1750) : "Remarques critiques sur les Réflexions
philosophiques de Maupertuis sur l'origine des
langues et la signification des mots", dans <laria
linguistica, éd. par C. Porset.
(1750):
"Sur les progrès successifs de l'esprit
humain",
dans <laria linguistica,
éd.
par C.
Porset.
567
"Deuxième discours
Sur l'histoire des
progrè s de l' espri t
humain" ,
dans Varia
linguistica, éd. par Porset.
"Réflexions
sur les
langues",
dans
Varia
linguistica, éd. par C. Porset.
Vanderveken,
D.
(1988):
Les Iktes de discours.
Essai de
philosophie du langage sur la signification des
énonciations, à paraitre chez Pierre Mardaga.
(1989):
Heaning and Speech Rets,
volume 2 de The
Se.antics of Success and of Satisfaction,
à
paraître chez C.U.P ..
Vendler,
Z.
(1972)
Res Cogitans,
Ithaca,
Cornell University
Press.
Watkins,
Whitney,
J.
(1970): "Imperfect Rationality", in R. Borger et F.
Cioffi
(éd .),
Explanation
in the Behavioural
Sciences, Cambridge, C.U.P ..
W.D.
Wittgenstein,
(1867):
Language and the Study of Language
( réimpression selon la 6 i • m - édition de 1901),
New York,
ÀMS Press, 1971 .
L.
(1953): Philosophical Investigations, Oxford,
Blackwell.
(1969)
Worrall,
J.
D~
la certitude, Paris, Gallimard, 1976.
(1978):
"The Ways
in which the Methodology of
Scientific
Research
Programmes Improves on
Popper's Methodology", dans Radnitzky et Àndersson (dir.), Progress and Rationality in Science,
Dordrecht, Reidel.
Zaefferer, D. et Grewendorf, G. (1984a): "Theorien der Satzmodi",
art.
du manuel ( Handbuch) Se.antik,
éd . par D.
Wunderlich et À, von Stechow, manuscrit.
568
Zaefferer,
D.
Zuber,
(1983) : Hon-Declarative Sentences,
Benjamins Publishing Company.
R.
(1984b):
"The
Typologically
Hattori
(éd . )
International
1984.
Semantics
of
Sentence Mood
ln
Differing Languages",
in
Shiro
,
Proceedings
of
the
XIIr: h
Congress
of
Linguists,
Tokyo,
***
569
Amsterdam,
John