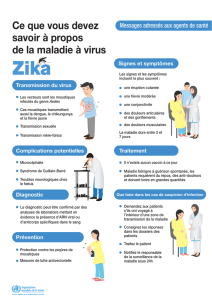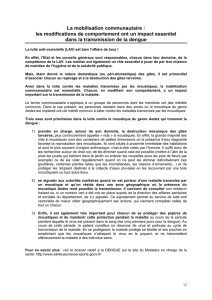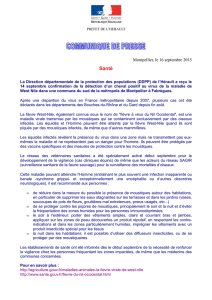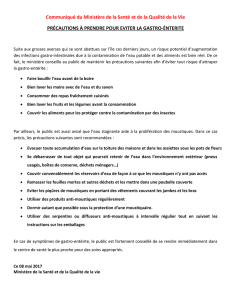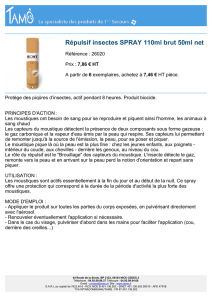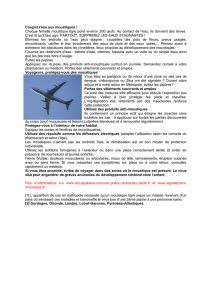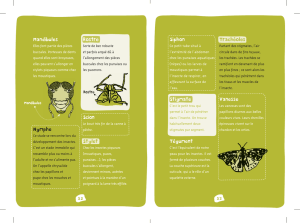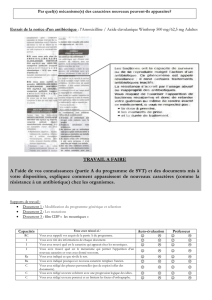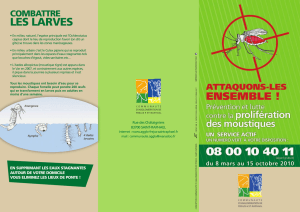UNIVERSITE 00 QUEBEC MEM)IRE PRESENTE EXIGENCE PARTIELLE
publicité
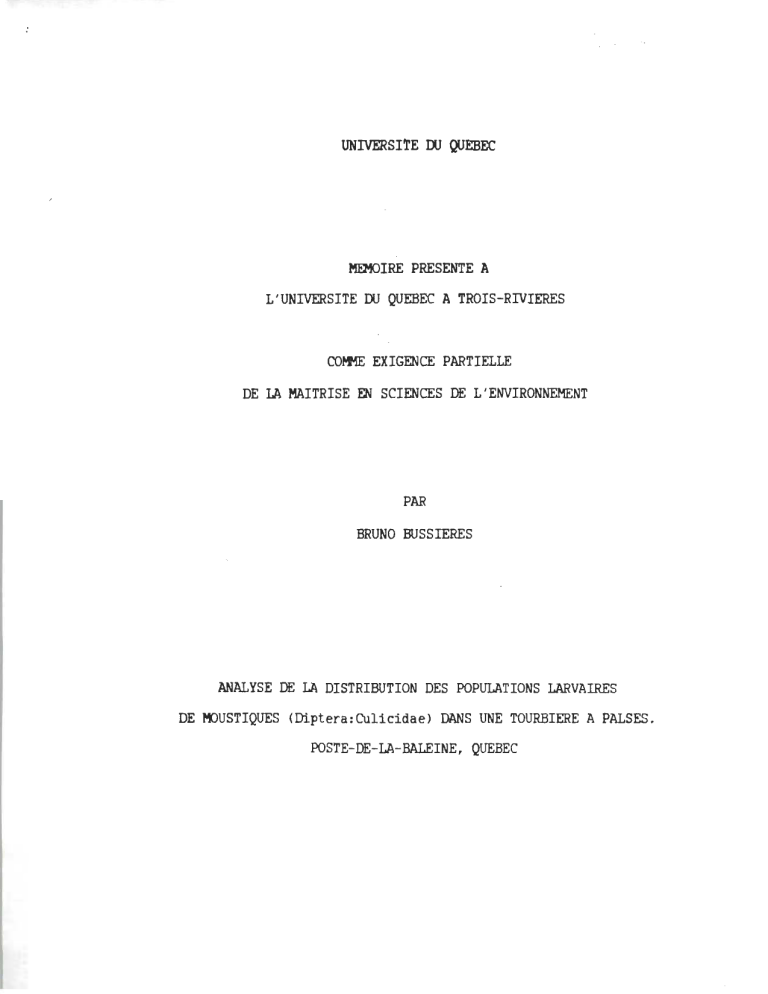
UNIVERSITE 00 QUEBEC
MEM)IRE PRESENTE A
L'UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES
COPfffi EXIGENCE PARTIELLE
DE LA MAITRISE EN SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
PAR
BRUNO BUSSIERES
ANALYSE DE LA DISTRIBUTION DES POPULATIONS LARVAIRES
DE K:>USTIQUES (Diptera:Culicidae> DANS UNE TOURBIERE A PALSES.
POSTE-DE-LA-BALEINE, QUEBEC
Université du Québec à Trois-Rivières
Service de la bibliothèque
Avertissement
L’auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l’Université du Québec
à Trois-Rivières à diffuser, à des fins non lucratives, une copie de son
mémoire ou de sa thèse.
Cette diffusion n’entraîne pas une renonciation de la part de l’auteur à ses
droits de propriété intellectuelle, incluant le droit d’auteur, sur ce mémoire
ou cette thèse. Notamment, la reproduction ou la publication de la totalité
ou d’une partie importante de ce mémoire ou de cette thèse requiert son
autorisation.
RESUME • • • •
.........
. . . . . . . . . . . . . . • 1v
. . . . . . . . . . . . . • vi
. . . . . . . . . . . . . viii
REMERCIEMENTS
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES FIGURES
.......................
CHAPITRE l
INTROOOCT10N
CHAPITRE II
LE MILIEU
11.1
11.1.1
SITUATION GEOGRAPHIQUE
• ix
II-l
L'HEMIARCTIQUE AU QUEBEC-LABRAOOR
II-3
11-4
II. 2
LE CLIMAT
• • • • •
11.3
ETUDES BOTANIQUES
11-6
11.4
LES PALSES • • •
II-8
II. 5
LES CUL1CIDES
. . 11-10
II. 5.1
BIOLOGIE GENERALE
II. 5. 2
LES ETUDES ANTERIEURES •
CHAPITRE III
111.1
. 11-10
• • • • • 11-14
MATERIEL ET METHODES
LA NOTION DE "NIVEAU ECOLOGIQUE" OU "UNITE
ECOLOGIQUE"
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 111-1
- 1 -
111.2
LES CULICIŒS
111.3
LA VEGETATION
• III-5
111.4
LES PARAHETRES PHYSICO-CHIMIQUES •
• 111-6
111.5
CALCULS ET ANALYSE STATISTIQUE • • •
• 111-6
CHAPITRE IV
IV.l
• •
111-2
RESULTATS ET DISCUSSION
LA VEGETATION • . . • •
IV-l
IV.1.1
ANALYSE FLORISTIQUE
IV-l
IV. 1. 2
LES GROUPEMENTS VEGETAUX
IV-6
IV.2
LES MOUSTIQUES . • • • • • • .
• • • IV-19
IV.Z.l
LES ESPECES ET LEUR PHENOLOOIE .
IV.Z.Z
ANALYSE QUANTITATIVE • • • • .
IV.Z.3
ANAL YSE DE GROUPœENT DES ESPECES
IV.Z.4
ANALYSE DE GROUPœENT DES ECHANTILLONS.
IV.3
•• 1V-19
· IV-23
. . • • . · IV-27
• IV-30
LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES GITES
CULICIDIENS
. • . • • •
•• IV-32
IV.4
LES UNITES ECOLOGIQUES .
• IV-36
IV.5
L'ANALYSE DISCRIMINANTE
CHAPITRE V
.• IV-39
SYNTHESE ET CONCLUSION
V.l
RELATIONS HABITATS-ESPECES DE MOUSTIQUES . . • . • V-l
V.Z
SOMMAIRE DES ANALYSES STATISTIQUES. . . .
- 11 -
. • V-3
........
V.3
LIMITES DE LA METHODE
V.4
CONSIDERATIONS ET AVENUES DE RECHERCHE •
• V-6
• • • V-7
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES • . . . . . . . • . . . . • . . 93
ANNEXES
l LISTE DES TAXONS
II LISTE DES SPHAIGNES
- 111 -
ANALYSE DE LA DISTRIBUTION DES POPULATIONS LARVAIRES
DE MOUSTIQUES (Diptera:Culicidae) DANS UNE TOURBIERE
A PALSES.
Les
â palses sont caractéristiques des régions
tourbi~res
discontinu
POSTE-DE-LA-BALEINE, QUEBEC.
au
pergélisol
â
La tourbière étudiée
Canada, en Scandinavie et en URSS.
est située dans la région de Poste-de-la-Baleine (55• 16' N, 77• 48 ' 0)
la
limite
entre
la
taiga
subarctique
distribution des populations larvaires de
à
et la toundra forestiére.
La
moustiques
en
est
analysée
tenant compte des groupements végétaux, méthode qui a donné d ' excellents
résultats
dans
sélectivité
analyse
les
des
zones
tempérée,
habitats
discriminante
quantitatives .
Trois
utilisées afin de
larvaires
boréale
et
subarctique.
par les moustiques est testée par
(DFA)
multivariée
partir
à
de
mesures
types d'analyse de groupement (clusterlng) sont
mettre
en
évidence
la
structure
des
populations
larvaires de moustique ainsi que celle des communautés végétales.
espèces présentes dans la tourbière, 4 ont
des
présentant
Aedes.
punctor
une
(47%),
groupements
aquatilis,la
argyrocarpa
bétulaie à
l ' analyse
fréquence
vég~taux
Betula
(23%)
soit:
et
~
populations
a mousses,
glandulosa.
Les
larvaires
(21%).
Six
la cariçaie a Carex
a Scirpus cespitosus, la saulaie
pessière
Des 9
hexodontus (93%l,A.
excrucians
ont été mis en évidence, soit:
sc irpaie
la
élevée,
communis
~
La
a
Sal i x
la pessiere a cladonies et la
résultats
obtenus
à
partir
de
discriminante indiquent une apparente non selectivité dans l e
- iv -
choix des
co..unis
sites de ponte des
et
A.
espèces dominantes.
Par contre A.
canadensis sont confinés a des mares spécifiques.
nature des .ares serait préférées a l'habitat.
La
Le rOle indicateur de la
végétation par rapport aux habitats larvaires de .oustique serait plus
faible dans l'
sud.
H~arctique
que dans les zones
bioclimatiques plus
Il semble que la diversité des habitats dans la tourbière à palses
étudiée est réduite par l'homogénéité des conditions hydrologiques,
présence
palses
la
d'argile au travers de la tourbe suite à la dégradation des
et
la
structure relativement
L'interprétation des
simple
de
la
végétation.
résultats tient compte que les facteurs du milieu
mis en évidence par la végétation n'expliquent qu'une partie du
des
au
femelles de moustique pour leur site d'oviposition.
recherche en milieu nordique sont présentées.
- v -
choix
Des avenues de
Nous exprimons des re.erciements très
Maire
sincères é .onsieur Alain
pour nous avoir proposé cette étude et pour son aide et direction
tout au long de cette recherche. Nous tenons également à exprimer nOtre
gratitude
à
.ansieur Antoine Aubin pour ses judicieux conseils lors de
l'élaboration de l'échantillonnage et du traitement des données.
Nous sommes reconnaissant à monsieur
Centre
d'études
Serge Payette directeur
Nordiques de l'Université Laval,
facilité l'accès à Poste-de-la-Baleine
et
nous
du
pour nous avoir
avoir communiqué
son
enthousiasme débordant pour les études nordiques. Nous sommes également
reconnaissant
et
à
identifier
monsieur Robert Gauthier pour avoir accepté de vérifier
nos échantillons de sphaignes ainsi que monsieur Jacques
Cayouette pour la vérification des plantes vasculaires.
Nous tenons
a remercier aussi monsieur Jean-Pierre Beaudoin pour
l'identification des moustiques, monsieur André Leblanc pour son aide et
ses conseils dans l ' emploi des logiciels SPSS et BHDP ainsi que dans
préparation de
tableaux et
figures, monsieur Christian Back pour son
encouragement et ses conseils, madame Suzanne Dupuis qui m'a aidé à
récolte de
plantes,
la
la
monsieur Alain Chalifour pour son aide dans
l'utilisation de l'ordinateur et
- vi -
certains
aspects mathématiques,
et
..da.e
C~line
Guilbert pour avoir
dactylographi~
plusieurs tableauz.
Nous remercions aussi aonsieur Claude Olou ina rd
du
service de
l'informatique de l'Université du Québec • Trois-Rivières, .onsieur
André Paquette du département de .athématiques et monsieur Claude
Tessier,
chercheur,
pour nous avoir facilité l'accès au traitement de
texte par ordinateur.
Nos plus sinceres remerciements vont également à tous
du
Groupe de
recherche
les membres
sur les insectes piqueurs de l'Université du
Quèbec à Trois-Rivières et du Centre d'études Nordiques de l'Université
Laval qu'il
serait
trop
long de nommer ici,
lesquels de par leur
discussion et l'amitié qu'ils .'ont té.oigné .'ont beaucoup aidé.
Enfin, cette étude a été rendue possible grace a une subvention de
la
Fondation Donner du Canada attribuée à monsieur Antoine Aubin, d'une
subvention du Ministére des Affaires Indiennes et du Nord du
d'une
Canada
et
subvention du Fonds FLAC attribuée à messieurs Alain Maire et
Antoine Aubin. Nous leur exprimons toute notre gratitude.
- vii -
LISTE
1.
Noabre
d'e~p~ces
par faaille
tE)
TABLFAUX
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 35
2. eo.paraison entre les ~pectres biologiques de la tourbière â
palses(TP) et Poste-de-la-Baleine (PDLB) • • • • • • • • • • • • • • 36
Comparaison des affinités géographiques entre les flores de la
tourbière â palses (TP) et Poste-de-la-Baleine (PDLB)
••••
3.
4.
. 38
Caractéristiques des strates de la végétation de la tourbière â
palses.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.
Cariçaie,Scirpaie,Saulaie et culicides
6.
Pessières.
. . • • . • • . • • • • . 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7. Fréquence et densité moyenne des espèces de moustiques pour
l'ensemble de la tourbière (juin et juillet) • • • . . • .
. •• 58
Fréquence et densité moyenne des espèces de moustiques classées par
groupements v~gétaux selon le mois de juin et juillet. . • • . • . . 59
8.
Caractéristiques physico-chimiques des gîtes culicidiens classés par
groupements végétaux selon trois périodes de mesures. • • • . • . • . 66
9.
10.
Les unités écologiques de la tourbière
a palses.
• • • • • • • 71
Il.
Résultats de l'analyse discriminante par étapes.
• • • • • • • 74
Espèces végétales et culicidiennes choisies de la caricaie à
Carex aquatllis classées selon l'état de dE!<jradation des palses. . . 80
12.
- viii -
LISTE lES FIGURES
1. Localisation de Poste-de-la-Baleine et de la
étudiée. • • . • • . . • • • • • • • • . •
2.
tourbière à
palses
• • • • •
6
Situation géographique de la toundra forestière au Québec-Labrador.9
3. Température .ayenne et précipitations totales pour les mois de juin
et juillet 1982 a Poste-de-la-Baleine. • • • • • • • • • • • • • • • Il
4.
D1stribution du pergélisol au Québec-Labrador.
• • • • . • • • • 13
5. Localisation des mares échantillonrtees et classification des palses
selon leur état de dégradation.
• • • • • • • • • • • • • • • • 22, 42
6.
Abaque donnant les indices d'abondance-dominance des culicides •• 27
7.
Schéma de l'analyse discriminante.
8. Carte schematique des
transects topographiques.
• • • • • • . • • • • • • • • 31
groupements végétaux
et
localisation des
. . . . . . . . 41
9. Répartition des groupements végétaux selon le gradient topographique
(Exagération de l'angle de pente 10 %).
. • • • • • • • • • • . • • 47
10.
Liste des espèces de moustiques inventoriées à Poste-de-la-Baleine.
53
11. Distribution 1atitudina1e de 16 esp~ces de moustiques holarctiques
~ travers les zones et sous-zones bioclimatiques du Québec-Labrador • 54
12.
à
Représentation schématique de la phénologie des larves de Culi~idae
Poste-de-la-Baleine.
. • • . • . • . • • • • . . . . 55
13. Matrice de corrélations entre
tourbière à palses.
14.
Dendrogramme.
les espèces de moustiques
Analyse de groupement des espéces.
- ix -
de
la
61
. . . • • • . 62
Page 2
15.
Dendrogra.e.
Analyse de groupellent des
~chantnlons.
• • 64
16. Droite de régression entre la teapérature de l'eau des .ares et
celle de l'air dans la tourbiére 4 palses. (Mares de caricaie juin et
juillet 1982)
. . • . . • . . . . . . . . . . • • . • . • • . . . . 68
- x -
CHAPITRE l
INTRODUCTION
Depuis 1973,des etudes écologiques sur les espèces de moustiques du
Québec sont entreprises au sein du Groupe de recherches sur les insectes
piqueurs de l'Université du Québec
ont
été
prospectées,
a
Trois-Rivières.
principalement
dans
les
Plusieurs
zones
régions
bioclimatiques
tempérées et subarctiques.
Ces études ont été menées grace
d'analyse
du
milieu
basée
sur
la
a l " approfondissement d'une méthode
notion d'unité écologique dont le
principe essentiel consiste à mettre en évidence les relations
entre
existant
la présence des groupements végétaux et les populations larvaires
de moustiques. La
générale,
les
végétation en
intégrant
assez
bien,
d'une
façon
conditions du milieu, il était donc possible en étudiant
la répartition des populations larvaires de moustiques
à
l'intérieur
des différents groupements végétaux des zones biogéographiques du Québec
de cerner quels sont les facteurs
du
milieu
amenant
les
espèces
moustiques à sélectioner leurs g1tes de développement larvaire.
de
Page 1-2
Ces
fait
~tudes
dans les zones tspérée,
l'objet de
bor~le
et subarctique ont -déj6
synthéses (Maire et Aubin 1980;Maire 1980b). Ainsi il
appert que les facteurs écologiques qui semblent prépondérants
choix des
espèces
traduite plus
ou
argilo-limoneux,
pour
le
le
type de .tlieu sont: l'acidité du ailieu
moins directement
tourbeux>,
dans
par
le
le .ode de aise
substrat
en
eau
(argileux,
et
le degré
d'ensoleillement. De plus Maire (1982), dans une analyse détaillée de la
distribution des
espèces de moustique au sein des groupements végétaux
de tourbières réticulées du Subarctique, arrive à la conclusion que les
espéces de moustiques
écologiques propres
propres à
Ainsi
à
étudiées
sont
l'ensemble d'un
plus
sensibles
groupement
aux paramètres
végétal
que
ceux
chacune des mares distribuées au sein de ce même groupement.
a chaque groupement végétal correspond une
communauté
de
moustiques relativement stable.
L'étude des milieux
intéressante
vu
à
larves de moustiques
sur
tourbe
est
l'importance des dépOts organiques au Québec et de la
zonation des types de tourbières en fonction de la latitude. Ainsi, pour
simplifier,
l'on distingue une zone méridionale à hautes tourbières ou
tourbières bombées au sud du 50e parallèle, une zone intermédiaire riche
en
tourbières
réticulées
ou structurées entre le 51 et le 54 degré de
latitude nord (Thibodeau et Cailleux 1973), et une zone septentrionale à
palses s'étendant jusqu'au 58e degré lat. N. (Ddonne 1978, Brown 1979).
- 2 -
...
Page 1-3
Jusqu'a
présent aucune étude des
populations
larvaires
de
.oustiques présentes dans les tourbières a palses n'a été effectuée. Il
nous apparaissait intéressant compte tenu des recherches antérieures
milieu
tourbeux des zones plus
~ridionales
en
(Maire et Aubin 1976, Maire
1977, Mailhot 1979, Maire 1982), d'intégrer une analyse détaillée d'une
tourbière è pa1ses dans le cadre d'une étude quantitative plus vaste des
populations larvaires de moustique dans
l'Hémiarctique
(Maire
et
est de vérifier
la
Bussières 1983).
Le
probl~me
sélectivité
que
des
cette recherche
habitats
hémiarctique. Dans cette étude
aborde
par les moustiques
nous
nous
en milieu
proposons de
tourbeux
connaître la
distribution qualitative ' et quantitative des populations larvaires de
moustiques présentes au sein de la tourbière
distribution des
et de
Ces
Les
renseignements permettront
et les
r~8ultats
d'examiner
nature physico-chimique des g1tes
relations existant entre la présence des
tourbière
palses,
la
espèces végétales sous l'angle de la phytosociologie
préciser la
moustique.
à
seront
à
larves
ensuite d'apprécier
groupements
végétaux
de
de
les
la
populations larvaires de moustiques correspondantes.
comparés â
ceux obtenus dans
les
zones
plus
méridionales. Cette étude est restreinte géographiquement à la ré910n de
Poste-de-1a-Baleine.
- 3 -
Page 1-4
- 4 -
;.
CHAPITRE II
LE MILIEU
II.1
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Poste-de-la-Baleine
l'embouchure de
(55- 17' N,
n° 46 '0) est
situé
près
de
la Grande rivière de la Baleine, sur la cOte orientale
de la mer d'Hudson (Wilson 1968). Cette localité est
comprise dans
la
zone bioclimatique Hémiarctique.
La
rive
tourbi~re
sud
de la
a palses étudiée (55• 13'N, 77• 47'0) se
rivi~re
du Cen, soit approximativement
situe
a six kilomètres
de la station du Centre d'Etudes Nordiques de l'Université Laval
1).
82,9
sur la
(Fig.
A une altitude moyenne de 75 métres, elle occupe une superficie de
hectares
2-
(0,83 Km
dans
une
cuvette
formée
par le
socle
granitique.
Cette
tourbi~re
a été choisie en raison de son accessibilité et
de
la diversité possible des groupements végétaux d'après les photographies
Page
n-2
Â
2J7m
O"IIIt====j21111.3~
Figure 1. Localisation de
tourbière è palses étudiée.
- 6 -
Poste-de-la-Baleine
et
de
la
Page 11-3
aériennes (HQ 79 1023:231-232. 1/15 000 ).
II.1.1
L'HEMIARCTIQUE AU QUEBEC-LABRADOR
Tel que défini par Rousseau (1952,1961) et
précisé par
Du crue
et
al
(1976), l'Hémiarctique est le domaine de la toundra forestière.
Elle désigne
continues
au
sud
la
et
cette
Physionomiquement,
sous-zone
région
une
forestière
comprise
ligne
zone
des
se
entre
arbres
méridionale
et
septentrionale (fig. 2). La premiére est
forestier
important,
particulièrement
limite
( "tree
en
divise
la
deux
une
line" )
plateaux
végétation
par
distinguer
basse.
d'épinettes
blanches
une
arbustive
un couvert
les sites bien pourvus en
forestière
forêts
noires
(Picea
bande
Ces
de
(Picea
qlauca
2 à
sont
10
mariana
(Moench.)
km de
en
majeure
(Mîll.)
Voss.)
dont
du
partie
BSP.
il
et
faut
Golfe de
Dans la seconde, les forêts d'épinettes noires sont confinées
aux dépressions, bien que la
partie
tels
largeur le long de la Baie
d'Hudson, exceptionnellement de 20 à 25 km dans la région du
Richmond.
une
sommets des massifs montagneux sont recouverts d'une
arbustive
constituées
d'épinettes
et
au nord.
sous-zone
eau. Les sites édaphiquement impropres à la croissance
les
forêts
sous-zones,
caractérisée
dans
des
terrain,
le
plus
végétation
arbustive
occupe
la
majeure
souvent sous forme de krummholz (Payette
1983) •
- 7 -
Page 11-4
Cette zone est très développée au Qu~bec entre le
S5 et
le
sfl.
La
température .oyenne y est de -4,8 •C, la précipitation de 540 . . et .oins
(Richard 1978). Ce secteur correspond sensiblement 4 la
région où
le
nombre de degrés-jours varie de 600 è 800 (Wilson 1971). C'est aussi une
zone
a
pergélisol
discontinu.
Les
tourbières
a
palses
en
sont
la
manifestation la plus caractéristique.
Du point de vue entomologique, l'Hémiarctique constitue également
une
zone
de transition, où les espèces boréo-tempérées atteignent leur
limite de distribution 1atitudinale, tandis que les espèces ho1arctiques
circumpolaires
atteignent
y
limite
leur
sud
et
les
espèces
arctico-alpines leur aire optimale (Maire et Aubin 1980).
II.2 LE CLIMAT
D'aprés Wilson (1968) , le climat
type
subarctique.
La
température
période moyenne sans gel est
(période
,
ou
de
de
Poste-de-la-Baleine est
moyenne
67
jours.
annuelle est de -4.3 •C. La
La
saison
précipitation moyenne
Les
importantes,
de
croissance
la température moyenne quotidienne est supérieure à 5,6 C>
est de 109 jours et s'étend du début de juin é la fin de
neige.
de
annuelle
prtcip1tat1ons de
o~
il
pleut
septembre.
La
atteint 680 mm dont 40 % sous forme de
juillet
pendant
a
octobre
sont
plus
plus de 50% du temps, souvent sous
forme de bruine. A cette latitude, la majeure partie de
culicides se déroule pendant les mois de juin et juillet.
- 8 -
les
l'activité des
Page 11-5
o
Postede-Ia-
Baleine
55
o
5
.
,.,"
45
- . ......
~
o
7
_ . _._._
___ _ _
•
Frontière des Etats-Unis
limites interprovinciales
o
o
60
O_JOO~::JIIlllif)()1i Km
~
~ Toundra forestière
sous-zone arbustive
Toundra forestière
sous -zone forest ière
Figure 2. Situation géographique de la
au Québec-Labrador
D'après Payette (1983)
9 -
toundra
forestière
Page 11-6
Les températures .oyennes quotidiennes pour le! .ois de juin et
<1937-1965)
sont
respectivement de 5,7 •C et 10,4 •C. Les précipitations
totales (1930- 1961) sont de 54,61.m et
traitement
statistique
è
85,34 .m
partir des données
(Wilson
afin
Un
1977-1982)
a
été
de comparer les données è 17 et 20 ans d'intervalle. Les
.
températures
1968).
aétéorologiques de la
station de Poste-de-1a-Baleine (Environnement Canada
effectué
juillet
moyennes
pour
les mois
de
.
juin
et
juillet
sont
respectivement de 5,7 C et 10,1 C. Les précipitations de 73,3 mm et 78,5
mm. On observe une variation de 34 % de plus pour les précipitations au
mois
de juin et de 8 % de moins en juillet. Les moyennes de température
sont comparables. La figure
3 donne
la
température moyenne
et
les
précipitations totales pour les mois de juin et juillet 1982.
II.3
ETUDES BOTANIQUES
La région de
botaniques.
études
Poste-de-la-Baleine
Parmi
celles-ci,
a
fait
notons
l'objet
de
nombreuses
l'analyse floristique de
Forest et Legaut (1977) , é partir des spécimens d'herbier amassés depuis
d'un
plus
siècle
par
les
explorateurs
et botanistes et de rècoltes
effectuées en 1969 et 1970; les études sur la
et
formes
de
succession,
croissance des forêts de Picea glauca
Picea mariana (Mill.) BSP. (Payette 1974,1975,1976);
et
les
structures
de
distribution
(~oench.)
la
Voss. et
cartographie
la végétation de la région (Payette et Gauthier
1972).
- 10 -
Page 11-7
JUIN
g
..
.,;
~
...'"
.
0
0
<?
<!
~
JUILLET
0
û, ,..,
...
-
VIN
:>
-:>
U
C
....Jo
U
....JO
ILl .
ILI<?
u"
~!
J
lU
cr
ILl
cr
=>"
:>0
... ~
c_
cr-
lU
c_
a:-
~~
ILl
Q.
r
IL
:1:
lA'
ILl
...
~O
n
...
...,",
0
~
'", 1··
o
o
o
.
.
•
"
,.,"
.6
1·
24
R.
24
1b
JOUR
JOUR
gJUILLET
JUIN
.
()
..
o
o
o
"
,.,
...
N
i:
:1:
~o
Z
o
·
o~
....
c
-"
~o
~o
Q..
-0
Q.. .
•
_'"
0-
_CI
0lU
ILl
cr
cr
Q..
IL
."
o
J OUH
JOUR
Figure 3. Température moyenne et précipitations totales
pour les mois de juin et juillet 1982 à Poste-de-la-Baleine.
D'après Environnement Canada (1982)
- Il -
II
Page 11-8
Dans la région de Poste-de-la-Baleine, les tourbières è
rencontrent
principalement
au
pa1ses
sud de la Grande rivière de la Baleine,
entre le 55• et le 55• 14' N., é une altitude comprise entre 60 et
et
occupent
parfois de grandes étendues (jusqu'â 5
Dans ce contexte,
les
se
tourbières
â
palses,
~
~
150 •
) (Dionne 1978).
constituant
un élément
physiographique important de cette région, n'ont pas ou peu été étudiées
au point de vue végétal.
II.4
LES PALS ES
Les palses sont des buttes cryogénes produites par un gonflement de
la surface dO à la ségrégation de glace dans le sol (Dionne 1978). Elles
ont de 7 à 20 m de diamétre, 10 à 200 m de longueur
hauteur
(Séguin
caractérisé par des
d'épaisseur
et
Crépault
lentilles
<Washburn
1973).
1979).
Le
coeur
de
l
pergélisol
glace généralement
de
On
les retrouve
les
dans
et
7 m de
à
de
pergélisol discontinu, au Canada, en Scandinavie
1968).
et
en
2 â 3
régions
URSS
est
cm
à
(Rail ton
La figure 4 présente la distribution du pergélisol au Québec. La
plus grande concentration de palses est
située
dans
la
partie ouest
entre les limites de la mer de Tyrell et en plus faible proportion dans
l'est près de la cOte atlantique (Brown 1979). Les palses
non
boisées
se rencontrent principalement entre le 55• et le 56• N, les palses boisées
du 52°24 ' N au 54-24 ' N. (Dionne 1978). En Jamésie-Hudsonie, on retrouve
parfois des
palses
entièrement
organiques mais les palses à la fois
minérales et organiques demeurent les plus abondantes (Dionne 1978).
- 12 -
'.
Page
[I1J
Pergélisol continu
11111/111
Pergélisol discontinu
(-11111
Marge sud de la régipn a
--_.
Figure 4.
n-9
pergélisol
limite sud du pergélisoJ continu
Limite sud du pergélisol
Distribution du pergélisol au Québec-Labrador.
D' après Brown (1970)
- 13 -
Page 11-10
Les palses de la tourbière étudièe sont des palses
minèral
tel
que
démontré
par
l'étude
organiques
stratigraphique
coeur
è
de Séguin et
Crépault (1978).
On peut grouper les études
réalisées
sur
les
palses
sous
cinq
aspects différents, soit: 1) étude géomorpho1ogique , 2) étude botanique
des tourbes (datation pollinique), 3) régime thermique, 4) cycle d ' évolution,
5)
description
des
formes
et distribution (Séguin et Crépault
1978). Jusqu ' à présent, aucune étude n'a été réalisée sur les tourbières
à
palses
en
tant
qu'écosystème
organismes vivants et
pergélisol
leur
discontinu.
relation
Dans
à
comprenant plusieurs types de
mar~s.
la
l'affaissement du sol autour de la
dépression humide
avec
un
i.e.
milieu
l'ensemble
à
présence
des
de
ce mémoire, on s ' intéressera non pas aux
palses elle-mêmes, mais plutot
d'une
fonctionnel
zone
humide
entre
les
buttes,
La fonte du pergélisol provoquerait
palse
périphérique
et
la
formation
fréquente
(Hamelin et Cailleux 1969). Ces
mares temporaires ou permanentes sont un lieu de
prédilection
pour
le
développement des populations larvaires de moustiques.
II.5 LES CULICIDES
II.5.1 BIOLOGIE GENERALE
Les moustiques appartiennent à l'ordre des Diptères, sous-ordre des
Nématocéres.
Cet
ordre
groupe
plusieurs familles dont les moustiques
- 14 -
Page II-Il
(Culicidae),
les
mouches
noires
(Simuliidae)
et
les
brulOts
(Ceratopogonidae). Les taons (Tabanidae) appartiennent au sous ordre des
Brachycères. Au Canada, on a
recensé
jusqu'à
présent
74
espèces de
moustiques dont 52 sont présentes au Québec (Wood et al 1979). Le genre
Aedes, sous-genre Ochlerotatus comprenant des espèces â
homogène
(" snoH melt
species")
est
biologie
très
le plus représenté (29 espèces).
Comme tous les Diptéres, le moustique est
un
insecte a métamorphose
complète. Il passe par quatre stades larvaires et un stade nymphal avant
d'atteindre celui de l'insecte parfait ou imago (Wood et al 1979).
cycle de vie
se déroule
en deux phases principales. La première en
milieu aquatique ou semi-aquatique correspond aux stades de l'oeuf,
la
Son
de
larve et de la nymphe. La seconde en milieu terrestre est celle de
l'adulte.
Seule la femelle est hématophage. Ce besoin de
une nécessité vitale de
l'espèce:
il
permet
maturité. Le besoin de sang est lié à un choix
espèces.
Ainsi,
sang
à
aux oeufs d'arriver à
préférentiel
selon les
telle espèce ne pique que les mammifères, telle autre
les oiseaux, telle autre les batraciens (Pautou et al
espèces
correspond
sont autogènes
1973).
Certaines
ou autogènes facultatives, cependant le nombre
d'oeufs produit sans l'apport protéinique du sang est beaucoup moindre.
Le male
et
également
moustique est un
petites
fleurs
la
important
femelle
se
nourrissent de suc végétal. Le
pollinisateur,
particulièrement pour les
sauvages n'intéressant pas les abeilles (Neilsen 1979).
- 15 -
Page II-12
Les moustiques présents dans
génération
par année.
Ces
l'Hémiarctique ne produisent
espèces
genre Aedes passent l'hiver é l'état
qu'une
sont dites univoltines. Celles du
dormant
sous
forme d'oeuf.
Les
oeufs qui sont embryonnés avant l'hiver sont très résistants au froid et
à
la dessication. Un nombre réduit d'espèces CCuliseta
~
alaskaensis
et
impatiens) passent l'hiver â l'état adulte dans des endroits protégés
et apparaissent plus tot au printemps que les adultes du
(Danks 1981).
dormante ou
divers
Les larves de moustiques
très
faiblement
courante.
se développent
Différentes
dans l'eau
espèces habitent
types de mares. Le type d'habitat é développement larvaire est
choisi par la femelle lors de la ponte. Cette
par un
genre Aedes
sélection est
gouvernée
certain nombre de facteurs. Maire (1983), dans une revue de la
littérature sur le sujet note que les mécanismes amenant les femelles de
moustique â
sélectionner leur · site de
ponte dans
les
conditions
naturelles sont encore mal connus. Les tests
effectués
montrent
du milieu très diversifiés
qu'un grand
nombre de
facteurs
peuvent attirer ou stimuler les femelles
(paramètres
biophysiques,
â
1
en laboratoire
pondre en un
microorganismes,
matière
site donné
organique
en
décomposition de différentes natures). Des phéromones produites par les
oeufs,
les larves
ou les
nymphes
selon les genres et les espèces
semblent également jouer un rOle actif.
Bien que dan3
que
dans
l/H~miarctique
l'Arctique,
certaines
le climat ne 30it pas aU3si limitant
adaptations
- 16 -
sont nécessaires
pour
Page 1I-13
permettre
l'~xistence
adaptations
sont
des moustiques dans cette région. Ces principales
l'univoltinisme
permettant d'utiliser de façon
Viennent
ensuite des
et
l'émergence printanière précoce
optimale la
courte période estivale.
adaptations physiologiques telle la capacité des
oeufs à demeurer viables plus d'un hiver (minimisant le risque associé
aux variations
climatiques
annuelles)
et
la résistance au froid. En
effet, les moustiques vivant dans cette région demeurent actifs
•
jusqu'à
0
des températures aussi basses que 1,7 C et 0 C pour certaines espèces et
capables d'affronter des
stratégiques
vents
jusqu'~
14
km/ho
Ces
adaptations
et physiologiques se complètent par des modifications dans
le comportement
et les
périodes d'activité afin d'éviter
le plus
possible les conditions défavorables (Danks 1981).
En région tropicale
importants
ou
sub-tropicale les moustiques
sont d'
vecteurs de maladies (malaria, fièvre jaune, filiarose, ••• ).
"Au Canada , certaines espèces de moustiques peuvent être des
agents de
transmission de maladies daes a des arbovirus pathogènes, principalement
des encéphalites. Les plus connues sont:
l'Est
(EEE) ;
l'Encéphalomyélite
l'Encéphalomyélite Equine de
Equine
de
l'Ouest
l'Encéphalite de Californie (CE). Cette dernière est la plus
(HEE),
et
importante
en milieu nordique. Elle est, en fait, un complexe comprenant des virus
appartenant à plusieurs souches distinctes. La souche à "Snowshoe Hare"
(SSH)
de
ce groupe est la plus largement distribuée et a étée recencée
jusqu'au 70e lat. N. (Danks 1981).
Notons
- 17 -
toutefois
que l'infection
Page II-14
virale à SSH n'est
pas
considérée
comme une maladie sérieuse pour
l'homme, mais plutot bénigne, sous-clinique, non contagieuse.
De plus,
le moustique ne peut acquérir le virus d'une personne contaminée, ce qui
limite les possibilités de
contagion
potentiellement vectrices de
canadensis,
punctor,
~
et
cinereus,
A.
~
(Sommerman 1977).
Les
espèces
cette infection sont: Aedes communis, A.
fitchii ,
~
excrucians,
~
hexodontus,
~
stimulans (McLean et al 1975;McLean 1979; Wagner et al
1975; Sommerman 1977; Belloncik
~
1982)
II.5.2 LES ETUDES ANTERIEURES
Plusieurs études ont été consacrées à la
régions
nordiques
du
Canada.
faune
culicidienne des
Au cours de la période allant de 1947 à
1954, un grand essor fut donné aux recherches dans les régions Arctiques
et Subarctiques. Ces recherches avaient pour objet principal un meilleur
contrOle des
' ~ncommodait
populations d'insectes
le
personnel
installé dans
surveillance situées au nord du
arthropodes
insectes
arctiques Danks
piqueurs,
basé
piqueurs
continent.
(1981)
les
la
nuisance
bases militaires de
Dans
consacre
principalement
dont
son volume
un
sur les
sur les
chapftre entier aux
études
nordiques
réalisées au cours de cette période.
La politique d'aménagement du Moyen-nord développée par le Québec
depuis
le
début
des
années
écologiques notamment au sein du
1970 a favorisé un nouvel essor d'études
"Territoire de la
- 18 -
Baie de James".
Page II-15
Citons
et al
les travaux de Maire et Aubin (1976, 1980); Hai1hot (1979);Maire
(1979);Goyette
et
Maire
(1980);
Maire
(1980,1982).
Pour
la
localité de Poste-de-la-Baleine, nous disposons de deux études réalisées
à trente ans d'intervalle. (Jenkins et Knight
1983).
- 19 -
1950;Haire et
Bussières
CHAPITRE III
MATERIEL ET METHODES
111.1
LA NOTION DE "NIVEAU ECOLOGIQUE" OU "UNITE ECOLOGIOUE"
Le principe de la méthode d'analyse du milieu utilisée consiste à
mettre en évidence les
relations
groupements végétaux et les
existant
populations
entre la
présence des
larvaires de moustiques.
On
distingue ainsi des unités écologiques dénommées "niveaux écologiques"
caractérisées aussi bien par le couvert végétal que par les espèces de
moustiques.
Tel
que défini
par Pautou et al (1973), le niveau est l'
"unité biologique élémentaire caractérisé par une composition floristique
homogène révélatrice des conditions écologiques tant physico-chimiques
que biotiques bien définies. Le niveau est caractérisé par un
sol,
par des
type de
conditions d'hydromorphie plus ou moins marquées, par un
cortège floristique de composition et de
structure homogène et par
certaines espèces culicidiennes qui lui sont inféodées.
Cette méthode qui est
a la base de recherches entreprises sur
l'écologie des populations larvaires de moustiques du Québec et sur la
- 20 -
Page 111-2
description des milieux hygrophiles
développent
Dès le début
fut
au
sein
desquels
elles
se
précisée et approfondie plusieurs fois de 1974 â 1979.
l'on
se
rendit
compte que l'analyse des
populations
larvaires de moustiques basée sur la présence ou l'absence des espèces
pour mettre en évidence des associations culicidiennes conduisait à des
interprétations
fallacieuses
non en rapport avec la réalité écologique
(Maire et Aubin 1976; Maire et al 1979).
Il
fallait
donc
trouver un
moyen de quantifier les populations larvaires de moustiques d'une
similaire â celle de la végétation. C'est ainsi
notion
d'abondance-dominance
phytosociologues,
développement
aux
que
(Guinochet
populations
fut
de
.
populations larvaires de moustiques
biosociologique aussi
fa~on
et en
données
allait
également
végétal
et des
leur attribuant
bien les espèces
culicidiennes (Maire et Aubin 1980). De plus, cette
les
Ce
associées. En effet, sur un même
tableau on peut représenter de la même
valeur
moustiques.
des
de la méthode permettait donc l'exploitation analogue des
résultats obtenus lors de l'analyse d'un groupement
même
appliquée la
connue
1973)
larvaires
fa~on
fa~on
la
végétales que
de quantifier
permettre l'exploitation simultanée des
paramètres de la végétation et des moustiques
â
l'aide de l'analyse
statistique multivariée.
111.2
LES CUL1C1DES
La figure 5 donne la localisation des 43 mares échantillonnées dans
l'ensemble de la tourbière à palses, du 8 au
- 21 -
13
juin 1982 pour les
N
N
~pol.e.
peu
degrodee,
.~
o
Po I.e.
deg,odee.
-
50
100
150
m
0-0
Ql
I.Q
~
Figure 5
Localisation
des
mares
échantillonées
et
classification des palses selon leur état de dégradation.
C=caricaie, S=Saulaie, Sc=Scirpaie.
H
' H
H
1
W
Page 111-4
espèces à aéveloppement larvaire printanier et du 4 au 12 juillet 1982
pour les espèces à développement larvaire estival.
distribuées
de
façon
à
couvrir
l'ense~ble
Les
des
stations
sont
types de milieux
représentés dans le secteur étudié.
Les larves de moustique
(dipper)
d'un litre,
puis
cerceau. Pour chaque mare,
sont
échantillonnées avec une louche
filtrées
sur un
l'échantillon est
de 300 pm sur un
filet
constitué de
5 litres
prélevés au hasard. Les larves et nymphes sont conservées dans un "Kirl
pack" de 100 ml avec de l'eau du gîte jusqu'au retour au laboratoire.
Pour
chaque
préalablement
échantillon,
tuées
â
l'eau
les
larves
chaude
sont
de
3e
et
comptées
de 4e
stade
et identifiées a
l'espèce avec la clef de Wood et al (1979). Les larves trop jeunes ainsi
" que les
nymphes
sont mises en élevage selon la technique décrite par
Tessier et al (1981) jusqu'à
ce que l'identification
soit possible.
Chaque échantillon est conservé dans de l'alcool à 70 % + glycérine dans
des piluliers de 2 drachmes.
Tous les spécimens ont été déposés dans la collection du Groupe de
recherche
sur
les
insectes
piqueurs de l'Université du Québec â
Trois-Rivières.
- 23 -
Page 111-5
III.3
LA VEGETATION
Un relevé de végétation pour les milieux
échantillonnées
selon
1973).
la
méthode
préconisée
la
de
tourbiére.
Pour
chaque
indice
par
Braun-B1anquet
la
mesure
chaque strate, ainsi
que
Des
pour
été
d'abondance-dominance modifié
présence) à 3 (très abondant).
apportées
par
relevé de
échantillon des espèces de sphaignes présentes a
selon un
43 mares
A ces relevés s'ajoutent 27 autres afin de préciser
les limites de chacun des groupements et 18 autres
bordure
aux
est effectué au mois de juillet alors que la végétation
est à son maximum,
(Guinochet
associés
informations
la
forêt
en
végétation,
un
prélevé
allant
de
et
noté
+ (simple
complémentaires
sont
de la hauteur des espèces représentatives de
deux
transects
des
niveaux
topographiques
effectués avec les instruments de mèsure suivants: un climomètre Suprême
No
802
(Degrés)
et
un
ruban
Topofil
de
Chaix
Canadian Forestry
Equipement (mètres).
Les plantes vasculaires ont été identifiées
Porsild
et
Cody
(1980)
et
de
l'aide des
identifiées
de
avec
la
Crum et Anderson (1981). La nomenclature utilisée suit l'ordre
des ouvrages mentionnés, sauf pour les sphaignes où l'ordre de
(1966)
clefs
Fernald (1970) 8e ed. du Gray's Manual of
Botany et Cinq-Mars (1966). Les sphaignes ont été
clef
~
est
suivi.
Un
Isoviita
spécimen de chaque espèce récoltée a été déposé
dans la collection générale de l'herbier de
Trois-Rivières.
- 24 -
l'université du Québec à
Page 1II-6
III.4 LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Simultanément aux échantillonnages entomologiques, sont notées les
dimensions . et la hauteur moyenne d'eau libre de la mare prospectée; la
nature du substrat au fond de la
d'éclairement
progressif
mare,
sur une
effectuées avec un luxmètre General
la
nature du
échelle de 1 â
electric,
type
sol,
5.
le
taux
(Des mesures
214 Light Heter,
établissent pour le 10 juin 1982 que les cotes 2-3 correspondent â un
éclairement moyen < 3 000 pieds-chandelles; les 4-5 a un éclairement
moyen
> 5 000 pieds-chandelles.) ; le taux de recouvrement de la mare
par la végétation et le taux de recouvrement en eau du milieu (%)
température de l'eau
de
thermomètre ERTCO -35 â 50·C
la
mare
et
± 0,5 t. ;
la
celle de l'air, notée avec un
le pH mesuré avec un pH mètre
Digi-Sense pH Meter Madel 5985-40·Cole-Parmer ± 0,01 ; la conductivité
avec un conductivimètre OS Heter Hodel EP. Hyron Compagny en pS/cm â
l'unité près.
III.5 CALCULS ET ANALYSE STATISTIQUE
Les mesures ainsi obtenues
larves
permettent d'estimer la densité en
par m~ et la fréquence relative (%) de chaque espèce au sein de
chacun des
relevés~
culicidiennes de
Ces deux mesures servent à exprimer les populations
chaque espèce en un
indice d'abondance-dominance
similaire a celui de la végétation, variant de simple présence â très
abondant.
Cet
indice est
calculé par l'abaqùe de
transformation
Fréquence relative par espèce (%) , Larves/m! (Maire et al 1979. ;
- 25 -
Haire
Page 111-7
et Aubin 1980.) Cet abaque est présenté â la figure 6.
La distribution des
milieux
aquatiques
densités
temporaires
en
ne
larves
de moustique dans
suit pas une distribution normale.
Elle présente une distribution de type contagieux (en essaims)
et
al
1981)
Tel
(Tessier
que suggéré par Legendre et Legendre (1979) et Green
(1979), il est important de transformer ces données initiales avant
appliquer
les
d'y
les tests statistiques classiques. La transformation utilisée
consiste â remplacer x par Log (x + 1) afin de tenir compte des
relevés
nuls.
Afin de mettre en ëvidence les associations larvaires de moustique
et
de
connattre
la
descripteurs (espèces)
phytosociologique
et
structure ' des populations, nous avons soumis les
et
une
les
objets
analyse
de
(échantillons)
â
une analyse
groupement (c1ustering) par les
programmes lM, 2M et PKM du logiciel BMDP (Dixon et al 1981).
La principale méthode
discriminante
discriminante
s'applique
utilisée
(Discriminant
e~t
cette étude
dans
functlon
une technique largement
ana1ysis
utilisée
est
l'analyse
(DFA».
L'analyse
en
écologie.
Elle
â l'étude de niche, allocation des ressources, sélection des
habitats, structure des communautés, etc.
En
fait,
cette méthode
e~t
particulièrement utile pour toute situation écologique dans laquelle une
- 26 -
0
IV
10
a.
III
.,
+
U
. IV
20
IV
~
c
a.
30
40
IV
>-
:;: ~ 50
c
IV
60
~
IV
N
-...J
u
C
IV
70
80
::l
C"
"oP
90
~
00-
100
1
+
2
4
8 10
10
indice d' obondance-dominance
Figure 6. Abaque
des cu1icides
donn~nt
les indices
D'aprés Maire et Aubin (1980)
2
10!
ind . / m
10·
5
10
3
d'abondance-dominance
"CI
QI
\Q
CD
H
H
H
1
CD
Page III-9
association est désirée entre des groupes bien définis et une série de
mesures.
Le problème ne consiste plus ici à ètablir les groupes; on les
suppose connus a priori, à la suite d'un
gr~upement
ou d'une ordination,
et ce type d'analyse a pour but de les interpréter (Legendre et Legendre
1979) •
Le premier objectif de l'analyse est
de prédire la
catégorie
(groupe) a laquelle appartient une observation. L'équation de prédiction
qui remplit cette fonction est appelée fonction de
second
objectif
Le
est d'établir la "séparation optimale des groupes" à
partir des combinaisons linéaires
qualifie de
classification.
de descripteurs discriminants.
On
fonction discriminante simple le cas de deux groupes et de
fonctions discriminantes multiples ou de variables canoniques le cas de
plusieurs groupes. (Williams 1981f Legendre et Legendre 1979)
'.
Deux tests statistiques serviront â décrire les relations entre la
présence des
groupements
végétaux
et
les populations larvaires de
moustiques de la tourbière. Le premier est le test de F. Rappelons
tout
simplement que F est le rapport des variances de deux distributions noté
comme suit
~.a
, =
Sa
/
S,
Ce rapport, dans lequel on convient de mettre au numérateur la
- 28 -
variance
Page III-IO
la
plus élévée, traduit la divergence entre les deux variances S,et
Si les échantillons
rapport
sera
de
sont
tirés
En
1.
d'une même population d'origine
raison des
fluctuations
l'échanti11onage, cependant, ces variances
rapport F sera
supérieur
différent
Cette
valeur
forcément
et
ce
de
le
a 1. Toutefois, les variations fortuites ne
sont responsables de l'augmentation de rapport que
limite.
fortuites
S~.
varie
évidemment
échantillons en présence. On peut lire
jusqu'à une valeur
avec les
ces valeurs
effectifs des
limites dans une
table de F au seuil de probabilité choisi. Lorsque le rapport F dépasse
cette valeur limite, la divergence est trop importante pour être due au
hasard
CGeller 1975).
Notons
discriminante est un rapport
cependant que le rapport F de l'analyse
multivarié de
la
variance
inter-groupe
.
divisé
par la variance intra-groupe. Ainsi, dans notre cas, l'on pourra
determiner si les groupes sont différents ou semblables en
mode de
classement
fonction
du
et du type de variable. En dimensions multiples le
lambda de Wi1ksremp1it cette fonction. Cette valeur doit cependant être
ramenée a une dimension simple pour être testée selon la distribution du
rapport F. Le programme utilisé produit un F équivalent
Wilks
que
nous
i.e.
lambda
de
appellerons F-estimé. Le second est la performance de
classification des
initiale,
au
échantillons
le
groupe
en
auquel
fonction
il
est
de
CD>
de
chaque
classification
sensé appartenir.
performance exprimée en pourcentage est calculée
générale de Mahalanobis
leur
Cette
a partir de la distance
échantillon â la moyenne des
échantillons. La probabilité d'appartenir â un groupe est le rapport
- 29 -
Page 111-11
(n étant
le nombre de groupes).
Ce
rapport
est
affecté par la
probabilité initiale d'appartenir a un groupe.
La representation des observations selon les variables
dans
canoniques
un espace de dimension réduite (espace canonique) est généralement
utilisée. En plus d'obtenir une image de la répartition des groupes l'on
essaie
également
coefficients
des
d'interpréter les différences
fonctions
par l'examen des
(canoniques).
discriminantes
Ces
interprétations doivent cependant tenir compte de nombreuses difficultés
conceptuelles
statistiques particulièrement de la
distances par les
transformations
canoniques
distorsion
des
(Williams 1981). Cette
dernière approche ne sera pas .utilisée dans cette étude.
'.
La figure 7 presente le schéma d'analyse du milieu en relation avec
la théorie des unités écologiques. Il se divise en deux
la
formation des
parties,
soit:
groupes et la discrimination entre ces groupes. La
formation des groupes se fait en utilisant la méthode phytosociologique
classique
et
est
vérifiée par l'analyse de groupement PKM (K-means of
cases) du logiciel
distance
entre
BMDP.
un
Cette analyse pour
cas et la moyenne des
simplifier calcule la
cas dans
son groupe.
L'expérience démontre que cette analyse colle
particuli~ement
mode de
Elle
classification phytosociologique.
- 30 -
bien au
présente l'avantage
MILIEU
Formation des groupes
lA.)
......
MOUSTIQUE
VEGETATION
Analyse
discriminante
Physico - chimie
Physico- chimie
"0
PI
Figure 7.
Schéma de l'analyse discriminante.
I.Q
('1)
H
H
H
.....1
N
Page 111-13
d'essayer des combinaisons multiples très rapidement et de
comparer la
variance des groupes.
On peut classer les groupes retenus en quatres catégories selon le
critère utilisé
pour
leur formation, soit: l)les plantes vasculaires,
2)les moustiques , 3)les sphaignes et 4)les
l'état
de
dégradation physique des
secteurs de palses
buttes
(Fig.
5).
selon
L'état de
dégradation des palses est déterminé d'aprés les critères suivants:
Peu dégradé= Lichens et arbustes sur le sommet
Dégradé = Tourbe nue sur le sommet
Très dégradé= Tourbe nue, argile et blocs sur le sommet
Lorsque les groupes sont constitués, le problème consiste â trouver
les
combinaisons linéaires de descripteurs discriminants qui . maximisent
-'la différence entre les groupes tout
en minimisant
la
variabilité â
l'intérieur de chaque groupe. Chaque élément de la partie discrimination
de la figure 7 est testé en fonction
appartenir,
selon l'hypothèse
du
groupe
suivante de
auquel
la
il
est
théorie des
sensé
unités
écologiques:
Une . communauté larvaire de moustiques
caractéristique
correspond à chacun des groupements végétaux distincts de la tourbière à
palses étudiée.
Hypoth~~e:
l'hypothèse nulle devient alors:
Dans la tourbière à palses étudiée, l'on ne peut reconnaître une
communauté larvaire de moustique propre à chacun des groupements
- 32 -
Page 1II-14
végétaux
dis~incts.
Le raisonnement a l'inverse suit le même schème (groupes formés par les
moustiques).
Le programme utilisé est l'analyse discriminante par étapes P7M du
logiciel
BMDP.
Les données utilisées sont celles constituées par les
indices d'abondance-dominance. Ces données présentent
se rapprochant
une distribution
des conditions de multinormalité. Les descripteurs sont
métriques. Ce qui est conforme aux conditions stipulées par Legendre
Legendre (1979) pour cette analyse.
- 33 -
et
CHAPITRE IV
RESULTATS ET DISCUSSION
4.1 LA VEGETATION
4.1.1 ANALYSE FLORISTIQUE
La flore vasculaire de la
tourbiére
â
palses
étudiée
comprend
90
.
espèces. La liste des taxons est présentée en annexe I. Les récoltes ont
permis d'ajouter deux nouvelles mentions pour Poste-de-la-Baleine,
soit
Antennaria pulcherrima et Carex livida. Ces deux espèces soht calcicoles
et d'affinités subarctiques
(Rousseau
1974).
D'après les
cartes de
'.
distribution de
Porsild
et Cod Y (1982)
et Rousseau (1974) ces deux
espéces ont été récoltées plus au nord.
La liste des familles est présentée au tableau 1. Les familles
plus
abondantes
sont les Cypéracées (20 espéces), Rosacées (7 espèces)
et les Ericacées (7 espèces). Le tableau 2 donne le
de
la
tourbière
les
à
spectre
biologique
palses, comparé a celui de Poste-de-la-Bale1ne. Le
pourcentage de chaque forme est sensiblement le même dans la tourbière â
palses que dans l'ensemble du secteur. Les affinités phytogéographiques
de la flore vasculaire confirme le caractère nettement Hémiarctique
Page IV-2
Tableau 1.
Nombre d'espèces par famille
NOMDRE n'ESPECES
FAMILLE
PInacées
3
Lycopodiac ées
1
E4uIsctacécs
2
Joncllginacées
1
Potamogetonacécs
l
l.11iacécs
J
Orclllùncï;cs
1
Juncacécs
2
Salicacées
4
lJetulncées
1
l'olygonacï;es
1
Cyperacées
20
Poacées
4
Drassicacécs
1
Renonculacées
J
Dr06crncécs
1
. Saxif ragacécs
1
Ho s a cé es
7
Vlolacï;eR
2
Curnllcées
2
Pyrolacées
1
Ericacées
Empetracécs
1
Ncnyanthacées
1
Scrophulariacées
4
I.entil>ulariacï;cs
)
Rubiacées
1
Caprifoliacées
1
Va loé rinnacécs
1
Astt;racécs
9
Totsl
90
- 35 -
Page IV-3
Tableau 2.
Comparaison entre les spectres biologiques de la
tourbière â palses(TP) et Poste-de-la-Baleine (PDLB)
FORMES DIOLOGIQUES
TP
n
i.
n
i.
8
9,2
38
7,8
CHAMEAPHYTES
12
13,8
83
17,0
Il EMI CRYP TOP HY TES
47
5/.,0
251
51,4
GEOPHYTES
16
18, l.
69
1/.,1
14
2,9
PHANEROPHYTES
THEROPHYTES
HELOPHYTES
2
2,3
15
3,1
HYDROPHYTES
2
2,3
18
3,7
87
100,0
488
100,0
Total
1. D' après Forest et Leyaut (1977)
n: nombre d'espèces
- 36 -
Page IV-4
de la tourbière étudiée (Tableau 3.)
représentative
de
la
zone
diffèrences
floristiques
Trente-sept
pour
Ainsi
cette
tourbière est
bioclimatique. étudiée
par rapport
à
et présente peu de
l'ensemble
du
secteur.
cent des taxons de la tourbière sont considérés comme
rares et peu communs c'est-â-dire n'existant qu'en peu d'exemplaires
très dispersés ou
peu
fréquents
cette
étude
et
dans leur habitat selon l'étude de
Forest et Legaut(1977). Ceci s'explique puisque le
par
bien
territoire couvert
~
couvre une superficie de 100 km (aire myriamétrique)
dans laquelle les tourbières â palses représentent à peine
2 % de la
surface totale.
.
L'analyse de la flore invasculaire se
Nous
limite
au
genre Sphagnum •
présentons la liste des sphaignes récoltées en annexe II. Dix-huit
espèces ont été recencées; ce nombre représente
connues
au
Québec-Labrador.
Les
affinités
% des
43
espèces
42
phytogéographiques des
sphaignes de la tourbière, établies d'après Isoviita (1966) et Gauthier
(1980),
montrent
que
toutes
les
espéces
sont
circumpolaires avec
diverses tendances, sauf Sphagnum pulchrum, (Braithw.) Warnst.
qui est
amphiatlantique, ouest-pacifique subocéanique. La section Acutifolia est
la plus importante (8 espèces). Elle représente des espèces généralement
petites
croissànt
Sphagnum russowii
identifiés,
en
est
coussins
ou
en
banquettes.
le plus abondant
(12
%
De
cette section
des
échantillons
n=lOO). Sur les banquettes de réticules, il occupe la place
de Sphagnum fuscum dans le Subarctique (Mailhot 1979). La section
- 37 -
Page IV-5
Tableau 3.
Comparaison des affinités géographiques entre les flores
de la tourbière à palses (TP) et Poste-de-la-Baleine (PDLB)
PDLB
TP
TYPE DE DISTRIBUTION
n
nt
%
n
nt
%
16
1
4
2l
23,0
101
12
16
8
137
28,7
circumpolaire
amphi-atlantique
améric ain
est -amé rica in
16
30
34,4
78
7
32
21
138
28,9
circumpolaire
amphi-atlantique
américains
est-américain
11
30
34,4
53
3
68
30
154
32,0
5,7
38
8,0
américa 1n9
12
1
15
est-américain
la
4
0,8
6
1,3
circumpolaire
amphi-atlantique
américa in
ARCTIQUE
est-américain
ARCTIQUE-SUBARCTIQUE
SUBARCTIQUE
SUBARCTIQUE-TEMPERE
la
4
15
4
circumpolaire
amphi-atlantique
américain
TEMPERE
est-américain
ENDEMIQUES POUR LA
BAIE D'HUDSOtl
1,1
1. D'aprèp Forest et Leyaut (1977)
n: nombre d'espèces, nt: nombre total d'espèces
- 38 -
Page IV-6
Cuspidata est caractéristique d'espèces
dépressions
humides
souvent
24
palses dans
% des
croissant dans les
submergées. Elle occupe le second rang (5
espèces). Sphagnum riparium, facilement
constitue
robustes
échantillons.
l'ensemble de la
identifiable
sur le
terrain,
Cette espèce colonise les mares de
tourbière,
bien que
légèrement
plus
abondante dans le secteur de palses peu dégradées.
IV.l.2 LES GROUPEMENTS VEGETAUX
Le classement des unités de végétation se limite
Nos
groupements végétaux.
végétation des tourbières
système de
connaissances
à
palses
ne
classification hiérarchisé
l'établissement
à
trop
fragmentaires
permettent
comme
de
sur la
pas d'adopter un
celui de Braun-Blanquet
(alliances, ordres et classes). En raison de la
méthodologie
adoptée,
les
tableaux phytosociologiques comprennent aussi l'abondance-dominance
des
culicides.
comparaison des
Abstraction
88
en
sera
faite
détaillée.
cette
relevés de végétation à permis
l'existence de 5 groupements végétaux soit: la
saulaie,
dans
cari~aie,
partie.
La
de reconnaître
la scirpaie, la
la pessière et la bétulaie dont nous donnerons une description
Le
tableau
4 présente les mesures
ayant
servi
à
la
dénomination des · strates selon la classification proposée par Payettte
et Gauthier (1972). Une carte schématique des
groupements
au 1:5 000
(figure 8) donne leur répartition spatiale au sein de la tourbière. Les
tableaux 5 et
6 présentent
les
groupements végétaux
l'analyse phytosociologique.
- 39 -
résultant de
Page IV-7
Tableau 4.
Caractéristiques des strates de la végétation
de la tourbière à palses • .
ESPECE '
HAUTEUR
MOYENNE (m)
CARACTERISTIQUE
DES STRATES
P-<.c.e.a nraiUana.
(30 relevés)
3,6
arborescente basse
P,Lce.a mcvU.a.na
6,0
arborescente basse
3,9
arborescente basse
Betula. 9.la ndu1.o -6 a
(10 relevés)
0,63
arbustive basse
~9y~oca~pa
0,59
arbustive basse
1,5
arbustive basse
0,46
herbacée basse
(1 0 relevés)
LaiUx .ea.JUuna.
(JO relevés)
Sal-<.x
(10 relevés)
Sa.U x p.e.an-<.6ow
(10 relevés)
C~ e. X aq ua..t.U..i..6
(8 relevés)
Dénomination des strates d'après Payette et Gauthier (1972)
- 40 -
1
IV-a
Page
~
8
. .
e
e'
0
.~
ëi
VI
0
i
~
8
."
2
v
0
0
~
,
2
ga0
.~
I!
• ;e0
~
U
v
VI
0
.~
0
- 41 -
~
e-
~
II>
v
01:>N
~poises
peu
de9rodee~
~
o
Po ises
d eg,odees
SO
100
ISO m
00
PI
Ul
(1)
Figure 5
Localisation
des
mares
échantillonées
et
classifi cation des palses selon leur état de dégradation.
C=caricaie, S=Saulaie , Sc=Scirpaie .
~\.0
Page IV-IO
Tableau 5.
Caricaie,Scirpaie,Saulaie et culicides
--------------/11o 4\1 ni ...
'(("'IIIW'"
IA4ll LMlc.irlll
+ +
nUl! "lIUSfIVl IAsn
I,(uü ,tut1ulou
Iflu~U...w.
'icrc
• +
uUtlM,.
1 +
1
+ +
+ •
+ +
polilot.ic
... +
t
+ +
..•
.. .. + + + • .. .. .. .. +
+
hdlMlt g"lu"lGIWiUu.
Satil prd.(ccll4Au
À"'"O"'~
+ + +
+
+ + +
"""CM
14-'ü !Mid,...
(diAU,
+
+ +
+ •
++++.+-
+ +
Scal,ü C'IfV'\0CA"l'"
$cLU. plu.c:'oLtc
....
+ +
•
• '.
flou~o",.yU.
••
~:~~!!.J~!!~
s.tir .... tto~lUla
111
1
Il
Il
Il
1
Il
1
1
1
1
1
1
l " "-4<:'' I0IIII "UllIu
CIIPCtAu.- Mg.w.
~AÇ!!
,
Ca}! .... &4UA(ltU
)
2
1
l
)
)
Sei "f'U cupi (0'''"'
2
,
)
••
Lbu. c" .... ~'1Il.
WO~O"UII ."!lu.t.i,o~
,
2
•
t
2
1
2
2
•
+ •
,
,
2
J
)
l
)
l
)
2
1
J'
)
•
• + •
Cuuc:."ucr".
c~"",dt~.u
C."u ~,( ,tO Il .
('4.\(t JIIlIIP«tW.t.
)
)
,
1
1
Il
1
1\
Il
•••
+ •.
1
)
• +
CGlUCI94.0'tü
•
2
.",lI," acftulu
'ot,..tlU. ptlu. t , 1.4
r"io""o,1.IIII 4UUlOluIII
hlOv'UM.. . ,pi HYM
Sotida.go pu.,uhU
,tl~u~
,u.uw .
Ca.\u
'olY9 o_
v.(\lipc&JUlotl
CC-.!' hptdt. ·
i4tJ.cU.
""da
~;~!!l::~~!~CUM
,y (, \ puIlit"""
Va"" l"gr (ow4
l
Ge"", o\.ilHllt
lli!!f.!!!!
)
$pha."" ,u,PtAU-
$""-9-
•
. U U OWI j
SpII.a, ... ,""CUIII
SpIwa9"''' 'l"'boIIUII(utII
SpII49rlU1111 (tAU
)
1
l
1
1
•
•
11
S,.hIlI)IIWII '41&4"0'"-S~9"'" t..ü,db'·' 9'{
SpII.a,MMI ,.iAgrl\toltllÜ
+
i
l
l
~J~(-!t!!!)
Ardu
.a«du
A'dU
A,dU
Ardu
III
III
Il
1 1
1
•• ••+ ••
•i •
1
l
htodOlt(..w,
l
1
,PLIneC"
e~,"'
ueN.u:tA1t4
•
,•
plo""".
1
l
1
i
•
•• •
,
l
1
,• •
1
.,
l
1
•
('LI(iUtd duh'lt.u
('LllL U(. UIIpdfult'
Ardu IIuodolt( lw
Ardu ue""c..i. IW
"1
t
1
1
t
Ardu pi.ONpA
Ardu t.Aud«AIou
•
euht tt-\.-\i1.Ivw
Atdu(.~
ln owtn d.n. 1•• ullv" : 110 1. (' •• du,It' J'VIal'It,i, +, no 11 . Nt"Yd-Itth,. h l ,otl4(11 ' . r" i"toclt", "'l(.UIU~ +, "0 21 . P<t ou '" . /" ' ",:rl"tt •• ' . r\r " .
- - - -- -.- -.. -- - Ut.o Utu/a..'" Ü.ttltlllf.d44 +. no ,) . VcltA.-UtM dcoArlII 'fIr . 'VtV/lllÎCII +. no \4 . ('lUlU blUlI... Urt .... +. C"'doI.,,ltf P'!4tf ... U ' .
ao 51 . ('IlL"" b'mlltlÂt'''''. , no ' • . Pr~ r ul4'.Ü (.boudo,,"",eA ., 110 60 . Arlu ttr •• b.·u oatil +, no 6l. J.I,nloldltth, h " O(IIi/. +. "0 U . VI I' l a , .. b,,. ... '0' • • ,
HU . J.... ue ... (41Jf'U .. .i. ru- . ,
i .. vi A4lntA,. +, •• H. Ut.\lcutAA..ût i"tfA."U... , no 61 . Adldtr. b"Hdu • • no 1) . ('AAr. ~o.tMf. " rIO 1\ .
O"O'e.u .. ot.uNli'ow +, .. .,. Viol .. t.b".,w.\.u·AlI • •
"'.qa.
lA chtU ...
1I:.,..... '0ft4
"
III
Il
Il
1 1 · .... ft4.nc:. ; .k"IIIln.M . . . . . . " ••• 1,. • • -111 •• ,""
••lA !!..!!!!.I
_fi;.,•• ""Un
"0) .
, ..... l' •••• ''c .....
(l'U), ,--allie ••• c...ltcl' ••• 1· •••" ....
'r''''''o"o:.
(l
t •• nl
0" •• 1 ' •• ,le ••• ". l i ni... .
1.. c.trle '''dt.''. 1.' r.l ••'
- 43 -
d ....... t.IIt." ... .,1 ••• '"
"I. r l,,' ( 1' / I.,. •• ,.J
Page IV-ll
Tableau 5. (suite)
.."hl. 1 S.tlll '.\'V'oc.~~
Scirpe" l SdA'.... CUp(.to,,,,,
st Br,CId..
llu'(o ...
"t...
et S&U.. pli"';' 'oU.
!!!.~~IA:;S'
1
'<lCU III:L\.(.4lY
I.&.Ul lA4lc.iM
Il
STlATI.~~
8r (nb 9 t 4Mllto ..
S4U.
MglJ.\Ot4.1tpt
• ••
1
!:!-:~~~~!rftQ'_
ricu ............ ,..
~:!:::!~ .f:~!!:':'
••
~/tt aA((op"a.
to"ic,-1., ~Uto ..
[.,,~
1
•••••••
• •• •
1".. ,- l&4id.,..
lrd"" lJ'UtAl.. PldLcIMll
SAll! puUctt~
kal",ÛI, poU ,oUa
A"d"lolllrw. .taucopftvu.
1
Il
Il
Il
+
,
+tll
• 111
1
1
1
1
1
III
III
III
1
1
1
Il
+•
IU.g"lMII
,
•
1
•• • +
. • . •·
+ +
•,,
1
Il
.n.'TI K!UACU
C4AU
'qUG titu
cupit06W
Sci~ptW
lutm.
+ ..
t.ÙpftO"lUM ."91.Wl.·qot.UClLo'Itl (4"Uer'"
Car4*g"oUü CAl'tIldtIWit
CIL\CII
1
C"UI plUPt,c!&l4
Rubw U4U.tÜ
hiopl.o .. u. .pi.uu.
$otiddgo pu.t6W
,w..U..
..u-""
Il
1
>\A"i'to ...
Pol,rtWl. pal.cutAU
h.topfto.. u. "IuufOlUIII
1
1
•+
I!II#,wItN"I1U
••
..
..
.. +
..
Onu ... oti U.. ,
·
+
1
1
• III
.
•1
••
1
Il
1
•
Il
1
PoI1J90,uUII\l{vi~
ral,!1 hpl4l.u. ·
"'HeU. "1.Id4
Il
Il
1
1
1
1
C""'I' 9Ii"OC!A4(U
Gollu. tab4.lldo.ucu.
~t"
puMt:(.uA
CAHI bl!l,ruwI(,
••
GCu.llU~t
~tCNU
1
Sr"-cl9 .... .uP"l~
Sph"9""'" H'Ut..... '"
·
S""«glUl 'I.iJoCtMI
SpM9/111..
,u.-btialUlil
Splta91W111 ttAU
+
SpllogltWII 'qIl4"'\O'UIII
Splld!JIlUIIIU~bf}l9a
1
1
1
1
1
SphagN.lllt .lAfrlUok","
CI1LIC~(~..!!)
Ardu AuodorttiU
Ardu J'U"UO\ .
"rdu t:o_",i.
•
1
1
Af du tt C." uCÂoI".
Afdu ",..·o""p'
Cuttufa ,.llullulU.i.t
C'ull uta '''''JlI('''''
Acdu Itr.odc"tu.
Âldu ue...uc.ia ""
Acdu ,w,of\i p6
Ardu t:1l""dlJûU
C...lu (,,,,,UtUW
hdut:~
- 44 -
Il
,
t
1
•
•••
1111
•
Il
1
1
Page IV-12
Tableau 6.
Pessières.
i
a
1
1
1
l'eHRI~re
cl ,,<111111 "H
rc""'~rc
mm'HHCH
a
1
--------------1--------------1 -l------------------T-No clu relevé
1
13 14 11 10 08 09 121
F 106 05 01 04 03 07 02 16 17 18 151 F
1 __ 1L _________________ J1__
______________ 1_____________ L
~
STRATE AHIIOIŒSLENl'E
IIASSI~
Picea mall.ial1a
!.Mü lall-ic.il1a
STRAn;
ARnIiSTIV~:
v
3
2 1 2 2 2
3
+
+
3
2
V
+ III
+ +
HASSE
P.icea mallA'ana
Vacu"i/lm /lUg ,il1owm
Betu.la gfal1r/ulo6a
JlIl1ipVt'~1 commlll1i~
v
v
2
+ +
+ + + +
+ + + + + +
+ +
+ +
+
Kalmia pof-i6oUa
L~dllln g'LDel1tal1r/icum
Ernpet/tliln hMmUpl''LodUum
+
+
+
,,1f{{'LOrn~d,1 !lfnucu,.,I'~ltla
V
+
t
32++++V
++322+V
+ +
+ +
III
Il
l
l
+ +
+
III
+
Il
+
+
+
+ + +
+
+ +
+
+
II
+
1
+ 1 +
La"i~ falli cl "a
Saf ü pcr/lce{'fa'Li.6
Safü a~c(opl,lr.a
Il
+
+
+
...
+
V
III
III
11
II
STIIATE IIERIlAr.EE liASSE
l1u6 callar/(' ,,,\ 11
"1<Je'",'i i
V,"onlrn ' ofpil1n
SCill~~H cell.tl tOI'16
[qulldurn 6"fvn(,icllln
1
J
RoIHl~ 1.·'/f"1II1{lm(l~'It~
+
COli
Ca,,~~
re ta 6.UC 1 pa fmn tu.l
IIabel1aiUa dUata ta
Sotidago pUJt.lll.i i
Ca"e~ IIaJt.i 6r.olla
JUI1C"6 baftic"6
rer/ic,Lfa'Ll6 glloenlal1dica
Calle ~ aqua ti fi.6
A.l tell pun.iceu6
T(vra~acum fappollicum
CMn pauc.i6loJta
+ + + + +
IV
+
lV
111
+ +
1
+
IT!
1
1
+ +
+
1[f
+ + +
J
1
Il
l
J
1
+ + +
J
1
+
+
1
1
l
+
T
+
II
II
+
IV
Il
1
11
+
+
1
+ +
+
+
+
TV
... +
+
1
1
1
... +
TI
II
l
+
l
II
+ + + + +
+
+
+
1
...
III
J
Il
l
l
+
+ + +
+
+
+ III
STRAT E H1ISCINAI.E
Cladon.ia
Splragl1l11n
Splragl1l11n
Spl,agtlum
Sp"ngl1l11"
SI'P ,
6"6cum
IIuM',"IIU
a 111]116 ti.6oUum
t i mlhe,,!) i i
3
IV
+
+
+ +
+
3
Il
II
l
T
3
III
l
l
2
no 3. EiUopl,o/Uim 6pW611m +, no 7, Ca6üUeja HptentiUol1aÜ4
l'otel1ûUa
tico6a +, no
CopW W60Ua +, Viola
lablladoiUca +, no 10. SoUdago mtlcllopllijUa +, Ep<lobium al1!l"H~6ot.ium +. no 12, rhleum
comtnlltatllm +, no 14, C(Vle~ vn!ltntl ,ta +, no 15. Amelanchiell bMtllamiana +, no 16 . JUI1CM
atbuceM l, no 17, redicllflllt.t6 lablladotUca +.
~~_~~::~_~~~~_!:~_:~!~:::_~:!:
nll"
- 45 -
8.
II
+.
Page IV-13
Finalement
la
disposition de
ces groupements
selon
un
gradient
topographique est présentée a la figure 9.
A)Cariçaie é Carex aquatilis (39 relevés)
Ce groupement est caractérisé par la dominance de Carex aquatilis
Hahlemb. dont l'abondance varie d'un
relev~
a l'autre. D'autres
herbacées accompagnent Carex aquatilis, mais l'assemblage des
espèces
varie d'un relevé â l'autre de sorte qu'aucune n'est caractéristique ou
constante du groupement. Carex canes cens L., de meme que Calamaqrostis
canadensis
(Michx.)
Beauv.
et
Rubus
cha na emoru s L.,
sont les plus
fréquentes bien que leur recouvrement demeure faible. Au niveau du
la
strate muscinale,
sol,
.
composée en grande partie de sphaignes, est bien
représentée. Sa composition en espèces est cependant très variable d'un
relevè â l'autre. Sphagnum riparium Angstr. et Sphaqnum russowii Warnst.
sont constantes dans le groupement.
Les
arbustes
sont
présents dans
"
presque
tous
les
glandulosa Michx.
cariçaie
laricina
faire
est
(Du
un
relevés.
est
Leur
recouvrement
l'arbuste dominant.
caractérisée par
une
fréquence
partie
plus
est de
cette
élevée de Larix
Roi) Koch. dont l'importance ne permet pas cependant d'en
sous-groupement
typique.
représente 58 % (estimé d'aprés
retrouve en bordure des mares
la
La
cariçaie â
carte)
de
la
carex aquatilis
tourbière.
On la
de palses, des mares ordinaires et
des étangs. Elle forme parfois de vastes
plates
La
demeure faible. Betula
prairies dans les
étendues
entre les buttes de palses très distancées. La cariçaie â Carex
- 46 -
Page IV-14
B
'ftAHSr CIl
a
..
..,"
c
cs
Pm
Pc
a
0::0
::J'
w~
.....
J
<
.
.
La
a
ID
-_.
' .--H-
a
()
ID
....
a
()
N
....
o
n
'"'"
a
"
~.
-,-~
0 . 00
:::
'0 . 00
100 . 00
a
0::0
~
::J
..
ISO . OO
~';n uo
JOU . UU
OIS r "NCf (M)
2I1U . OO
J"O . UO
"HI . nu
",U . UO
"UO . OU
IRAHSrCI 2
J: .
::Jà
,----,--,-,··- ' -··l--'--- , -- ,···-T"--'---l ----y-·1
i
i
Pm
c
P B
c
s
Pm
Pc
<
:ra
.
n
GO
/
a
a
ID
....
o
"
'~If---'--'-
~-,
'"
....
a
.'"
n
n
a
~.I--'----'i-,--,----'--r--"-I-r---'--1-1-'-r-,
0 . 00
'0 . 00 '
100 . 00
150.00
2UO . 00
2 ~ O . [)0
JUU . OU
J~O . OO
OIS r ANrl'
--T-.--r-'----1
'OO . OU
'''0 . 00
"00 . 00
(M)
PC: Pessiére à cladonies, Pm:
Pessiére à mousses, C:
Caricaie à Carex aquatilis, S: Saulaie à Salix argyrocarpa
B: Boulaie Betula glandulosa, P: Palse
Figure 9. Répartition des groupements végétaux selon le
gradient topographique (Exagération de l'angle de pente lO%i
- 47 -
Page IV-1S
aquatilis
peut , occuper
topographique.
Le
plusieurs positions par rapport
transect
2 de la
la
niveau
figure 9 le démontre bien. Ceci
semble da au système hydrologique inhabituel des
Ainsi,
au
tourbières
â
palses.
présence d'une nappe phréatique perchée entre les palses due
au pergélisol (Railton 1968) expliquerait l'installation de cariçaies â
Carex aquatilis au niveau le plus élevé.
B)Scirpaie â Scirpus caespitosus (14 relevés)
Ce groupement caractérise les
prairies
tourbeuses dominées par
Scirpus caespitosus (Pallas) Ash. & Graeb. Le sol y est ferme voire sec.
Le recouvrement de Scirpus caespitosus est généralement élevé, celui des
autres herbacées faible. Carex rariflora est la seule herbacée constante
du groupement. La strate muscinale 'composée de
plusieurs espèces de
bryophytes notamment du genre Polytrichum (observations personnelles), y
comprend peu de sphaignes. Les quatre relevés mentionnant des
sphaignes
"sont ceux effectués sur des banquettes de petites tourbières structurées
sises en bordure de lac. Néanmoins le nombre peu élevé de relevés dans
ce groupement
sous-estime l'importance des sphaignes. Les arbustes y
sont abondants. Betula qlandulosa est l'espèce dominante
bien que
son
recouvrement demeure faible. Cette espéce est constante du groupement.
La scirpaie a Scirpus caespitosus couvre environ 36 % de
Elle
est
localisée principalement dans
cependant la
pr~5ence
de petites
la
tourbi~re.
le secteur sud-ouest. Notons
plages de
Scirpus
caespitosus
en
bordure de la pessière. Ces plages peu nombreuses n'ont pas été figurées
- 48 -
Page IV-16
sur la carte.
C)Saulaie à Salix argyrocarpa (16 relevés)
Ce groupement végétal consiste en une
dominée par
couverture arbustive
basse
Salix arqyrocarpa Anderss., que complète Salix planifolia
Pursh •• La strate herbacée y a un faible recouvrement. Rubus chamaemorus
y
est l'espèce la
plus
abondante.
Les espèces de milieux ombragés
humides Mitella nuda L., Galium labradoricum Wieg., Aster puniceus L. et
Geum rivale L.
sont
caractéristiques du groupement. La couverture de
sphaignes y est peu importante. On y retrouve de nombreuses hépatiques â
feuilles et à thalle, notamment Marchantia polymorpha, près du ruisseau.
La pessiere
èva1uation de
en
bordure de
la
tourbière a été exclue de l'
la superficie, puisqu'elle déborde largement les limites
du secteur étudié. Ce groupement se divise en deux types, la pessière à
'. mousses et la pessiére à cladonies.
D)Pessière à mousses (11 relevés)
Il s'agit d'un groupement végétal
constitué d'épinettes
noires
(Picea mariana) (Mill.) B.S.P. clairsemées d'environ 3,6 m de hauteur. A
travers les
épinettes apparaissent quelques rares mélèzes
(Larix
laricina) de taille équivalente. Cette pessière est située sur un relief
de pente basse de part et d'autre de la tourbiére (Fig. 9) Ce groupement
précède généralement
lacariçaie à Carex aquatilis • Sphaqnum fuscum
- 49 -
Page IV-17
(SChimp.) Klinggr. y forme
lesquelles
croissent
des
buttes
plus ou moins
principalement Scirpus
élevées entre
caespitosus et Rubus
chamaemorus. Pedicularis qroenlandica Retz. et Carex paucif10ra Lightf.
sont
caractéristiques du
groupement.
La strate arbustive traduit une
bonne regénération de l'épinette. Ces arbustes
avec
un
y sont
très
abondants
faible recouvrement. Empetrum hermaphroditum Hag. est l'espèce
constante du groupement. On le retrouve principalement au pied des
arbres.
Vaccinium uliqinosum L.
y est
très
abondant.
Une zone de
transition entre ce groupement et la cariçaie est constituée d'arbustes
isolés de
Picea mariana
et Betula qlandulosa. Carex aquatilis a dans
cette zone un recouvrement d'environ 20%.
E)Pessière
â
cladonies (7 relevés)
C'est essentiellement une forat d'épinette noire (Picea mariana) de
densité moyenne
sous laquelle s'étalent de grandes colonies de lichens
du genre Cladonia.
Juniperus
communis L.
et
Carex
biqelowii
sont
"
caractéristiques du
espèces démontrent
groupement. Avec la présence de cladonies ces deux
bien le caractère
sec
et
subarctique
de
ce
groupement.
F)Boulaie à Betu1a glandu10sa
Ce dernier groupement
caractérisé par un
fort
recouvrement de
Betula glandulosa est localisé dans le secteur nord-est de la tourbière,
en bordure de la saulaie. C'est un groupement
contenant
aucune
mare
temporaire ou
- 50 -
essentiellement sec ne
permanente.
Aucun relevé de
Page IV-lB
végétation n'a été effectué dans ce groupement.
Les buttes de palses elles-mêmes ont été exclues des relevés de
végétation.
Nos
observations
personnelle~
permettent
cependant d'en
tracer le portrait type. D'une façon générale, le pied des
buttes est
caractérisé par Rubus chamaemorus. Le flanc des buttes est colonisé par
Betula qlandulosa avec un fort recouvrement. Le sommet dénudé et sec est
caractérisé par une couverture dense de lichens dans laquelle croissent
des
tlots
clairsemés
Pedicularis labradorica
de Betula
et
q1andulosa,
Ledum
qroenlandicum,
Carex bigelowii. Parfois un clone de Picea
mariana ou de Larix laricina y est présent. Ces observations
concordent
avec les descriptions de la végétation des buttes de palses du Golfe de
Richmond (Lagarec 1979; Samson 1974) et du nord de l'Ontario, â
de
l'ouest
la Baie de James (Rai1ton 1968): La couverture nivale des tourbières
â palses influence directement cette distribution
1972);
ainsi la
(Payette et Lagarec
hauteur du bouleau glanduleux (Betula glandulosa) sur
""les flancs de buttes est supérieure â celle sur le sommet (Samson 1974).
Une
section de tronc de deux" épinettes noires (Picea mariana) croissant
au sommet de ces
buttes
a permis d'établir l'age de ces arbres
respectivement â 90 et 120 ans.
- 51 -
Page IV-19
IV.2 LES MOUSTIQUES
IV.2.1 LES ESPECES ET LEUR PHENOLOGIE
Dix-sept espèces de moustiques ont
Poste-de-la-Baleine
espèces sont
(Maire et Bussières 1983).
prèsentes dans la
apparaissent
en
été re'c ensées dans
foncé
à la
tourbière à
figure 10.
Parmi
région de
celles-ci,
palses ètudièe.
Toutes
(distribuées en Amérique du Nord et en Eurasie), à
canadensis
la
sont
9
Elles
holarctiques
l'exception d'Aedes
Aedes hexodontus et Culiseta alaskaensis sont des espèces
typiquement arctico-alpines (Maire et al
1979).
Aedes hexodontus
est
caractéristique de l'Hémiarctique et Aedes punctor du Subarctique (Wood
et al 1979;Maire et Aubin 1980;Maire et Bussières 1983). Les
présentes ont
toutes
été
9 espèces
citées au moins une fois en milieu tourbeux
ouvert ou fermé (Maire et Aubin 1980). Sauf Aedes hexodontus, toutes les
espèces y atteignent leur limite nord de distribution (Fig. Il). Culex
territans est signalé dans ce secteur par Wood et al (1979).
'.
D'un point de vue phénologique (Fig. 12), les populations larvaires
qui
apparaissent
successivement dans la tourbière à palses sont Aedes
communis, A. punctor et
~
dévelopement
printanier
larvqire
.
hexodontus. Dans une deuxième
tardif,
notons A.
excrucians,
~
)
pionips et A. canadensis. Les populations larvaires des deux
Culiseta
catégorie é
espè~es
de
ainsi que celles du Culex territans n'ont éclos qu'à partir du
24 juin en 1982 (Maire et Bussières 1983).
- 52 -
Page IV-20
l.
Aedes (Aedes) cinereus Meigen
2.
Aedes (Ochlerotatus) canadensis (Theobald)
3.
A,. (Och.) communis
4.
L.
5.
L. (Och.) diantaeus Howard, Dyar et Knab
6.
L. (Och.) excrucians (Halker)
7.
~
8.
L. (Och.) hexodontus Dyar
9.
L. (Och.) impiger (Walker)
Geer)
(De
Wch. ) decticus Howard, Dyar et Knab
(Och.) fitchii (Felt et Young)
10.
L. (Och.) nigripes (Zetterstedt)
ll.
L.
Wch.) pionips. Dyar
12.
~
(Och.)
13.
L.
(Oc~ ~nctor
14.
L. (Och.) rempeli Vockeroth
15.
Culex (Neoculex) territans Halker
16.
Culiseta (Culiseta) alaskaensis (Ludlow)
17.
~liseta
~llatus
(Coquillett)
(Kirby)
(Cs.) impatien! (Halker)
Figure 10. Liste des espèces de moustiques
Poste-de-la-Baleine.
D'après Maire et Bussières (1983)
- 53 -
inventoriées
à
Page IV-21
-ze> ~-
Q..
ARCTIQUE
HEMIARCTIQUE
X
W
J:
....
::>
Q..
-0
Q..
~ <0( ~
u
Z
~ a: U
<0(
w
Q..
V
w
a:
....
e
x ::> 0 w w
Q
1ua:
Houl
Moyen
<
cc
::>
on
Bas
....
Houl
<0(
w
a:
0
cc
Bas
Froid
w
a:
w
Q..
Moyen
~
w
1-
Z
<0(
e u
-u. u-Z
1-
----~ -=
-=--- -----=--=--- - -- ----- --=--- - § ~ ----- -- ---- ---§
=
::
---- --- --- --- -=
-- --- --- -- ----§
---- - - ---- ---- ---- --::
=
--- - --- ------- -=---- ---- --- --
1
w
::>
1-
Chaud
---=- -------
1
-=
----
AlA: Cs, o/oskoemis,CAN: A ,canadens;s, C IN: A , cinereus , COM:A ,commun;s
DIA: A " diontoeus, DEC : A , decticus , EXC: A ,excrucians , F Il : A . fitchi i ,
HEX :A ,he)(odon/us, IMP :Cs,impatiens,NIG : A , nigripes, PIO : A ,pionips,
PUL :A . pullatus, PUN : A . punctor, REM : A • rempe/i , TER : Cx : territans ,
Figure Il.
Distribution de 16
holarctiques
à
travers les
bioclimatiques du QUébec-Labrador.
D'après Maire (1980)
- 54 -
espèces de
zones et
moustiques
sous- zones
Page IV-22
~9
.
MAI
NIG
JUIN
~1
JUILLET
30
, ,
15,
15
, ,
~5,
. .. ..,:: . :.,'.i -
.......... :::: .... ........... 11111111111111111111111111111111111111111111111111······· ··
.............
IMP
....... ~
...~
..'!'!'
.. '!'!'
; ;
~
!; ' !; " !
COM
••••••
•
·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
.. .. .. ;;;::::::#
::::·,
.. 5· .. ·% ~=.
11111111111111111111111111111111111111111111111111 · .... .• ...... .... ..... ....
-
.................... ..
PUN
41
11111111 III Ililh 11111111111111111111111111111111111' ............... .
..
HEX
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilÏiiiiiiÎlIIIII111111111111111
..................
PUl
_ .. ::::::::::::::: :-:::::::::::::: :iiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllil
EXC
...... .... .... ............ 11111 111111' Il IIU ......... ... . ,
PlO
........... .. , ........... ... ·1111111111111111· .. ·· ··• .. · .. •· .. ····
AlA
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111Il
MAI _
-
1111111
la," ••
_JUILLET
JUIN
non
capturées
femelle.
..
oblerv'
"do. ioll' (com be.
Figure 12. Repré sent ation s chématique de la phénologie
larves de Culicid a e de Pos te-de-la-Ba l eine. Ligne 1, stade 1 et stade 2;ligne 2, stade 3;ligne 3,
4; l i gne 4, nymphe;ligne 5, i magos f emelles.
D'après Maire et Bussières (1983)
a
ne ige)
des
stade
Page IV-23
IV.2.2 ANALYSE QUANTITATIVE
Au stade larvaire, les espèces les plus
frequentes
(Tableau
7)
sont:
Aedes hexodontus, présente 40 fois sur 43 échantillons (93 % ) et Aedes
punctor (47 %). Les espèces récoltées une
fois
seulement
sont:
Aedes
(800 larves/m! ), Culex territans (ZOO larves/m3 ) et Culiseta
canadensis
.J
.
impatiens (400 larves/m ). Il est à cette étape intéressant de noter la
très
grande
fréquence
et l'ubiquisme remarquable d'A. hexodontus qui
dans l'Hémiarctique prend la place
la
forêt
boréale
(Maire
d'~
et Aubin 1976,1980).
moustiques de la région du lac Delorme
1980) ,
située
dans
punctor, l'espèce dominante de
Une
étude
sur les
(Maire 198Z;Goyette et Maire
le Haut-Subarctique mais à
l'Hémiarctique, ·montrait que A. hexodontus et
~
la
limite avec
punctor se partageaient
la dominance sur les autres espèces.
'.
Nous indiquons au tableau 8 les fréquences et les densités moyennes
respectives des
9 espéces de la tourbière â palses pour chaque type de
milieu correspondant â un groupement végétal (mois de juin et
Ces
donnees
mettent
juillet).
en évidence l'ubiquisme remarquable d'Aedes
hexodontus, qui manifeste toutefois une frequence plus
elevee dans la
scirpaie (86,6 %), avec une densité moyenne légèrement inférieure (1 241
~
3
larves/m ) a celle de la cariçaie (1 696 larves/m ). A. punctor
une
fréquence
et
pregent~
une densité moyenne plus élevées dans la saulaie. Sa
- 56 -
Page IV-24
fréquence
aquatilis.
la
plus
faible
est
atteinte dans
la
cariçaie à
A. communis présente localement les plus fortes densités (52
3
8321arves/m
),
avec
une moyenne de
confirmant des données
antérieures
572 larves/m
6
comparables
3
(Jenkins
,
résultats
et Knight
1950;Dahl 1974;Maire et Aubin 1976;Nikolaeva 1978; Tessier et al
Dans
cette
Carex
tourbière on
la
1981).
rencontre presque exclusivement dans les
mares de palses peu dégradées, profondes, dont l'eau est très foncée. Ce
type de mare de la cariçaie est localisé dans le secteur nord-ouest de
la tourbière. Au mois de juillet
exclusivement dans
la
Culiseta
cariçaie.
avec
alaskaensis
une
domine presque
frèquence (93,6 %) et une
3
densité moyenne élevée (3 733 larves/m )
Notons de plus que les densités larvaires des
de moustiques de
la
tourbière
plus élevées que dans les mares de
Poste-de-la-Baleine
a palses
rocher,
principales espèces
étudiée sont dans l'ensemble
milieu
bien représenté à
(Maire et BUssières 1983). Par contre, ces densités
" larvaires de moustiques sont fort comparables à celles obtenues dans des
unités
écologiques
similaires à LG-l, Moyen-Subarctique (Tessier et al
1981). Dans ce secteur cependant,
principalement
Care~
par
la
l'absence d'
composition en espèces diffère
Aedes hexodontus dans la cariçaie à
aquatilis et la saulaie à Salix planifolia, milieux sur argile. A.
hexodontus présente alors seulement une certaine importance dans l'unité
sur tourbe à Carex
dominance avec
~
limosa
et
Scirpus
punctor.
- 57 -
caespitosus
en partageant
la
Page IV-25
Tableau 7.
Fréquence et densité moyenne des espèces de moustiques
pour l'ensemble de la tourbière (juin et juillet)
3
Nombre de larves (m )
correspondant
ESPECE
f (%)
A. c.o"r"urU.4
A. e.xCJtuc..ian6
A. h uo do n.,tu1>
23
X±a
(Log(X+
3,6663
21
2,6366
93
16
3,1467
Â. p.LorUP.6
punctOll.
47
2,8617
Â.
A. c.anaJe.n6-W
2,7490
2
2,9036
16
3,4753
C. .ùnpa..t.Len6
2
2,6031
ex.
2
2,3010
c.
a(M kae.n6.u.
.t eNtil.a n.6
1))
X -
± 0,9786
± 0,4184
± 0,5038
± 0,3672
± 0,3541
± 0,0000
± 0,3870
± 0,0000
± 0,0000
- 58 -
a
X
X+s
487
4 637
44 146
185
433
1 135
439
1 401
4 471
240
561
1 306
321
727
1 643
1 225
2 987
800
400
200
7 282
Page IV-26
Tableau 8.
Fréquence et densité moyenne des espèces de moustiques
classés par groupement végétaux (juin et juillet).
. 3
Nombre de 1arves(m )
correspondant
ESPECE
f (%)
X± s
(Log (X + 1»
X - s
X
817
181
540
241
290
6 572
334
1 696
561
699
52 832
619
5 333
1 306
1 679
1 430
3 733
400
200
9 740
571
1 241
800
2 696
X
+ s
A - CARICAIE (JUIN)
Aede6
Aede6
Aede6
Aede.6
Aede.6
commul'I.t6
excltuc .ta/'1.6
hexodontu./>
p.to l'I.tp./>
punctolt
18,3
5,8
58,3
3,4
14,2
3,8177
2,5248
3,2296
2,7488
2,8443
±
±
±
±
±
0,9052
0,2671
0,4974
0,3672
U,3809
(JUILLET)
CL ala.6/laen6 .t.6
CL .i.mpat.tVI.6
Cx. teltlt.ttal'l./>
96,3
1,0
2,7
3,5720
2,6031
2,3010
±
±
±
0,4166
0,0000
0,0000
B - SCIRPAIE (JUIN)
Aede.6 hexodontul>
Aede./> pllnctOIt
86,6
13,4
3,0938
2,9036
±
±
0,3370
0,0000
(JUILLET)
Aedu ca~lad en./>.t./>
100,0
2,9036
±
800
0,0000
C - SAULAIE (JUIN)
Aede.6 commul'I.tl>
Aede../> 1te.l(Odontu6
Aedc6 punctolt
12,8
58,6
28,6
2,3032 ± 0,0000
2,8530 ± 0,5710
2,9165 ± 0,3329
191
383
200
113
825
(JUI I.LET)
C./> • ala./> kaen.6.t.6
100,0
3,1461 ± 0,0000
- 59 -
1 400
2 655
1 776
Page IV-27
Aedes pionips et Aedes excrucians n'ont pas été figurés au
tableau
8 pour le mois de juillet, puisque présents seulement dans 2 relevés
(No. 5 et
6).
L'examen du tableau
5 indique que
ces
espèces â
développement larvaire printanier sont présentes dans des mares à fortes
densités
d'~
communis au mois de juin.
IV.2.3 ANALYSE DE GROUPEMENT DES ESPECES
Afin de vérifier les groupements formés par les espèces au
sein de la
tourbière, nous avons appliqué une analyse de groupement â la matrice de
corrélation entre les
espèces
échantillons
type de développement larvaire printanier. Deux
selon le
(Figure 13)
associations ressortent de cette analyse
constituée d'A.
communis-A.
pionips
(Fig.
14)
l'ensemble
La
des
première est
avec la corrélation (mesure de
" similarité) la plus élevée (R= + 0,28).
formée
pour
Une deuxième association est
par le couple A. hexodontus-A. punctor (R= +0,25). Bien que ces
coefficients de corrélation ne soient pas
significatifs,
le
seuil de
signification de Rest 0,29 pour 43 échantillons (probabilité de 95 %) ,
ils sont du moins en accord avec ceux déja obtenus
Poste-de-1a-Ba1eine
du
Subarctique
(Maire
(Maire et
pour la
région de
et Bussières 1983) et pour d'autres
al 1979).
~
corrélation nulle avec les autres especes.
- 60 -
excrucians
r~gions
présente
une
Page IV-2B
HEX
HE}{
COM
PUN
EXC
PlO
1.0000
.0108
.2463
-.0399
-.0349
COM
1. 0000
-.1999
.0040
.2788
1.0000
.0739
.1603
Figure 13. Matrice de corrélations entre
moustiques de la tourbiére ~ palses.
IIEX:!!~
EXC:&
he}{odontu~,
e}{çr.!!f..! an~,
PlO
EXC
PUN
COM:A.
fornmuni~,
PlO:&. Eionips
- 61 -
1. 0000
1.0000
.2037
les
PUN:A.
espèces
de
punctor,
Page IV-29
,..
JUIN
-0,2
,..-- c------l
--,
1
50
0,0
1
1
Z
0
Z
1
1
0
1
I
l-
1-
4:
4:
...J
...J
W
W
~
~
0
u
~
~
0,5 0
75
u
w
Cl
w
U
~
~
~
1,0
100
HEX
PUN COM
PlO
EXC
COM: Ae. communis, EXC: Ae. excrucions, HEX: Ae. hexodontus
P 10 : Ae. pionips, PUN: Ae. punctor
Figure 14.
Dendrogramme.
Analyse de
espèces.
- 62 -
groupement
des
Page IV-30
IV.2.4 ANALYSE DE GROUPEMENT DES ECHANTILLONS
Une fois les groupements mis en évidence,
approfondir l'analyse afin de
il
aux
groupements
1nt~rC9,ant
d'
connaître quels sont les échantillons
correspondant â ces groupements de moustiques
correspondent
est
végétaux de
contexte, nous avons soumis les échantillons du
et
si
ces groupements
la
tourbière.
mois de
Dans
juin â
ce
une
analyse de groupement des échantillons. Le dendrogramme ainsi formé est
présenté â la figure 15.
Nous admettrons en premier lieu qu'il
connaissance,
n'existe pas,
à
notre
de test statistique permettant de déterminer le niveau de
signification des
groupes d'échantillons
distingue clairement
formés.
Néanmoins
l'on
3 groupes dont la distance Euclidienne entre les
" variables (racine carrée de la somme des carrés des différences entre
les
valeurs des variables
pour deux cas) est très proche. Le premier
groupe correspond aux cas à présence
cas a présence d'
d' A. hexodontus-A.
évidents â
~
d'~
communis seul. Le second aux
hexodontus seul et le troisième aux cas a présence
punctor.
distinguer
A ceci
s'ajoutent deux
soit un groupe â
~
groupes moins
hexodontus-A. punctor-A.
excrucians et un dernier correspondant aux trois échantillons justifiant
l'association A.
communis-A.
pionips.
Ces résultats
renforcent les
associations d'espèces mises en èvidence en première analyse.
- 63 -
Page IV-3I
8~
10~
8~
25 <l
35 <l
12 <l
23 <l
134
204
74
11 4
184
154
r
J
224
~
14
40~
r
J
24 ...
16 ...
21 ~
39<4
41
t-
lY-
~
42 "1
38 ...
33 ...
27 ...
26 ...
I
r-
2 ...
32 ...
34 ...
29 ...
1-
~
.
30 ...
31 ...
19 ... J
43 ...
37 ...
f-
I
38 ...
28 ...
3.
4.5.
17'"
9.
D-
1.
6
i
0,05
i
0,1
1
0,2
i
i
0.3
0,5
i
i
i i
0,8 1,0
,
1,5
..... communi,
Â
Il A •. communi'- pionip'
t; Ae. hexodontus-punctor
Ae. hexodontus
i
2p
~ Ae. hexod?ntus-pu~ctor­
excruc,ans-p,on,p'
Figure 15.
Dendrograrnme.
échantillons.
Analyse de
- 64 -
groupement
des
Page IV-32
La
com~araison
du dendrogramme des échantillons avec le
permet de constater que les groupes d'échantilons
espèce ne correspondent pas à la réalité
seul
caractérise
la
scirpaie mais
échantillons a A. hexodontus seul dans la
A.
~
communis-A. pionips sont dans la
d~
le
problème de
5
a présence d'une seule
terrain. Ainsi A. hexodontus
l'on retrouve
cari~aie. ~
cari~aie
également des
communis seul
et
où l'on retrouve également
hexodontus seul ou avec d'autres espèces. Ces résultats
dèjà
tableau
introduisent
la sélectivité des habitats qui sera élaboré aux
sections IV.4 et IV.S de ce chapitre.
IV.3 LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES GITES CULICIDIENS
Le
tableau
9 présente
échantillonnées de
la
les mesures · physico-chimiques
cariçaie,
la
scirpaie
et
et
tourbe, tel
tourbières
les
concentrations
que démontré
. mares
la saulaie selon 3
périodes. Précisons tout d'abord qu'il n'existe pas de
le pH
des
relations entre
ioniques de l'eau libre et celles de la
par Gauthier
(1980)
dans
une
étude des
du Parc des Laurentides (Québec). Ainsi, ces mesures ne sont
pas représentatives .du sol sur lequel croissent les végétaux mais
bien
des mares distribuées au sein du couvert végétal.
L'examen de
caractères
ce
tableau
permet
de
constater l'homogénéité des
physiques et chimiques des mares des différents groupements
végétaux de la tourbière pour chaque période de mesure. Au mois de juin,
le
pH
est
légèrement acide (5,86-6,05), la conductivité faible (34-42
- 65 -
Page IV-33
Tableau 9.
Caractéristiques physico-chimiques des g1tes
culicidiens classés par groupement végétaux
selon trois périodes de mesures.
GROUPEMENT
VEGETAL
pH
}lS/cm
T(eau)
C
T(air)
C
% VEG.
MARE
A - 01-25 JUIN
CARI CAlE
SCIRPAIE
SAULAIE
5;88
6~05
5,86
14
13
13
42
34
41
19
18
20
21
18
50
B - 26 JUIN - 15 JUILLET
CARICAIE
SCIRPAIE
SAULAIE
5,57
5,83
5,70
52
35
52
13
15
13
12
12
12
C - 16-31 JUILLET
CARICAIE
S CI RPAIE
SAULAIE
5,29
5,84
5,66
48
40
46
9
11
9
- 66 -
10
10
10
Page IV-34
pS/cm).
Toutes
les
mares
présentent
un
fort
coefficient
d'ensoleillement, la tourbière étudiée étant dans son ensemble un milieu
1
de type ouvert. La tendance vers une acidification des mares de cariçaie
semble
due
la
â
diminution
du
volume des
l'assèchement graduel de ce milieu pendant
milieu
d'eau
de
La
l'été.
résultant
de
saulaie est
un
circulante généralement bien drainé. On y retrouve peu de
gttes culicidiens sous l'abri des arbustes.
dites
mares
saulaie
sont
situées
en
En
clairière
fait,
è
plusieurs mares
Carex aquatilis. La
température moyenne de l'eau suit généralement celle de l'air à -quelques
degrés
près. Une droite de régression établie à partir des températures
de l'eau et de l'air dans la tourbiére pour la
(figure 16)
du
01-25
juin
permet de confirmer cette relation (R=0,478 ). Le seuil de
3~
signification de Rest 0,36 pour
Les
période
différences
de
l'ordre de
échantillons ( probabilité de 95 %).
5 â
8 degrés au printemps semblent
coincider avec la fonte récente des glaces.
Ces quelques constatations nous aménent à discuter
hydrauliques
de
caractères
d'une tourbière sur pergélisol. Les mesures de température
de l'eau des mares de palses semblent indiquer une faible
d'eau
des
participation
fonte du pergélisol. De plus, il est difficile de vérifier la
part des argiles dans l'enrichissement et la neutralisation
du
pH du
milieu. Selon Dever et al (1982) dans une étude des écoulements de l'eau
dans une tourbière sur pergélisol à l'aide de traceurs isotopiques,
eaux
de
fonte
des
neiges
et
du
pergélisol
écoulements de surface. On se rappellera que la
- 67 -
les
ne participent pas aux
Page IV-35
•
17,5
•
•
.u
•
•
~
w
--~
•
w
§'"
w
10
•
~
~
w
.....
•
o
20
TEMPERATURE DE L'AIR
(·C)
Figure 16. Droite de régression entre la température de
l'eau des mares et celle de l'air dans la tourbière à
palses. (Mares de caricaie juin et juillet 1982>
- 68 -
Page IV-36
masse de pergélisol
est
située en majeure partie dans
la
couche
argileuse (Railton 1968; Lagarec 1979). Néanmoins, l' exudation d'argile
aux travers de la tourbe par la dégradation de certaines palses pourrait
également contribuer par érosion â enrichir localement le milieu.
On ne peut devant ces faits considérer la tourbière â palses comme
un milieu
classé
strictement
la
tourbeux.
tourbière
argilo-tourbeux"
Poste-de-la-Baleine
palses
â
dans
notre
(Maire
minérotrophique de la
Pour
toutes ces raisons, nous avons
dans
la
catégorie
étude de l'ensemble du
et
Bussières
1983).
"substrat
secteur de
Le
caractère
tourbière serait principalement lié aux eaux de
ruissellement en provenance de la réserve en eau
du
bassin
suite aux
précipitations.
En résumé,
la
argilo-tourbeux de
tourbière â
type ouvert.
palses
Il
étudiée
est
un
milieu
y a peu de différences dans les
' caractères physico-chimiques des g1tes culicidiens entre les
différents
groupements végétaux.
IV.4 LES UNITES ECOLOGIQUES
Nous présentons au . tableau 10 chacune des
écologique)
de · la
tourbière
classique des milieux â
identifié
par
les
espèces
unités
écologiques
(niveau
palses étudiée résultant de l'analyse
â
larves
de moustiques.
végétales
Chaque niveau
est
caractéristiques, ainsi que les
principales espèces constituant la flore compagne. De plus nous avons
- 69 -
Page IV-37
indiqué quelles sont les espèces de moustique caractéristiques et celles
qui les accompagnent.
moyenne de
Nous
indiquons
également la densité larvaire
l'espèce dominante et le % de recouvrement en eau du milieu
au mois de juin et juillet. Une brève description du
gtte
complète la
caractérisation des niveaux.
En fait, ce tableau a pour objet principal de présenter une image
globale des
groupements végétaux
et de la répartition des espèces de
moustiques dans ces groupements. Cette méthode d'analyse permet dèjà
se rendre
compte de
la
faible sélectivité des moustiques pour leurs
habitats larvaires. Ainsi, l'association
présente dans
tous
de
~
hexodontus-A.
punctor est
les groupements. Tel que discuté précédemment, le
niveau à Carex aquati1is et Sphaqnum riparium identifiant l'association
A.
communis-A. pionips ne serait pâs mis en évidence par la végétation.
Nous avons cependant tenu à l'isoler en raison de la forte densité d'A.
communis et des caractéristiques des mares à cet endroit.
'.
Nous tenterons à la section suivante,
discriminante multivariée,
de vérifier
sélectivité.
- 70 -
par l'emploi de l'analyse
cette
apparente absence de
Tableau 10.
Les unités écologiques de la tourbière à palses.
SIVEAU ECOLOGIQUE
PLASTES
CO~PAGKE3
ESPECES CULICIDIENNES
ESPECES CULlCIDIE!llŒS
CO:1PAGSES
DESjITE
LIt!
Ae. he.xodol1.tu4
,I.e.. punctoIL
C4. ala4kan4-i.4
Ae..
Ae..
C4.
ex.
l
Ae. commun-i.4
DO~ll:;ANTES
8etuia oian duio4a
Siveau li
Calte.x aq ua t.i. Lü
Mares de pied
de palses
dégradées et
très dégradées
peu profondes
(20-30 cm)
Ae.. p-i.on-i.p4
6 600
28
21
Mares de pied
de palses peu
dégradées
profondes
(
40 cm)
Ledum gILoe.I1Land-i.cum
Ae.. hexodontu4
Sal-i.x ped-i.ce.llaIL-i.4
AllCi'tomW 9iaucoph~!La
CalamagJto4t-i.4 canade.n4-i.4
EIL-i.opnoJtum ILu44eoLum
Ae.. punctolt
Ae.. canade.n4-i.4
l
200
26
33
Mares de
rlticules
Sal.i.x plan.i.6ot-La
8etu!a gianduLo4a
Rubu4 acaul-i.4
At.i.te.!l.a nu da
Gal-i.um Labltadolt-i.cum
Ae.. excILuc-i.an4
Ae.. commun-i.4
C4. o..üu.lute.n6-L4
800
35
Calte.x aou,,-t.i.t-i.4
et Sphagl1um r•.i.pa .'t-i.um
à
~iveau
Sc.i.ltpU4
ce.~p-i.to4u4
et
8e..tula 9Landulo4a
l/iveau li
Sat-Lx
aJtg~JtocaJtpa
DE3CRIPTlON
Dr GITE
38
29
potentin.a palu4.t-'t-L4
Niveau li
HILIEU
700
Sphagnu~ ~.i.paJt.i.um
Sphagnum Jtu44 ow-i..i.
Caltex cane4cen4
RublU cnamae.mOltlU
--J
1-'
e.xcltuCÙtn4
p-i.on-i.p4
-i.mpatie.n4
te.ltlt-i.tan4
% EAU
Ae.. he.xodontu4
Ae. punctolt
Mares ouvertes
ou fermée s
peu profondes
"0
CIl
I.Q
t1I
H
~
W
CD
Page IV-39
!V.S L'ANALYSE DISCRIMINANTE
Nous avons groupé au tableau Il
l'analyse.
les
résultats de
l'ensemble de
L'ordre de présentation respecte le schéma de la figure 7.
Chaque test se réfère à l'hypothèse présentée à la section S du chapitre
III.
Mentionnons tout d'abord
végétation-végétation,
que
les
tests de classement
moustique-moustique
et
simples
sphaignes-sphaignes
servent uniquement à vérifier l'assignation initiale des échantillons à
chacun des groupes selon la variable ayant servi à la classification. De
ce fait, les % de classification correcte
L'hypothèse n'est
sont
toujours très élevés.
vraiment testée qu'à partir du moment où l'on change
de variables (par exemple, Végétation-moustique).
En premier lieu,
moustiques
nous avons
vérifié
si les
populations
de
présentent la même distribution que les groupements végétaux
définis â la section 1.2 du chapitre IV (cariçaie, scirpaie et saulaie).
Il s'est avéré que les différences entre les populations de moustique de
ces groupes étaient insuffisantes pour les différencier. Ce qui confirme
implicitement
l'hypothëse nulle. L'importance des sphaignes est masquée
par d'autres variables lorsque l'on utilise à la
- 72 -
fois
les plantes
Page IV-40
vasculaires
et les
sphaignes.
Pour
constitué un groupe d'analyse â part.
"
- 73 -
cette raison, les sphaignes ont
Tableau 11.
Resultats de l'analyse discriminante par étapes.
A.'1ALYSE DISCRH!lNANTE PAR ETAPES
GROUPES
VARIABLES
UTILISEES
VARIABLES
COHPOSA.'H LA
FONCTION
TEST
de F
% TOTAL
47,58
(6,74)
2,59
97,6
33
LAMBDA
DE WILKS
F-Estimé
42
0,0424
(2,39 )
NOMBRE
D'OBSERVATIONS
DISCRI~!lNA."TE
Végétation
de CLASSIFI CATION
CORRECTE
PROBABILITE
INITIALE
Végétation
C. a.o ua...ti.Li..6
S. eùpUolllL6
S aJtg IjlLO COJtpa.
Moustique
.............
Moustique
Ae.. hex.odol'l.t.L.l.ll
Ae.. eommU11..Ü>
42
0,0074
(2,39 )
202,61
(4,76 )
2,97
97,6
33
Végétation
R. ehrunaemol!..UA
42
0,7911
(2,39 )
5,15
(2,39 )
4,05
35,7
' 33
Sphaignes
S. ILipa./I..i.um
35
0,7739
(2,32 )
4,68
(2,32 )
4,15
48,6
33
Volume des
mares
42
0,6105
(2, 39)
12,44
[2,39 )
4,05
61,9
33
Physicochimiques(b)
Surface des
mares
7. eau du milieu
35
0,5542
(2,32 )
5,32
(2,32 )
4,15
60,0
33
Physicochimiques(c)
pH
35
0,7492
[2,321
5,35
[2,32)
4,15
31,4
33
"-.1
~
Moustique(A)
Physico. chimiques (a)
'"0
III
<Q
~
M:>ustique(.B)
Moustique
Ae.. hex.odon-tw.
Ae.. eommU11..Ü>
42
0,0289
(1,401
654,91
(2,39 )
4,05
100,0
50
H
cp
~
1-'
Tableau 11.
( suite)
ANALYSE DISCRIMINA.'lTE PAR ETAPES
GROUPES
"'.oustique(B)
-...J
111
Secteurs
de pals es
VARIABLES
UTILISEES
VARIABLES
COHPOSA.'>T
LA FONCTION
DIS CRiHINA.'lTE
Végétation
R. _c.h.amaemOJt.u.4
P. pa..ltu..tJt..U.
U• -i..n.tvune.d.ia.
B. g.l.a.nd.u.ùJsa.
P. maJLÜ1na. (a. 1
S. I1Jlctophil.o.
42
Physicochimiques Ca)
Surface des
mares
40
Phvsicochimiques (b)
pH
35
Physicochimiques Cc)
pH, surface des
mares, volume.
35
Sphaignes
S. JLi.pcvr...i.wn
35
Végétation
Moustique
Sphaignes
NOMBRE
D'OBSERVATIONS
V. uLig.i.no6u!7I
L. .ù:vUc..i.na (a. )
O. m.i.CJto CtlIlpW
26
Ae. plUtctoll
Ae. commwuA
Ae.. hex.odon..tw.
26
..............
LAMBDA
de WILKS
F-Estimé
0,4522
(1,401
(6,351
0,5342
16,13
(1,381
(2,371
7,07
0,8167
7,41
(1,33 )
(1,33)
0,5518
8,39
( 1,33)
(3,31 )
0,7897
8,79
(1,331
(1,33)
0,2590
6,75
(2,23 )
(6,42)
0,2261
7,72
(2,23 )
(6,42)
TEST
de F
% TOTAL
2,80
90,5
50
4,08
87,5
50
S,50
71,4
50
3,59
88,6
50
S,50
71,4
50
2,72
80,8
33
2,72
13,1
33
de CLASSIFI CATI ON
CORRECTE
PROBABILITE
INITIALE
'1j
CD
~
Cl)
H
<1
.z::,.
N
tableau Il.
(suite)
A.~ALYSE DISCRI~rrNANTE
GROLl'ES
Secteurs
de pa1ses
-.....J
O"t
Sphaignes
VARIABLES
UTILISEES
VARIABLES
COHPOSA."T
LA FO~CTION
DISCRHIINA..'<TE
Physicochimiques (a)
T de l'eau
% eau du milieu
26
Physicochimiques (b)
% eau du milieu
24
Physicochimiques (c)
% rec. veg.
Sphaignes
S. JUpaJuum
S. JtM6oi.CÜ
34
Ae. c.orrmwU6
34
Moustique
NOHBRE
D'OBSERVATIONS
Physicochimiques (a)
Volume des
mares
Physicochimiques (b)
.............
Physicochimiques(c)
pH
LA!1BDA
de WILKS
F-Estimé
TEST
de F
% TOTAL
0,4527
5,39
[4,44)
3,09
61,5
33
0,5820
7,54
4,42
58,3
33
(Z, 2 11
[2,21 )
0,1551
10,26
2,74
88,0
33
[Z,22)
(6,40 )
0,2589
14,48
3,01
85,3
33
(2,31 )
(4,60)
4,10
38,9
33
4,35
65,4
33
4,38
48,0
33
(2,23)
25
T eau, pH.
26
PAR ETAPES
0,7995
4,14
(2,33)
(2,33)
0,7043
li,S3
(2,23)
12,23)
0,5429
9,26
12,22)
(2,22)
de CLASSIFI CATION
CORRECTE .
PROBABILITE
INITIALE
00
25
Dl
I.Q
CD
H
<:
1
~
W
-
Page IV-44
._ ._- - - - ----- - -
LEGENDE ET COMMENTAIRES
Abréviations.
F-estimé
= Rapport
F équivalent au Lambda de Wilks
Lambda de Wilks: Test multivarié permettant d'établir
si les groupes présentent des différences significatives
quant a la position dè leurs centroides.
(O:dispersion maximum à l:pas de dispersion intergroupe)
% total de classification correcte: Pourcentage de
classification correcte pour tous les groupes
d'après la fonction de classification établie â partir
de la distance de Mahalanobis (D ) de chaque cas au
au centre du groupe.
Probabilité initiale = Probabilité initiale
d'appartenir a un groupe due au hazard.
Par exemple, pour trois groupes
cette probabilité est de 33 %.
Les degrés de liberté sont indiqués en italique entre
parenthèses sous les valeurs du .lambda de Wilks et du
F-Estimé
L'analyse du premier test "végétation" ne se poursuit pas · au
niveau physico-chimique puisque ces mesures sont;. celles de
l'eau des mares plutOt reliées à l'habitat du mou~tlque.
Dans certains tests, le nombre de cas utilisés est inférieur
au nombre de cas initial, puisque certains échantillons ne
comportent aucune donnée
(dépendant
des
variables
utilisées).
Elles sont alors automatiquement rejetées par
l'analyse (Dixon et al 1981 p. 519)
Le test de F est lu dans la table "Critical values of the F
distribution" (Zar 1974), au niveau de probabilité .0,05 ou
95 % d'intervalle de confiance du test bilatéral.
- 77 -
Page IV-45
Il devenait intéressant de raisonner à l'inverse afin de vérifier si la
distribution
des
populations végétales
correspondait
moustiques sériée selon leur dominance. De plus,
d'identifier
les
celle des
cette analyse permet
espèces végétales qui sans constituer des groupements
ou sous-groupements typiques sont le plus liées aux
moustiques.
à
communautés de
A cette fin l'analyse a été effectuée dans un premier temps
sur trois groupes de moustiques,
soit:
A.communis,
~
hexodontus-A.
punctor et A. hexodontus- A. punctor-A. excrucians-A. pionips (densitès
faibles). Les résultats obtenus donnent pour les plantes vasculaires un
% de
classification correcte de 35,7 % et pour les sphaignes 48,6 %,
donc dans l'ensemble très faible, compte tenu de la probabilité initiale
(hasard)
de
33
%.
Les variables discriminantes Rubus chamaemorus et
Sphagnum riparium seraient associées au groupe
vue
physico-chimique,
le
~
volume des mares
communis. Au point de
serait
principalement
responsable des différences au mois de juin et juillet. Les différences
de pH â la fin de l'été sont non' significatives. Dans un deuxième temps
ne furent retenus que les groupes les plus différents soit
et
~
hexodontus-A. punctor. Le groupe à densité faible
punctor-A. excrucians -A. pionips fut
inclus dans
~
~
communis
hexodontus-A.
ce dernier.
Cette
analyse devient de ce fait une fonction discriminante simple (2 groupes)
qui peut être considérée comme un cas particulier de l ' analyse canonique
(Legendre et Legendre 1979). Il faut donc interpréter les résultats avec
prudence. Nous considérons ici cette analyse comme une précision de la
première.
- 78 -
Page IV-46
Les résultats obtenus donnent un % de
90,5 % pour les
classification correcte de
plantes vasculaires et de 71,4 % pour les sphaignes.
Notons toutefois que dans ce cas la probabilité initiale passe de 33 % a
50
Les
%.
F-estimés sont légèrement supérieurs à la première analyse.
Les variables discriminantes Rubus chamaemorus et
sont
reliées
au
groupe A.
et
Betula qlandulosa
Salix
Potentilla
palustris
communis, alors que Utricula intermedia ,
arctophila
sont
associés
au
groupe A.
hexodontus- A. punctor. Au point de vue physico-chimique, la surface des
mares et le pH au mois de juillet contribuent le plus à séparer les deux
Même
groupes.
si
le rapport F et le % de classification correcte sont
élevés, il est cependant plus difficile sur le terrain de constater des
différences
réelles.
secteur du groupe
~
mares occupées par
Ainsi
Potentilla
palustris
est présent dans le
communis sans nécessairement se
cette espèce.
De plus,
trouver dans les
le secteur du groupe
~
communis est aussi un secteur à forte présence d'A. hexodontus. La plus
grande
faiblesse de cette dernière analyse est que le nombre de mares à
A. communis est petit (10) comparé à celui de l'autre groupe
variance
intra-groupe
est
donc
plus
élevée
(33).
La
pour le groupe A.
hexodontus-A. punctor. De plus, le nombre d'échantillons
limite de 40
proposé par Tatsuoka (1970) pour ce genre d'analyse n'est pas respecté.
Nous
avons
aussi
voulu
vérifier
l'influence
de
l'état
de
dégradation des palses sur le milieu. Les palses étant toutes situées a
l'intérieur du vaste groupement de la
Cari~aie
â
Carex aguatilis,
échantillons de la scirpaie et de la saulaie ont étés exclus de cette
- 79 -
les
Tableau 12.
Espéces végétales et culicidiennes choisies de la
de la caricaie à Carex aquatilis classés selon
l'état de dégradation des palses.
CARI CAlE
A
PALSES PEU DEGRADEES
Ca~~x
aquat~i~
PALSES DEGRADEES
PALS ES TRES DEGRADEES
10 12 18 11 13 14 15 17 16
19 27 25 23 21 20 24 22
1
No.
du relevé
1
5
6
4
,
•
·
8
2
3
9
7
1
Strate arbustive basse
Vaee~n~um
u!~g~no~um
La~~x
CD
o
!aJt.~e~na
Oxyeoeeol> m~e/lo ea~pul>
+
+
+
· · .
·
..
+
+
.
·
+
+ +
+
.
.
.
+
.
1
·
+
+
+
+ +
1 +
+
+
3
3
3
3
+
Strate herbacée
Ca~o~
Rubul>
aouat~i~
diama~mo~ul>
Pot~nt~!!a
pa!ul>t~~l>
1
·
+
2
1
2
1
2
1
3
3
4
+
1
3
2
1
·
·
3
3
+
+
2
3
~pa~~um
Culicides (Juin)
h ~xo do ntlLl>
Ae.du punetolt
Ae.du eommun~l>
A~du.
A~du
Ae.de.l>
~xe~ue~anl>
p~on.<.pl>
Culicides (Juillet)
Culü e..ta
~ka(>J~~
4
3
3
3
1
1
.
1
4
+
+
5
+
+
·
+
3
· · ·
· 4
+ 5 4 + 4
.
· · 1 ·
.
· ·
· +
· .
+
+
4
+
3
2
2
2
+
+
+
1
1
3
4
1
.
·
3
.
5
.
3
+
·
SEhaignes
Sphagnum
3
+
1
·
1
2
+
+
3
1
4
1
+
·
+
1
·
3
·
4
· ·
2
+
·
·
2
4
2
2
3
1
·
3
.
1
·
· . ·
·· +. · ·
·
+
2
+
3
4
.
1
3
··
1
·
·
.
. · +·
.
3
2
1
2
3
2
3
.
+
+
.
+
+
.
+
"0
III
I.Q
('1)
H
Extrait du Tableau 5.
Le chiffre correspond à l'abondance-dominance au sens de
Braun-Blanquet (1932), celui des culicides à l'abaque
fréquence relative(%)/Larves/m3 de Maire et Aubin (1980)
"f
,to.
-....J
Page IV-48
analyse.
Les résultats obtenus permettent de différencier les
secteurs de
palses d'après la végétation à 80%. Vaccin1um uliqinosum serait le plus
présent dans la zone de palses dégradées
et
Larix
laricina
dans
le
secteur de palses très dégradées. (Tableau 12). Ces faibles différences
avec des indices d'abondance-dominance de l'ordre de la simple présence
sont
difficilement
perceptibles
sur le terrain. Les différences pour
Oxycoccos microcarpus montrent bien la puissance de discrimination de
l'analyse.
Les
populations
différenciées (73,1%).
le
~
de
moustiques
sont
bien
punctor aurait une fréquence plus élevée dans
secteur de palses dégradées.
~
communis et
.
~
également plus fréquentes dans le secteur de palses peu
point de vue
également
pionips seraient
dégradées.
Au
physico-chimique les différences dans la température de
l'eau et du pH seraient les plus importantes.
Nous terminerons cette série de tests statistiques par l'examen de
la
relation
entre
la
distribution des
invasculaires (les sphaignes) et celle des
(tableau Il).
Il
s'est
avéré
populations de plantes
populations de moustiques
que ce critère ne permet qu'une faible
différenciation des populations de moustique (38,9%). Une fois
de plus
le volume et le ,pH des mares contribuent le plus â séparer les groupes.
- 81 -
Page IV-49
Nous pensons,
compte
tenu
de l'information recueillie,
avoir
épuisé toutes les alternatives possibles. La présence d'A. communis dans
la cariçaie
végétal
Care! aquati1is sans être associée â
â
plus
fin,
celle d'A.
un
sous-groupement
canadensis dans la scirpaie é Scirpus
caespitosus milieu dominé presque exclusivement par A.
hexodontus,
la
localisation nette de Cu1iseta alaskaensis dans le secteur des pa1ses
peu dégradées de la cariçaie,
l'analyse des
ainsi que les
résultats obtenus pour
secteurs de pa1ses, semblent indiquer que la nature des
mares elles-mêmes serait préférée â l'habitat.
Ces résultats viennent donc
étude pour l'ensemble du
confirmer les
secteur de Poste-de-1a-Baleine. Les travaux
antérieurs montraient avec netteté que
habitats
mares.
conclusions de notre
l'on pouvait
caractériser les
â larves de moustiques pat le groupement végétal englobant les
Dans
le
prochain chapitre nous
tenterons d'expliquer
différences rencontrées dans cette zone biogéographique.
- 82 -
les
CHAPITRE V
SYNTHESE ET CONCLUSION
V.l RELATIONS HABITATS-ESPECES DE MOUSTIQUES
Compte tenu des résultats de l'analyse discriminante et des limites de
notre étude,
il
semble que
le
rOle
indicateur de
la
hémiarctique en termes d'habitats larvaires de moustiques
végétation
serait
plus
faible que dans les zones bioclimàtiques méridionales. Cela s'explique
en partie en considèrant la diversité réduite des
structure relativement
habitats due a la
simple de la végétation
,l'homogénéité des
" conditions hydrologiques et la présence d'argile au sein de
D'autre part,
cette diminution du
la
tourbe.
rOle de la végétation dans la
caractérisation des habitats larvaires de moustiques
semble également
liée aux stratégies complexes du choix de ponte des femelles confrontées
aux pressions écologiques du milieu telles que la rareté des
et
ressources
la rigueur du climat. Les facteurs influencant le choix des femelles
encore mal connus et partiellement discernables par la méthode utilisée,
paraissent
une
favoriser
tendance vers l'ubiquisme
l'habitat.
r6~ultante
serait
spécialisation
dans
un opportunisme marque dont la
Aedes hexodontus
plutOt
serait
a
que la
ce
titre l'exemple le plus
Page V-2
a
remarquable, mais ceci
peut
communis,
et dans une certaine mesure à A. pionips. Cette
A.
punctor
s'appliquer aussi
tendance serait en accord avec
présentées
la
tendance
A.
excrucians,
générale . des
A.
adaptations
par les arthropodes arctiques, dont la somme est une réponse
globale face aux conditions défavorables au lieu d'une spécialisation en
fonction d'une condition spécifique (Danks 1981).
Toutefois, plusieurs espèces, souvent d'ailleurs se trouvant
limite de
leur distribution latitudinale,
habitats similaires
au
â
la
se retrouvent dans des
a ceux dans lesquels elles avaient été notées plus
sud. Ainsi Aedes canadensis ne s'observe que dans les mares de fen à
Scirpus caespitosus dominant; A. pionips ne se trouve que dans les mares
ombragèes et y est souvent avec
~
communis; ce couple a déjà été mis en
évidence plus au sud. Enfin A. punctor est l'une des
fréquentes
des
Subarctique,
-même les
~
champs de
palses,
milieu
espèces les plus
sourtout tourbeux. Dans le
punctor est caractéristique de cette zone,
sites
plutOt
mesure, confirment
le
ombragés.
caractére
y
préférant
Ces observations, dans une certaine
boréal
de
cette
espèce
(Maire
et
Bussières 1983).
Aedes excrucians est l'une des espèces
les
régions
Eurosibérie
nordiques
(Natvig
Ostroushko 1967;Hood
mares
de la
observations
analogues,
1948;Curtis
régulièrement
surtout
1953;Frhone
citées dans
en Scandinavie
1953;Dah1
et
en
1974,1975;
et al 1979). Le fait de l'avoir observée dans les
tourbière
antérieures
a pa1ses est conforme, relativement,
aux
concernant l'écologie de cette espèce dans le
- 84 -
Page V-3
Boréal
(Maire 1980,1982)
précédents
auteurs.
et
aux renseignements
Quant è
Aedes hexodontus,
excellence de
l'Hémiarctique,
populations
et
leur
rèputée
fournis
par
c'est l'espèce par
pour l'abondance
agressivité
les
(Nikolaeva
de
1978;
ses
Da hl
1974,1975;Ostroushko 1967;Hood et al 1979)(Maire et Bussières 1983)
Les espèces à développement larvaire estival Culiseta alaskaensis
et
Cs.
impatiens souvent associées, sont largement distribuées dans la
forêt boréale et se retrouvent fréquemment au sein de mares atypiques
dont
l'eau présente une forte turbidité. Des larves de ces deux espèces
ont également été récoltées dans
Sakami-LG 3
des
cari~aies
à
Carex aguatilis à
(Maire et Aubin 1980). L'on devait donc s'attendre a les
retrouver dans la tourbière è palses étudiée.
V.2 SOMMAIRE DES ANALYSES STATISTIQUES
Bien que les analyses statistiques utilisées apparaissent multiples
et
"
complexes, la démarche dans son ensemble est des plus simple. Il importe
tout d'abord de se rappeler que celle-ci
distinctes,
soit
l'étude des
populations larvaires de moustiques
(analyse de groupement des espèces (lM) et
échantillons
(2M»
se divise en deux parties
analyse de groupement des
et l'étude de la sélectivité des habitats larvaires
(analyse de groupement KM et analyse discriminante).
analyses
données
s'est
ces
inscrit dans la suite d'un effort de quantification des
relatives
permettant
L'emploi de
â
l'étude des moustiques
et de leur
habitats
leur traitement au moyen des statistiques paramétriques. Ces
- 85 -
Page V-4
analyses présentent des perspectives fort intéressantes bien qu'elles
aient
été
peu
utilisées par le passé. Leur utilisation constituait en
fait, un exercice de recherche en soi. Certaines d'entre elles
se
sont
avérées trés pertinentes d'autres un peu moins.
En ce qui concerne l'étude des populations larvaires de moustique,
l'analyse
de
groupement
des
espéces permet de distinguer les
associations d'espèces avec un niveau
de
précision
satisfaisant.
Le
seuil de signification des coefficients de corrélation peut être obtenu
facilement d'une table, permettant ainsi la vérification instantanée de
l'analyse. Le dendrogramme qui en est issu permet en outre de visualiser
les relations d'une espèce à l'ensemble de la communauté. Cette méthode
fut
appliquée
aux
populations larvaires de moustiques avec succès à
quelques reprises (Maire 1982;Mairè et
l'analyse de groupement
plus
grand
défaut
··signification.
de
Bussières 1983).
Par contre
des échantillons s'est avérée moins utile. Le
cette analyse
Néanmoins,
est
l'absence
de
test
de
elle pourrait servir à compléter une analyse
d'ordination (PCA,RA, •• ).
Dans le cas de l'étude de la sélectivité des habitats larvaires, le
plan d'échantillonage
avait
été conçu ·de façon à utiliser une analyse
multivariée permettant de tester les différences
retenu
l'analyse discriminante,
comportait
2 étapes
(1)
le plan de
formation
différences entre groupes.
- 86 -
des
entre groupes.
Ayant
traitement des données
groupes,
(2)
test
des
Page V-S
L'analyse discriminante est appliquable lorsque
bien
définis
et
que l'ensemble des mesures
les groupes
a
une
sont
signification
écologique. Les groupes ou habitats définis par la présence ou l'absence
d'une espèce ne sont pas toujours bien définis. Au moins 3 raisons pour
qu'une espèce soit absente peuvent être mentionnées: (1)
incompatible,
(2)
l'habitat
est
est
compatible mais l'espèce est absente
pour d'autres raisons, (3) l'habitat
l'échantillonage
l'habitat
est
compatible et occupé,
mais
ne permet pas de détecter la présence de l'espèce. Une
analyse discriminante basée sur des groupes formés par absence-présence
implique
que
l'absence
est due
seulement
â
la
première raison
mentionnée, ce qui n'est pas forcément vrai (Johnson 1981). La recherche
de
groupes
formés
autrement
que par absence-présence
l'utilisation de l'analyse de group;ment
KM du
conduisit a
logiciel
BHDP. ·Cette
analyse s'est avérée fort efficace. Elle correspond sensiblement au mode
de formation
des
groupes
L'analyse discriminante
de l'analyse phytosociologique
classique.
est un outil puissant et précis permettant de
'.
vérifier clairement les différences entre groupes. Par contre la rigueur
de
cette analyse
trompeuses
où
le
nous
l'avons vu,
test
statistique est
signification écologique.
peut
amener
valide
des
â
mais
situations
n'a
aucune
Enfin, pour utiliser l'analyse discriminante
au maximum de ses possibilités, il est préférable de disposer en début
de
traitement
d'un lot de données assez important afin de conserver un
nombre limite d'échantillons (cas) par groupe. Le nombre d'échantillons
conservés en fin
de
certain groupes et de la
traitement
sera moindre en raison du retrait de
formation de
- 87 -
sous-groupes.
Il
conviendrait
Page V-6
également de surveiller la représentativité de chaque groupe au sein de
l'échantillonage par un pré-traitement des données disponibles.
V.3 LIMITES DE LA METHODE
L'interprétation de nos résultats doit tenir compte aussi des faiblesses
de la méthode. La notion d'habitat larvaire est toujours demeurée assez
vague puisque l'on ne
responsables du
connait
pas
précisement
les
paramètres
choix des moustiques pour un lieu donné. L'on admet
maintenant que les facteurs du milieu que l'on peut mettre en évidence
par la
végétation n'expliquent qu'une partie du choix des femelles de
moustiques pour leur habitats larvaires (Maire 1983). D'autres
tels
que la
présence de produits de dégradation liés aux bactéries et
des phéromones produites par l'oeuf; la larve ou
également
très
les
nymphes
la
seraient
importants. Outre ces facteurs, le choix sera également
influencé par le comportement ovipositeur (attirance vers les
' noires)
facteurs
capacité de dispersion,
le potentiel
surfaces
génétique, l'état
nutritione1 de l'individu et les conditions climatiques.
A la lumière
des nouvelles connaissances dans le domaine, le lien entre la végétation
et ces facteurs devra cependant être précisé par le développement de
nouvelles techniques de mesure.
- 88 -
Page V-7
V.4
CONSIDERATIONS ET AVENUES DE RECHERCHE
En ce qui concerne les moustiques, il est difficile de généraliser
compte
tenu des variations zonales et intrazonales dans la distribution
des espèces. Au sud, les espèces
rapport
sont
cependant mieux
partagèes par
l'affinité du substrat, même lorsque la présence des tourbes
â
devient très
précédemment,
importante
comme dans
en comparant
le Subarctique.
Nous avons vu
les résultats obtenus dans la tourbière â
palses avec ceux de l'ensemble du secteur, que les espèces dominantes de
la
tourbière Aedes hexodontus, A.punctor et A. communis sont également
présentes
en milieu
caractéristique de l'
D'autre part,
biotopes,
~
rocheux.
D'une
Hémiarctique,
part,
~
hexodontus
son ubiquisme y est remarquable.
communis semble confiné à un nombre plus restreint de
soit la saulaie-aulnaie,' les mares de palses peu dégradées et
profondes, les mares â feuilles et la pessière â mousses.
propos que
est
Notons à
ce
la pessière â mousses ou ("shaded spruce forest" de Jenkins
" et Knight (1952»
a été peu
prospectée dans
notre étude
(Maire et
Bussières 1983); son importance a de ce fait été masquée. Néanmoins, un
relevé effectué lors d'une expédition longue confirme la présence d'
A•
.5
communis en densité élevée dans ce milieu (1 700 larves/m ).
A partir de ces faits on est
en mesure de poser les questions
suivantes.
l)Quels sont les facteurs du milieu qui justifient
une telle sélection biogéographique et écologique?
pour A.
hexodontus
2)Pourquoi A. communis est présent seulement dans les mares de pied de
palses peu dégradées profondes dans la tourbière étudiée?
- 89 -
Page V-B
3)Qu'est ce qui â l'échelle du moustique est différent
l'Hémiarctique par rapport aux régions plus méridionales?
Ce travail ne permet pas de répondre a
ces questions mais
dans
l'on peut
émettre des hypothèses.
D'une façon générale, la longueur du
fonction
de
la
latitude.
Par exemple,
printemps, les jours sont plus longs aux
l'augmentation y est
plus
jour et
é
sa
variation sont
partir de l'équinoxe du
latitudes plus élevées et
rapide qu'au sud. Cependant le climat est
habituellement plus froid de sorte que la
saison de reproduction est
réduite CSaunders 1976;Beck 1980). Les espèces de moustiques présentes â
ces latitudes ont développé des stratégies d'adaptation tels l'autogénie
et la diapause. Cette dernière est régie en partie par les phénomènes de
thermopériode et de photopériode et' a pour effet de limiter le cycle du
moustique
a de courtes périodes de développement de masse.
Les relations entre la photopériode et la thermopériode . sont
fort
complexes. Des différences â la réponse photopériodique pour différentes
localités à la même latitude ont déja été notées.
sur la
rigueur du
climat
L'influence maritime
serait très importante CSaunders 1976). La
situation particulière de l'Hémiarctique au Québec à une latitude plus
basse que
celle . notée
pour
cette zone lorsque comparée à d'autres
régions du globe ainsi que l'influence de la
être
considérées.
Tout
historiques reliés à la
génétiques de la
en
tenant
mer d'Hudson,
devraient
compte des facteurs écologiques et
dernière glaciation,
une analyse des
bases
réponse climatique des moustiques pourrait également
- 90 -
Page V-9
fournir des éléments intéressants dans la compréhension de l'évolution
et la migration des espèces en milieu nordique.
Bien que l'on admet généralement
les facteurs
qu~
écologiques
responsables du choix des sites de ponte par les moustiques seraient mis
en évidence avec plus de netteté en région nordique,
d'espèces
et
o~
intra-spécifiques des moustiques.
ou permanentes,
pergélisol,
de
il ya moins
la pression de sélection est plus grande, l'on connait
peu de choses sur les phénomènes de
temporaires
o~
la
fonte
compétition inter-spécifiques et
\
De
plus,
résultant
rapide des
du
le nombre de mares d'eau
mauvais
neiges
au
drainage
printemps
et des
précipitations abondantes, nous semble très grand dans ces régions,
ignore la
proportion de
est
absent
on
sites réellement valides pour le moustique.
Notre expérience sur le terrain a permis en effet de
moustique
sur
constater que le
dans un grand nombre de mares de la tourbière à
palses.
Ce dernier aspect nous améne é discuter de la
protection apportée
aux espèces par l'habitat. Dans son traité sur les arthropodes arctiques
Danks (1981), signale que les espèces arctiques évitent
adverses
au
les
conditions
lieu de les confronter. Les espéces aquatiques vivant dans
un habitat qui est réchauffé par
changements rapides
de
radiation
solaire mais
protégé des
température est très commun. Haufe et Burgess
(1956) ont démontré le rOle températeur du pergélisol sur la température
de
l'eau de mares à Aedes communis et la migration des larves de cette
espèce vers les zones de température préférentielle selon les variations
- 91 -
Page V-10
journalières de
profondes,
température.
Les mares de
sans doute influencées par la
importante de
pergélisol,
palses
peu dégradées et
proximité
d'une
masse
ainsi que les mares de combes â neige,
possèderaient cette caractéristique contrairement aux mares de
rocher
soumises a un réchauffement et â un refroidissemnet rapides. Une analyse
en composantes principales de la distribution des populations larvaires
de
moustiques
en milieu
rocheux pour l'ensemble du
Poste-de-la-Baleine a montré qu'
~
distribuée
combes â neige.
dans
températeur de
le
secteur des
ces mares,
l'oviposition pourraient
ainsi
communis
que
les
est
secteur de
principalement
Ainsi,
le r01e
caractéristiques
de
expliquer partiellement le choix préférentiel
d'A. communis pour ces sites. Nous appuierons cet énoncé par l'étude de
Savignac
(1980) qui a démontré
qu'~
communis présente un développement
larvaire relié â un nombre de degrés jours â
atteindre étalé
sur une
certaine période.
De plus amples recherches en milieu nordique permettront sans doute
de préciser la
notion d'habitat
larvaire,
de mettre en lumière les
facteurs de distribution zonale des espèces et de mieux
facteurs
écologiques responsables du
choix de la
femelles de moustique pour leur site d'oviposition.
- 92 -
comprendre les
sélectivité des
Page V-Il
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BECK,S.D. 1980. Insect photoperiodisme Second edition.
387 p.
Academie Press.
BELLONCIK, S., L. POULIN, A. MAIRE, A.AUBIN, M. FAUVEt, and F.X.
JOUSSET. 1982. Activity of California encephalitis group viruses in
Entrelacs (province of Québec, Canada)
Cano
J.
Microbiol.
28:572-579.
BROWN, R.J.E. 1970. Nature of Permafrost. In Permafrost in Canada. It!
influence on northen development. Toronto University Press. p.
3-30.
BROWN, R.J.E. 1979. Permafrost distribution in the southern part of the
discontinuous zone in Québec and Labrador. Geogr.Phys. Quat.
33:279-289.
CINQ-MARS, L. 1966. Mise au point sur les violettes
Québec. Nat. Cano 93:895-958.
-CRUM, H.A. and L.E. ANDERSON. 1981. Mosses
of
Vol. 1. 663 p. Columbia University Press.
DAHL, C.
(Viola
du
~)
eastern North America.
1974. Circumpolar Aedes (Ochlerotratus)
Fennoscandia. Mosq. Syst. 6:57-73.
species in North
DANKS,H.W. 1981. Arctic arthropods. A review of systematics and ecology
with particular reference to the north american fauna.
Entomological Society of Canada. 605 p.
DEVER, L. LAITHIER, M. et C. Hi11aire-Marce1. 1982. Caractéristiques
isotopiques (18 0, 13 C02, 3 H) des écoulements dans une tourbière
sur pergélisol au Nouveau-Québec. Cano J. Earth. Sei. 19:1255-1263.
- 93 -
"
..
', ' t
. 1..
Page V-12
DIONNE, J.C. 1978. Formes et phénomènes périglaciaires en Jamésie,
Quèbec Subarctique. Nat. Cano 32(3):187-247.
DIXON, H.J. and Al. 1981. BMDP STATISTICAL SOFTHARE 1981. University of
California Press. 726 p.
DUCRUC,J.P. ,R. ZARNOVICAN, V. GERARDIN et M. JURDANT. 1976. Les régions
écologiques du territoire de la baie de James: Caractéristiques
dominantes de leur couvert végétal.
Cah.
Geogr.
Qué.
20(50):365-392.
ENVIRONNEMENT CANADA. Résumé mensuel. Données météorologiques pour le
Canada oriental. Division des services climatologiques. Service de
l'environnement atmosphériques. Centre d'édition Approvisionements
et Services Canada. (1977-1982)
FERNALD, M.L. 1970. Gray's Manual
Compagny, New York. 1632 p.
of Botany.
8ed.
American Book
FHRONE, H.C. 1953. Mosquito breeding in Alaskan salt marshes, with
special reference to Aedes punètodes Dyar. Mosq. News. 12:263.
FOREST, P. et A. LEGAUT. 1977. Analyse de la flore vasculaire de
Poste-de-la-Baleine, Nouveau-Québec. Nat. Cano 104:543-566.
GAUTHIER, R. 1980. La végétation des tourbières et les sphaignes du parc
des Laurentides, Québec. Laboratoire d'écologie forestière. Univ.
Laval, Qué. No 3. Etudes écologiques. 634 p.
GELLER, S. 1975. Abregé de statistiques à l'usage des
médecine et en biologie. Masson & Cie. 222 p.
étudiants en
GOYETTE, D et A. MAIRE. 1980. Les sentiers de
caribou dans
1'Hémiarctique, un type séculaire de biotope à larves de moustiques
(Culicidae). Cano Ent. 112:1007-1012.
GREEN, R.H.
1979. Sampling Design and
Statistical Methods
Environmental Biologists. John Hiley and Sons. 257 p.
- 94 -
for
Page V-13
GUINOCHET, M. 1973. Phytosocio1ogie. Masson & Cie. 227 p.
HAMELIN, L.E. et A. CAILLEUX. 1969. Les pa1ses dans le bassin de la
Grande Rivière de la Baleine. Rev. Geogr. Montr. 23:239-337.
HAUFE,
W.O.
and
L.
BURGESS.
1956.
Development
of
Aedes
(Diptera:Culicidae) at Fort Churchill, Manitoba, and prediction of
dates of emergence. Ecology 37(3):500-519.
ISOVIITA, P. 1966. Studies on Sphaqnum L. I. Nomenc1atura1
the European taxa. Ann. Bot. Fenn. 3:199-264.
revision of
JENKINS, D.W. and K.L. KNIGHT. 1950. Eco1ogica1 survey of the mosquitoes
of the Great Wha1e River, Québec. Proc. Ent. Soc. Wash. 52:209-223.
JOHNSON, H.J. 1981. The use and misuse of statistics in Ni1d1ife habitat
studies. P 11-19. In The Use of Mu1tivariate Statistics in Studies
of Wi1d1ife Habitat. General Technica1 Report RH-87. Rocky Mountain
Forest and RAnge Experiment Station Forest Service. U.S. Department
of Agriculture. 249 p.
LAGAREC, D. 1979. Etude géomorpho1ogique de palses
(Nouveau-Québec) Thèse Ph.D. Univ. Laval. 308 p.
en
Hudsonie.
-· LEGENDRE L. et LEGENDRE P. 1979. Ecologie numérique Tome l et II.
Masson. 197 et 254 p.
PUQ.&
MAIRE, A. 1980a. Ecologie comparée des espèces de moustiques
holarctiques. (Diptera:Culicidae) Cano J. Zool. 58:1582-1600.
MAIRE, A. 1980b. Ecologie des moustiques du Québec. (Diptera:Culicidae>.
Thèse de doctorat d'ètat. Université scientifique et médicale de
Grenoble.
MAIRE, A. 1982. Selectivity by six snON melt mosquito species for larval
habitats in QUébec string bogs. Mosquito NeNs. 42:236-243.
MAIRE, A. 1983. Sélectivité des femelles de moustiques CCulicidae)
- 95 -
pour
Page V-14
leur sites d'oviposition:
expt1. 42(2):235-241.
Etat de
la question. Rev. Cano Biol.
MAIRE, A. et A. AUBIN. 1976. Inventaire et classification écologique des
biotopes â larves de moustique (cu1icides) de la région de Radisson
(Territoire de la baie de James, . Québec)
Cano
J.
Zool.
54: 1979-1991.
MAIRE, A. et A. AUBIN. 1980. Les moustiques du Québec (D1ptera:
Culicidae) Essai de synthése écologique. Mem. Soc. Ent. Qué. No. 6
107p
MAIRE, A. et B. BUSSIERES. 1983. Analyse de la distribution des
populations larvaires de moustique (D1ptera:Culicidae) dans
l'Hémiarctique. Cano J. Zool. 61:2539-2549
MAIRE, A. , MAILHOT, Y. et A. AUBIN. 1979. Caractérisation écologique
des biotopes à larves de moustiques (Culicidae) du littoral
subarctique de la baie de James, Québec. Cano Ent. 111:251-272.
NATVIG, L.R. 1948. Contribution to • the knowledge of the Danish and
Fennoscandian mosquitoes: Culicini. Nor. Entomol. Tidskr., Suppl.
I.
NIKOLAEVA, . N.V.
1978.
Numbers
of
b100dsucking
mosquitoes
(Diptera:Cu1icidae) in the forest and tundra biocenoses of South
Yama1. Zool. Zh. 7:1017-1023 (en russe, résumé anglais).
McLEAN, D.M. 1979. Bunyavirus infection rates in Canadian arctic
. mosquitoes, 1978. Mosquito News 39(2):364-367.
McLEAN, D.M., S.K.A. BERGMAN, A.P. GOULD, P.N. GRASS, M.A. MILLER et
E.E.
SPRATT.
1975. California encephalitis virus prevalence
throughout the Yukon Territory, 1971-1974. Am. J. Trop. Med. Hyg.
24(4):676-684.
NIELSEN, L.T. 1979.
156(3):426-440.
Mosquitoes,
the mighty ki11ers.
- 96 -
Nat.
Geogr
Page V-15
OSTROUSHKO, T.S. 1967. B1ood-Sucking mosquitoes from the Komi ASSR and
their . biology.
Parazitologyia,
1:311-318 (en russe, résumé
anglais).
PAUTOU, G. , AIN, G. , GILOT, B. , COUSSERANS, S. , GABINAUD, A. et P.
SIMONNEAU.
1973.
Cartographie écologique appliquée à la
démoustication. Documents pour la cartographie écologique II: 1-16.
PAYETTE, S. 1974. Classification des formes de croissance de Picea
qlauca (Moench.) Voss. et de Picea mariana (Mill.) BSP. en milieux
subarctiques et subalpins. Nat. Cano 101:893-903.
PAYETTE, S. 1975. La limite septentrionale des forêts sur la cOte de la
Baie d'Hudson, Nouveau-Québec. Nat. Cano 102:317-329.
PAYETTE, S. 1976. Succession écologique des forêts d'épinette blanche et
fluctuations climatiques, Poste de la Baleine, Nouveau-Québec. Cano
J. Bot. 54:1394-1402.
PAYETTE, S. 1979. La
orientale de
102:317-329.
limite septentriQnale des forêts sur la cOte
la
baie d"Hudson, Nouveau":Québec. Nat. Can.
PAYETTE, S. 1983. The forest-tundra and present tree-1ines of the
northern Québec-Labrador peninsula. p. 3-23. In Tree-Line Ecology.
Procedinqs of the Northern Québec Tree-Line Conference. Collection
Nordicana No. 47. Centre d'Etudes Nordiques de l'Université Laval.
188 p.
PAYETTE,S et L. FILION. 1975. Ecologie de la limite septentrionale des
forêts maritimes.
Baie d'Hudson, Nouveau-Québec. Nat. Cano
102(6):783-802.
PAYETTE, S. et B. GAUTHIER. 1972. Les structures de végetation
interprétation géographique et écologique. Classification et
application. Nat. can. 99:1-26.
PAYETTE, S. et R. GAGNON. 1979. Tree-line dynamics in Ungava
Nothern-Québec. Holarctic Eco1ogy 2:239-248.
- 97 -
peninsula,
Page V-16
PAYETTE, S. et LAGAREC D. 1972. Observations sur les conditions
d'enneigement à Poste de la Baleine, Nouveau-Québec. Cah. Géogr.
Qué. 16(39):469-481.
PAYETTE, S. , SAMSON, H. and D. LAGAREC. 1976. Evolution of permafrost
in the taiga and in the forest-tundra, Hestern Québec-Labrador
peninsu1a. Cano J. For. Res. 6:203-220.
PORSILD, A.E. and H.J. CODY. 1980. Vascu1ar plants of continental
NorthHest Territories, Canada. National Museums of Canada. 667 p.
RAILTON, J.B. 1968. The ecology of palsa bogs. M.Sc.
Toronto. 89 p.
Thesis.
Univ.
of
RICHARD, P. 1978. Aires ombrothermiques des principales unités de
végétation du Québec. Nat. Cano 105(3):195-207.
ROUSSEAU, C.
1974.
Géographie floristique du Québec-Labrador,
Distribution des principales espèces vasculaires. Travaux et
documents du Centre d'Etudes Nordiques. No. 7.
Presses de
l'Université Laval, Québec. 79B p.
ROUSSEAU, J. 1952. Les zones biologiques de la péninsule Québec-Labrador
et l'Hémiarctique. J. Cano Bot. 30(4}:436-474.
ROUSSEAU, J. 1961. La zonation 1atitudina1e dans la péninsule
Québec-Labrador.
Ecole pratique des Hautes-Etudes (Sorbonne).
Centre d'études artiques, Contrib. I.
SAMSON, H. 1974. Evolution du pergélisol en milieu tourbeux en relation
avec
le dynamisme de la végétation. Golfe de Richmond,
Nouveau-Québec. These M.Sc. Univ. Laval. Québec. 105 P.
SAVIGNAC, R. 1980. Dynamique des populations larvaires de trois espèces
de Cu1icidae (Diptera) dans quelques milieux humides de la
Basse-Mauricie (Québec). Mémoire de maïtrise. Université du Québec
à Trois-Rivières. 94 p.
SAUNDERS,D.S. 1976. Insect c1oks. Pergamon Press. 279 p.
- 98 -
Page V-17
SEGUIN, M.K. et J. CREPAULT. 1979. Etude géophysique d'un champ de
pa1ses . â Poste de la Baleine, Nouveau-Québec. Geogr. Phys. Quat.
33:327-337.
SOMMERMAN, K.M. 1977. Biting fly-arbovirus probe in interior Alaska
(Culicidae)
(Simuliidae}-(SSH:Ca1ifornia
comp1ex)
(Northway:
Bunyamera group). Mosquito News 37(1):90-103.
TATSUOKA, M.M. 1970. Discriminant analysis: The study of group
differences. Selected topics in advanced statistics, an e1ementary
approach. Number 6. Institute for personality and abi1ity testing.
Champaign, Illinois, USA.
TESSIER, C. , MAIRE, A. et A. AUBIN. 1981. Productivité en larves de
moustiques (Diptera:CU1icidae) des milieux aquatiques peu profonds
d'un secteur du Moyen-Nord québecois. (LG-l, Territoire de la baie
de James) Cano J. Zool. 59:738:749.
THIBODEAU, E. et A. CAILLEUX 1973. Zonation latitudina1e de structures
de thermokarst et de tourbières vers 75 Ouest, Québec. Rev. Geogr.
Montr. 26(2):117-138.
WAGNER, R.J., C. De JONG, M.K. LEUNG, J. McLINTOK and J.O. IVERSEN.
1975. Isolations of California encephalitis virus from tundra
mosquitoes. Cano J. Microbio1. 21(4):574-576.
WASHBURN, A.L. 1973. Periglacial processes and environnements. St-Martin
press, New-York. p. 150-161
WILSON, C.V. 1968. Notes on the climate of Poste de la Baleine, Québec.
Univ. Laval. Travaux Centre d'études nordiques. No 4. 93 p.
WILSON, C.V. 1971. Le climat du Québec. Atlas climatique.
climatologiques II. Service Météorologique du Canada.
Etudes
WILLIAMS, B.K. 1981. Discriminant analysis in wildlife research: Theory
and applications. p 59-70. In The use of mult1var1ate statistics in
etudies of wildlife habitat. General technical report RM-87. Rocky
Mountain Forest and Range Experiment Station. Forest Service U.S.
Department of Agriculture. 249p.
- 99 -
Page V-lB
WOOD, D.M. DANG, P.T. and R.A. ELLIS. 1979. The insects and arachnids of
Canada.· Part 6. The mosquitoes of Canada Diptera:Culicidae.
Biosystematics Research institute. Ottawa, Ontario. Publication
1686. 390 p.
ZAR, J.H. 1974. Biostatistical analysis. Prentice Hall Inc. 620 p.
- 100 -
ANNEXE l
LISTE DES TAXONS
EQUISETACEES
.
Eq~e..:tum
aJtven6e L.
Eq~e..:tum
.6yR..vctUc.uin
L.
LYCOPODIACEES
Lyc.o pocüum
.6 e1.ago L.
PINACEES
L~x ~~na.
P~c.ea.
(Du Roi) Koch.
gR..a.uc.a. (Moench) Voss.
P~c.ea. m~na.
(Mill.) B.S.P.
JONCAGINACEES
T~gR..oc.hin m~um
L.
POTAMOGETONACEES
Po-tamoge:ton a.R..pÙI.LL6 Balbis. var.
;te~6oUU.6
POACEES
Ca1.a.maglto.6fu
c.a.nadert.6~
Ve.6c.ha.mpla. 6R..exuo.6a
H~eJt.oc.h1oe a.R..Y.J~na.
(Michx.) Beauv.
(L.) Trin.
(Sw.) R. & S.
PhR..eum c.ommutatum Gaud.
(Raf.) Hult.
CYPERACEES
Cd4ex
aq~ Wahlemb.
Cd4e~
bigelowii Torr.
CaJLè.x
CaJLex
CaJLex
CaJLex
Cd4ex
CaJLex
CaJLex
CaJLex
CaJLex
CaJLeX
CaJLex
bJtU.rtrte.6 cen6 Po ir •
carte.6 cen6 L.
cho~do~hiza L.f.
leptalea Wahlemb.
Limo.6a L.
liv~da Willd. VaJL.
g~yarta (Dew.) Fern.
ma.ge.U.ct.n1.ca. Laur. ssP.
pauci6lo~
~6l0Jt.a.
~O.6tnata.
~gua.Qwahl.)
B. S.P.
Lightf.
(Wahl.) SUl.
Stokes
.6 axa.ti..U..6 L. .6. W.
~ex tert~ttoJt.a. W~hlemb
CaJLex i:JU.6 p~a Dew.
CaJLex vag~rta.ta. Tausch.
E~phoJtU.m a.ngU6tl6otlum Honck.
~ophoJtU.m ~.6eolum Fries.
~pho~um .6p~.6um Fern.
SWpU6 Ce.6pUo.6U.6
L. ssp.
aU.6.tJü.a.CU.6 (Pallas) Ash.
& Graeb.
JONCACEES
JUrtCU6 atbucen6 (Lange) Fern.
JUrtCU.6 battlcU.6 L.
ORCHIDACEES
Habe~ ~ (Pursh.) Hook.
LILIACEES
Sm-Ua.cin.a. tJU60Ua
(L.) Desf.
S:tIteptopU.6 a.mpteu6o~ (L.) D. C. var. a.meM.ca.rtU.6 Schul tes.
To6~ei..cüa.
pU.6il..ta. (Michx.) Pers.
SALICACEES
Satix a4ctophlla
Cockerell
Satix
a4gy~o~pa Anderss.
Sa11.x
pecU.c.~ Pur sh
Sallx
p!a~6olia
Pursh
BETULACEES
Betuta
g!anduto~a
Michx.
BRASSICACEES
Ca4cfa.m.i.ne pJta.ten6-L6
L. var.
angU6il6oUa
RENONCULACEES
Anemone
pa4vi6!o~a
Michx.
Ca.Ltha. palLu, tM..6 L.
Copti6 gftoen!ancU.c.a
(Oeder.) Fern.
POLYGONACEES
Po!ygonum
vivip~um
L.
DROSERACEES
V~o~~ ~otuncU.6o!ia
L.
SAXIFRAGACEES
ULteUa nuda
L.
ROSACEES
Amei.a.n.c.fU.~ b~a
(Taush.) Roemer.
FlUlfJaIIlA. V,()[giniaM Duchesne
Geum ûva!e L.
Potenil!!a 6~u.ilc.o~aL.
Poten.-tU1.a. pa..iU6:0U..6 (L.)
RubU6 ac.au.!-i...6 Michx.
RubU6 c.ha.maemo~ L.
Scop.
Hook.
EMPETRACEES
Empe..tAum hvr.maplvtocUtum Hag.
CORNACEES
CO~U6 canaden6~ L.
CO~U6 .6 Ueu.c.a L.
VIOLACEES
V,tola R..a.bJtO.doJUc.a Schrank.
V,toR..a. pa.t.een.6 (Banks) Brainerd.
PYROLACEES
Pyltola rrU.nolt L.
SCROPHULARIACEES
CM tille j a. .6 eptert.tlU.o na..U6 L ind 1.
Pedic.~ gltoenlan~ca
Retz.
Pedi~
R..a.bltadoJUca Wirsing.
VeltOMca alp,tna L. var. unala.6c.hen.6~ C.
8. S.
M!NY ANTHACEES
Menyanthu
W6o~ L.
var. rrU.nolt Raf.
ERICACEES
Andltomeda pol,{,6011a L.
Altc.to.6taphylo.6 ItUbJtO. (Rehd. 8. Wils.) Fern.
Raim,{,a po~oli4 ~ang.
Ledum gltoenland,{,c.um Oeder.
Turcz.,
Vac.u.Mum ul,{,g,tno-6 um L. .6. i.a.t.
OxyC.OC.C.U6 m,{,CllOC.MpU6
Vac.u.Mum
v~-ùle.a.
L. vM. nU.nU6 Lodd. .
LENTIBULARIACEES
Pingulcula
Pingulcula
v~~a
L.
vulg~
L.
U~~c~ inte~edia
Hayne.
RUBIACEES
Gatium
lab4ado~cum
Wiege
CAPRIFOLIACEES
LonA.ce/ta v.J.lo.ôa (Michx.) R.
& S. vaJt. ca1.ve.6CeYL6 (Fern. & Wieg.) Wiege
J. '
VALERIANAGE.ES
Va1.~ana
dtoica L.
V~ • .6ylv~ca
(Sol.) Gray.
ASTERACEES
Ac~ea bo~e~ Bang.
Anten~ pulch~a (Hdok.) Greene
MtVL pu.rUceU6
PetMlie.6
L.
pa1.m~
(Ait.) Gray.
Seneub aWteU6 L.
Seneuo pauu6lo~ Pursh
SoUda.go maC/tophyUa Pursh.
SoUdago pUM~ Porter.
T~xacum lappo~cum
Khilm.
VM.
thYMoidu (Mey.) Fern.
ANNEXE
II
LISTE DES SPHAIGNES
LISTE DES SPHAIGNES
TOURBIERE A PALSES
POSTE DE LA BALEINE, NOUVEAU-QUEBEC.
1. Spha.gnum a.ngU6.ti.6oUum (Russow.) C. Jens.
2. Spha.gnum ba.Lt.<.c.um (Russow.) C. Jens.
3. Spha.gnum 6a.lla.x (K1inggr.) K1inggr.
4. Spha.gnum 6.-UnbJUa..tum Wils.
S. Spa.gnum
6U6 c.um
(Schimp.) K1inggr.
6. Spha.gnum g-Ut.gert.6oh/'L.Ü. Russ.
7. Spha.gnum
Undb~g~ Schimp.
.
8. Spha.gnum ma,gella.nic.um Brid.
9. Spha.gnum nemo~eum Scop.
10. Spha.gnum p.e.a..typhyUum (Braithw.) Warnst.
Il. Spha.gnum pulC.Mum (Braithw.) Warnst.
12. Spha.gYLUm ~p~um Angstr.
13. Spha.gnum 4Ubettum Wi1s.
14. Spha.gnum
~~o~ Warnst.
is.
~qu.a.llJLo~um Crome.
Spha.gnum
16. Spha.gnum ~l.Lb~ec.WLdu.m Nees.
17 .Spha.gnum
.t~u
18. Spha.gYLUm
~.to~6~
(Schimp.) Angstr.
Russow.