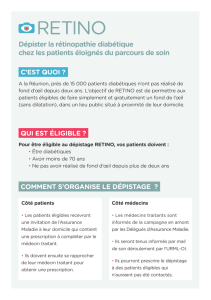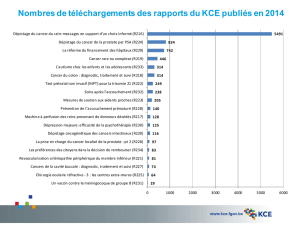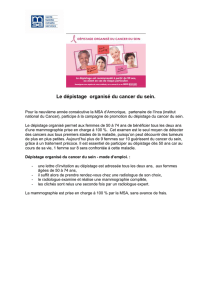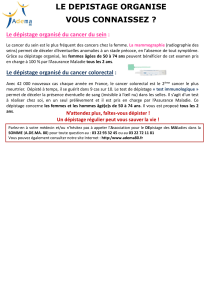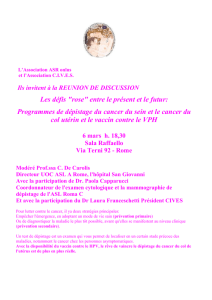PREVENTION LE ROLE CLE DU MEDECIN TRAITANT

Dossier Médecin traitant et prévention – 8 mars 2007 1
Le 8 mars 2007
PREVENTION
LE ROLE CLE DU MEDECIN TRAITANT
Pivot du parcours de soins coordonnés, le médecin traitant est le mieux placé pour
organiser le suivi préventif de ses patients parce qu’il les accompagne dans la durée et
coordonne leurs soins. Le médecin traitant se situe ainsi au cœur de la démarche de
prévention que l’Assurance Maladie et les représentants des médecins ont souhaité
renforcer depuis un an.
Aujourd’hui, le parcours de soins coordonnés est une réalité pour 80% des assurés, soit 40
millions de personnes ayant choisi un médecin traitant
1
. La coordination des soins par le médecin
traitant a créé les conditions nécessaires au développement d’actions de prévention plus
personnalisées et donc plus efficaces.
La convention nationale de 2005 prévoyait l’implication du médecin traitant dans des actions de
prévention. L’avenant signé par l’Assurance Maladie et les représentants des médecins en mars
2006 a précisé les champs d’action retenus et confirmé l’ambition partagée des partenaires dans
ce domaine :
• la prévention de la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes de plus de 65 ans
La iatrogénie médicamenteuse est une priorité de santé publique et si tous les patients sont
potentiellement concernés, les personnes âgées sont plus vulnérables à ce risque. L’action
engagée par l’Assurance Maladie et les médecins en juin 2006 concernent en priorité les
personnes de plus de 65 ans poly-médiquées de façon régulière, ce qui correspond à environ
1 million de personnes. Pour ces personnes, les partenaires conventionnels avaient identifié
quelques prescriptions sensibles sur lesquelles il convient de s’interroger.
Six mois plus tard, on observe que le nombre de personnes de plus de 65 ans poly-
médiquées de façon importante et régulière a baissé de 8% entre les périodes juillet
2005-juin 2006 et janvier-décembre 2006. Leur consommation de benzodiazépines à
demi-vie longue a diminué de 9% et celle de vasodilateurs de 11%.
• la promotion du dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74
ans
Les analyses de l’Assurance Maladie montrent qu’il existe de fortes disparités à la fois
géographiques et dans la patientèle des médecins traitants, concernant le dépistage du cancer
du sein (organisé ou non).
Ainsi, 86% des médecins traitants ont plus de 50% de leur patientèle de femmes de 50 à 74
ans ayant bénéficié d’une mammographie au cours des 2 précédentes années. Seuls 15%
d’entre eux ont plus de 80% de leur patientèle concernée dépistée, soit le taux préconisé
par le Plan Cancer.
L’objectif des partenaires conventionnels est de développer et d’harmoniser au niveau national
le taux de dépistage des femmes concernées.
1
Les Français ont choisi à 99,5% un médecin généraliste comme médecin traitant et 98% des généralistes
sont des médecins traitants. (cf point presse du 23 janvier 2007)

Dossier Médecin traitant et prévention – 8 mars 2007 2
Pour les accompagner dans cette démarche, l’Assurance Maladie met en œuvre des actions et
des outils destinés à faciliter l’engagement des médecins traitants : 15 400 entretiens confraternels
portant sur le thème de la iatrogénie ont été réalisés au cours de second semestre 2006. En 2007,
les entretiens se poursuivront au même rythme pendant que les délégués de l’Assurance Maladie
consacreront 16 000 visites à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
• Enfin l’Assurance Maladie va développer en concertation avec les associations de patients
et les médecins un programme d’accompagnement des patients diabétiques en lien avec la
troisième priorité de santé publique retenue par les partenaires conventionnels : la
prévention des risques cardio-vasculaires des diabétiques.
Si l’Assurance Maladie choisit d’investir dans la prévention et accompagne les médecins dans
cette démarche conjointe, c’est pour mieux gérer les risques de demain.
Aux trois premiers thèmes retenus en 2006 s’ajouteront progressivement d’autres préoccupations
majeures de santé publique : les facteurs de risques chez les femmes enceintes et l’obésité des
adolescents et des jeunes.

Dossier Médecin traitant et prévention – 8 mars 2007 3
Fiche 1 – Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse
1. Un enjeu de santé publique
• Le programme de prévention de l’Assurance Maladie
La iatrogénie (ou iatrogénèse) désigne les effets provoqués par un acte médical, ou par un ou
plusieurs médicaments, sans qu’il s’agisse nécessairement d’une erreur médicale.
La iatrogénie médicamenteuse constitue un problème majeur de santé publique : on estime en
effet que près de 130 000 hospitalisations y sont liées chaque année et que, 40 à 60%
d’entre elles sont évitables.
L’importance de la consommation de médicaments, traditionnelle en France, augmente les risques
iatrogènes. Le vieillissement actuel de la population tend également à les accroître.
Dès lors, les pouvoirs publics ont fait de la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse un enjeu
prioritaire, avec pour objectif de réduire le nombre d’hospitalisations d’origine médicamenteuse
2
.
Dans ce cadre, l’Assurance Maladie a développé un programme pour sensibiliser les médecins et
les accompagner dans leur action de prévention auprès des patients. Cette démarche s’appuie sur
les recommandations de l’Afssaps et sur les outils d’aide à la prescription conçus par la Haute
Autorité de Santé (HAS)
3
.
L’enjeu est moins de diminuer les prescriptions de médicaments de manière systématique,
car la prise quotidienne de plusieurs médicaments est nécessaire pour certains patients,
que de veiller à une bonne utilisation des médicaments.
Populations les plus vulnérables :
Si tous les patients sont potentiellement concernés par le risque iatrogène, les personnes
les plus vulnérables sont les femmes enceintes, les enfants mais aussi les sujets âgés qui
sont notamment les plus exposés. Ainsi, les effets indésirables des médicaments sont deux
fois plus élevés chez les personnes de plus de 65 ans, qui sont souvent poly-médiquées,
plus fragiles et dont les mécanismes d’élimination fonctionnent moins bien. Ils sont
également plus graves : 10 à 20% de ces effets indésirables mènent à une hospitalisation.
Or, selon les études de l’Assurance Maladie, entre juillet 2005 et juin 2006, 12% des
personnes âgées de plus de 65 ans, soit 1 million d’individus, étaient dans une
situation de poly-médication régulière au cours de l’année, consommant plus de 10
fois dans l'année au moins 7 médicaments différents.
2
Loi relative à la santé publique publiée au Journal Officiel le 9 août 2004.
3
Recommandations de l’Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) de juin 2005 sur la
prévention de la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées. Référentiels de bonnes pratiques de la HAS
(Haute Autorité de Santé) sur la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé d’avril 2006.

Dossier Médecin traitant et prévention – 8 mars 2007 4
Médicaments retenus :
Compte tenu de la complexité du sujet, l’Assurance Maladie a centré son action autour de
trois classes thérapeutiques, définies notamment selon la fréquence des prescriptions et la
gravité des risques iatrogènes qu’ils peuvent provoquer.
Benzodiazépines à demi-vie longue (dont l’élimination est supérieure ou égale à 20 heures)
Ces médicaments, largement utilisés, présentent des risques d’accumulation, plus
importants encore chez les personnes âgées, et peuvent générer les effets suivants :
troubles de la vigilance ou de la mémoire, augmentation des risques de chute, etc. Ainsi,
les produits à élimination rapide (dits à demi-vie courte) sont à privilégier lorsqu’une
benzodiazépine est indiquée.
Cependant, on constate que la consommation de benzodiazépines à demi-vie longue reste
fréquente : 38%
4
de la population poly-médiquée de façon régulière avaient
consommé ce type de benzodiazépines.
Psychotropes
Ce sont notamment les hypnotiques, anxiolytiques, anti-dépresseurs, neuroleptiques et
régulateurs thymiques. L’association de plusieurs psychotropes peut provoquer des chutes,
des troubles cognitifs, de la mémoire ou de la vigilance.
Vasodilatateurs
La faible efficacité de ces médicaments les rend superflus sur des ordonnances souvent
déjà denses. Or, selon les études de l’Assurance Maladie, le niveau de prescriptions de ces
médicaments reste élevé : 29% de la population concernée (voir plus haut) avaient
consommé au moins un vasodilatateur.
Schéma 1 – Courbe de concentration du médicament dans le sang
5
4
Entre juillet 2005 et juin 2006.
5
Médicaments à élimination lente, associé à d’autres médicaments.

Dossier Médecin traitant et prévention – 8 mars 2007 5
Des disparités géographiques importantes :
On constate des disparités géographiques notables du pourcentage des plus de 65 ans
poly-médiqués de façon régulière au cours de l’année
5
: de 6 à 30% selon les
départements (cf Annexe 1– carte a). Les départements enregistrant les taux les plus élevés
se situent dans le nord et l’est de la France ainsi que dans la région Limousin. Or, ces
variations s’avèrent difficiles à expliquer sur le plan médical.
• Le médecin traitant au cœur de la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse
La loi de santé publique de 2004 a fixé comme objectif, d’ici à 2009, une diminution des
prescriptions inadaptées chez les personnes âgées et des événements iatrogènes d’origine
médicamenteuse entraînant une hospitalisation.
Dans cette perspective, les partenaires conventionnels ont intégré la iatrogénie
médicamenteuse chez les personnes âgées de plus de 65 ans comme l’un des 3 thèmes
prioritaires de prévention pour les médecins traitants.
Au centre de la coordination des soins, le médecin traitant dispose en effet d’une vision globale
des traitements de ses patients et est ainsi le mieux à même d’identifier puis de minimiser les
risques d’effets indésirables. Dans ce cadre, l’Assurance Maladie sensibilise et accompagne
les médecins traitants dans leur démarche de prévention, en les incitant notamment à revoir
périodiquement les traitements de leurs patients à « risques ». Il s’agit ainsi, en s’appuyant sur
les travaux de la HAS et l’Afssaps, de :
Réévaluer régulièrement l’intérêt de chaque médicament en termes de bénéfices /
risques individuels,
Supprimer tout médicament inadapté, soit à l’origine d’effets indésirables, soit
superflu compte tenu des pathologies traitées, de leur hiérarchisation et du risque de
syndrome de sevrage
6
,
S’interroger sur la nécessité de poursuivre un traitement et éviter l’accumulation
des médicaments au fil des années.
Par ailleurs, l’Assurance Maladie proposera progressivement en 2007 aux médecins un
nouveau service en ligne permettant de consulter l’historique des soins remboursés aux
patients, dont la liste des médicaments remboursés et leur ayant été délivrés. Cela constituera
ainsi un nouvel outil de connaissance pour le médecin traitant, facilitant l’analyse et le suivi des
traitements médicamenteux pris par chaque patient.
2. De premiers résultats encourageants pour l’année 2006
• Des actions d’information et de sensibilisation pour les professionnels de santé et les assurés
Au cours du second semestre 2006, plus de 15 400 échanges confraternels ont été menés.
Ces rencontres ont concerné les médecins traitants qui ont une patientèle importante atteinte de
poly-pathologies et/ou qui consomme de nombreux médicaments.
Les médecins-conseils de l’Assurance Maladie ont ainsi eu l’opportunité de présenter les
recommandations de l’Afssaps et certains outils élaborés par la HAS (recommandations, grilles
d’évaluation). Un outil pratique d’aide à la prescription des benzodiazépines, conçu par
l’Assurance Maladie en collaboration avec la HAS, a été remis à l’occasion de ces rencontres
(mémo benzodiazépines).
6
L’Afssaps rappelle ainsi que l’arrêt de certains médicaments doit être progressif pour éviter les phénomènes de
sevrage. L’arrêt de la prescription doit être expliqué au patient et à son entourage.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%