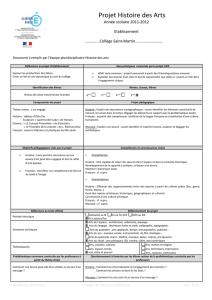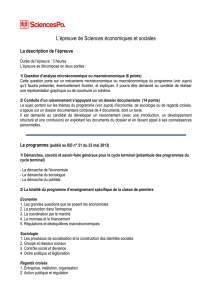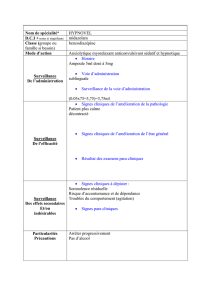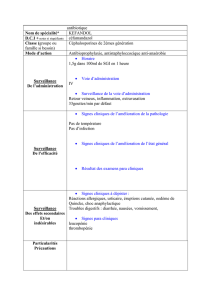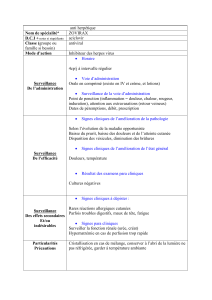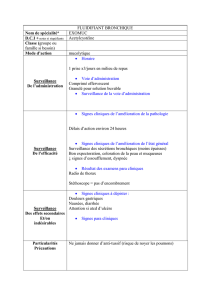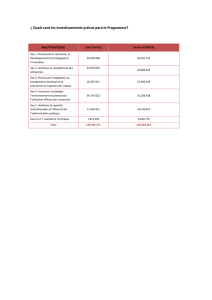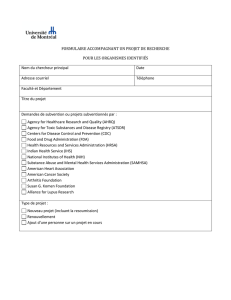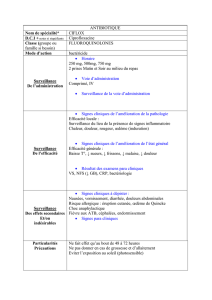UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE FACULTÉ DE DROIT

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
FACULTÉ DE DROIT
L'EXIGENCE DE MAINTIEN DE TRAITEMENT
CHEZ LE PATIENT À L’INCONSCIENCE IRRÉVERSIBLE
Catherine PASCHALI
Programme de maîtrise en droit et politiques de la santé
SEPTEMBRE 2014

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
FACULTÉ DE DROIT
L'EXIGENCE DE MAINTIEN DE TRAITEMENT
CHEZ LE PATIENT À L’INCONSCIENCE IRRÉVERSIBLE
Par
Catherine PASCHALI
Étudiante à la maîtrise en droit et politiques de la santé
Mémoire soumis à la Faculté de droit
En vue de l’obtention du grade de « Maître en droit »
SEPTEMBRE 2014
© Catherine Paschali 2014

iii
RÉSUMÉ
Alors que les progrès technologiques repoussent les frontières de la mort, un nouveau
débat éthique et légal émerge. Lorsqu’un patient se retrouve en état végétatif et que tout
espoir de réhabilitation s’éteint, la communauté médicale propose de cesser les soins de
maintien en vie et de ne pas tenter la réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire. Or,
certaines familles, la plupart religieuses, s’opposent à toute cessation des traitements, et
en exigent le maintien. Avec l’éclairage des données scientifiques actuelles qui
permettent d’accéder à la conscience malgré les apparences, l’état du droit canadien sera
examiné. Dans un premier temps, l’auteure examine en quoi la perte apparemment
irréversible de la conscience justifie le refus des médecins de poursuivre les soins de
maintien en vie. Dans un deuxième temps, elle aborde les droits fondamentaux pouvant
être invoqués par les proches au soutien de l’exigence de la poursuite des traitements.
Dans un dernier temps, elle évalue les pistes de solution proposées visant à clarifier à qui
appartient le pouvoir décisionnel ou à mettre en place un processus de règlement des
différends. En arrière-plan de ce débat, la science continue de progresser, avec l’espoir
d’un meilleur respect des droits des patients apparemment inconscients dans le futur.
CIHR Fellow in Health Law, Ethics and Policy (2010-2011)
Les propos contenus dans le présent texte sont personnels à l'auteure et n'engagent pas
son employeur, le ministère de la Justice du Québec.

iv
ABSTRACT
As technological progress pushes the boundaries of death, a new ethical and legal debate
emerges. When a patient is in a vegetative state and all hope of rehabilitation is gone, the
medical community proposes to withdraw life-sustaining treatment and withhold
resuscitation. However, some families, in most cases religious, are opposed to
withdrawing treatments and request that they be maintained. Keeping in mind recent
scientific advances allowing an unprecedented access to consciousness, against all odds,
the Canadian legal landscape will be explored. Firstly, the author will examine how
irreversible unconsciousness justifies doctors’ refusal to pursue life-sustaining treatment.
Secondly, the fundamental rights invoked by the relatives’ to support their requests for
life-sustaining treatment will be analyzed. Lastly, solutions aimed at clarifying who has
the right to decide or to create a dispute resolution process will be evaluated. The
background of this debate is scientific progress, with the hope of improving the respect
of presumably unconscious patients’ rights in the future.
CIHR Fellow in Health Law, Ethics and Policy (2010-2011)
The views and opinions expressed in this text are not those of the author’s employer, the
Ministère de la Justice du Québec.

v
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier Mme Suzanne Philips-Nootens pour son support constant pendant la
conception et la rédaction de ce mémoire de maîtrise. Elle a su me guider et m’a
généreusement offert des critiques constructives et partagé sa grande expérience tout au
long du projet. Merci aux professeurs qui m'ont soutenu dans des démarches pour
intégrer le programme. Une pensée particulière va à feu le professeur François
Chevrette, qui m'a transmis son amour du droit. Merci à mes parents, pour m’avoir
encouragé à me dépasser et m’avoir inculqué l’importance des études. Merci à mes amis,
pour m'avoir encouragé à compléter ma maîtrise alors que ma carrière débutait. Merci à
mon employeur, pour son ouverture envers ce projet personnel et les accommodements
qui m’ont permis de terminer la rédaction. Finalement, les Instituts de recherche en santé
du Canada m’ont fait confiance et m’ont offert une aide financière dans le cadre du
programme de droit de la santé, éthique et politiques, sans oublier la possibilité
d’échanger avec des étudiants brillants qui partageaient mes intérêts et de discuter de
mon sujet avec des professeurs émérites. Je les remercie sincèrement pour cette belle
opportunité.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
1
/
144
100%