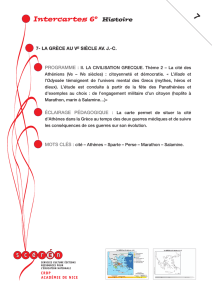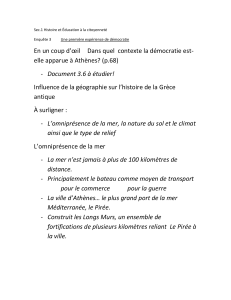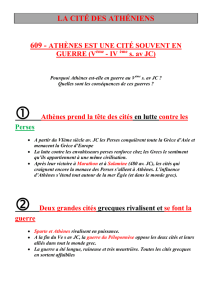(Recueil de textes : pp.63 à 74 inclusivement

Cours 8
La civilisation grecque
Articles obligatoires à lire :
(Recueil de textes : pp.63 à 74 inclusivement.) = Bonnet, Christian.
Athènes, des
origines à 338 av. J.C.
Paris, PUF, 1997. pp. 100 à 123.
1- L’armée grecque
Recrutement des troupes est lié { l’organisation sociale
Tactique est simple : choc frontal entre adversaires en rase campagne
Ordre de bataille : corps de bataille au centre; troupes légères et cavalerie sur
les flancs
Corps de bataille : hoplites sur 8 à 12 rangs de profondeur sur l’aile droite
Rites et augures avant la bataille : devins, exégètes
Si les signes sont néfastes, on hésite à engager le combat
Sinon, on engage le combat
Troupes légères, archers, frondeurs attaquent en premier, puis les hoplites
avancent en chantant le Péan, un chant guerrier
La cohésion des rangs assurait la victoire, l’aile droite défonçait les rangs
ennemis
Toutefois, en 371 à Leuctres, le Thébain Épaminondas« tricha » ; il plaça ses
hoplites { l’aile gauche et brisa la résistance spartiate
Après une victoire, la cavalerie poursuivait l’ennemi et l’armée victorieuse
érigeait un trophée (mannequin couvert d’armes), chantait le Péan de la
victoire et on faisait des offrandes dans les sanctuaires
Composition :
Les hoplites : infanterie lourde munie d’armement défensif et offensif
(bouclier, lance).
L’infanterie légère (gens qui ne peuvent pas payer les armes, ils n’ont pas les
moyens) : armes d’attaque
La cavalerie : soutient les troupes
La marine : la trière (la supériorité d’Athènes est vraiment sur l’eau et non
pas sur terre. Sparte par contre, va avoir une supériorité terrestre).
La guerre à un aspect religieux ou le but est de démontrer la supériorité.
Trophée : armes, boucliers et casques des adversaires.
La phalange = bloc de guerrier en armure.
L’éphébie (Athènes)
On va former l’individu pour servir dans l’armée.
Détails de cette institution ne sont connus qu’après la bataille de Chéronée
(338) de par la Constitution d’Athènes d’Aristote. Elle existait probablement
avant.

Institutions qui s’insère dans le cadre de la formation militaire du jeune
homme âgé de 18 à 20 ans = service militaire obligatoire
Jeunes gens groupés par tribus sous commandement des chefs élus par le
peuple
Entraînement physique et préparation militaire par instructeurs spécialisés
Prennent repas en commun au frais de l’état
Lors de la 2e année de service ; envoyés { l’extérieur pour tenir garnison et
faire des manœuvres
Statut de citoyen avec plein exercice { la sortie de l’éphébie
De 20 à 60 ans, ils demeurent mobilisables en cas de conflit
Donc : obligations militaires pendant 42 ans
2 ans d’éphébie ; 30 ans de disponibilité dans l’armée ; 10 ans dans la
réserve territoriale
L’Agogè (Sparte)
L’individu n’appartient pas { lui-même, il appartient à la collectivité. Donc, il
appartient { l’état. Le service est obligatoire. Ceci est une différence majeure par
rapport à Athènes.
L’Agogè a deux fonctions principales :
o Intégrer le jeune spartiate dans le système collectiviste propre au
citoyen spartiate (seul il n’est rien, mais en groupe il est tout).
o Préparer l’enfant { la vie de citoyen-soldat en développant
l’endurance, l’obéissance et l’émulation
o Le soldat doit réussir l’Agogè. C’est le conseil des anciens qui choisit.
L’Agogè perpétue et renouvelle de vieilles pratiques initiatiques
Elle est obligatoire et est organisée par la cité
Seul l’héritier du trône en est exempté
Si un individu ne peut pas supporter l’Agogè, il devient alors un citoyen de
droit restreint
La cité intervient dès la naissance de l’enfant. Ce n’est pas le père qui décide
si l’enfant est apte { devenir un futur bon soldat, mais un conseil d’anciens
(conseil de révision) qui impose soit de l’élever, soit de le jeter dans un
précipice.
Ensuite, l’enfant intégrera les divers stades de la vie collective :
o Jusqu’{ 7 ans, il reste avec sa famille
o De 7 { 12 ans, il est embrigadé dans un système d’éducation collective,
mais retourne dormir chez-lui. Il prend son repas en commun
(syssitie)
o À partir de 12 ans, il ne revient plus dormir chez-lui et peut prendre
part aux relations pédérastiques (c’est l’idée de ce qu’on appelle le
mentor ou le coaching. Ceci va faire en sorte qu’il y aura une relation
entre un adulte et un jeune. L’adulte doit l’encadrée) avec un adulte
(éraste et éromène).
Pour accroître l’endurance des enfants, on les fait vivre { la dure :

o Dès le plus jeune âge, ils sont pieds nus ; dès 12 ans, ils ne portent plus
de tunique (chiton), mais plutôt un vêtement long { l’année
(himation). Ils doivent dormir sur une paillasse de roseaux et
n’obtiennent qu’une nourriture sommaire, qu’ils doivent compléter
par le vol sans se faire prendre. S’ajoutent { cela les combats
perpétuels entre groupes d’enfants et les châtiments corporels (coups
de fouets).
L’idée derrière cela était de crée dès le jeune âge cette notion
selon laquelle le guerrier est élevé à la dureté. N’importe qui
pouvait châtier un enfant.
o De plus, les vieillards suscitent les rivalités et veillent { ce qu’elles
soient entretenues afin de développer l’agressivité et l’émulation.
L’obéissance est développée par l’organisation en groupes hiérarchisés :
o boua, agéla, ila, chacun pourvu d’un chef désigné parmi le groupe ou
d’un jeune de 20 ans.
Chaque groupe est sous l’autorité d’un haut magistrat (pédonome), assisté de
jeunes gens ayant des fouets.
En plus, tout citoyen a le droit de donner des ordres à un enfant ou de le
châtier
Le jeune homme doit réussir l’épreuve de la cryptie pour obtenir l’Agogè
La cryptie : le jeune homme doit rester caché pendant un an, sans armes,
sans nourriture ni domestiques et sans se faire prendre et il doit tuer des
hilotes.
2- Les guerres médiques (499 –449 av. J.C.)
Contexte :
Opposition fondamentale entre Perses et Grecs : deux visions politiques opposées :
Perses = ils se perçoivent comme les rois de l’univers et des quatre directions. Ils
veulent exercer un empire universel et quiconque s’y oppose est dans le mensonge
et tout ennemi est un rebelle. Bien que les cités ioniennes conservent leurs
institutions, le roi de Perse installe des satrapes ou des tyrans à la tête de ces cités,
ce qui crée une forme de dépendance envers le pouvoir perse. L’Empire Perse est
énorme. Les Perses se voient comme les meilleurs du monde et quiconque ne pense
pas comme cela a un problème. L’idée est que l’on ne veut pas de contestation.
Grecs = l’émergence de la cité grecque en tant qu’entité politique inquiète les
Perses. Les cités grecques d’Ionie aspirent { la souveraineté et sont donc moins
enclines à être soumises que les habitants des cités de Phénicie ou de Mésopotamie.
La fermeture de certaines routes commerciales par les Perses et l’émergence d’un
sentiment nationaliste chez les Grecs augmentera le ressentiment des cités d’Ionie,
en particulier, de Milet.

Conséquences : la tension croissante entre les deux groupes va culminer et le conflit
éclatera en 499 avec la révolte ionienne, laquelle sera l’amorce d’une série
d’affrontements.
La guerre se déroulera en trois phases :
I - la révolte ionienne (1re guerre médique) : 499 – 490
II - l’invasion de la Grèce (2e guerre médique) : 490 – 480
III - la reconquête de la Grèce et l’impérialisme athénien : 480 - 449
I- la révolte ionienne (1re guerre médique) : 499 – 490
Les Grecs d’Ionie renversent les tyrans et proclament l’isonomie (égalité par
et devant la loi (par la loi et devant la loi). Concept pour dire que les citoyens
ont des droits égaux.)
Prise de Sardes par les Grecs, mais défaite à Éphèse
Prise de Byzance par les Grecs et alliance de Chypre
Reconquête perse en Hellespont et en Troade
Bataille navale et siège de Milet par les Perses, qui tombe en 494
Darius, roi des Perses impose des conditions modérées
Il planifie toutefois une expédition punitive contre Athènes et Érétrie, deux
cités qui avaient appuyé les Grecs d’Ionie.
L’expédition est confiée à son neveu, Mardonios, en 492. Ce dernier prend la
Thrace, la Macédoine et Thasos
Cependant, une violente tempête au large du cap du Mont Athos fait perdre la
moitié de sa flotte à Mardonios ; il ordonne donc une retraite. C’est l’échec de
cette 1èreexpédition.
Darius planifie donc une deuxième offensive, mieux préparée cette fois-ci.
L’armée, commandée par Atapherne, et la flotte, commandée par Datis, se
dirigent vers la Grèce continentale et débarquent à Marathon
Bataille de Marathon (490)
Victoire des Athéniens sur les Perses
II- l’invasion de la Grèce (2e guerre médique) : 490 – 480
Xerxès succède { son père Darius, mort en 486, et décide de venger l’échec de
Marathon
Préparatifs minutieux pour l’invasion de la Grèce (troupes, trières, cavalerie)
Les Perses, commandés par Mardonios (cousin de Xerxès) passeront cette
fois par le nord et descendront vers l’Attique
Congrès de Corinthe (481) et alliance de 31 cités sous le commandement de
Léonidas et Eurybiade, deux Spartiates afin de contrer la menace perse
Bataille des Thermopyles (480) et résistance héroïque de Léonidas et ses
Spartiates
Les Perses pénètrent en Grèce centrale et se dirigent vers Athènes
Sac d’Athènes et de l’Acropole par les Perses

Thémistocle fait construire les longs murs entre Athènes et le Pirée, ainsi que
200 trières et croit qu’une victoire navale peut décourager les Perses
Bataille navale de Salamine (480) et victoire grecque
Toutefois, Mardonios ravage Athènes et l’Attique et se replie en Béotie
Bataille de Platées (479); mort de Mardonios et victoire grecque
Bataille du Cap Mycale et victoire finale grecque (479)
Athènes sort grandie du conflit : attitude « pan-hellène »
Formation de la Ligue de Délos en 477 sous l’égide d’Athènes : alliance
politique et militaire
But de la ligue : libérer les Grecs des Perses tout en exerçant des représailles
contre les possessions du Grand roi
Les cités alliées contribuent financièrement à la Ligue :
phoros
III- la reconquête de la Grèce et l’impérialisme athénien : 480 - 449
Athènes adopte une attitude impérialiste et agressive envers les autres cités
membres de la ligue, ce qui augmentera les tensions. Des révoltes éclateront
et Athènes réprimera durement ces manifestations.
Transfert du trésor de la ligue de Délos à Athènes en 454 et centralisation du
pouvoir
Ostracisme de Thémistocle (472) ; Cimon devient le politicien le plus
populaire d’Athènes. Il entreprendra des campagnes punitives contre les
Perses et connaîtra des victoires (Thrace, Pamphilie)
Mais l’impérialisme d’Athènes la pousse { s’attaquer aux possessions du Roi
des Perses à Chypre et en Égypte ; elle subit des défaites en Égypte et connaît
un succès mitigé à Chypre
Suite à ces événements, les deux camps jugent opportun de conclure une
trêve
La Paix de Callias est signée en 449 entre Athènes et les Perses
La table est mise pour que les antagonismes entre cités ressurgissent, ce qui
mènera à la Guerre du Péloponnèse (431 – 404)
L’entre deux guerres :
Pentekontaetie
(479 –432 av.J.C.)
Caractéristiques :
I- Transformation de la Ligue de Délos en empire athénien
II- Rupture de l’alliance entre Athènes et Sparte
III- Accroissement de l’emprise athénienne sur l’Empire
I- Transformation de la Ligue de Délos en empire athénien (479 – 462 av.J.C.)
Athènes est supérieure à Sparte sur mer, mais pas sur terre, donc :
Fortifications d’Athènes par la construction des longs murs et du Pirée
Supériorité financière et maritime d’Athènes est liée { la formation de la Ligue de
Délos
Les actions militaires athéniennes en Grèce inquiètent ses alliés (expéditions à
Thasos et en Thrace)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%