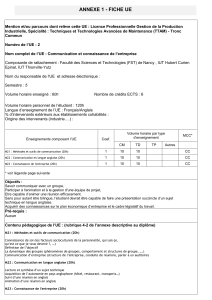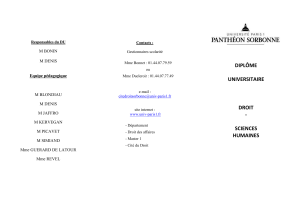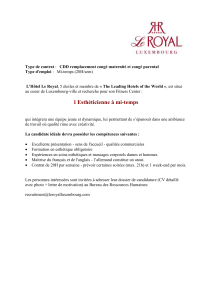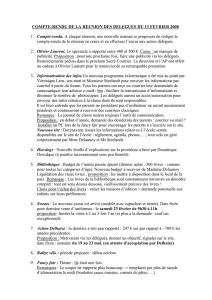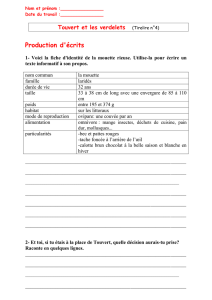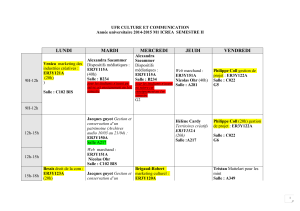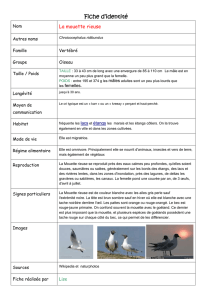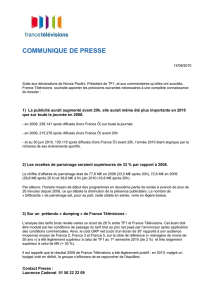ON OD lettre N 20

LES PALMIERS SAUVAGES
WILLIAM FAULKNER / SÉVERINE CHAVRIER
UNE FUGUE,
UNE FUITE
Lettre No20
Odéon-Théâtre de l’Europe mai – juin 2016
OD ON
NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS
(Déjeuner chez Wittgenstein)
THOMAS BERNHARD / SÉVERINE CHAVRIER
LA COMÉDIE
DU SACCAGE
LA MOUETTE
ANTON TCHEKHOV / THOMAS OSTERMEIER
CRISE DE L'AMOUR,
CRISE DE L'ART

2 Nous sommes repus mais pas repentis 3
sommaire
p. 2 à 4
NOUS SOMMES REPUS
MAIS PAS REPENTIS
(Déjeuner chez Wittgenstein)
LA COMÉDIE DU SACCAGE
ENTRETIEN AVEC
CLAUDE FISCHLER
p. 4 à 5
LES PALMIERS SAUVAGES
UNE FUGUE, UNE FUITE
p. 6 à 7
LA MOUETTE
CRISE DE L'AMOUR, CRISE DE L'ART
p. I à IV
LES BIBLIOTHÈQUES
DE L’ODÉON
GASTON BACHELARD
OU LE «DROIT DE RÊVER»
LA VOIE DE L'ACCÉLÉRATION
FESTIVAL JAZZ À SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS PARIS
À PROPOS DES MONUMENTS
NATIONAUX
p. 8 à 9
ADOLESCENCE
ET TERRITOIRE(S)
F(EUX)
GÉNÉRATION(S) ODÉON
CAMPAGNE DE MÉCÉNAT
PARTICIPATIF
p. 10
AVANTAGES ABONNÉS
Invitations et tarifs préférentiels
p. 11
ACHETER ET RÉSERVER
SES PLACES
p. 12
LANCEMENT DE SAISON
2016-2017
SOUTENEZ LA CRÉATION
THÉÂTRALE
LE CERCLE DE L’ODÉON
SUIVEZ-NOUS
Twitter
@TheatreOdeon
#repuspasrepentis
#Palmierssauvages
#LaMouette
#Bibliodeon
#AetT
Facebook
Odéon-Théâtre de l’Europe
© Samuel Rubio
LA COMÉDIE
DU SACCAGE
Voyager de William Faulkner à Thomas Bernhard n'est pas donné à tout le monde. Comment et pourquoi passer d'un
grand roman de la passion amoureuse (Les Palmiers sauvages) à un huis-clos familial (Nous sommes repus...) signé par
un maître de la dramaturgie contemporaine ? Entre la folle fuite en avant façon Nouveau Monde et la non moins folle
révolte sur place façon vieille Europe, Séverine Chavrier interroge avec brio – et comme toujours, en musique – deux
styles de refus, deux manières de se cogner la tête contre les murs du monde. À ses côtés, Marie Bos, Déborah Rouach
(qui fut la Cendrillon de Joël Pommerat) et Laurent Papot (dont la saison à l'Odéon s'est ouverte sur le rôle de Rodolpho
dans Vu du pont, mis en scène par Ivo van Hove).
Le titre du spectacle, Nous sommes
repus mais pas repentis, est une sorte
d'interprétation instinctive du titre
français de l'œuvre, Déjeuner chez
Wittgenstein. Et ce titre-là était déjà
une lecture proposée par son traduc-
teur, puisqu'en allemand, la pièce est
désignée par le nom des trois acteurs
qui l'ont créée : Ritter, Dene, Voss.
Pour Bernhard, c'était donc un titre-
dédicace, une façon de dire que le texte
a été écrit pour ses interprètes. De
rappeler aussi que nous sommes
en plein théâtre, mais que le théâtre
concerne des gens réels, des contem-
porains, et non pas simplement des
rôles plus ou moins fictifs. La tra-
duction recentre l'œuvre du côté de
la fiction, car l'histoire qui nous est
racontée consiste effectivement en
trois moments d'une journée dans
l'intimité de la famille Wittgenstein, le
frère et les deux sœurs. À vrai dire, le
fameux philosophe n'est jamais vrai-
ment nommé par Bernhard, mais on ne
peut avoir aucun doute sur son identité,
vu les indices qu'il a semés dans sa
pièce et sa manière de s'amuser avec
les allusions : par exemple, le méde-
cin de la famille s'appelle Frege, du
nom d'un spécialiste de logique dont
le Wittgenstein historique a discuté
les conceptions. Et donc, au-delà de la
traduction, avec le passage au plateau,
nous avons à notre tour déplacé le titre.
Wittgenstein nous intéresse, bien sûr,
et le théâtre aussi. Mais nous tenions
à pouvoir ouvrir le texte, à y intégrer
d'autres passages de Bernhard, tirés
de ses pièces ou de ses romans. Sur-
tout, il s'agissait de revenir à ce que
l'auteur visait, à savoir, le temps pré-
sent. Il nous dit quelque chose de nous-
mêmes, de notre situation historique,
à nous autres Européens. C'est diffi-
cile à exprimer... L'Europe a tout, et
en même temps non, ça ne va pas,
ce n'est toujours pas ça. Bernhard a
écrit quelque part que Salzbourg a le
taux de suicide par habitant le plus
élevé d'Autriche ; curieusement, nous
créons ce spectacle en Suisse, qui est
le pays dont le taux de suicide est le
plus élevé d'Europe. Une enclave de
richesse, de confort, de tranquillité,
comme à l'abri de l'Histoire, sauf que
c'est illusoire, qu'il n'y a pas d'abri,
et que comme disait Brecht, et nous
le voyons tous les jours, «le ventre
est toujours fécond d'où est sortie la
bête immonde». Qu'on le veuille ou
non, la violence du monde hante nos
mémoires, nos corps. Et le plateau.
Déjeuner chez Wittgenstein est une
des pièces les plus abouties de son
auteur, avec Place des héros et Avant
la retraite, qui met déjà en scène un
frère et ses deux sœurs. Mais l'ac-
cent y est moins sur le passé nazi de
l'Autriche que sur la figure de l'intel-
lectuel, et sur son extrémisme propre,
entre pensée et folie. Le Wittgenstein
de Bernhard est très proche de cer-
tains fous shakespeariens. Ce qui me
touche aussi chez lui, c'est qu'il est un
mixte d'autodidacte et d'héritier. Il y a
d'abord sa volonté de rupture absolue.
Il veut tout devoir à ses propres capaci-
tés. Et de même qu'il tente de penser à
partir de son propre fonds, contre toute
la tradition occidentale, de même il
veut être capable de pouvoir construire
lui-même sa maison. Mais en fait, l'être
que nous montre Bernhard est fragile,
démuni, maladroit. C'est comme s'il
n'avait plus de mains, ou des livres à
la place des mains. Ou plus de monde.
On le sort d'une clinique, qui est le seul
endroit où il peut à peu près vivre. Son
corps l'obsède et en même temps le
trahit, parfois jusqu'à la grivoiserie.
Comme si c'était le prix à payer pour
une pensée qui danse en tâtonnant,
d'une singularité à l'autre, toujours en
débat. Les fameux «jeux de langage»
pratiqués par Wittgenstein dans la
deuxième période de sa réflexion,
autour de son grand projet de
Grammaire philosophique, sont comme
autant de petites machines de guerre
individuelles anti-généralité, anti-
métaphysique, qui détraquent toute
visée systématiste.
Ce sabotage inquiet de la banalité,
c'est quelque chose de commun à
Wittgenstein et à Bernhard. Cela pro-
duit un humour assez particulier. Autre
point commun, tous les deux parlent
énormément d'art, et en particulier
de musique. La musique hante la
réflexion du philosophe comme elle
hante la scène du dramaturge. Elle
fixe une sorte de point de nostalgie.
Bernhard rêvait d'être chanteur lyrique
avant que la maladie l'en empêche. Et
l'une des grandes questions qu'aborde
Wittgenstein dans ses Remarques
mêlées est de déterminer ce qu'on veut
dire quand on parle de «comprendre»
un thème musical. La musique est
pour lui une grammaire, et la façon
dont cette grammaire fonctionne a
des incidences sur son propre style.
Le frère de Wittgenstein, qui était un
grand pianiste, a perdu le bras droit
pendant la Première Guerre mon-
diale. C'est pour lui que Ravel a écrit
son Concerto pour la main gauche...
Toujours cet étrange mélange de virtuo-
sité et de gaucherie ! Dans le spectacle,
la musique est donc partout. Je joue
du piano en direct. Le sol est recouvert
de disques vinyle. À un moment, on
voit s'élever tout un mur de pochettes
de 33 tours, comme une tenture. Nous
travaillons avec des platines, nous tra-
fiquons les bruits de vaisselle...
Dans ses recherches sur les jeux de
langage, Wittgenstein a commenté la
notion de «plan de table», s'est inté-
ressé à la façon dont on décrit la dégus-
tation d'un vin. Pour la dramaturgie de
ce Déjeuner, nous sommes partis du
fait que pour accueillir leur frère à la
maison en toute tranquillité, les deux
sœurs ont renvoyé les domestiques.
Les voilà obligées de se débrouiller
toutes seules. Or elles n'ont jamais eu à
le faire. Elles ont été servies toute leur
vie. Apporter les plats, débarrasser les
assiettes sales, elles ne savent pas. Le
petit personnel dont elles sont si dépen-
dantes circule entre ces trois héritiers
de grande famille patricienne comme un
fantôme. Bernhard avait d'ailleurs des
rapports compliqués, ambigus, avec les
gens dits «simples», les chasseurs, les
cuisiniers, passant sans cesse de l'atti-
rance au rejet. Comment survivre sans
les domestiques qui vous servent
de mains ? Je suis fascinée et touchée
par la maladresse. Peut-être parce que
je suis moi-même d'une maladresse ter-
rible ! Laurent, lui, est un virtuose, un
«adroit du plateau». Il est maladroit s'il
le veut et comme il le veut. Il peut tout
casser à la façon des grands clowns ou
de certains enfants.
Ces trois personnages bernhar-
diens ont aussi un aspect enfantin.
On sent qu'ils ont été livrés à eux-
mêmes, élevés sans tendresse – on
les croirait tout droit sortis de certains
romans de Henry James. Cela fait que
Déjeuner chez Wittgenstein a quelque
chose d'une comédie enfantine du
saccage, donc une sorte de gaieté,
mais quand même un peu désespé
-
rée, sous le regard austère des por-
traits des parents. La loi de la famille
est redoutable : le regard peint main-
tient le pouvoir des ancêtres, les garde
en «vie». Comment échappe-t-on à
l'héritage ? Même en fracassant la vais-
selle, même en retournant les portraits
contre le mur, on est toujours repris
par la famille, et pourtant on ne peut
pas ne pas tenter de lui échapper, de
partir courir dans la neige, en forêt
– mais rien à faire : pour Bernhard, toute
enfance est une catastrophe, le mort
saisit le vif. Dans le spectacle, soit dit
en passant, nous jouons nous-mêmes
tous les membres de notre famille.
Le penseur qu'invente Bernhard dans
sa pièce s'échappe d'une autre façon.
Chez lui, la joie de la pensée est aussi
13 – 29 mai 2016
Berthier 17e
NOUS SOMMES
REPUS MAIS PAS
REPENTIS
(Déjeuner chez Wittgenstein)
de Thomas Bernhard
conception Séverine Chavrier
scénographie
Benjamin Hautin
dramaturgie
Benjamin Chavrier
lumière
Patrick Riou
son
Frédéric Morier
vidéo
Jérôme Vernez
avec
Marie Bos
Séverine Chavrier
Laurent Papot
durée
2h20
production
Théâtre de Vidy
Compagnie La Sérénade interrompue
coproduction
Odéon-Théâtre de l’Europe
CDN de Besançon Franche-Comté
créé le
9 mars 2016 au Théâtre de Vidy
la Compagnie La Sérénade interrompue
est en résidence artistique au Théâtre
Roger Barat d’Herblay
avec le soutien de la ville d’Herblay, de la
DRAC Île-de-France, du conseil général
du Val d’Oise et du Festival Théâtral du
Val d’Oise
le plaisir de la tyrannie assumée.
L'urgence de l'une s'accompagne tout
naturellement de l'égoïsme de l'autre. Il
faut qu'on l'écoute ! Tant pis s'il abuse,
tant pis si l'irresponsabilité est la consé-
quence de son exercice infantile du
pouvoir. Pour lui, être intellectuel, c'est
aussi conquérir le droit de penser ce
que les autres ne pensent pas. Donc il
faut savoir délirer. Étymologiquement,
délirer, c'est sortir du sillon. Comme une
aiguille qui rippe sur un disque et pro-
duit des sons inouïs... Si la «folie» est le
prix qu'il doit payer pour y arriver, soit.
Si ses sœurs acceptent son jeu, elles
doivent en assumer les conséquences,
et si ce jeu-là leur déplaît, elles n'ont
qu'à ne pas jouer à être ses sœurs !
À la fin, d'un seul geste, les sœurs
deviennent ou redeviennent des
infirmières. À ce moment du par-
cours, trois enfants viennent jouer
de la musique de chambre – piano,
violoncelle et violon. Comme si tout ce
qui précède n'avait été qu'une comé-
die jouée à la clinique. Je ne voudrais
pas que ce signe soit trop rassurant,
qu'on se dise : ouf, il rentre à l'asile,
peut-être même qu'il n'en est jamais
sorti. Je préférerais qu'on se demande
lequel des deux espaces, le familial
ou l'asilaire, est le plus fou des deux.
Et que le théâtre, qui permet d'inventer
et d'occuper un lieu indécidable entre
folie et raison, ne résout pas la ques-
tion, au contraire : il la rend encore
plus inquiétante, en laissant entrevoir
que l'hôpital n'est qu'une couche de
plus dans un jeu qui décroche et dérive
d'une position à l'autre sans jamais se
refermer sur une conclusion trop rassu-
rante. Cela dit, la musique des enfants
est là, et sa beauté libère de la pure ironie.
Elle fait résonner la note sérieuse dans
la mélancolie de Bernhard, qui n'était
pas qu'un ricaneur, qui portait un fond
terrible de tristesse et de douleur.
Le spectacle dure un peu plus de deux
heures. La première a lieu dans trois
jours. J'hésite encore à placer un
entracte. Le mouvement conduit d'une
irritation insomniaque, les nerfs à vif,
jusqu'à une sorte d'enlisement dans la
glu familiale, en passant par l'exécution
des jeux de rôle et des codes du déjeu-
ner. Pour finir, on débouche sur une
troisième partie plus tchekhovienne,
une atmosphère de suspension rési-
gnée et presque minérale après épui-
sement des figures de la révolte. C'est
l'après-midi, il pourrait pleuvoir, on
dirait que l'heure de la sieste approche...
On pourrait aussi penser à Beckett,
mais Vincent Baudriller, en venant voir
une répétition après avoir assisté à
La Mouette d'Ostermeier, nous a dit qu'il
était frappé de retrouver tellement de
thèmes de Tchekhov : l'actrice et ses
frustrations, l'aspiration à la beauté, à
l'intelligence, qui se fracasse en plein
vol, le rêve de nouveauté et de liberté
qui plie sous le poids des héritages
– sans parler des abîmes quotidiens
qui s'ouvrent entre les êtres qu'on dit
proches, ces concentrés de béances, de
violences, ces nœuds de complicités et
de malentendus qu'on appelle familles.
Propos recueillis par Daniel Loayza
6 mars 2016
© Samuel Rubio
Il est un mixte
d'autodidacte
et d'héritier.
La musique
fixe une sorte
de point
de nostalgie.
Pour Bernhard,
toute enfance
est une
catastrophe.

Les Palmiers sauvages 5
3 – 25 juin 2016
Berthier 17e
LES PALMIERS
SAUVAGES
d’après le roman de William Faulkner
mise en scène Séverine Chavrier
dramaturgie
Benjamin Chavrier
scénographie
Benjamin Hautin
son
Philippe Perrin
lumière
David Perez
vidéo
Jérôme Vernez
avec
Séverine Chavrier
Laurent Papot
Déborah Rouach
durée 1h45
production
Théâtre de Vidy
Compagnie La Sérénade interrompue
coproduction
Nouveau Théâtre de Montreuil
avec le soutien de
la SPEDIDAM
du Ministère de la Culture
et de la Communication
du CDN de Besançon Franche-Comté
de Pro Helvetia – Fondation suisse
pour la culture
créé le
25 septembre 2014 au Théâtre de Vidy
certaines scènes de ce spectacle peuvent
heurter la sensibilité des plus jeunes,
il est déconseillé aux moins de 16 ans
Quelle belle aventure ! Quel beau voyage dans
l’univers de Faulkner ! J’ai été totalement séduite
par l’univers de cette proposition. Je l’ai trouvée
d’une fraîcheur revigorante. Elle s’empare de ce texte,
de cette réécriture de Faulkner qui est faite de hiatus
et qui part parfois dans tous les sens, mais qui va
très loin en profondeur pour sonder l’âme humaine.
Elle arrive avec liberté et audace à restituer cette
histoire d’amour, cette passion folle et incandescente
entre ces deux êtres d’une fragilité incroyable,
portée magnifiquement par Laurent Papot et Déborah
Rouach. Je suis restée subjuguée. On entend tout :
les sons, le vent, les embruns de ce lac qui, de temps
en temps, apparaît en fond de scène, les soupirs,
les silences, les cris de la jouissance...
Elle pose sur le plateau un décor qui est comme un
territoire, leur territoire : des matelas qu’ils retirent,
qu’ils remettent, qu’ils piétinent, dans lesquels
ils se roulent, s’enroulent, s’emmêlent et puis ces
sommiers anciens, métalliques, sur lesquels parfois
ils sautent, tables, étagères comme celles que l’on
imagine voir dans certains drugstores d’une
Amérique fantasmée ou en tout cas faulknérienne,
boîtes de conserve, fauteuils : on part dans cette
aventure, on prend le train et on les suit jusqu'au bout.
Marie-José Sirach, journaliste à l'Humanité
Retranscription de la critique des Palmiers sauvages
Diffusée sur France Culture le 8 décembre à 21h dans
l’émission «La Dispute», animée par Arnaud Laporte
Claude Fischler, quelles réflexions
la lecture de ce Déjeuner chez
Wittgenstein vous a-t-elle inspirées?
Le premier détail qui m'a intrigué
en lisant Bernhard, c'est que les
Wittgenstein, si je me souviens bien,
étaient une tribu assez nombreuse, dont
beaucoup de membres se sont suicidés.
Leur identité était assez complexe. Du
côté du père, ce sont des Juifs conver-
tis au protestantisme luthérien. Mais
la mère de Ludwig était catholique,
et Ludwig a été baptisé et élevé dans
cette religion. Ce qui a son importance.
Ce déjeuner est-il un symptôme?
Il est un révélateur, et le point focal
de la pièce. Bernhard l'a divisée en
trois parties : avant, pendant, et
après le déjeuner. Celui-ci est donc
au centre de l'œuvre. Si l'on s'en tient
à son déroulement, on peut relever
plusieurs écarts, voire des dysfonc-
tionnements, mis en évidence par les
didascalies. Par exemple, l'une des
sœurs semble resservir inlassable-
ment de la «viande» dans les assiettes,
selon un rythme assez peu déchiffrable.
Puis elle y déverse de la «sauce», alors
même que son frère n'y touche pas.
Ensuite, et ensuite seulement, plusieurs
pages plus loin, arrivent les pommes
de terre et le riz... On insiste aussi sur
le fait qu'une sœur a préparé pour lui
sa «sauce préférée» et son «dessert
préféré», des profiteroles. J'ai d'ail-
leurs trouvé remarquable que Bernhard,
qui note si scrupuleusement le service
de la sauce sur la «viande», ne précise
jamais qu'on verse du chocolat fondu
sur ces fameuses profiteroles... Peut-
être que les profiteroles à l'autri-
chienne sont servies ainsi: je sais bien
que le goulasch, qui est un ragoût de
viande, devient une Gulaschsuppe en
Autriche. Mais on a plutôt l'impression
que la recette personnelle de la sœur
constitue en elle-même une déviation,
une de plus, par rapport à la norme
gastronomique.
La sauce est donc le signe d'un
déréglage, par excès et par défaut?
En effet, ce repas n'a pas de mesure. Il
transgresse plusieurs points de la syn-
taxe commensale. Du côté des sœurs,
elles veulent contrôler le repas, mais ne
savent pas comment en régler le bon
déroulement. Et du côté du frère, les
refus vont croissant. D'abord, il mange
sans appétit, ne fait pas honneur au
repas, violant ainsi l'un des principes
fondamentaux de la commensalité. Le
don alimentaire est en effet quasiment
assimilable à une forme de don de soi,
et le contre-don du récipiendaire doit
consister à accepter ce don. À l'hos-
pitalité, on répond en principe par la
confiance. En espagnol, on dit «mi casa
es su casa», en français «vous êtes chez
vous»: l'un fait tout pour l'autre, et réci-
proquement ce dernier se livre, s'en-
gage. Ce qu'on lui offre, il le paie, si je
puis dire, de sa personne en l'absor-
bant. Comme si, en effet, il était chez lui.
Mais justement, le protagoniste ne se
sent pas chez lui...
C'est même l'un de ses refus explicites,
et l'une des façons les plus radicales
de subvertir le lien de la commen-
salité. Le titre français est d'ailleurs
un peu trompeur, car il laisse suppo-
ser que les sœurs sont allées manger
chez lui. Déjeuner chez les Wittgenstein
serait plus exact. J'ai même cru au
début qu'elles seraient peut-être allées
le voir dans sa cabane en rondins
norvégienne. Ce qui soulève la ques-
tion: où habite-t-il, où est son foyer?
Il n'en a plus. Il est dans un état de
semi-nomadisme revendiqué, sans feu
ni lieu... Les rapports sont donc for-
cément non réciproques – et à l'occa-
sion, le héros sait très bien exploiter
cette asymétrie à son profit. Mais pour
en revenir au don alimentaire, notez
qu'il y a une autre façon de le renver-
ser, à savoir la dévoration animale. Au
moment du dessert, le héros s'étouffe
avec les profiteroles, qu'il engloutit
avec une sorte de rage suicidaire. Là
encore, on passe du vide au trop-plein:
soit je ne mange pas ta tambouille,
soit je me fais crever avec, et tu auras
ma mort sur la conscience. À la racine
de la commensalité et de la convivia-
lité, vous avez le même préfixe, le cum
latin, l'être-avec. Soit qu'on ne mange
rien, soit qu'on ne fasse que cela, on
n'entre pas dans le jeu de l'être-avec,
on ne partage pas sa présence avec
ses hôtes. La syntaxe, c'est une façon
de co-ordonner, de co-organiser un
tel sens de la présence plus ou moins
rituellement partagée. Elle est le fait
des deux parties, de la puissance invi-
tante, mais aussi de l'invité.
Manger, c'est donc toujours manger
«avec»?
C'est ce trait qui définit la commensa-
lité. On ne vit pas que de pain. Il y faut
des conditions de temps et d'espace.
Même quand on mange seul, on s'as-
sied plutôt en tournant le dos au mur.
Le refus du foyer n'est-il pas aussi un
refus du père?
Il est en effet frappant que le prota-
goniste insiste pour changer de place
et prendre celle du père. On y trans-
porte son couvert. Et c'est à partir du
moment où il s'y installe que le déjeu-
ner commence vraiment à dérailler.
Autrement dit, c'est bien là qu'il y a un
compte à régler. Comme dans Festen.
Celui qui devrait être garant de la tra-
dition familiale et culinaire, celui pour
qui l'on va essayer de reproduire, res-
pecter, reconduire cette tradition, est
précisément celui qui va l'achever en
mettant tout par terre. En renversant
la table, comme on dit, ou ici en tirant
sur la nappe.
Les pauvres sœurs ne maîtrisent pas
la syntaxe sur laquelle elles comptent
tant...
Le formalisme est omniprésent, même
s'il n'est pas respecté. Bernhard écrit:
«manie de géométrie même sur la table
de salle à manger»... Ou encore: «Je vais
dresser la table comme il aime, comme
la mère l'a dressée», et là-dessus, on
rectifie la position des couverts. L'iro-
nie est féroce: Ludwig Wittgenstein
était un grand penseur de la syntaxe,
un spécialiste du formalisme. Et là,
toute la formalité est dans les choux!
Il faut dire qu'elles ne connaissent pas
trop bien les rails qu'il faudrait suivre.
L'une d'elles met un plat creux sur la
table, alors qu'il devrait rester en cui-
sine en attendant d'être garni... Jamais
les domestiques ne commettraient un
impair pareil. Ce déjeuner fait interférer
différentes formes de sabotagecom-
mensal : l'involontaire, celui des sœurs,
par incompétence ou incapacité, et le
volontaire, celui de leur frère – du moins
dans la mesure où il est effectivement
responsable de ses actes, ce qui est
loin d'être sûr. En somme, il n'y aurait
pas eu de pièce si elles n'avaient pas
donné leur congé aux gens de maison.
Les apparences auraient sans doute
été beaucoup plus sauves...
Propos recueillis par Daniel Loayza
Paris, 9 mars 2016
Si Les Palmiers sauvages est excen-
tré dans l’œuvre de Faulkner, l’histoire
demeure faulknérienne. Elle met en jeu
cette relation à soi, à autrui, au même,
à l’autre, à l’étranger dont Faulkner a
exploré les linéaments et les butées
entre les membres d’une famille, à l’in-
térieur des demeures, des domaines,
des foyers, voire tout au fond de la
conscience de ses personnages, ou de
ce qui en tient lieu. Le roman retrace
une fugue-fuite dans le monde inter-
médiaire où confine l’adultère et une
romance de littérature de gare. L’œuvre
prend une dimension mythique, chimé-
rique : malédiction, damnation, expia-
tion, rédemption... Vouée à l’exigeante
religion de l’amour, refusant de donner
la vie, captive de sa culture, Charlotte
voue les deux amants à un angélisme
mortel, à l’amour à mort. Qui se révé-
lera être un amour de la mort. Elle ne
voit pas que cette fuite en avant est
un enfermement, que cette exigence
quasi nietzschéenne de cultiver un
art de vivre et d’aimer, dans le face-
à-face nu de deux êtres désemparés,
se révèle être un art de mourir.
Chez Faulkner, l’hyperromantisme,
loin de Werther et de Bovary, devient
minéral et tue la vie : à force d’aimer
l’amour, on finit par perdre la trace de
l’autre, par le nier, par perdre la via-
bilité de cet amour. L’amour comme
absolu – qui ne s’abaisse à chercher
les conditions de sa survie. L’amour
qui laisse l’identité se confondre avec
l’identification: je suis ce que je lis du
devenir de l’autre...
Des paysages exténués : brises,
odeurs, rivières, glycine, taillis, futaies
C’est une cavalcade venteuse dans «un
vent sans horaires, sans lois, imprévi-
sible, venant de nulle part et n’allant
nulle part, comme un attelage emballé
à travers une plaine déserte». Il y a
une fonction topique du paysage chez
Faulkner. Ni bucolique, ni idyllique,
fantomatique, presque fantastique.
Comment rendre sur scène ces traces
ou signes d’une histoire naturelle en
décomposition à l’image de ces pay-
sages traversés ? De ces bruits, brises,
odeurs, rivières, glycines, taillis,
futaies, odeurs puissantes, lumières
particulières, vent omniprésent, qui
enveloppent les protagonistes et
Le don
alimentaire
est une forme
de don de soi.
Toute la
formalité
est dans
les choux ! Suis-je donc
condamné
à vivre
éternellement
derrière une
barricade
d’éternelle
innocence
comme un
poulet dans
un enclos ?
William Faulkner,
Les Palmiers sauvages
Est-ce qu’une relation vécue
comme une œuvre d’art n’est
pas une entreprise solitaire,
vouée à l’échec? Est-ce qu’un
art d’aimer poussé à son
absolu ne devient pas un art
de mourir ? Séverine Chavrier
ON NE MANGE PAS SEUL:
ENTRETIEN AVEC
CLAUDE FISCHLER
Pourquoi Thomas Bernhard a-t-il choisi de mettre en scène
un philosophe à table ? Quels rapports entre son éducation
religieuse et son comportement de convive ? Pourquoi le
déjeuner avec ses sœurs prend-il une tournure si bizarre ?
Éléments de réponse avec le sociologue Claude Fischler,
spécialiste de l'alimentation humaine.
Claude Fischler
est directeur de recherches au Centre
National de la Recherche Scientique
et dirige l'Institut Interdisciplinaire
d'Anthropologie, dont il est le
cofondateur. Il a notamment publié
L'Homnivore (Odile Jacob, 1990),
Manger mode d'emploi ? Entretiens
avec Monique Nemer (PUF, 2013) et
a dirigé et préfacé Les Alimentations
particulières : mangerons-nous encore
ensemble demain ? (Odile Jacob, 2013).
participent de leurs fixations, de
leurs pressentiments, de leurs dou-
leurs immobiles ? Cette sensualité des
éléments, cette nature prémonitoire
qui invente une polyphonie est bien
celle de «ces États-Unis d’Amérique
où la civilisation naissait sous la hutte
et allait mourir dans les bois», disait
Tocqueville.
Trajet, traque : biffures et bifurcation
Cinq chapitres, quatre lieux: de l’hôtel
à l’atelier de Chicago, puis le chalet
dans l’Utah et enfin le bungalow au
bord de la mer, ultime paysage, ultime
horizon. Un trajet de la vie de bohème
au cabanon de plage, abandonné au
seul bruit des palmiers sauvages, un
trajet de la vie à la mort. Une histoire
d’amour, de bruit et de fureur. On a
beaucoup écrit sur la prescience de la
circulation, du trajet dans la littérature
américaine, comme si «l’âme ne s’ac-
complissait qu’en prenant la route». Ici
c’est aussi une descente aux enfers,
une précarité qui gagne, une sau-
vagerie, celle de la nature, du corps
engrossé, qui prend le dessus ; un trajet
particulièrement clair qui, libératoire à
l’origine, finit par l'agonie (Charlotte)
et l’enfermement (Harry) et où chaque
étape rature la précédente.
Séverine Chavrier
extrait de la note d'intention, 2014
UNE FUGUE, UNE FUITE
© Samuel Rubio
4 Nous sommes repus mais pas repentis

6 77
LES
BIBLIOTHÈQUES
mai – juin 2016
OD ON
Portrait de Gaston Bachelard par Manach&Bienvenu
© Costume3pièces.com
Thomas Ostermeier: Nous avons prin-
cipalement recentré l’action autour
de ce qui me semble être les deux
thèmes principaux de la pièce, l’art et
l’amour. Par ailleurs, entre la version
d’Amsterdam et celle d’aujourd’hui, j’ai
pris davantage en compte la biogra-
phie de Tchekhov et son influence sur
son théâtre, comme en arrière-plan.
Tchekhov était très engagé sociale-
ment, il a soigné des milliers de per-
sonnes précaires sans être payé, a
fondé des écoles et des librairies.
Il a envoyé des livres aux détenus
du bagne de l’île de Sakhaline après
l’avoir visité comme médecin volon-
taire et avoir entrepris là-bas une sorte
d’enquête sociologique pour témoi-
gner des conditions de vie atroces qui
y régnaient. Plus tard, il a écrit que
toutes ses œuvres avaient été mar-
quées par cette expérience fondatrice
– et cela a beaucoup influencé ma com-
préhension de son œuvre. Tchekhov
était ce qu’on appellerait aujourd’hui un
human rights activist, ou quelqu’un
qui travaillerait pour une O.N.G. Pour-
tant il écrit une pièce qui parle peu de
questions sociales ou politiques. Au
contraire, il décrit la bourgeoisie, les
nantis de son époque, obsédés conti-
nuellement par leurs petits problèmes
de carrière et de renommée ou leurs
histoires d’amour malheureuses, sans
aucune référence à d’autres problé-
matiques. Mais en arrière-plan sourd
une crise humaine fondamentale, une
crise sociale et politique qui malmène
des êtres, torturés, malades ou livrés à
eux-mêmes. Je vois dans cette oppo-
sition entre ses engagements et ses
descriptions un écho à la situation d’au
-
jourd’hui en Europe, et pas seulement
à la nôtre, d’artistes et d’intellectuels.
Vous avez commandé une nouvelle tra
-
duction à Olivier Cadiot, qui avait déjà
traduit pour vous Les Revenants. Son
écriture poétique se retrouve dans cette
traduction, à travers une langue à la fois
contemporaine, presque quotidienne,
tout en étant vive et rythmée. Qu’est-
ce que la langue de Cadiot apporte à
votre lecture du texte?
Pour mettre en scène un texte dans
une autre langue que l’allemand, j’ai
besoin de travailler avec quelqu’un
en qui j’ai une totale confiance dans
son rapport au langage. D’une part
Olivier Cadiot est un écrivain qui
connaît mon travail, et nous parta-
geons le même intérêt pour le lan-
gage quotidien, la langue que l’on parle
tous les jours. D’autre part il est poète
autant qu’auteur, et j’ai également
besoin d’une langue élaborée, bien
pensée, qui nourrisse et structure le jeu.
C’est le cas avec sa traduction. Enfin,
nous avons rajouté du texte tiré d’his-
toires propres aux acteurs ou de
citations utilisées lors des répétitions.
Vous mettez en scène des acteurs fran-
cophones avec lesquels vous aviez mis
en scène Les Revenants, rejoints par
trois autres comédiens. Est-ce que
cela influe sur votre travail scénique?
Il faut d’abord dire qu’il y a de grands
acteurs partout dans le monde et qu’il
n’y a pas une culture théâtrale meil-
leure qu’une autre. Dans ce cas précis,
parce que je connais déjà une partie de
la troupe, et parce que ces acteurs me
connaissent et connaissent mon travail,
il est plus simple de travailler ensemble:
le fait qu’ils soient suisses, français ou
belges n’est pas essentiel.
Après un Richard III d’anthologie et après des mises en scène d’Henrik Ibsen décisives dans votre parcours de metteur en
scène, La Mouette est le premier texte d'Anton Tchekhov que vous portez à la scène et votre seconde création en français
après Les Revenants d’Ibsen, que vous aviez créé à Vidy en 2013. Trois ans après l’avoir mis en scène à Amsterdam,
vous revenez à La Mouette, en français cette fois. Quelle direction a prise votre adaptation de ce texte emblématique
du répertoire du XXe siècle?
CRISE DE L'AMOUR,
CRISE DE L'ART
© Arno Declair
© Arno Declair
Tchekhov a
envoyé des
livres aux
bagnards de
Sakhaline.
6 La Mouette
ENTRETIEN AVEC THOMAS OSTERMEIER

8 9Les Bibliothèques de l’Odéon III
GASTON BACHELARD
OU LE «DROIT DE RÊVER»
Parfois, pour savoir, il faut se concentrer sur les signes.
Parfois, faire confiance à ses cinq sens. Mais parfois,
il faut aussi consentir à ne plus distinguer sens et signes,
à les laisser infuser les uns dans les autres. C'est alors, dit
Bachelard, que s'éveille la connaissance poétique, au pays
de «l'amour écrit»...
Mettant du jeu dans la réalité, l’art de
la comédie fait vivre, par l’image, la
«magie du théâtre». Aller au fond du
rêve pour approfondir le réel; travail-
ler à métamorphoser les images toutes
faites du monde pour en réveiller l’ex-
pression native, découvre que l’ima-
gination est, dans notre petit théâtre
intérieur, l’âme de notre âme. C’est cette
idée qu’explora Gaston Bachelard
pour qui l’imagination n’est pas une
faculté qui forme des images mais qui
les déforme. Aussi est-ce se faire une
bien piètre idée du rêve pour ne le consi-
dérer que comme le contraire de la réa-
lité. C’est là réduire la rêverie à de la
rêvasserie, ou à une divagation inop-
portune. «Tu prends tes rêves pour la
réalité !», «Arrête de rêver, d’avoir la
tête dans les nuages»… Toutes ces
expressions manifestent la police du
rêve propre à l’esprit de sérieux. Elle
ne conçoit la puissance des images
que comme une petite machine intime
à fabriquer de l’illusion. Mais il faut se
faire une idée bien pauvre de la réalité
pour se laisser croire qu’elle se décline
dans les seuls contours matériels d’un
monde; qu’elle se réduit à un système
de fonctionnalités et d’utilités. Un peu
comme le personnage de Charles
Dickens Thomas Gradgrind dans Temps
difficiles, pour lequel, avec une règle et
une balance, aucune parcelle de nature
humaine n’échappe à la pesée ou à
la mesure, tout le reste n’étant que…
de la littérature! Bachelard n’est pas
de ceux qui croient que le rêve serait
l’autre du réel; qu’il serait la marque
en nous d’une pathologie de l’imagi-
nation. Pour lui la rêverie n’est pas
clôture d’un repli sur soi mais ouver-
ture au surréel. Rêver ce n’est pas se
divertir, c’est s’approfondir. Ce n’est
pas s’évader mais se renouveler inté-
rieurement. Les méfaits de l’imagina-
tion ne disent pas tous des effets de
la rêverie active que convoquent, le
poète, le théâtre, les arts plastiques,
Jean-Philippe Pierron
philosophe, enseigne à la Faculté
de philosophie de l'Université Jean
Moulin, à Lyon. Il enseigne dans la joie
de transmettre la philosophie morale
explorant les liens de l'imagination
et de l'action. Auteur des Puissances
de l'imagination, récemment paru aux
éditions du Cerf, il a trouvé chez
Les petits Platons l'occasion de donner
à entendre combien la philosophie
de Gaston Bachelard, en plus d'être
une philosophie qui aide à bien penser
et à bien rêver, est aussi une
philosophie qui aide à bien vivre.
Salon Roger Blin
LES PETITS PLATONS
À L'ODÉON
À PARTIR DE 8 ANS
Les Rêveries
de Gaston Bachelard
samedi 28 mai / 14h30
raconté par Jean-Philippe Pierron
Le Professeur Freud
parle aux poissons
samedi 11 juin / 14h30
raconté par Marion Muller-Colard
le rêve éveillé. Certes, il peut y avoir un
trop d’imagination dans un esprit fan-
tasque. Mais que serait une vie avec
un trop peu d’imagination, à la créati-
vité psychique bridée, prisonnière de
l’injonction d’un autre ou d’un système ?
Certes, la psychanalyse nous a appris
à lire «le rêve comme voie royale d’ex-
ploration de l’inconscient», onirisme
névrotique qui tourne (mal) en boucle.
Mais une grande image rêvée n’est-elle
qu’un symptôme ?
Philosophe du théorème, mais aussi
du poème, Bachelard défend un droit
de rêver. Insatisfait d’une conception
pasteurisée du monde – comme on dit
d’un beurre qu’il l’est – il nous apprend
à bien rêver, à goûter la partialité des
images que nous donnent les poètes.
Une grande image ne se réduit pas à
une astuce d’écriture ou à une figure
de style, telle la métaphore. Elle se vit
et nous donne la présence au monde
dans son émergence et sa surprise. La
rêverie nous intensifie. Elle nous aug-
mente. Elle nous enrichit par la grâce
des «hormones de l’imagination». Elle
est, pour cette raison, une école de
la liberté.
Jean-Philippe Pierron
6 Tartuffe
II Les Bibliothèques de l’Odéon
FESTIVAL JAZZ À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS PARIS
YARON HERMAN DUO «EVERYDAY» & FRIENDS
, MICHEL PORTAL, BASTIEN BURGER, ZIV RAVITZ
Depuis sa première venue au Festival
en2005, le pianiste Yaron Herman a
gravi les sommets du jazz, enregistré
sept albums et marqué à jamais les
esprits par ses reprises de Radiohead
ou de Britney Spears. Il est aujourd’hui,
à seulement 34 ans, un phénomène de
la scène jazz internationale.
Improvisateur-né et créateur en per-
pétuelle évolution, il a publié en 2015
pour le prestigieux label Blue Note,
«Everyday», un album en duo avec le
sorcier des fûts, le batteur virtuose
Ziv Ravitz, remarqué aux côtés de Shaï
Maestro. En exclusivité pour le Festival,
Yaron Herman réunit un plateau excep-
tionnel, autour de ce duo audacieux:
le chanteur-guitariste -M-, le saxo-
phoniste-clarinettiste Michel Portal qui
jouera égalementles 27 et 31 mai dans
des formations inédites, et le bassiste
du groupe pop The Dø, Bastien Burger.
Des amis brillants et inclassablespour
une création qui ne sera jouée que
deux fois en France, ici et au festival
Jazz in Marciac.
Depuis six ans, l'Odéon-Théâtre de
l'Europe et le Festival Jazz à Saint-
Germain-des-Prés Paris créent l'événe-
ment en invitant des artistes d’exception:
Richard Galliano, Stefano di Battista,
Michel Legrand, Didier Lockwood, Lisa
Simone. Yaron Herman nous fait l'hon-
neur de prolonger le rêve et d'inves-
tir le célèbre théâtre de l'Odéon pour
une soirée qui s’annonce mémorable.
Yaron Herman piano
Ziv Ravitz batterie
Matthieu Chedidguitare, voix
Michel Portalsaxophone, clarinette,
bandonéon
Bastien Burgerbasse
Grande salle
CONCERT / création
lundi 23 mai / 20h30
tarifs exceptionnels (cf p.11)
Le Festival Jazz à Saint-Germain-
des-Prés Paris est organisé par
l'association L'esprit Jazz
festivaljazzsaintgermainparis.com
LA VOIE DE L'ACCÉLÉRATION
Le progrès n'est pas seulement une question de direction, mais de rythme. Le capitalisme libéral, loin d'être
un horizon indépassable et un accélérateur d'innovation, est un frein à toute véritable transformation véritable.
La pensée critique contemporaine, pour être féconde, doit se tourner résolument vers l'avant. Depuis leur
publication il y a trois ans, ces thèses iconoclastes de Nick Srnicek et Alex Williams sont discutées dans le
monde entier. État des lieux avec Laurent de Sutter.
Le 14 mai 2013, deux doctorants
londoniens en sciences politiques, Nick
Srnicek et Alex Williams, publiaient
sur le site «Critical Legal Thinking» un
bref texte, composé de courts para-
graphes numérotés, et titré «#Acce-
lerate : Manifeste pour une politique
accélérationniste ». C’était un texte à la
fois provocateur et radical, plaçant la
pensée de gauche contemporaine face
à ses impasses nostalgiques, et récla-
mant l’invention d’une nouvelle logique
théorique et politique de dépassement
du capitalisme – un dépassement vers
l’avant, et non vers l’arrière. Là où la
pensée de gauche contemporaine ne
cessait de promouvoir un retour illusoire
à la situation d’équilibre keynésien qui
était celle de l’après-guerre, en Europe
(parfois mâtinée de décroissance, et de
désir rousseauiste d’Arcadie), Srnicek et
Williams en appelait à une réconciliation
profonde avec le contemporain. Ce
n’était pas ralentir, qu’il fallait; c’était
accélérer. Il fallait s’emparer de ce
Laurent de Sutter
écrivain et éditeur. Ses livres, traduits
en plusieurs langues, et salués par
le public et la critique, explorent de
manière inlassable les failles de ce
que nous persistons à nommer réalité.
Derniers titres parus : Striptease, l'art de
l'agacement (Le Murmure, 2015), Magic,
une métaphysique du lien (PUF, 2015),
Vies et morts des super-héros (PUF,
2016). Il enseigne la théorie du droit
à la Vrije Universiteit Brussel, et dirige
les collections «Perspectives Critiques»
aux Presses Universitaires de France,
et «Theory Redux» chez Polity Press.
Salon Roger Blin
LES DIALOGUES
DU CONTEMPORAIN
animé par Laurent de Sutter
La voie de l'accélération
avec Yves Citton et Nick Srnicek
mardi 26 avril / 18h
que l’époque proposait de meilleur
en matière d’invention scientifique
et technologique, et d’expérimenta
-
tion politique, et aller plus vite encore
dans l’innovation, de sorte à brûler la
politesse du capitalisme néolibéral,
lequel ne cessait de freiner. Car, contrai-
rement à ce que l’on continue à croire
trop souvent, le capitalisme n’est pas
cette idéologie de la vitesse absolue;
au contraire, il est devenu, depuis les
années 1970, celle du management de
la rétention de l’innovation – de son
ralentissement et de l’exploitation
systématique de chaque micro-progrès.
Pour Srnicek et Williams, il fallait
retrouver le sens du progrès, et remettre
celui-ci au service d’une véritable entre-
prise de sortie de la crise politique,
sociale, économique et écologique de
notre temps – une sortie par le plus
haut, et non une sortie par le bas. Bien
entendu, des tels propos ne pouvaient
rester sans réponse. Aussitôt après sa
publication, le «Manifeste» suscita un
immense débat mondial, dans lequel
les plus grandes figures de la pensée
contemporaine sont intervenues, qu’il
s’agisse de soutenir Srnicek et Williams,
ou au contraire de leur adresser les
critiques les plus vives. À l’heure où
les pièces du débat paraissent enfin
en France, il fallait en discuter avec un
des auteurs, Nick Srnicek, ainsi qu’avec
celui qui, chez nous, a dialogué de la
manière la plus active avec ceux que
l’on appelle désormais «accélération-
nistes», Yves Citton.
Laurent de Sutter
Provoquer l'imprévisible, dompter et libérer la musique du
moment : un programme qui paraît simple, mais dont seuls
les plus grands, quand ils se rencontrent, savent tirer ces
étincelles qu'on appelle jazz. Ils sont cinq à s'être fixés
rendez-vous à l'Odéon. Ils vous y attendent pour une
soirée – évidemment – unique...
illustration Yann Kebbi © Les petits Platons, Paris
La rêverie que nous voulons étudier
est la rêverie poétique, une rêverie
que la poésie met sur la bonne pente,
celle que peut suivre une conscience
qui croît. Cette rêverie est une rêverie
qui s'écrit, ou qui, du moins, se promet
d'écrire. Elle est déjà devant ce grand
univers qu’est la page blanche. Alors
les images se composent et s'ordonnent.
Déjà le rêveur entend les sons de
la parole écrite. Un auteur, que je ne
retrouve plus, disait que le bec de la
plume était un organe du cerveau.
J’en suis convaincu : quand ma plume
crache je pense de travers. Qui me
rendra aussi la bonne encre de ma vie
d'écolier ?
Gaston Bachelard : La Poétique de la rêverie (Paris, PUF, 1968, p. 14)
© Sébastien Vincent
Grande salle
LA VIE COMME UN SONGE
animé par Raphaël Enthoven
Gaston Bachelard,
la rêverie et son poème
samedi 28 mai / 14h30
Sigmund Freud,
l'interprétation des rêves
samedi 11 juin / 14h30
Les cycles philosophiques La Vie
comme un songe et Les petits
Platons à l'Odéon sont programmés
les mêmes jours au même horaire.
Pendant que Raphaël Enthoven
philosophe pour les adultes en
grande salle, les plus jeunes sont
accueillis pour philosopher au salon
Roger Blin. Venez donc en famille !
© Lisa Roze© Jean-Marc Lubrano© DR
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%