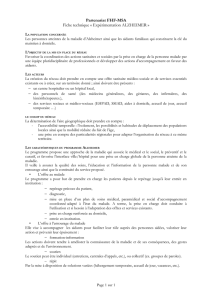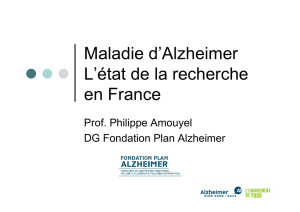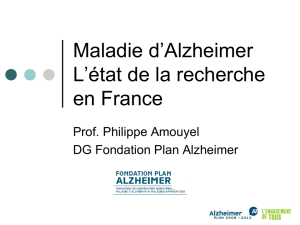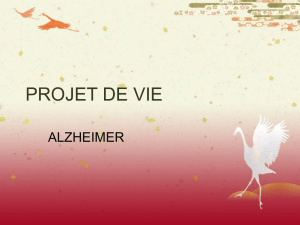Rapport 3

L’accompagnement et la
prise en charge des malades
d’Alzheimer en Midi-Pyrénées :
Les points de vue
de la demande et de l’offre
Rapport 3
Synthèse pour
une mise en débat
Juin 2005
Étude commanditée par la CRAM Midi-Pyrénées

L’accompagnement et la
prise en charge des malades
d’Alzheimer en Midi-Pyrénées :
Les points de vue
de la demande et de l’offre
Rapport 3
Synthèse pour
une mise en débat
Jean Mantovani
Christine Rolland
Maïté Delarue
Dr Françoise Cayla

SOMMAIRE
1 – Quelles évolutions de la demande ? ................................................................. 2
2 – Le développement des « réseaux » locaux......................................................... 5
3 – Pour le développement de dispositifs plus adaptés............................................ 7
4 – Une Action spécifique mais dans le cadre d’une action
gérontologique globale .................................................................................... 10
5 – Le besoin de formation .................................................................................... 11
Éléments de débat pour une politique régionale....................................................... 12

La démarche d’investigation se donnait pour
objectif de préfigurer et d’animer un débat
dans le cadre d’une politique régionale.
Cette dernière partie présente les enseigne-
ments principaux des deux volets d’enquête et
cherche à préciser les conséquences que l’on
peut en tirer d’un point de vue opérationnel
autour de plusieurs questions et dans la pers-
pective d’une réflexion sur les besoins :
• En quoi les « dispositifs » existants répon-
dent ou non aux attendus d’une prise en
compte adaptée des situations liées aux trou-
bles de type Alzheimer ?
• Quels sont les lacunes, manques et dysfonc-
tionnements repérables ? (Considérant qu’il ne
s’agit pas de dresser un inventaire des équi-
pements nécessaires, mais aussi et surtout
d’œuvrer à une meilleure mobilisation et inté-
gration ou « mise en réseau » des moyens exis-
tants).
• Comment participer à rendre l’offre de
services adaptés plus accessible, plus lisible,
plus visible, et le recours à l’offre plus légitime
pour les personnes concernées ?
• Quelle action peut participer en ce sens à
lever la réticence, à désamorcer la stigmatisa-
tion des malades, la » culpabilité » des pro-
ches… ?
• Dans quelles limites en matière de profes-
sionnalisation des interventions et dans quelle
articulation entre soutien formel et informel ?
• Selon quels principes en matière de dignité
et d’insertion sociale des personnes ?

1
1 – QUELLES ÉVOLUTIONS
DE LA DEMANDE ?
X Des publics différenciés pour une politi-
que de santé publique
Les deux volets d’étude laissent transparaître les
difficultés qu’éprouvent les personnes atteintes de
troubles des fonctions supérieures et leur entourage
à s’inscrire comme public légitime d’une action
spécifique de santé publique. Cette prise de position
implique une double reconnaissance de la maladie :
au niveau des familles et des personnes malades, il
s’agit d’avoir fait une démarche de diagnostic
médical et d’en avoir entendu le résultat expliqué
par le médecin et un niveau collectif que la maladie
soit reconnue comme pathologie neurologique aux
effets évolutifs. Or les personnes touchées (malades
et entourage) risquent toujours d’être confrontées à
la stigmatisation dont font l’objet la vieillesse et
plus encore la démence, et tendent à s’isoler dans
l’intimité des relations familiales, souvent jusqu’à
épuisement des ressources mobilisables à ce niveau.
Toutefois, le premier volet de ce rapport présente
des exemples de personnes diagnostiquées qui
adoptent une identité de malade, et cherchent par-là
à se situer dans une optique « renversement du
stigmate ». Il s’agit essentiellement de personnes en
début de maladie et plus jeunes que la moyenne
dont les attentes et les besoins diffèrent des plus
âgés et qui nécessitent une prise en charge
adaptée1 : poser un diagnostic précoce de manière à
agir le plus tôt possible sur les troubles et leur
évolution ; considérer l’impact familial au niveau
du couple et des enfants ; prendre en compte les
effets sur le mode de vie actuel (dont l’activité
professionnelle et la conduite automobile) ; consi-
dérer les personnes diagnostiquées comme acteur
de leur maladie et de leur vie. Or d’une part, cette
population des jeunes malades en phase débutante
est mal connue aussi bien quantitativement que
qualitativement, d’autre part, les actions et les
services spécifiques restent exceptionnels en France
1 Rolland-Dubreuil C, (2002), Analyse de la littéra-
ture sur les « jeunes » personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et les personnes « diagnostiquées précoce-
ment », ORSMIP, Unité INSERM 558, rapport, Fonda-
tion Médéric Alzheimer, Décembre 2002
spécifiques restent exceptionnels en France comme
dans d’autres pays. Notons qu’un mouvement so-
cial émerge : des jeunes malades Alzheimer com-
mencent à s’organiser dans l’espace public, no-
tamment via des sites internet, de manière à être
représentés par eux-mêmes et non par des familles
de personnes malades. Amenés à être de plus en
plus nombreux du fait de l’augmentation des dia-
gnostics posés précocement, leur voix sera de plus
en plus légitime à être entendue.
X Des modes de recours aux profession-
nels et une organisation de l’offre en redé-
finition
La première partie de ce travail témoigne du par-
cours de certaines familles qui ont suscité un dia-
gnostic relativement précoce auprès d’experts hos-
pitaliers et qui se sentent par la suite renvoyées à
elles-mêmes. En début de maladie, des traitements
sont mis en place et contribuent à un ralentissement
dans la progression des troubles. Quand ceux-ci
sont plus importants, quand la maladie est déclarée
à un stade avancé, l’action médicale se réduit à un
contrôle des symptômes associés à la pathologie.
Les familles ressentent l’impuissance des médecins
à agir contre la maladie et se perçoivent délaissées,
comme mises à l’écart des nombreux progrès faits
par la médecine dans d’autres domaines. La mala-
die d’Alzheimer est une pathologie complexe qui
en appelle à des compétences médicales techniques
et cliniques mais aussi à une prise en charge qui
dépasse le seul champ médical. Le médecin peut
difficilement s’en tenir à la dimension scientifico-
technique de son rôle, ou du moins l’approche mé-
dicale seule n’est pas suffisante. La dimension
sociale apparaît tout autant ce qui nécessite la défi-
nition d’une action coordonnée médico-sociale.
Le deuxième volet confirme qu’en dehors des spé-
cificités familiales la réticence reste forte, qu’une
grande partie des demandeurs potentiels accède
tardivement à l’offre existante de soins ou de sou-
tien, et souvent en situation de crise ouverte. Ce-
pendant, certains intervenants font état de signes
qui laissent penser que « les gens s’en préoccupent
beaucoup plus, beaucoup plus tôt »2, et avec une
2 Gériatre 81
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%