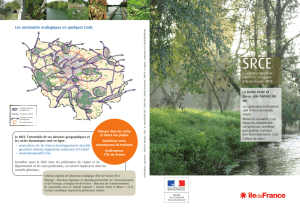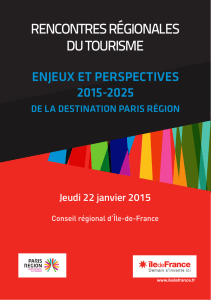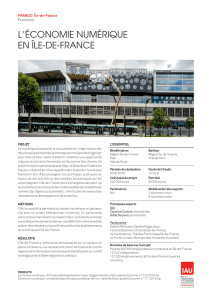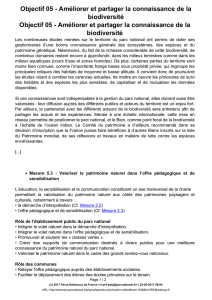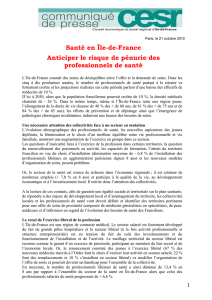Biodiversité_et_continuités_écologiques_en_Île-de

SRCE Île-de-France – Tome I : Les composantes de la trame verte et bleue 15
1. Biodiversité et continuités
écologiques en Île-de-
France
Le constat d’une dégradation tendancielle de la biodiversité est partagé. A l’horizon 2050, tous les scénarios s’accordent sur la
poursuite d’une tendance lourde d’érosion, moindre qu’hier, mais réelle, de la biodiversité, avec une cause anthropique
reconnue.
Parmi les causes identifiées, on trouve :
- la destruction et la dégradation des milieux naturels ;
- la fragmentation des habitats naturels, liée aux changements de modes d’occupation des sols et au développement des
infrastructures de transports ;
- le changement climatique, en particulier le décalage entre sa rapidité et les capacités de réponse des espèces, aggravé
par les deux causes précédentes ;
- l’exploitation non durable d’espèces sauvages (surpêche, surchasse, braconnage…) ;
- les pollutions locales et diffuses ;
- l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, principalement dans les écosystèmes insulaires.
La biodiversité représente pour l’homme une source multiple d’aménités qu’il utilise pour se nourrir, se vêtir, se soigner, embellir
son cadre de vie…. Chaque jour, nombre de nos activités dépendent plus ou moins directement de services écosystémiques,
qu’ils soient liés au fonctionnement des sols, au cycle de l’eau, à la pollinisation, à la protection contre l’érosion… Chaque
disparition d’espèce signifie la perte irréversible d’un patrimoine génétique important, mais est surtout accompagnée par la
perte d’interactions entre cette espèce et les autres espèces de l’écosystème, « moteur » essentiel qui permet aux
écosystèmes de se reconstituer après une perturbation (capacité de résilience).
L’Île-de-France présente une biodiversité riche mais menacée. Ce constat donne d’autant plus d’importance à la qualité des
continuités écologiques et à la compréhension des facteurs qui conditionnent cette biodiversité.
La biodiversité
La biodiversité* est le tissu vivant de notre planète. Plus précisément, la biodiversité recouvre l’ensemble des
milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, virus…) ainsi que toutes les
relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces
organismes et leurs milieux de vie.
La notion même de biodiversité est complexe. Elle comprend trois niveaux interdépendants :
la diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies, forêts… au contenu des cellules
en passant par la mare au fond de son jardin ou les espaces végétalisés en ville… ;
la diversité des espèces qui vivent dans ces milieux, qui interagissent entre elles (prédation, coopération,
symbiose…) et qui interagissent avec leur milieu de vie ;
la diversité des individus au sein de chaque espèce. Les scientifiques parlent de diversité génétique.

1. Biodiversité et continuités écologiques en Île-de-France
SRCE Île-de-France – Tome I : Les composantes de la trame verte et bleue
16
1.1. Une biodiversité francilienne remarquable mais
menacée
L’Île-de-France abrite un riche patrimoine naturel avec une diversité spécifique comparable à celle des régions voisines pour
une superficie réduite (12 072 km
2
, soit 2,2 % du territoire national). Cette situation s’explique par la diversité des substrats
géologiques et par le maintien d’un territoire rural important. Les terres agricoles occupent 50 % du territoire et les boisements
23 % de la superficie régionale. Les milieux urbains représentent 21 %. Le reste (6 %) est occupé par les surfaces en eau, les
milieux humides, divers types de friches…
Le tableau ci-après permet de dresser un bilan partiel du nombre d’espèces connues pour les groupes les mieux étudiés.
Groupe taxonomique Nombre total d’espèces
spontanées ou naturalisées Nombre d’espèces
protégées
Nombre d’espèces sur les listes
rouges régionales (LRR) ou
nationales (LRN)
Flore vasculaire
Sources : CBNBP,
Ecosphère, G. ARNAL ~1440 observées depuis 1990,
dont 1274 indigènes ~185 observées depuis
1990 LRR : 400 menacées
Sources : CBNBP
Mammifères
Sources : Ecosphère,
UICN, MNHN, SFEPM,
ONCFS
64, dont 57 indigènes (21
chauves-souris) 26 (21 chauves-souris) LRN : 9 espèces quasi-menacées
Sources : UICN, MNHN, SFEPM,
ONCFS
Oiseaux nicheurs
Sources : Ecosphère, J.
BIRARD, M. ZUCCA 168 nicheuses, dont 160
indigènes 129 nicheuses LRR : 39 menacées
Sources : J. BIRARD, M. ZUCCA
Reptiles
Sources : Ecosphère
12, dont 11 indigènes 9 LRN : 0
Amphibiens
Sources : Ecosphère 17, dont 16 indigènes 15 LRN : 2 espèces menacées ou
quasi-menacées
Sources : UICN, MNHN, SHF
Poissons
Sources : Hydrosphère,
UICN, MNHN, SFI,
ONEMA
53, dont seulement 31
indigènes vues récemment sur
le bassin de la Seine
14 sur le bassin de la
Seine LRN : 10 sur le bassin de la Seine
Sources : UICN, MNHN, SFI,
ONEMA
Ecrevisses
Sources : Hydrosphère,
UICN, MNHN 6, dont 2 indigènes 2 LR internationale : 2
Sources : UICN, MNHN
Libellules (odonates)
Sources : Ecosphère,
SFO, JL DOMMANGET
60 13 LRR : 29 menacées
Sources : JL DOMMANGET
Papillons diurnes
(lépidoptères
rhopalocères)
Sources : Ecosphère,
UICN, MNHN, OPIE
92 vues récemment, dont 91
indigènes 19 LRN : 2 espèces quasi-menacées
Sources : UICN, MNHN, OPIE
Sauterelles, criquets,
grillons (Orthoptères)
Sources : Ecosphère, E.
SARDET, B. DEFAUT
57 vues récemment 5 LRN : 3 espèces menacées
Sources : E. SARDET, B. DEFAUT
Tableau 1. Nombre d’espèces total, protégées et menacées en Île-de-France pour différents groupes taxonomiques
(Source : Ecosphère, 2012)

1. Biodiversité et continuités écologiques en Île-de-France
SRCE Île-de-France – Tome I : Les composantes de la trame verte et bleue 17
Les espèces menacées occupent différents types d’habitats dont les principaux sont :
pour la flore : les pelouses sèches et les landes (44 %), les milieux aquatiques (15 %), les marais et tourbières (15 %),
les cultures et friches (15 %), les boisements (10 %)…
pour les oiseaux nicheurs : les zones humides (31 %), les milieux aquatiques (20 %), les boisements (20 %), les
cultures (8 %), les prairies et friches (8 %), les falaises (8 %), les pelouses sèches et les landes (5 %).
Les espèces menacées des autres groupes se retrouvent principalement en milieu forestier (mammifères, amphibiens…), dans
les landes, pelouses et friches sèches (reptiles, papillons, orthoptères…), les zones humides (mammifères, invertébrés…), les
réseaux de mares et mouillères (amphibiens, odonates), les cours d’eau « naturels » (poissons, écrevisses, odonates)…
Outre le nombre d’espèces considérées comme rares et menacées au niveau régional et ou national, la régression de la
biodiversité peut être illustrée par le grand nombre d’espèces non revues ces dernières décennies et présumées disparues
au niveau régional.
Cela représente :
environ 6 % de la flore sauvage : un peu moins de 100 espèces parmi lesquelles on peut citer divers Orchis (à fleurs
lâche, odorant, punaise, sureau, vert), des Linaigrettes (à feuilles larges, grêle), des Gentianes (amère, ciliée), la Violette à
feuilles de pêcher ;
près de 6 % des oiseaux nicheurs réguliers (10 espèces) comme la Bécassine des marais, le Butor étoilé, l’Outarde
canepetière, le Râle des genêts, le Tarier des prés ;
près de 12 % des poissons naturellement présents sur le bassin de la Seine (3 espèces) : l’Eperlan, l’Esturgeon et le
Saumon atlantique, même si ce dernier est quelques fois aperçu en Île-de-France ;
plus du tiers des papillons diurnes (27 espèces) comme les Azurés des mouillères, du serpolet et de la croisette, le
Fadet des laîches, les Damiers de la succise et du frêne, la Bacchante… ;
8 % des orthoptères (5 espèces) : les Criquet bourdonneur et migrateur, le Grillon noirâtre, le Dectique des brandes et la
Decticelle des alpages.
Les autres groupes comme les odonates, les amphibiens et reptiles, les mammifères semblent en apparence mieux
pourvus (pas de perte récente depuis la disparition déjà ancienne du Castor et de la Loutre). Certes, on ne relève pas de
disparition complète de la région, mais on note cependant un effondrement de certaines populations qui sont maintenant au
bord de l’extinction, citons certains chiroptères comme les Rhinolophes, des odonates des tourbières et eaux acides
(Leucorrhines…), des amphibiens (Grenouille de Lessona, Sonneur à ventre jaune) ou la Couleuvre vipérine.
Concernant la faune aquatique la plupart des poissons migrateurs amphihalins ont disparu et la Truite de mer, la Lamproie
marine, ainsi que deux espèces d’écrevisses autochtones ont quasiment disparu.
Si des espèces disparaissent, d’autres ont colonisé récemment le territoire. C’est notamment le cas :
d’espèces méridionales dont l’aire de répartition remonte vers le nord (flore, divers insectes, certains oiseaux) ;
d’espèces très mobiles attirées notamment par le développement des plans d’eau : nombreux oiseaux comme les
Sternes naine et pierregarin, divers canards, Le Grand Cormoran, Le Héron bihoreau, la Mouette mélanocéphale ;
mais aussi d’un grand nombre d’espèces exotiques, introduites volontairement ou non par l’homme, et qui se sont
implantées durablement dans la région. Ces espèces appartiennent principalement à 4 groupes :
- des espèces végétales se développant le long des infrastructures de transport et dans les friches (Buddleja,
Séneçon du Cap…) ;
- diverses espèces se dispersant à travers les milieux aquatiques appartenant à des groupes variés : des plantes
(diverses Elodées, les Jussies…), des poissons (Perche soleil, Poisson chat, Silure…), des invertébrés
(Ecrevisse américaine, Moule zébrée…) ;
- des oiseaux échappés de captivité (Bernache du Canada, Canard mandarin, Perruche à collier, Léiothrix
jaune…) ;
- des mammifères introduits (Ragondin, Rat musqué, Raton laveur, Tamia de Sibérie…).
Certaines espèces autochtones peuvent voir leurs populations totalement disparaître pendant plusieurs dizaines d’années du
fait de la dégradation de leur habitat ou d’activités néfastes puis réapparaitre lorsque les conditions redeviennent favorables.
C’est le cas du Faucon pèlerin, de certains poissons migrateurs dans la Seine en aval de Paris, qui ont fait un retour remarqué
dans le bassin de la Seine en amont de l’Île-de-France et qui devraient pouvoir atteindre ces prochaines années certains
territoires de la région comme la Bassée ou la vallée de la Marne.

1. Biodiversité et continuités écologiques en Île-de-France
SRCE Île-de-France – Tome I : Les composantes de la trame verte et bleue
18
1.2. Importance des continuités écologiques pour la
biodiversité
Les espèces, même les moins mobiles, ont besoin de se déplacer. La graine d’une plante ne peut germer à l’exact endroit de la
plante mère : il lui faut trouver une autre place. La majorité des animaux n’ont d’autre alternative que de trouver un territoire
disponible différent de celui de leurs parents. Le cycle de vie de la majorité des êtres vivants implique au moins un
déplacement, sur une plus ou moins grande distance. Cette phase de déplacement s’appelle la dispersion. Elle a
généralement lieu entre la naissance et la première reproduction d’un organisme. Le besoin de trouver un nouveau territoire
n’est pas le seul facteur en jeu : limiter la consanguinité est essentiel, si bien que l’avenir de différentes populations est lié à leur
interconnexion.
Les déplacements ne concernent pas uniquement ceux liés à la dispersion, mais aussi à la migration. De nombreuses
espèces effectuent des déplacements journaliers au sein de leur domaine vital, et beaucoup font une ou deux migrations dans
l’année. Les espèces occupent fréquemment plusieurs types d’habitats complémentaires, exploités de façon successive au
cours de l’année : par exemple beaucoup d’amphibiens se reproduisent dans les mares mais passent le reste de la saison dans
des prairies ou des boisements.
Les capacités de dispersion des différents organismes sont extrêmement variables : de l’ordre de quelques mètres pour
certaines graines, quelques centaines de mètres pour les carabidés, quelques kilomètres pour les amphibiens, plusieurs
dizaines de kilomètres pour certains mammifères. Cette distance est fonction du mode de locomotion, de la taille, et du temps
disponible pour cette étape du cycle de vie. En règle générale, les organismes strictement terrestres et de petite taille
(amphibiens, reptiles, micromammifères, certains invertébrés…) ont des capacités de déplacement bien inférieures aux
animaux de grande taille (grands mammifères) ou aux organismes volants (oiseaux, chauves-souris, papillons, libellules, la
plupart des orthoptères, etc.). Toutefois, au sein d’un même groupe taxonomique, chaque espèce présente des potentialités qui
lui sont propres. Ainsi, la Rainette arboricole peut parcourir jusqu’à 13 km entre un site de reproduction et un site d’hivernage,
tandis que le triton alpestre ne parcourra guère plus d’1 km dans l’année.
Si certaines espèces sont ubiquistes, ou au moins capables de traverser un habitat différent du leur, d’autres ne sont pas
capables de franchir la matrice* séparant deux parcelles de leur habitat. Suivant les espèces, l’obstacle ne sera pas le même.
Les forêts peuvent constituer un obstacle au déplacement des espèces spécialistes des milieux prairiaux par exemple. La
fragmentation et l’isolement des parcelles d’habitat favorables condamnent ainsi une partie des espèces les moins mobiles au
cloisonnement, et à l’extinction à plus ou moins long terme des populations isolées, faute de renouvellement lié à l’immigration
de nouveaux individus.
Les trajectoires de dispersion et de migration des organismes peuvent être très différentes d’une espèce à l’autre, en fonction
du cadre dans lequel elle se déroule.
Pour les espèces végétales et certaines espèces animales (insectes, mollusques terrestres) on ne perdra pas de vue les modes
de dispersion anémochores (par le vent), zoochores (fixé aux animaux) et évidemment anthropochores (directement ou
indirectement par l’homme) qui permettent des dispersions parfois très éloignées des sites d’origine.
Les possibilités de dispersion des espèces dépendent donc de leur taille et de leur mode de déplacement (aérien, aquatique ou
terrestre), mais également de l’organisation des paysages et de la qualité des habitats. Quelques points méritent d’être
retenus :
les espaces naturels vastes, bien conservés et bien reliés les uns aux autres abritent généralement plus d’espèces
animales et végétales que les espaces isolés et dégradés. Ils répondent en effet aux besoins d’un maximum d’espèces,
pour leur alimentation, leurs déplacements et leur reproduction ;
la diversité des habitats naturels ou semi-naturels, constituant ce que l’on nomme des « mosaïques de milieux », est, le
plus souvent, favorable à la biodiversité (association de parcelles variées (cultures, prairies, friches, bois), d’éléments
ponctuels (bosquets, arbres isolés, mares et mouillères) et de linéaires qui relient les espaces entre eux et servent de
couloirs de circulation à la faune (fossés, bandes enherbées, haies, chemins…)) ;
à une échelle plus locale, la fragmentation des milieux perturbe le déplacement des espèces. Ainsi, la raréfaction des
haies, des ripisylves, des pelouses calcaires le long des coteaux ou des zones humides entraine la disparition de micro-
corridors écologiques empruntés par de nombreuses espèces (papillons, amphibiens, petits mammifères terrestres,
chauves-souris...) qui utilisent systématiquement ces linéaires dans leur déplacement.
Par exemple, en l’absence d’obstacle la migration prénuptiale des amphibiens s’effectue généralement en ligne droite
(forte motivation des individus pour la reproduction) tandis que la migration postnuptiale est bien moins linéaire et
tend à sélectionner les couloirs de migrations les plus perméables au déplacement. Les migrations annuelles des
oiseaux migrateurs s’effectuent généralement en ligne droite ou en suivant de grands axes. Au contraire, les phases
de dispersion juvénile et les déplacements journaliers de certains papillons, chauves-souris ou passereaux
s’effectuent le long de structures de guidage (haies, etc.) ou par « sauts » entre fragments d’habitats favorables plus
ou moins éloignés.

1. Biodiversité et continuités écologiques en Île-de-France
SRCE Île-de-France – Tome I : Les composantes de la trame verte et bleue 19
Ainsi, les
continuités écologiques se composent :
de réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent réaliser tout ou partie de leur
cycle de vie ;
de corridors et de continuums écologiques : milieux de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les
réservoirs de biodiversité. Ils peuvent jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors, ils ne sont pas
nécessairement linéaires, et peuvent exister sous la forme de réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment proches
pour être fonctionnels ;
de cours d'eau et canaux, qui jouent les deux rôles à la fois ;
de zones humides, qui jouent l’un ou l’autre rôle ou les deux à la fois.
Figure 6. Schématisation de la notion de continuité écologique (d’après ECONAT)
1.3. Principaux facteurs naturels influençant la répartition
et la diffusion des espèces en Île-de-France
Ces facteurs sont la topographie, la nature du sol et du sous-sol, et les données bioclimatiques présentées successivement.
1.3.1. La topographie et la nature du sol et du sous-sol
Bien que peu marqués en Île-de-France, le relief et la géomorphologie jouent un rôle non négligeable dans la répartition des
espèces (cf. carte 1).
Les vallées constituent des axes majeurs de dispersion et de migration aussi bien pour les espèces aquatiques, que pour celles
liées aux zones humides ou aux habitats plus secs, le long des coteaux notamment. De ce fait, les vallées contribuent
généralement à l’ensemble des sous-trames arborée, herbacée, humide et aquatique. Par la fréquence et l’intensité des
mouvements d’espèces (oiseaux, insectes…) vecteurs de semences et de propagules, les zones humides constituent autant de
sites relais de dispersion pour les espèces ainsi transportées. C’est pourquoi la destruction des zones humides et la rupture des
continuités longitudinales et transversales des cours d’eau participent de façon majeure à l’isolement des populations.
Certaines espèces sont liées à la présence d’habitats naturels présentant des particularités topographiques rares tels que des
ravins ombragés (habitat privilégié de diverses fougères dans le Vexin ou le secteur de Fontainebleau notamment), des
pinacles (coteaux calcaire de la Seine vers La Roche-Guyon) et éboulis rocheux (amas gréseux de Fontainebleau…), les
sommets des buttes témoins les plus hautes (formation à myrtille du Val d’Oise et des Yvelines par exemple). Ces habitats
constituent souvent les ultimes refuges d’espèces ayant eu jadis des aires de répartition plus ou moins étendues. Il résulte de
ces situations des populations dispersées, souvent très originales, naturellement peu connectées et donc fragiles et sensibles à
toute fragmentation supplémentaire de leur territoire.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%