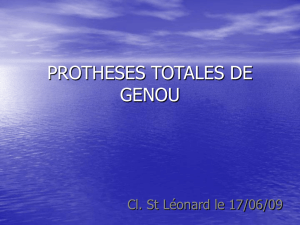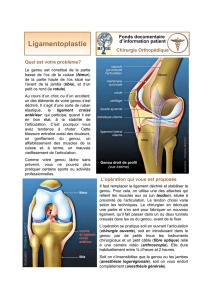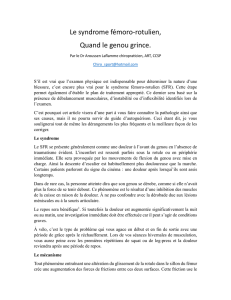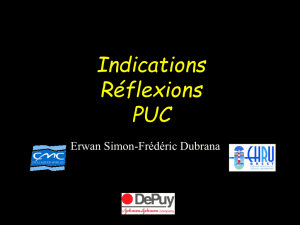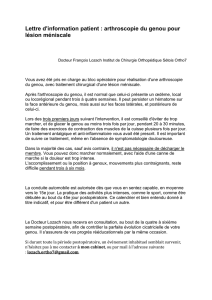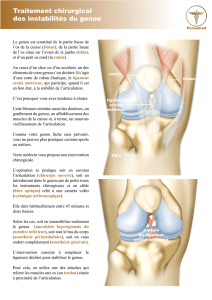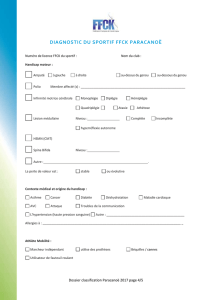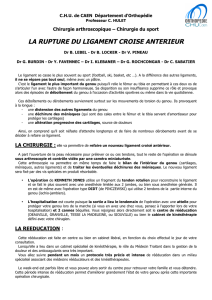Luxation irréductible du genou : un accident traumatique

CAS CLINIQUE
Figure 1.
Déformation
du genou
avec “avalement”
de la peau.
Figure 2.
Radiographie
du genou
confirmant
la luxation
latérale.
Figure 3. Hernie
du ligament
collatéral interne
désinséré.
34 | La Lettre du Rhumatologue • N° 361 - avril 2010
Luxation irréductible du genou :
un accident traumatique exceptionnel
The irreducible dislocation of the knee: an exceptional traumatic accident
O. Agoumi*, A. Daoudi*, A. Elmrini*, F. Boutayeb*, L. Ameziane*
* Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Hassan-II, Fès (Maroc).
L
a luxation du genou est une perte permanente des rapports
anatomiques entre l’extrémité inférieure du fémur et l’extré-
mité supérieure du tibia. C’est une lésion très rare, engen-
drée par un traumatisme de haute énergie. Sa réduction doit être
réalisée en urgence, et un bilan lésionnel capsulo-ligamentaire
précis pour la poursuite de la prise en charge est obligatoire.
Cas clinique
Un jeune patient de 36 ans, sans antécédent pathologique
particulier, se présente au service des urgences pour un trau-
matisme du genou gauche avec une douleur intense et une
impotence fonctionnelle totale à la suite d’un accident de la
voie publique (avec un traumatisme direct sur la face latérale
du genou). À l’inspection, on constate une attitude vicieuse
du genou gauche en flexion avec rotation externe de la jambe
et une déformation en baïonnette (figure 1). L’état cutané est
normal.
À la palpation, la rotule est luxée en dehors et on sent sous la
peau la face inférieure du condyle interne. Par ailleurs, l’examen
montre un genou bloqué et l’examen vasculo-nerveux du membre
est normal. Le diagnostic de luxation du genou est évoqué et
confirmé par les radiographies standard de face et de profil. Il
s’agit d’une luxation latérale du genou gauche (figure 2). Après
une mise en condition et un bilan préanesthésique, la réduction
sous anesthésie générale par manœuvre externe se révèle impos-
sible. Une réduction chirurgicale se déroule sous garrot pneuma-
tique, avec une voie d’abord interne du genou. Après incision de
la peau et du plan sous-cutané, le ligament latéral interne, qui
est désinséré au niveau fémoral, fait une hernie dans l’incision
(figure 3). On constate que le condyle interne du fémur est piégé

CAS CLINIQUE
Figure 4.
Condyle interne
du fémur piégé
par la capsule.
Figure 5.
Réinsertion
du ligament
collatéral interne
après réduction
de la luxation.
Figure 6.
Radiographies
du genou de face
et de profil après
la réduction. La Lettre du Rhumatologue • N° 361 - avril 2010 | 35
Les suites opératoires sont simples, avec un nouveau “testing”
ligamentaire réalisé au 15e jour (juste avant l’ablation des fils)
qui ne montre pas d’anomalie. L’attelle plâtrée est retirée à la
4e semaine, puis le patient commence la rééducation. Au 4e mois,
il est très satisfait et a un genou indolore, parfaitement stable,
avec une légère limitation de la flexion (0-135°).
Discussion
Les luxations du genou sont des lésions post-traumatiques excep-
tionnelles dont l’incidence varie de 0,001 % à 0,004 % selon
Hoover (1, 2). Leurs étiologies sont dominées par les accidents
de la voie publique et les traumatismes violents à haute énergie.
Classiquement, au XIXe siècle, ces luxations du genou étaient
classées par Malgaine, en fonction du déplacement de l’extrémité
supérieure du tibia, en 4 variétés : antérieure, postérieure, latérale
et médiale, mais Conwell et Alldredge (3) puis Kennedy (4) ont
ajouté une 5e variété, qu’ils nomment “luxation rotatoire”. Cepen-
dant, la réalité n’est pas aussi schématique, car le déplacement du
tibia se fait souvent dans les 2 plans, frontal et sagittal, la variété
antérieure restant la plus fréquente selon Green et Allen (5).
La gravité immédiate de ces luxations est liée à la survenue de
complications vasculaires par élongation, contusion (intima) ou
rupture. Leur taux est de l’ordre de 32 % pour Green (5). Elles
imposent un examen vasculaire systématique du membre en
pré- et en post-réduction, avec une artériographie au moindre
doute (6). Les complications nerveuses, en particulier l’atteinte
du nerf sciatique poplité externe par étirement, sont en relation
directe avec l’importance du déplacement. Ces lésions nerveuses
néces sitent une surveillance clinique, avec une analyse de la
progression du signe de Tinel pendant les 3 premiers mois, délai
au terme duquel une exploration chirurgicale avec éventuelle
greffe nerveuse est légitime en cas de non-amélioration (2).
Les lésions ligamentaires sont constantes, mais leur topo graphie
est variable et dépend du type de luxation. On peut avoir une
atteinte isolée du ligament croisé antérieur (7), du ligament croisé
postérieur (8), ou de 1 ou des 2 haubans latéraux (9). Le plus
souvent, plusieurs ligaments sont atteints en même temps. Un
bilan lésionnel doit être réalisé systématiquement sous anesthésie
générale après réduction (10, 11) et éventuellement complété par
des radiographies dynamiques (12, 13). Des complications osseuses
ou ostéochondrales et des lésions de l’appareil extenseur doivent
aussi être recherchées systématiquement.
L’irréductibilité dans les luxations latérales conduit systémati-
quement à une réduction chirurgicale. Elle est liée à l’incarcé-
ration du ligament collatéral médial (désinséré ou déchiré) dans
l’interligne articulaire (14, 15) ou, comme chez notre patient,
à l’incarcération du condyle fémoral interne dans une brèche
capsulaire “buttonholled” (16). Ces incarcérations peuvent être
suspectées dès l’inspection du genou si une dépression cutanée
en regard de l’interligne médial est constatée, faisant craindre
alors l’irréductibilité.
dans une brèche de la capsule articulaire (figure 4). Après un
lavage abondant, la capsule est remise en place par une spatule,
ce qui facilite la réduction. Puis la réinsertion du ligament latéral
interne est effectuée par des points transosseux à l’aide d’un fil
résorbable, après avoir perforé l’os avec une mèche au niveau de
son insertion (figure 5).
Le “testing” ligamentaire peropératoire, comprenant le test de
Lachman à 20°, la recherche des tiroirs antérieur et postérieur
à 90°, la recherche de laxité latérale externe et la recherche de
ressaut, se révèle normal.
L’intervention se termine par la mise en place d’un drain de Redon
aspiratif avec une attelle postérieure d’immobilisation. Les radio-
graphies postopératoires confirment la réduction (figure 6).

CAS CLINIQUE
36 | La Lettre du Rhumatologue • N° 361 - avril 2010
Le traitement des luxations du genou comprend 2 volets :
la réduction et la stabilisation de la luxation et le traitement
des lésions capsulo-ligamentaires et méniscales associées. Le
traitement orthopédique a longtemps été le seul proposé. Il
repose sur l’immo bilisation par un plâtre cruro-pédieux pendant
6 semaines, suivie d’un programme de rééducation. La réduction
chirurgicale s’impose chaque fois que la luxation est irréductible
par manœuvres externes. La stabilisation chirurgicale peut être
réalisée par brochage intra-articulaire fémoro-tibial, par olécrani-
sation tibio-patellaire ou par fixateur externe quand il existe une
brèche cutanée ou des complications vasculaires.
Le traitement chirurgical des lésions capsulo-ligamentaires est
réalisé par des sutures ou une réinsertion pour les ligaments laté-
raux et par une plastie de reconstruction (par auto- ou allogreffe)
pour le pivot central. Actuellement, plusieurs auteurs insistent
sur la réparation précoce de ces lésions à partir du 15e jour (2).
Conclusion
Les luxations du genou nécessitent une réduction en urgence sous
anesthésie générale par des manœuvres externes avec immobili-
sation. Le recours à la chirurgie s’impose devant l’irréductibilité
et une éventuelle instabilité primaire. Un “testing” ligamentaire
systématique après réduction oriente les examens complémen-
taires et les réparations capsulo-ligamentaires. ■
1.
Hoover NW. Injuries of the popliteal artery associated
with fractures and dislocations. Surg Clin North Am 1961;
41:1099-112.
2.
Versier G, Neyret PH, Rongièras F, Bures C, Ait Si Selmi T.
La luxation du genou. e-Mémoires de l’Académie nationale
de chirurgie 2006;5(2):1-9.
3. Conwell HE, Alldredge RH. Complete dislocation of the
knee joint. Surg Gynecol Obstet 1937;64:94-101.
4.
Kennedy JC. Complete dislocation of the knee joint. J Bone
Joint Surg Am 1963;45A:889-904.
5.
Green NE, Allen BL. Vascular injuries associated with
dislocation of the knee. J Bone Joint Surg 1977;159A:236-9.
6.
Neyret P. Lésions ligamentaires complexes récentes :
triades, pentades et luxations. In : Saillant G (ed.). Pathologie
du genou du sportif. Cahiers d’enseignement de la SOFCOT.
Paris : Elsevier, 1996;59:37-52.
7.
Cooper DE, Speer KP, Wickiewicz TL, Warren RF. Complete
knee dislocation without posterior cruciate ligament disrup-
tion. A report of four cases and review of the literature. Clin
Orthop 1992;284:228-33.
8. Bellabarba C, Busch-Joseph CA, Bach BR Jr. Knee dislo-
cation without anterior cruciate ligament disruption. Am J
Knee Surg 1996;9:167-70.
9.
Bratt HD, Newman AP. Complete dislocation of the knee
without disruption of both cruciate ligaments. J Trauma
1993;34:383-9.
10.
Walker DN, Rogers W, Schenck RC. Immediate vascular
and ligamentous repair in closed knee dislocation: case
report. J Trauma 1994;36:898-900.
11.
Schenck RC. The dislocated knee. Instr Course Lect 1994;
43:127-36.
12. Dardani M, Schweitzer M. Complete dislocation of the
knee: spectrum of associated soft-tissue injuries depicted
by MRI imaging. Am J Roentgenol 1995;164:135-9.
13.
Yu JS, Goodwin D, Salonen D et al. Complete dislocation
of the knee: spectrum of associated soft-tissues injuries
depicted by MRI. Am J Roentgenol 1995;164:135-9.
14.
Nystrom M, Samimi S, Ha’eri GB. Two cases of irreducible
knee dislocation occuring simultaneously in two patients and
a review of the literature. Clin Orthop 1992;277:197-200.
15.
Shields L, Mital M, Cove E. Complete dislocation of the
knee: experience at the Massachusetts General Hospital.
J Trauma 1969;9:192-215.
16.
Quinlan AG. Irreducible posterolateral dislocation of
the knee with button-holing of the medial femoral condyle.
J Bone Joint Surg Am 1966;48:1619-21.
Références bibliographiques
1
/
3
100%