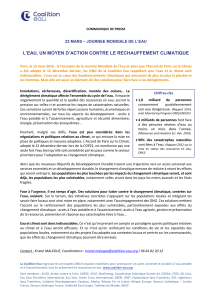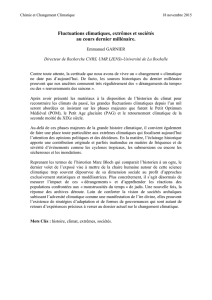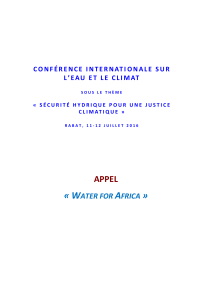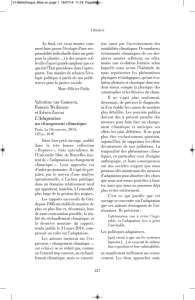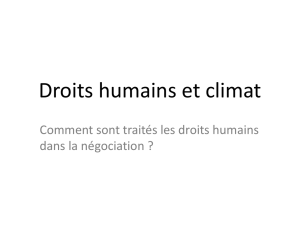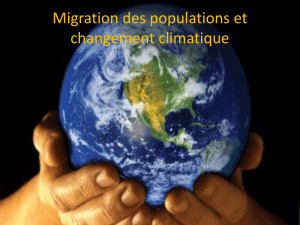Débat : Les changements climatiques, les objectifs du millénaire

1
DEBAT
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR
LE DEVELOPPEMENT
Avec
Bertrand Dardenne, directeur d’Aspa Utilities (société de conseil et assistance technique)
Jacques Labre, directeur des relations institutionnelles de Suez Environnement
Ghislain de Marsily, professeur émérite de géologie appliquée et d’hydrologie à l’Université
Paris VI et membre de l’Académie des Sciences.
Gérard Payen, président d'Aquafed, conseiller pour l'eau du Secrétaire Général des Nations
Unies.
Pierre Victoria, délégué aux relations institutionnelles internationales à Veolia Eau
Débat animé par Dominique Lorrain, directeur de recherche au CNRS
Propos recueillis par
Eric Maton, professeur assistant de gestion à Audencia Nantes Ecole de Management.
Dans un numéro de revue consacré à la gestion de l'eau à partir d'une approche
historique, nous avons souhaité centrer le débat sur des enjeux actuels et prospectifs. Pour
ces raisons les participants à ce débat sont tous impliqués à des titres divers dans des
organisations françaises et internationales qui contribuent à élaborer une politique de
l'eau
1
.
1
Ce débat a été enregistré le 3 avril 2008, transcrit par Eric Maton, mis en
forme par Dominique Lorrain et soumis aux participants. Les propos échangés
n'engagent que leurs auteurs et non leurs entreprises.

2
1. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES PROBLEMATIQUES DE L'EAU
Dominique Lorrain. Quand on regarde la problématique de l’eau à la fin des années 1990
(Marrakech, 1997) le thème des pauvres était dominant : 1,1 milliard d’habitants de la planète
n’ont pas accès à l’eau potable et 2,6 milliards n’ont pas d'assainissement. Le jugement
s'énonçait alors en termes de justice sociale. Ce qui frappe est de voir émerger, depuis trois-
quatre ans, une autre thématique, celle du réchauffement climatique. L’argument est différent :
ce n’est plus seulement un problème de justice sociale, c’est un problème mondial. Si nous
continuons comme cela nous allons connaître des bouleversements considérables avec une série
d’effets en cascade qui vont rétroagir sur la société, le gouvernement des villes et les équilibres
politiques : des inondations, des sécheresses, des populations déplacées en grande masse. Par
rapport à cela que peut-on dire sur l’état de ces questions et sur la réalité de ces menaces ?
Ensuite une autre question : alors que sur beaucoup de choses on a raisonné globalement,
comment peut-on passer de la vision planétaire à son positionnement régional ou local ?
Ghislain de Marsily : Je ne suis pas climatologue, donc ce que je vais vous dire, c’est ce que
j’en ai compris auprès des collègues qui s’y intéressent. Nous avons actuellement à l’Académie
des Sciences un nouveau groupe de travail intitulé : « Démographie, climat, et alimentation
mondiale ». Il fait suite au groupe sur « Les eaux continentales, 2006 ». En deux mots, sur la
réalité des changements climatiques, les climatologues entre eux sont absolument unanimes
pour dire qu’il y a quelque chose qui se passe : on le voit, on le constate et les modèles le
prédisent. Les prédictions sont faites à partir de modélisations qui sont malheureusement d’une
faible précision, si bien que les climatologues sont satisfaits quand au niveau des pluies (je parle
des pluies car les prévisions d’évolution des températures sont plus fiables), les 15-20 modèles
mondiaux utilisés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) créé en 1988 donnent le même signe de variation au même endroit. Par exemple, si on
regarde les cartes pour la zone méditerranéenne, ces latitudes-là sont des zones qui devraient
souffrir, avec des diminutions des précipitations. Tous les modèles le montrent à peu près mais
de manière peu précise, les amplitudes conduisant à être extrêmement prudent. Ils disent : oui,
c’est probable. Est-ce que ça va être 10, 15 ou 20 % en moins ? en fait on ne le sait pas
vraiment. Si on leur demande : « dans combien d’années serez-vous en mesure non seulement
de donner des signes mais aussi des amplitudes ? » ils disent dix, quinze ans. Par conséquent, ce
n’est pas un problème qu’on va résoudre demain. C’est quand même compliqué et difficile à
résoudre. Aujourd’hui, on est ainsi obligé de prendre des décisions malgré l’absence de résultats
fermes et définitifs.
Par exemple, si on regarde un diagramme avec une distribution des pluies en fréquence,
la courbe représente la précipitation mondiale enregistrée, entre le pôle nord, le pôle sud et

3
l’équateur avec les déserts chauds et les déserts froids, etc. D'autres courbes proviennent des
modèles. Ces modèles sont par moment à 100 % de la réalité. La tendance générale est de dire
que la zone climatique se déplace vers les pôles, et qu’il pleuvra plus dans les parties tropicales.
La partie méditerranéenne serait asséchée et la partie plus au nord verrait augmenter les
précipitations. Ces signes-là sont connus mais pour y mettre des valeurs numériques c’est
extrêmement difficile. Ceci, c’est pour les valeurs moyennes.
En ce qui concerne les événements extrêmes, et vous avez à juste titre parlé des
changements climatiques avec des crues et des sécheresses, on peut représenter la pluviosité
annuelle (c'est une courbe de fréquences avec les volumes des pluies en abscisse et la fréquence
en ordonnée). Admettons que le climat devienne plus humide et que la pluie moyenne soit d'un
volume plus grand ; la courbe des fréquences sera au minimum translatée. De part et d’autre, on
a les sécheresses et les crues. Les climatologues sont tous d’accord là-dessus. En revanche, est-
ce qu’en même temps que la courbe se translate, elle change de forme et elle devient plus
évasée ? (la fréquence des pluies moyennes diminue et celle des pluies extrêmes augmente). Il
semble que oui. Au niveau du rapport 2007 du GIEC, il faut savoir que sur cette question des
extrêmes les modèles sont incapables de fournir la moindre réponse. Les modèles ne voient pas
de variation dans les distributions, etc. Ils ont beaucoup de mal à le faire car au maximum on ne
simule aujourd’hui que 100 ans avec un modèle climatique. Pour voir des extrêmes avec une
fréquence de 1 sur 100 il faudrait simuler au moins 1 000 ans, donc on a un problème de
connaissances.
Gérard Payen : Pourquoi dit-on partout, y compris dans des documents institutionnels, que les
changements climatiques dans le domaine de l’eau vont accroître les événements extrêmes ?
Ghislain de Marsily : C’est ce qu’indique le rapport 2007 du GIEC. D’abord, dès qu’il y a un
événement extrême la presse dit que c’est le changement climatique. Il y a donc une sorte
d’emballement en disant que ce sont les changements climatiques qui engendrent ce que vous
voulez. Au niveau des documents institutionnels, le seul à en avoir parlé de façon assez arrêtée,
c’est le dernier rapport du GIEC, du début de l’année 2007. C’est uniquement à partir des
observations, ce sont des statistiques des variations éventuelles de précipitations sur un petit
nombre d’années puisqu’on considère que les effets climatiques mesurables le sont depuis 20 –
30 ans. Sur ces années, est-ce qu’on voit une tendance de déplacement des moyennes ? est-ce
qu’on voit une tendance à une augmentation de la variance ? Ils disent avec beaucoup de
prudence qu’il semble que oui, donc tout le monde le dit comme ça. Les climatologues disent
qu’il y a plus d’énergie dans l’atmosphère puisqu’on a un cycle de l’eau qui est accéléré. Il y a
plus d’évaporation, de condensation et de précipitations. Il n’est donc pas déraisonnable de dire
que cela va augmenter la variance du système mais on n’est pas beaucoup plus sûr que ça.

4
Comme, je l’ai dit, pour avoir ces statistiques sur ce qui se passe tous les 10 ans en moyenne il
faudrait peut-être avoir 100 ans pour faire quelque chose de sérieux, nous avons donc une
présomption.
Les modèles et ce qu'ils nous disent dépendent des données introduites et des questions
que nous posons. Donnons un exemple. C'est une affaire parue dans la presse il y a un mois et
notamment dans La Recherche et Le Monde et qui est due à Hervé Le Treut (de l’Académie des
Sciences). Les climatologues ont établi depuis dix-quinze ans l’équivalence entre tous les gaz à
effet de serre. Le gaz majeur est le CO
2
, mais on tient compte des autres gaz et on dit que tel
gaz a un effet de facteur "tant" par rapport au CO
2
. Considérons le cas du méthane (CH
4
) qui est
70 fois plus efficace par unité de Mole que le CO
2
en matière d’effet sur le rayonnement
infrarouge mais qui a une durée de demi-vie de douze ans dans l’atmosphère, alors que pour le
CO
2
c’est plusieurs milliers d’années. Pour faire l’équivalence, on fait le calcul suivant : on
prend une émission instantanée et unitaire de chacun de ces gaz et on regarde la présence de ce
gaz dans l’atmosphère sur une certaine période. Si on intègre sur cent ans une émission
ponctuelle instantanée de CO
2
et de CH
4
l’effet est de 20 (à équivalence en Mole le CH
4
génère
vingt fois plus d’effet de serre que le CO
2
). Depuis que cette équivalence a été faite on utilise le
chiffre de 20 pour faire les calculs de l'impact de l'émission de gaz à effet de serre. Or les
objectifs du GIEC ont un peu changé la donne. Tout le monde dit maintenant qu’il ne faut pas
dépasser 2 degrés de hausse des températures autour de 2050 car au-delà on va vers des risques
extrêmement importants. Donc l'horizon de cent ans ne veut plus dire grand-chose. Il faut plutôt
intégrer sur trente, quarante ou cinquante ans et regarder le poids relatif des différents gaz à
effet de serre avec cette nouvelle équivalence basée sur une période plus courte. On modifie
ainsi la manière de comparer les gaz, et si on fait cela le méthane passe d’un facteur 20 à un
facteur 50. Cela donne aujourd’hui une priorité beaucoup plus importante à la réduction de
production de méthane, au captage de tous les gaz de décharge et éventuellement ceux des
activités agricoles.
Gérard Payen : Je voudrais réagir sur la question : pourquoi a-t-on parlé de l’accès à l’eau pour
les pauvres durant un certain temps et maintenant des changements climatiques. Effectivement,
le débat public s'est déplacé. Mais il y a une grosse différence. Les pauvres ne sont pas chez
nous. Le problème de l’accès à l’eau ne se pose pas en France, en tout cas pas de façon très
importante alors que le changement climatique tel qu’il est diffusé par les médias donne
l’impression qu’il concerne tout le monde et génère une angoisse qui fait que tous les Français
se sentent concernés. De mon point de vue, dans le secteur de l’eau, le changement climatique
est un facteur aggravant de problèmes qui préexistaient et qui se distinguent en quatre catégories
: i) les problèmes des ressources en eau et du stress hydrique croissant, donc des problèmes
quantitatifs ; ii) les problèmes d’accès des personnes à l’eau potable ; iii) la mise en place de

5
dispositifs d’assainissement (il est alors question de la pollution de l’eau) ; iv) les catastrophes
liées à l’eau comme les inondations et les tsunamis. L’impact du changement climatique est une
aggravation de plusieurs problématiques mais il ne vient pas les révolutionner. On avait déjà des
problèmes de stress hydrique. L’humanité essaie de se préserver des inondations depuis
l’Antiquité. Il ne faut pas voir les changements climatiques comme un problème isolé. Il faut
plutôt les voir comme un nouveau sujet d’intérêt. L’opinion publique se passionne pour les
problèmes de changement climatique et a complètement oublié les problèmes d’alimentation en
eau potable et en assainissement, pensant, par raccourci, que c’est le même sujet. Or ce n’est pas
du tout le même sujet. Je voudrais en quelques mots vous dire pourquoi.
Le changement climatique impacte sans doute les problèmes quantitatifs de ressources
en eau mais la problématique de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (1,1 milliard de
personnes n’ont pas un accès satisfaisant à l’eau potable) n’est pas un problème de ressources en
eau. C’est un problème d’alimentation des populations ; là où il peut y avoir beaucoup d’eau, il
peut y avoir aussi beaucoup de gens qui n’ont pas accès à l’eau potable. Ce n’est pas du tout la
même problématique. Lorsqu’on se motive pour mobiliser davantage de ressources en eau, on
met plus d’eau dans les tuyaux, mais les gens qui ne sont pas au bout des tuyaux n’en
bénéficient pas. Or le milliard de personnes dont on parle n’a pas accès à des tuyaux. Il y a
même 3 milliards de personnes aujourd’hui sur cette planète qui n’ont pas l’eau potable à
domicile ou à proximité immédiate. La problématique de l’alimentation en eau est d’apporter de
l’eau à chacun, à chaque famille, à chaque logement. Cela n’a quasiment rien à voir avec la
problématique des ressources en eau. L’opinion publique a beaucoup de mal à le percevoir.
2. L'OPINION PUBLIQUE ET LA HIERARCHIE DES PROBLEMES
Dominique Lorrain : Si on parle de la mobilisation de l’opinion publique, il me semble qu’au
début les questions d’eau étaient portées par des techniciens et des décideurs politiques, la
société civile se trouvant peu impliquée. Au moment du sommet de La Haye (2000) et de sa
préparation, des représentants du Conseil Mondial de l’Eau et de la Banque Mondiale ont dit :
« il faut sortir du club un peu fermé des professionnels pour mobiliser l’opinion publique et ce
détour sera l’occasion de convaincre les décideurs politiques et de lever des fonds pour atteindre
les objectifs pour 2008 ». Or j’aurais tendance à dire, avec le recul puisqu’on est en 2008, qu’on
peut s’interroger sur l’efficacité de ce détour par l’opinion publique. D'ou ma question : qu’il
s’agisse d'une mobilisation de l’opinion publique pour l’accès à l’eau pour les pauvres ou pour
résoudre les problèmes des changements climatiques, la prise de décision publique est-elle
facilitée grâce à ce détour?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%