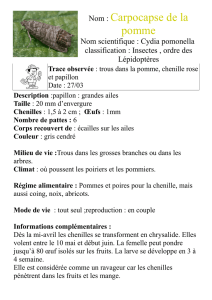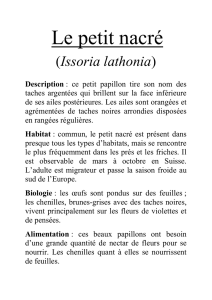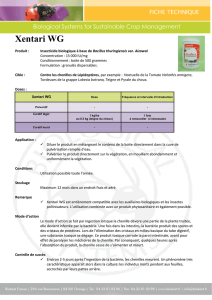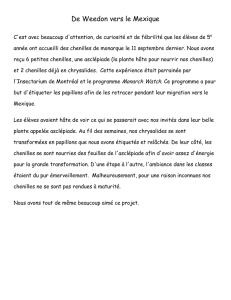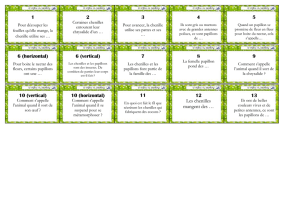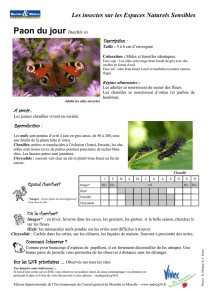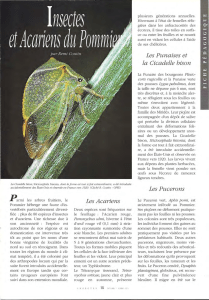LE BOMBYX VERSICOLORE

FICHE
TECHNIQUE
D'ÉLEVAGE
LE
BOMBYX VERSICOLORE: Endromis versicolora
par Didier Rochat
---------111----
----
--
Le
Bombyx versicolore
Endromis versicolora .
Ordre: Lepidoptera
Famille: Endromidae
Genre: Endromis
Espèce: versicolora Linné 1758
Nom commun : Le Bombyx versicolor
Endromis versicolora est répartie dans toute l'Europe occidentale.
C'est une espèce des forêts de feuillus, claires et fraîches et des
landes à bouleaux, jusqu'à 2000 m d'altitude. Dans le sud de
l'Europe, on la trouve uniquement en montagne.
Un
papillon du premier printemps
Le mâle a une envergure de 55-65 mm, les antennes noires briève-
ment pectinées, le corps roux très velu, les quatre ailes de couleur
fondamentale brun-roux. Les ailes antérieures sont marquées de
deux lignes noires liserées de blanc, d'une lunule discale noire, de
deux ou trois taches apicales blanches. Au bord des ailes, les
nervures sont marquées de blanc. Les ailes postérieures sont plus
uniformes, généralement sans blanc.
La femelle est plus grande (70-85
mm
d'envergure) et beaucoup
plus claire. Tous
l'es
dessins des ailes, similaires à ceux du mâle, sont
fortement envahis de blanc.
La période de vol est très précoce dans l'année, souvent dès les
premiers redoux: mi-février à mai selon le climat local et l'année
(en région parisienne: mi-mars à mi-avril) ; elle dure 10 à
15
jours
seulement. L'espèce est ainsi peu observée et souvent considérée
comme rare, ce qui n'est pas le
cas:
elle passe simplement inaper-
çue. Cependant, certaines années, les adultes semblent émerger en
nombre très limité.
Des mâles diurnes
pour
des femelles nocturnes
•
Les mâles volent en zigzag très rapidement, de jour, par temps
ensoleillé, et en début de nuit, à la recherche des femelles vierges qui
les attirent par l'émission d'une phéromone sexuelle. Les femelles
ne volent que la nuit, et principalement après l'accouplement, dans
le but de pondre leurs œufs dans des endroits variés.
Les papillons des deux sexes sont attirés par la lumière et peuvent
être trouvés en activité près de sources lumineuses entre 22h et 24h.
L'adulte ne s'alimente pas et, en captivité comme en conditions
extérieures, il vit près d'une semaine, uniquement sur les réserves
accumulées par la chenille.
•
Cette
femelle
d'Endromis
versicolora,
perchée
sur
un
rameau
de
bouleau,
attend
la
meilleure
heure
du
jour
pour
attirer
un
mâle
(cliché
P.
Velay
-
OPIE)
L'accouplement s'effectue plus facilement en extérieur (",10°C),
généralement sans difficulté, et s'obtient en plaçant deux couples
d'insectes vierges dans une volière (volume minimum: cube de
40 cm de côté) grillagée (tulle ou grillage plastique à mailles fines:
'"
1 mm) ou un seul couple dans une boîte à chaussures (carton) dont
on aura percé chaque côté de 10-15 trous
(2
mm). Les mâles sont
aussi vifs que ceux de la Hachette ou du Petit Paon de nuit et
s'abîment très vite les ailes dans de petites enceintes. L'accouple-·
ment dure en général quelques heures. Il convient d'éviter de
déranger les partenaires. Les mâles, une fois l'accouplement ter-
miné, peuvent partir à la recherche d'autres partenaires.
Les femelles sauvages attirées par la lumière sont presque toujours
fécondées. La ponte s'obtient plus facilement en extérieur
('"
1
O°C).
La ponte s'effectue en plaçant deux femelles au plus dans une boîte
à chaussures en carton ou en volière grillagée (cf. plus haut). Il est
cependant impératif de les mettre en présence de fins rameaux de
bouleaux
(0
maxi : 3 mm) portant des bourgeons, qui constituent un
stimulus indispensable à la ponte. Une femelle peut pondre jusqu'à
200 d'œufs. Les œufs ovales sont pondus à plat selon une ou deux
lignes de 6 à 20 œufs le long des rameaux de bouleaux. La ponte peut
durer 4-5 jours.
Une seule génération
par
an
•
L'œuf a la forme d'un tonnelet lisse d'environ 2 x 1
mm
(l
x 0). A
la ponte il est jaune clair, puis il s'assombrit en 2-3 jours pour devenir
brun foncé ou violacé. Les œufs seront conservés dans une boîte
hermétique (2,5 x
Il
cm : h x
0)
sans source d'humidité et à 20°C,
ou à l'extérieur dans les enceintes de ponte. Ce stade dure
10
jours
à 20-22°C,
",15
jours à 15°C, et près d'un mois en extérieur
(températures entre 0 et 10°C).
La chenille du premier stade a le corps d'abord noir, puis vert olive
quand elle s'approche de sa première
mue;
la capsule céphalique est
noire. Aux stades suivants, le corps est vert vif plus ou moins nuancé,
1iIiPIi~

avec au fur et à mesure de la croissance le renforcement d'une fine
ponctuation noire et des lignes latérales obliques blanches présentes
sur chaque segment. L'extrémité du corps porte en position dorsale une
pointe conique blanc-jaune de forme intermédiaire entre celles des
chenilles de sphinx et
de
la noctuelle Amphypyra pyramidea.
Au repos, la chenille a une attitude similaire à celle des sphinx: l'avant
du corps est dressé, la tête et les pattes thoraciques sont cependant
pointées vers l'extérieur du corps alors que chez les sphinx elles sont
repliées sous le corps. Comme aux deux premiers stades elles sont
groupées en colonies de
10
à 20 individus, le plus souvent à l'extrémité
des rameaux, cela donne à l'ensemble un air hérissé et agressif
vraisemblablement dissuasif pour les prédateurs, d'autant plus qu'elles
se hérissent encore davantage et s'agitent lorsqu'elles
sOnt
dérangées.
Il y a 4 à 5 stades larvaires, sans que l'on puisse expliquer la raison de
cette variation (tout comme pour Aglia tau).
Les plantes nourricières recommandées pour l'élevage sont le bouleau
avant tout, mais aussi le noisetier, les tilleuls, l'aulne, le charme,
l'orme
...
Il faut éviter de changer de plante nourricière en cours
d'élevage.
•
Le
mimétisme
et
l'immobilisme
est
la
meilleure
Un
élevage
délicat à son
début
•
Tout élevage à forte
densité et en atmos-
phère trop humide est
à éviter. Aux
~emier
et deuxième stades
larvaires, les chenilles
sont grégaires, tissent
continuellement un
fil
de soie sur leur pas-
sage
et
supportent
difficilement d'être
chance
de
survie
des
chenilles
d'Endromis
versicolora
(Cliché
P.
Velay
-
OPIE)
isolées. Lorsqu'elles
sont seules, elles cherchent à retrouver leurs congénères et s'épuisent
en déplacement. Il faut absolument éviter la manipulation des che-
nilles de ces jeunes stades. Au delà du deuxième stade, les chenilles
vivent en solitaire et supportent mal d'être dérangées par des congé-
nères .. . et par l'éleveur! Si on décroche de son support une chenille
qui va muer, on s'expose à la voir rater sa mue et mourir.
Les enceintes d'élevage seront placées en intérieur (20-22°C), dans un
endroit éclairé mais à l'abri du soleil. Les déjections seront enlevées
tous les jours, à l'aide d'un pinceau propre. Vérifier la propreté du
feuillage (à nettoyer avec un coton humide si nécessaire) et l'absence
de prédateurs et parasites, surtout pour les
LI
et L2. Changer le
feuillage non consommé tous les trois jours, plus fréquemment s'il
flétrit ou jaunit.
Durant les deux premiers stades larvaires (LI et L2) : Elever au
maximum
10
chenilles dans une boîte en plastique transparent (2,5 x
Il
cm:
h x
0)
percée de 10-12 trous à l'aide d'une épingle chauffée.
Mettre dans la boîte 4-5 jeunes feuilles dont le pédoncule est entouré
d'un coton humide, lui-même enrobé de papier d'aluminium.
Pour le troisième stade larvaire et le début du quatrième (L3 et début
L4) : Placer 6 chenilles
au
maximum dans une enceinte de 20 x
10
x
10
cm en plastique transparent, aérée au moyen de 15-20 trous (2 mm)
percés dans chaque côté
ou
d'une ouverture
(5
x 5 cm) grillagée (tulle
plastique ou treillis métallique à mailles fines). La base de l'enceinte
est percée de 3-4 trous permettant de faire tremper dans l'eau les
rameaux qui serviront à nourrir les chenilles. Colmater l'espace libre
des trous autour des tiges avec du coton pour éviter la fuite des
chenilles. Poser l'enceinte sur un récipient plein d'eau en veillant à la
bonne stabilité de l'ensemble.
Pour l'avant dernier et le dernier stades larvaires (fin L4 etL5) : Elever
les chenilles dans des enceintes aux côtés grillagés
(ex:
volière décrite
plus haut). Quinze chenilles au maximum pour une enceinte cubique
de 40 cm de côté. Placer des bouquets de feuillage dans 1 ou 2 pots à
confiture recouverts d'une rondelle de carton fort fixée au pot par du
ruban adhésif. Percer le carton d'autant de trous que de tiges à faire
tremper, au diamètre des tiges.
Durée des stades: La durée totale du stade larvaire est de 35-40 jours
à 20-25°C se répartissant en
LI
: 6-9 jours, L2 : 7-9 jours, L3 : 5-8
jours, L4 : 6-8 jours (existence d'une L5) ou 12-20 jours (pas de L5),
L5 : 8-10 jours. Tout comme pour Aglia tau, l'existence du cinquième
stade larvaire n'est pas systématique chez cette espèce.
La
nymphose et la chrysalide
Juste avant la nymphose, la chenille vide son intestin et change de
couleur: de vert, elle passe au brun-mauve plus ou moins clair et
s'enduit d'un liquide salivaire qui lui donne un aspect luisant. Elle
descend ensuite des rameaux et arpente sa cage à la recherche d'un
endroit pour fabriquer son cocon. Il convient alors de la transférer
dans une boîte aérée
(""
1
1)
tapissée d'une couche de terre humide (2-
5 cm), de mousse et de quelques feuilles mortes collectées en forêt
(vérifier l'absence de moisissure et d'animaux indésirables). On
peut utiliser des boîtes plus grandes, mais il ne faut pas mettre plus
de 4 chenilles simultanément en prénymphose dans la même boîte
car elles se gêneront pour fabriquer leur cocon.
Le cocon est plus ou moins ovoïde, assez solide, brun foncé et
entouré de mousse agglomérée à l'aide de soie grossière. Il est
construit à l'interface "terre / feuilles+mousse". La chrysalide se
forme 10-15 jours après
la
fabrication du cocon. Les cocons seront
impérativement conservés à l'extérieur jusqu'à l'émergence de
l'adulte, qui n'aura pas forcément lieu au printemps suivant. On
signale des chrysalides ne donnant un adulte que
la
4ème année après
leur nymphose! En région parisienne, la majorité (90-95%) des
chrysalides d,onne un adulte après un seul hiver, le reste après deux
hivers. Les cocons seront placés sur
10
cm
de terre que l'on
maintiendra humide par des arrosages réguliers, dans un vivarium
aéré (ou
un
pot de fleurs en terre), à l'abri des intempéries et des
prédateurs.
Les chrysalides noires et solides, garnies de couronnes de petites
pointes sur chaque anneau abdominal et renforcées dans leur partie
céphalique, percent leur cocon avant la sortie de l'adulte et se
dressent plus ou moins par l'orifice ainsi
formé;
elles en sortent
parfois totalement et sont capables de se déplacer sur quelques
centimètres, à la plus grande surprise de l'éleveurnéophyte vis-à-vis
de cette espèce. Ce phénomène intervient généralement
",,10
jours
avant l'émergence, mais parfois en plein hiver ou à la fin de
l'automne si un redoux prolongé intervient précocément. Placer dès
lors des supports pour l'émergence des adultes (branches) ou bien
transférer les cocons dans une volière. •
_
.....
1
/
2
100%