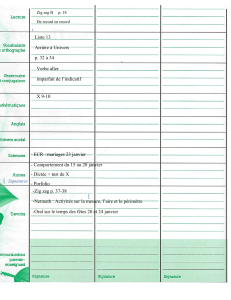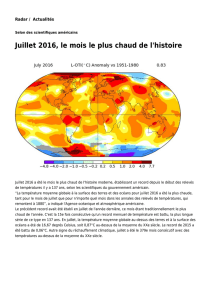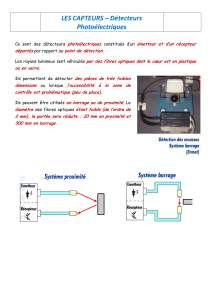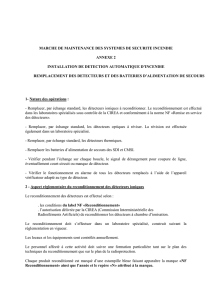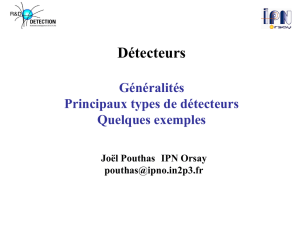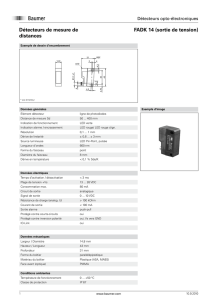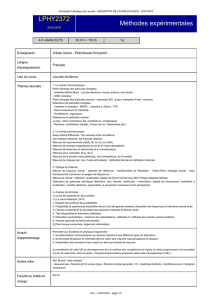Vitesse et record sur rail

René
Hocquet. Vitesse et record sur rail
Direction de l'Equipement SNCF.
TGV 26 février 1981 — SNCF
Pédale de mesure de vitesse Cl. SNCF
Tableau de contrôle optique de mesure de vitesse installé dans le PRS de
Pasilly — SNCF
«Le 26 février 1981, à 15 h
41,
en présence des mé-
dias du monde entier, le Train à Grande Vitesse a atteint
la vitesse de 380 km/h, battant ainsi largement le précé-
dent record du monde sur rail, détenu par la S.N.C.F.
depuis 1955 avec 331km/h.»
Ce communiqué, qui tombait sans tarder des télé-
scripteurs, oubliait cependant que la performance avait
été réalisée dans la seule foulée de cinq galops d'essais.
En effet, le mercredi 25 février 1981, veille du record, la
rame T.G.V. 16 de série s'était engagée résolument dans
une course contre la montre dont le programme, ambi-
tieux et prudent tout à la fois, prévoyait un minimum de
dix marches. Dès les premiers parcours, en raison d'une
tenue excellente de la voie, le record de 1955 était défi-
nitivement gommé, effacé, dans une discrétion quasi ab-
solue. Le palmarès de l'«Opération T.G.V. 100 a1 en est
d'ailleurs impressionnant. A chaque marche, la vitesse
maximale faisait des bonds prodigieux : successivement,
les compteurs atteignaient 310, 328, 340, 360 et
371km/h, sans poser de problèmes majeurs aux
spécialistes responsables des contrôles effectués à bord
de la rame et à la voie.
Le lendemain, 26 février, la première marche de
15 h 30 voyait à nouveau le plafond de la vitesse pulvé-
risé
:
les indicateurs enregistraient le 380 km/h sur quel-
ques centaines de mètres. Cette performance venait
couronner les innombrables essais à grande vitesse, réa-
lisés depuis plus d'une décennie dans les Landes et en
Alsace, et plus récemment sur la ligne nouvelle Paris-
Lyon.
Mais pour donner au record 1981 un haut degré de
crédibilité et lui conférer un caractère indiscutable et in-
contestable, les organisateurs de l'Opération T.G.V. 100
avaient décidé de mettre en œuvre des systèmes de
mesure à grande précision, tant à bord qu'à l'extérieur de
la rame T.G.V. 16.
Des dispositions furent donc prises à bord pour
obtenir une indication rigoureuse de la vitesse réelle.
Le système habituel de mesures, basé sur le relevé
de l'espace parcouru par le deuxième essieu moteur, ne
présentait pas, dans la gamme des vitesses 300 à
400 km/h, toutes les garanties suffisantes, pour la préci-
sion souhaitée.

Le moindre glissement de la roue motrice pouvait
accroître fictivement la distance parcourue et entraîner
ainsi une erreur de mesures non négligeable. C'est pour-
quoi, la rame T.G.V. 16 a été dotée de capteurs de vitesse
à dents montés sur essieu porteur.
Parallèlement à cette mesure continue de la vi-
tesse, un relevé au sol s'avérait indispensable pour
valider et homologuer les indications de bord. Après de
multiples recherches dans les possibilités offertes par
les techniques modernes de métrologie, le choix
s'est
porté sur un système utilisant un grand nombre de bases
de mesure ponctuelles. Toutes identiques, elles seraient
réparties judicieusement sur le parcours emprunté par
la rame du record et comprendraient, chacune, deux
détecteurs de passage, espacés de 10 m et un boîtier
d'adaptation qui ne prendrait en compte que le premier
essieu de la rame. Les tops de passage seraient adressés
par câble à un poste central où une baie de concentration
assurerait le traitement des informations provenant de
chaque base de mesure, le calcul des vitesses, l'affichage
et l'impression des résultats.
Le présent article se limite à la description som-
maire du système de mesure de la vitesse au sol, mis en
œuvre spécialement pour l'Opération T.G.V. 100, sys-
tème qui a permis de vérifier la parfaite concordance
entre les mesures linéaires de vitesse faites à bord et
celles relevées ponctuellement à la voie.
Plusieurs mois avant la tentative du record, une
étude de simulation et de faisabilité, tenant compte des
diverses contraintes inhérentes à la voie, et notamment
à l'insuffisance des dévers, précisait le site retenu pour
l'Opération T.G.V. 100 et les grandes lignes du pro-
gramme de montée en vitesse. La rame T.G.V. 16,
allégée de trois voitures, circulerait dans le sens pair sur
la voie 2 de la ligne nouvelle Paris-Lyon entre le viaduc
de Serein (km 192) et la sous-station de Carizey
(km 130). En réalité, le parcours a été limité les 25 et
26 février 1981 au poste T.G.V. de Tonnerre (km 140).
Par ailleurs, un graphique de circulation à la vitesse
plafond était établi en fonction du temps et de l'espace :
il permettait de localiser la zone où l'on pouvait espérer
atteindre 380 km/h et même 390 km/h. Ainsi cette zone
située entre les km 157 et 153 fut choisie pour l'enregis-
trement des contraintes voie exercées par la rame lors de
son passage en vitesse et également pour l'étude des sou-
lèvements de la caténaire par le pantographe.
Quant à la mesure de la vitesse au sol, elle serait
réalisée tous les 500 m, dans la zone à vitesses potentiel-
les supérieures à 360 km/h, c'est-à-dire entre les km 162
et 152. Pour mieux situer géographiquement la zone en
question, on remarquera que les points kilométriques
extrêmes correspondent respectivement au poste de
signalisation T.G.V. de Pasilly et au centre d'appareil-
lage intermédiaire T.G.V. de Sambourg.
Vingt et une bases de mesures furent donc mises
en place dans cette zone, tandis qu'en amont et en aval,
dix autres bases étaient implantées de manière à obte-
nir un suivi en vitesse de la rame et à réaliser un graphi-
que relativement linéaire pour la circulation entière,
facilement comparable à l'enregistrement réalisé à bord.
Au poste de signalisation T.G.V. de Pasilly
(PRS 17) devenu également dans le cadre du record, le
P.C.
des opérations du domaine voie, une baie de concen-
tration et d'interprétation des trente et une informa-
tions de vitesse était mise en œuvre, complétée par des
sous-ensembles et des périphériques, tels que horloge,
compteurs, afficheurs, minicalculateur, imprimante,
table traçante XY.
BASE DE MESURES DE VITESSE.
Chaque base comprend deux détecteurs électroni-
ques de roue, espacés rigoureusement de dix mètres et
un dispositif de mise en forme des impulsions, engen-
drées lors du passage.
Les deux détecteurs Pd 1 et Pd2 font partie de la
famille des pédales électroniques, couramment utilisées
sur les voies et en particulier pour les annonces des cir-
culations aux passages à niveau, équipés d'une signalisa-
tion automatique avec deux ou quatre demi-barrières.
Entièrement statique, ce type de détecteur est capable de
fonctionner à des vitesses très élevées, comme l'ont
montré des essais de simulation. Leur fonctionnement
reste très satisfaisant dans des conditions climatiques
sévères et à des vitesses voisines de 400 km/h. Leur
emploi est d'ailleurs recommandé sur les lignes à grande
vitesse et dans les régions fréquemment enneigées.
Le détecteur électronique de roue comporte
essentiellement un oscillateur et un circuit résonnant
accordé, auquel est associé un amplificateur à seuil. Deux
types existent pour les installations de signalisation:
D 50 et D 39, c'est-à-dire détecteurs accordés respective-
ment à 50 kHz et à 39 kHz. Les bases de mesures «Opé-
ration T.G.V. 100» ne comportaient que des détecteurs
du type D 50.
Le circuit résonnant constitue avec son circuit
magnétique une «tête de lecture» sensible au passage
des roues: le champ créé par ce circuit magnétique
engendre dans la masse métallique du bandage des cou-
rants de Foucault, donc des pertes, qui réduisent notable-
ment la tension délivrée par l'oscillateur et bloquent
l'amplificateur à seuil. Le passage d'une roue se traduit
donc par une absence temporaire du signal à 50 kHz et
ce créneau est ensuite exploité par le dispositif associé au
détecteur.
Tous les essieux de la rame agissent successive-
ment sur les deux détecteurs Pdl et Pd2, mais pour
obtenir le maximum de précision, l'appareillage d'inter-
prétation à pied d'œuvre ne prend en compte que le pas-
sage du premier essieu de la rame.
Un train de deux impulsions de 20 ms est alors éla-
boré et transmis par une paire de conducteurs jusqu'au
poste central de mesures, qui assure le comptage du
temps (tl -12) et en déduit la vitesse.
La base de mesures est alimentée par une pile de
9 V, dont la mise en service est télécommandée depuis le
P.C.
de Pasilly. Une quarte indépendante était donc
nécessaire pour le fonctionnement de chaque base de
mesures : une paire affectée à la transmission des tops de
passage tl et t2, et une deuxième pour les opérations de
mise en charge et de remise à zéro de la prise d'informa-
tion, qui avait mémorisé tous les essieux de la rame.
Des câbles existants ont été utilisés dans la mesure
du possible, mais un grand nombre de liaisons ont été
confectionnées pour la circonstance.
On notera que, par souci d'efficacité et pour mini-
miser les coûts de l'installation, les concepteurs avaient

Adaptât
ion
Pdl
Adaptation
Pd2
Elaboration
des
impuis
ions
Régulateur
d'alimen
-
tation
•
I
1
quarte
|
\
vers
PRS
17
POINT
DE
PRISE
D'INFORMATION
SCHEMA
SYNOPTIQUE
Télécommande
Imprimante Imprimante
Table
traçante
Table
traçante
POSTE
CENTRAL
DE
MESURE
SCHEMA
SYNOPTIQUE
DE
L'INSTALLATION

Sens de circulation
1 k l0m >
Pdl Pd2 Détecteur D50
r n r
Boîtier
d'adaptât ion
<Y 1 quarte vers PRS 17 (ZPAU ou
Z.C03)
•POINT DE-PRISE D'INFORMATION
DISPOSITION DES APPAREILS SUR LE TERRAIN
préféré confier le comptage du temps de passage à
l'unité centrale du P.C. plutôt que de procéder à un trai-
tement à pied d'oeuvre, avec transmission délicate des
résultats.
POSTE CENTRAL DE MESURES.
) La baie de concentration comprenait, pour chaque
point de mesures au sol, un étage de mise en forme des
tops d'information, un compteur, un afficheur numéri-
que de visualisation, des organes de commutation.
L'intervalle de temps, séparant les deux tops d'in-
formations adressées par la base de mesures, lors du pas-
sage du premier essieu sur les deux détecteurs électro-
niques, était converti en un créneau d'impulsions de fré-
quence 100 kHz. Un oscillateur interne à la baie et piloté
par quartz délivrait ces impulsions.
Le premier top issu de la base de mesure déclen-
chait le comptage des impulsions, l'arrêt étant assuré
par le deuxième top.
Le contenu du compteur, correspondant au temps
de franchissement des dix mètres de la base, était immé-
diatement visualisé sur l'afficheur numérique corres-
pondant.
Sur commande de l'opérateur, le contenu du comp-
teur était transféré dans la mémoire d'un mini-calcula-
teur, associé à la baie de concentration, pour traitement
et calcul de la vitesse exprimée en km/h. L'exploitation
des résultats s'effectuait ultérieurement, sur demande
des responsables, de deux manières différentes :
- édition sur une imprimante de la vitesse
mesurée en chacun des trente et un points,
- réalisation du graphique de la vitesse en fonction
de la distance sur une table traçante XY.
PRÉCISION DE LA MESURE.
La vitesse, donnée par la formule V = e/t, présen-
tait deux incertitudes : l'une sur la connaissance de l'es-
pace parcouru, l'autre sur la connaissance du temps de
passage.
Afin de réduire au minimum l'erreur relative faite
sur la mesure de vitesse, un certain nombre de précau-
tions ont été prises tant sur l'implantation des détec-
teurs que sur le choix des composants du matériel au sol
et des appareillages du poste central de mesures. Par
exemple, un soin particulier a été apporté à la pose des
détecteurs : la mesure de la distance entre les axes a été
réalisée par télémétrie. L'incertitude sur le temps de
réponse des circuits, des relais auxiliaires, du compteur a
également été appréciée, pour la rendre la plus accepta-
ble possible.
Le système mis en œuvre pour l'Opération T.G.V.
a donc permis de mesurer les vitesses dans la gamme
350 à 380 km/h avec une incertitude relative inférieure à
lkm/h.
Par ailleurs, la concordance entre les mesures
faites au sol et à bord a été vérifiée soigneusement avant
la tentative, notamment au cours des marches du
mercredi 25 février 1981.
La vitesse 380 km/h affichée par les appareils de
bord a été atteinte sur un parcours légèrement inférieur
à 500 m, entre deux bases de mesures ponctuelles, où des
vitesses légèrement supérieures à 379 km/h ont été
enregistrées.
De plus, les résultats obtenus lors des cinq marches
de montée en vitesse témoignent des hautes qualités du
T.G.V. et de la ligne nouvelle. La rame 16 a parcouru en
deux jours 80 km à plus de 331km/h, l'ancien record
de 1955, 31km à plus de 350 km/h, 17 km à plus de
360 km/h et enfin 5 km à plus de 370 km/h,
Cette performance, réalisée par une rame de série,
montre au grand public que la marge de sécurité,
disponible à la vitesse commerciale du T.G.V., soit
260 km/h, est très importante et que la voie nouvelle
présente une parfaite stabilité.
Note.
1.
Opération T.G.V. 100
:
opération visant à atteindre la vitesse de
100 mètres par seconde, c'est-à-dire
360
km/h.
1
/
4
100%