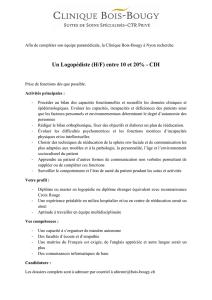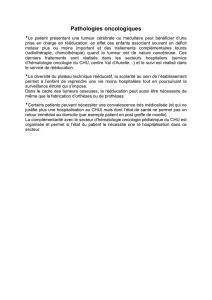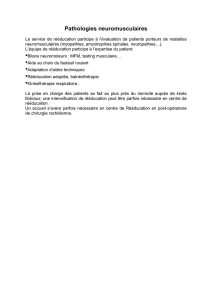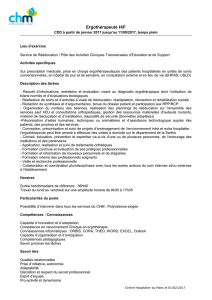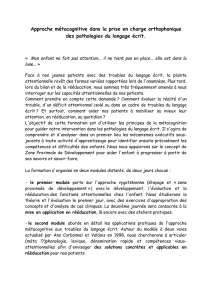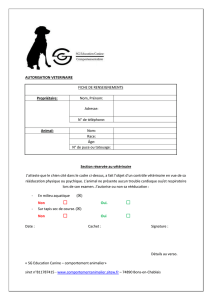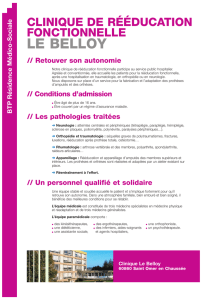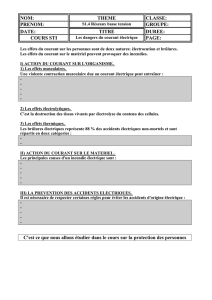Rééducation de l`enfant brûlé

Rééducation de l’enfant brûlé
H Descamps
C Baze Delecroix
E Jauffret
Résumé. –La brûlure de l’enfant est plus fréquente et source de séquelles plus graves que chez l’adulte dans
la mesure où la réparation tissulaire aboutit plus souvent à une cicatrice pathologique. L’évolution des
brûlures profondes vers la cicatrisation dirigée doit être autant que possible évitée. L’attitude thérapeutique
en rééducation est plus interventionniste que chez l’adulte pendant la durée de la phase inflammatoire.
L’appareillage joue un rôle important : bien conduit par une équipe entraînée, bien expliqué à l’enfant et à sa
famille et bien surveillé, il permet d’éviter les séquelles fonctionnelles et esthétiques, ainsi que les troubles de
croissance. L’association d’activités ludiques aux techniques plus contraignantes, la prise en compte de la
douleur, le soutien continu de l’enfant et de sa famille, doivent pouvoir limiter les conséquences
psychologiques. Les techniques nouvelles de recouvrement posent des problèmes spécifiques de rééducation
qui montrent toute la nécessité d’une bonne collaboration entre les différents intervenants au sein d’une
filière de soins.
©2001 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots-clés : enfant, brûlures, rééducation, séquelles, orthèses, croissance, filières de soins, derme artificiel,
culture d’épiderme.
Introduction
Tout enfant gravement brûlé réclame un
projet de rééducation individualisé qui
débute dès la phase initiale de la brûlure
jusqu’à maturation cicatricielle, cela afin
d’obtenir, comme chez l’adulte, un résultat
esthétique et fonctionnel optimal
[28]
, mais
aussi de prévenir les risques de répercussion
sur la croissance
[4, 14]
. La démarche, même si
elle repose sur les mêmes principes que celle
de l’adulte, doit tenir compte du fait que la
réaction inflammatoire – et donc le risque
d’évolution vers une cicatrice pathologique
– est plus importante chez l’enfant. Elle doit
aussi prendre en compte les répercussions
psychologiques et environnementales d’un
« être en devenir ».
Généralités
ÉPIDÉMIOLOGIE
L’enfant de 0 à 4 ans se brûle trois fois plus
souvent que tous les autres âges confondus.
Une étude épidémiologique, réalisée en 1995
sur l’ensemble du territoire français, donne
une idée des particularités de survenue des
brûlures de l’enfant
[1]
. Il s’agit six fois sur
Hauviette Descamps : Praticien hospitalier.
Christine Baze Delecroix : Masseur-kinésithérapeute cadre.
Étienne Jauffret : Médecin de rééducation.
Médecine physique et réadaptation, centre de pédiatrie et de
rééducation de Bullion, 78830 Bullion, France.
dix de garçons d’âge moyen de 2 ans, avec
un pic de fréquence aux heures de repas.
Les brûlures superficielles (61 %) sont
majoritaires, causées essentiellement par des
liquides chauds (73 %) et dans la cuisine.
Les brûlures par flammes sont moins
fréquentes (8,7 %) mais plus graves : 60 %
sont profondes et greffées. Les briquets et
les liquides inflammables pour allumer
barbecue et feu de bois sont régulièrement
incriminés et doivent faire l’objet de
campagnes de prévention. Les brûlures
électriques concernent 6,4 % des cas. Le petit
enfant se brûle les doigts dans les prises
électriques. Chez l’adolescent, on recense
plusieurs cas de brûlures électriques à partir
de caténaires qui génèrent des arcs
électriques de 15 000 à 25 000 volts, lorsque
le jeune monte, par jeu, sur le toit de wagon
de train. Ces brûlures sont alors volontiers
profondes et responsables parfois
d’amputations ou de lésions neurologiques.
Derrière l’accident par brûlures, se cache
parfois un problème de maltraitance : 8 %
des brûlures sont causées par des sévices et
11 % des enfants maltraités sont victimes de
brûlures. Il faut savoir y penser quand les
circonstances de survenue ne sont pas claires
et qu’ilyaretard de consultation après
l’accident.
ÉVOLUTION PHYSIOPATHOLOGIQUE
Elle dépend de l’intégrité de la membrane
basale qui sépare derme et épiderme (fig 1).
Les brûlures superficielles, qui respectent la
membrane basale, évoluent rapidement vers
la restitutio ad integrum. Les brûlures
profondes, avec destruction complète de la
membrane basale, sont atones ou
carbonisées (deuxième degré profond et
troisième degré), peuvent cicatriser
spontanément mais font classiquement
l’objet d’une excision-greffe précoce (dixième
jour). Entre les deux, les brûlures du
deuxième degré intermédiaire peuvent
évoluer, soit favorablement comme un
deuxième degré superficiel, soit
défavorablement comme un deuxième degré
profond, surtout en cas de complication
infectieuse.
La réparation tissulaire après brûlure
profonde est un phénomène complexe qui
aboutit parfois à une cicatrice pathologique,
hypertrophique et rétractile
[8]
, plus souvent
chez l’enfant que chez l’adulte, et dont la
compréhension, favorisée par de
nombreuses études récentes, est
indispensable pour appréhender la
prévention et le traitement des séquelles. Il
y a, dans un premier temps, formation d’une
escarre constituée de tissu nécrotique dont
la détersion est interne, spontanée, ou
externe, chimique et mécanique, aboutissant
à un plan de clivage entre tissu sain et tissu
mort. Pour combler la perte de substance,
un tissu de granulation hypervascularisé se
constitue. Les fibroblastes se multiplient et
sont responsables d’une production très
importante de fibres collagènes épaissies et
Encyclopédie Médico-Chirurgicale 26-275-D-10
26-275-D-10
Toute référence à cet article doit porter la mention : Descamps H, Baze Delecroix C et Jauffret E. Rééducation de l’enfant brûlé. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés),
Kinésithérapie – Médecine physique-Réadaptation, 26-275-D-10, 2001, 10 p.

désorganisées. Ces fibroblastes peuvent se
transformer en myofibroblastes (fig 2) qui
possèdent des caractéristiques morpholo-
giques et biochimiques comparables à celles
des cellules musculaires lisses et donc des
propriétés contractiles générées par les
microfilaments d’actine. Le résultat est une
cicatrice inflammatoire, hypertrophique et
rétractile, qui évolue pendant toute la
maturation cicatricielle
[13]
. Ces phénomènes
inflammatoires sont maximaux entre le
troisième et le sixième mois en moyenne,
puis diminuent progressivement jusqu’au
12
e
ou 24
e
mois, avec une grande variabilité
individuelle. Le tissu de granulation est
éliminé progressivement par apoptose (ou
mort cellulaire) ; la vascularisation se
normalise et la trame collagénique se
réorganise en lignes de tension parallèles.
La cicatrice stabilisée obtenue a un
revêtement épidermique correct, parfois
perturbé par des troubles de la pigmentation
définitifs. Le tissu sous-jacent est plus
fibreux et dense, ce qui se traduit par une
cicatrice moins élastique, pas toujours plane
et souvent irrégulière.
Les cicatrices chéloïdes se rencontrent
surtout, mais pas exclusivement, chez
l’enfant à peau noire ou fortement
pigmentée (fig 3). Elles présentent un aspect
pseudotumoral, avec persistance d’une
répartition anarchique du collagène. Leur
déterminisme est inconnu. Le diagnostic est
évolutif, suspecté devant l’absence de
régression d’une cicatrice hypertrophique.
FACTEURS DE GRAVITÉ
Outre l’âge et la profondeur qui font de
l’enfant brûlé gravement un candidat
potentiel aux séquelles sévères de brûlure,
les autres facteurs qui conditionnent
l’évolution sont la surface cutanée brûlée
(règle des neuf, table de Lund et Browder),
le siège (gravité des atteintes de la tête, du
cou et des mains), le type et la précocité du
recouvrement, la compliance au traitement
et les facteurs psychologiques et
environnementaux de l’enfant.
Filière de soins
La rééducation s’intègre dans un programme
de soins pluridisciplinaire pendant toute
l’évolution de la brûlure, jusqu’à maturation
cicatricielle (fig 4).
La prise en charge débute en centre aigu.
Elle ne doit pas gêner la réanimation et doit
respecter l’état local (détersion des cicatrices,
greffes, surinfections). Il s’agit surtout
d’« un état d’esprit » qui consiste à prendre
en compte, dès le début, la prévention des
séquelles (installation, pansements adaptés,
orthèses simplifiées) et qui doit être partagé
par l’ensemble de l’équipe (réanimateurs,
chirurgiens, équipe soignante, rééducateurs).
Lorsque l’enfant sort du centre aigu, il peut :
– soit rentrer au domicile avec des soins
ambulatoires (soins infirmiers,
kinésithérapie) ;
– soit être transféré en centre de
rééducation. La spécificité de la prise en
ÉPIDERME
MEMBRANE
BASALE
DERME
PAPILLAIRE
DERME
RÉTICULAIRE
HYPODERME
7
8
9
10
11
20
19
18
17
16
15
14
13
3
4
5
6
1
2
12
D.HORVÁTH
1Schéma de la peau. 1. Pore ; 2. lamelles de kératine ; 3. couche cornée ; 4. couche granuleuse ; 5. corps muqueux
de Malpighi ; 6. couche basale germinative (kératinocytes + mélanocytes) ; 7. corpuscule de Meissner ; 8. plexus ner-
veux sous-épidermique ; 9. glande sébacée ; 10. corpuscule de Pacini ; 11. poil ; 12. plexus nerveux profond ; 13. lobu-
les graisseux ; 14. vaisseaux ; 15. glandes sudoripares ; 16. fibres de collagène ; 17. fibres de réticuline ; 18. fibres d’élas-
tine ; 19. fibroblastes ; 20. cellules de Langerhans.
Bride
hypertrophique Peau
normale
Collagène anarchique
Myofibroblastes Collagène régulier
Fibroblastes normaux
2Schéma des modifications histologiques d’une brû-
lure profonde.
3Chéloïdes chez un sujet de race blanche.
Centre de brûlés aigus
Centre
de rééducation
Ambulatoire
Cure thermale
Chirurgie réparatrice
4Schéma de la filière de soin.
26-275-D-10 Rééducation de l’enfant brûlé Kinésithérapie
2

charge nécessite alors, comme en centre
aigu, une spécialisation de l’ensemble de
l’équipe. Le transfert dans un autre centre
de rééducation non spécialisé plus proche
du domicile, quand il est souhaitable, est
secondaire et fait l’objet d’un travail
préparatoire.
Après le séjour en rééducation, l’enfant
retourne habituellement au domicile, avec
un traitement ambulatoire et un suivi en
consultation externe.
Ce suivi est assuré au niveau du centre aigu
ou du centre de rééducation par le médecin
de médecine physique et de réadaptation,
ou le chirurgien, ou les deux ensemble dans
le meilleur des cas. Les prescriptions de
cures thermales ou les indications de
chirurgie réparatrice sont portées lors des
consultations de suivi.
Pour l’enfant et sa famille, suivre cette filière
de soins est un vrai parcours du combattant,
avec son lot d’inquiétudes et d’actes
douloureux, et il est fondamental que
l’ensemble des intervenants collabore pour
agir de façon coordonnée et cohérente. Le
kinésithérapeute de ville, souvent peu
habitué à ce type de pathologie, peut être
contacté par téléphone ou mieux encore,
convié à se déplacer au centre de
rééducation pour une meilleure transmission
des techniques de rééducation.
À l’heure où la qualité s’intègre dans toute
démarche thérapeutique, les centres aigus et
les centres de rééducation spécialisés doivent
pouvoir être considérés comme pôles de
référence dans chaque région concernée.
Objectifs et techniques
de rééducation
Le projet thérapeutique individualisé de
chaque enfant repose sur une bonne
observation de l’état local sans cesse
réévalué par un personnel compétent, et sur
l’état général et psychologique de l’enfant et
de sa famille, participation aux soins et
éducation étant les meilleurs garants de la
réussite (fig 5).
APPRÉCIER L’ÉTAT CICATRICIEL
Le bilan commence par un schéma des
brûlures initiales, avec estimation de la
profondeur de chaque zone, puis sur des
cartographies précises délimitant les zones
greffées, les prises de greffes, les ulcérations,
les zones surinfectées, les brides. Toutes ces
données sont régulièrement recueillies lors
de bains afin d’adapter les techniques de
rééducation en fonction du revêtement
cutané. On peut s’aider des bilans
photographiques répétés qui devraient
prendre un intérêt particulier avec l’arrivée
des appareils numériques.
Au cours de la maturation cicatricielle, la
qualité de la peau peut être appréciée par
des paramètres regroupés en échelle
d’évaluation :
– coloration plus ou moins rouge en
fonction de l’importance de la
néovascularisation ;
– relief secondaire au développement du
tissu de granulation et prolifération de
collagène ; après la phase inflammatoire, on
parle de relief résiduel, qui peut aller de la
cicatrice chéloïde à la cicatrice plane plus ou
moins irrégulière et fripée ;
– consistance, variable en fonction de
l’importance de la fibrose, appréciée par la
palpation ;
– défaut d’élasticité ou rétraction,
conséquences de la diminution des fibres
élastiques et de la transformation des
fibroblastes en myofibroblastes. La rétraction
peut être responsable de limitation
d’amplitudes articulaires et de déviations de
structure anatomique (mamelons, orifices,
etc) ;
– pigmentation appréciée par rapport à celle
de la peau saine de proximité. Elle est
normale, diminuée (vitiligo) ou exagérée
(hyperpigmentation) (fig 6) ;
– fragilité cutanée : présence de plaies,
ulcérations (fig 7) ;
– sécheresse cutanée et hyperkératose par
hyperproduction de kératinocytes ;
– prurit ;
– douleur au contact ;
– troubles de la sensibilité résiduels
(hypoesthésie, dysesthésie).
L’évaluation répétée de ces paramètres
permet d’avoir une vision évolutive de la
maturation cicatricielle jusqu’au stade de
séquelles. Au même moment, il est fréquent
de voir coexister des cicatrices à un stade
évolutif différent suivant le siège. Ainsi, les
cicatrices de la face, zone de grande
Volume cicatriciel
Compression souple
(vêtement compressif)
Compression rigide
(masque)
Orthèse permanente
Orthèse nocturne
Graissage
Massage
Première douche filiforme
Première vacuothérapie
Chirurgie réparatrice
ou
ou
3 mois 6 mois 12 mois 18 mois
5Schéma thérapeutique
d’une cicatrice hypertrophique
et rétractile.
7Ulcération persistante
sur coude.
6Dyschromie.
Kinésithérapie Rééducation de l’enfant brûlé 26-275-D-10
3

mobilité, sont classiquement plus longtemps
inflammatoires que les autres.
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’échelles
d’évaluation satisfaisantes. L’échelle de
Vancouver est la plus utilisée
[2, 31]
, mais elle
est imprécise et trop restrictive. Un projet
d’échelle plus performante est en cours
d’élaboration.
LUTTER CONTRE L’HYPERTROPHIE
L’hypertrophie est plus habituelle et plus
prononcée chez l’enfant que chez l’adulte,
surtout dans les zones de cicatrisation
dirigée (spontanée), les bordures de greffes
(fig 8) et entre les mailles du filet des
autogreffes expansées.
De façon générale, toute brûlure qui ne
cicatrise pas en une dizaine de jours est
considérée comme profonde et donc à
risque, particulièrement chez l’enfant.
L’indication de greffe dermoépidermique est
alors presque toujours indiquée pour limiter
au maximum la cicatrisation spontanée et
son habituelle évolution hypertrophique.
Pour prévenir et traiter l’hypertrophie, la
pressothérapie est la méthode de choix
pendant toute la phase inflammatoire. Son
action est prouvée histologiquement : après
compression, il se crée une hypoxie locale et
on observe une disparition partielle des
myofibroblastes par augmentation du
processus d’apoptose et une réorganisation
des fibres de collagène. Pour être efficace, la
pression doit être continue, 23 h/24 et varier
autour de 20 mmHg, ce qui n’est pas
toujours facile à obtenir
[16]
.La
pressothérapie doit commencer préco-
cement, avant même le stade
d’épidermisation pour diminuer l’œdème et
être poursuivie jusqu’à maturation
cicatricielle, c’est-à-dire entre 12 et 18 mois
en moyenne.
Le pansement lui-même joue un rôle
compressif et doit être surveillé afin d’éviter
toute ischémie qui ne ferait qu’aggraver la
plaie. L’efficacité de la compression et de la
lutte contre l’œdème par les pansements est
améliorée par l’adjonction de bandes
tubulaires élastiques en coton, découpées
pour confectionner des vêtements
compressifs transitoires sur mesure, et par
les bandages cohésifs type Cohebant,
Rolflext, particulièrement intéressants pour
comprimer les doigts individuellement et les
mains des enfants tant que les cicatrices
restent fragiles (fig 9).
Au niveau des membres inférieurs, en cas
de brûlures circulaires, les bandes de
contention (type Biflext) sont indispensables
pour éviter l’œdème lors de la
reverticalisation.
Après épidermisation, des vêtements
compressifs « définitifs » sur mesure sont
confectionnés en tissu synthétique plus
résistant à l’usure. Du fait des modifications
morphologiques et de la croissance, surtout
chez le petit enfant, les vêtements sont
renouvelés tous les 3 mois.
Au niveau du visage et du cou, la
compression est assurée par des orthèses
rigides en thermoplastique transparent
(Uvextou Orlent) mieux acceptées
psychologiquement que les cagoules en tissu
et plus efficaces
[18]
. La technique de
réalisation comporte une prise d’empreinte
(fig 10) avec des bandes plâtrées puis la
confection d’un positif en plâtre fin liquide à
prise rapide (fig 11), soigneusement évidé
pour retrouver les reliefs osseux et poncé au
niveau des zones d’hypertrophie avant le
moulage de la plaque thermoformable
(fig 12). La transparence de l’orthèse permet,
une fois sa mise en place, de vérifier
l’efficacité de la compression par le
blanchissement des zones hypertrophiques
et d’effectuer des adaptations éventuelles
(fig 13).
Les adjonctions sont placées sous les
compressions souples (bandes cohésives,
tissu) au niveau de certaines zones concaves
(commissures des doigts, région sous-
claviculaire…) pour mieux répartir les
8Cicatrisation dirigée en bordure de greffe.
9Compression par bande cohésive Cohebantet par
gant avec adjonction en silicone au niveau de la
quatrième commissure.
10 Prise d’empreinte.
11 Positif en plâtre fin liquide à prise rapide.
12 Moulage de la plaque thermoformable sur le positif.
13 Blanchiment des zones hypertrophiques sous
masque.
26-275-D-10 Rééducation de l’enfant brûlé Kinésithérapie
4

appuis, mais aussi au niveau de placards
particulièrement inflammatoires pour
renforcer la compression. On utilise des
mousses de latex expansé de différentes
épaisseurs, des cavaliers en cuir au niveau
des commissures, des silicones (gels, pâtes
modelables). L’efficacité d’action des plaques
de silicone, en fait, dépendrait plus de la
création par les plaques d’un environnement
anaérobie de la cicatrice que de la
compression elle-même.
LUTTER CONTRE LA RÉTRACTION
(tableau I)
La compression est un premier moyen de
prévention contre la rétraction car elle
diminue la prolifération de myofibroblastes,
cellules douées de propriétés rétractiles. Il
faut y associer la mise en tension cutanée
maximale par posture manuelle ou par
orthèse pour garder, au niveau des
articulations, un « capital peau » le plus
étendu possible.
L’abord du traitement de la rétraction par
orthèse chez l’enfant diffère de celui chez
l’adulte dans la mesure où :
– toute brûlure articulaire induit un risque
de rétraction plus fréquent et plus
prononcé ;
– une cicatrice rétractée peut perturber la
croissance cutanée ;
– l’absence d’évolution vers la raideur
articulaire, la faible incidence des ostéomes,
après immobilisation, autorise un port
d’orthèse plus prolongé.
Il en résulte une attitude plus intervention-
niste que chez l’adulte. Le bénéfice obtenu
par des immobilisations contraignantes doit
permettre de dépasser la perte fonctionnelle
transitoire qui en résulte, sans jamais abuser
de la contrainte lorsque celle-ci n’est pas
indispensable.
La conduite du traitement peut être
schématisée, mais est à adapter pour chaque
individu par une équipe expérimentée, en
fonction de critères d’efficacité et de
tolérance physique et psychologique.
On peut différencier la période initiale qui
encadre la greffe cutanée et la période
secondaire qui débute lorsque l’épidermi-
sation est en bonne voie.
¶Traitement postural initial
Il doit être mis en œuvre rapidement sans
entraver la réanimation et consiste à installer
l’enfant en tenant compte de la localisation
des brûlures et de la nécessité du maintien
de la tension cutanée maximale.
Classiquement, le cou est en extension, les
épaules en abduction à 120°, les coudes en
extension, les avant-bras en supination, les
hanches en extension et légère abduction, les
genoux en extension, les pieds à angle droit,
les poignets et les mains maintenus dans
une orthèse d’extension statique, doigts
écartés.
Le pansement joue un rôle posturant
important, surtout au niveau de la main et
des pieds : les doigts sont individualisés et
les commissures couvertes en « fronde » de
pansements gras.
À ce stade, le traitement est préventif, mais
les contraintes d’ordre local ou général ne
permettent pas toujours d’éviter l’apparition
de rétractions qui peuvent limiter
l’amplitude articulaire.
¶Traitement postural secondaire
Il repose sur le maintien des postures
pendant la phase inflammatoire.
L’installation simple est progressivement
remplacée par la mise en place d’orthèses
[25, 26]
. Le choix du type et la durée du port
des orthèses dans la journée sont évalués en
fonction du siège et de l’importance des
brides
[27]
.
En cas de limitation importante des
amplitudes articulaires, des plâtres successifs
sont refaits tous les2à3jours en fonction
de l’état cutané, jusqu’à obtention d’une
amplitude normale (fig 14). Si les rétractions
sont plus limitées, des orthèses amovibles
en résine sont confectionnées et portées, soit
uniquement la nuit, soit en permanence
23 h/24, avec habituellement une
diminution progressive du port journalier
pour arriver à un port uniquement nocturne.
En outre, l’observation précise des cicatrices
permet de distinguer :
– les brides monoarticulaires ;
– les brides ou placards étendus,
pluriarticulaires, nécessitant la posture
simultanée des différentes articulations
concernées ;
– les brides antagonistes pour lesquelles on
alterne différentes orthèses.
Le rétablissement de la fonction peut aussi
conduire à alterner les orthèses, par
exemple : orthèses thoracobrachiales droite
et gauche alternées le jour, pour permettre
l’utilisation d’un membre supérieur (fig 15,
16, 17) et, au niveau des mains, alternance
d’orthèses de fonction et de posture.
Les orthèses sont confectionnées en divers
matériaux : plâtre, résine ou thermofor-
mable. On cite les plus communément
réalisées en pratique quotidienne :
– les conformateurs faciaux et cervicaux qui
jouent un rôle à la fois compressif et
posturant, associés, pour les brides
cervicales, à un collier mousse ou minerve ;
– les orthèses thoracobrachiales ou
thoracobibrachiales, souvent relayées dans la
journée par un redresse-dos lorsque le
placard thoracique antérieur entraîne un
enroulement des épaules, fréquent chez
l’enfant ;
Tableau I. – Traitement postural d’une cicatrice en zone articulaire.
État cicatriciel Posture
Greffe récente Installation Pansement adaptés
Cicatrice inflammatoire avec présence de bride
• Non rétractile • Posture nocturne
• Rétraction limitée • Posture permanente
• Rétraction importante • Plâtres successifs
• Chaîne articulaire • Posture simultanée de l’ensemble des articulations concernées
• Brides antagonistes • Postures alternées
Ulcération sur bride • Posture permanente
Cicatrice mature, rétractile • Chirurgie réparatrice
14 Plâtres successifs de coude.
15 Attelle thoracobrachiale droite.
16 Attelle thoracobrachiale gauche.
Kinésithérapie Rééducation de l’enfant brûlé 26-275-D-10
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%