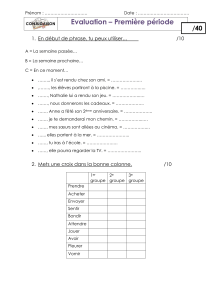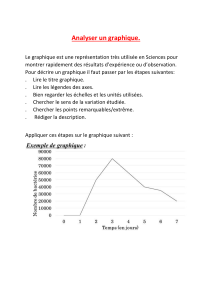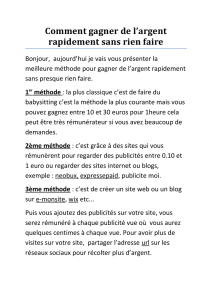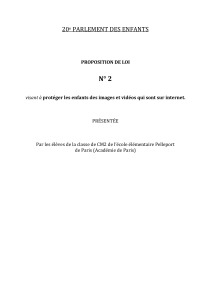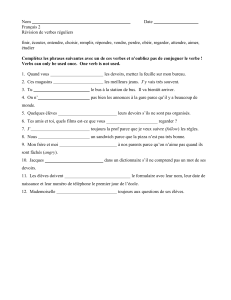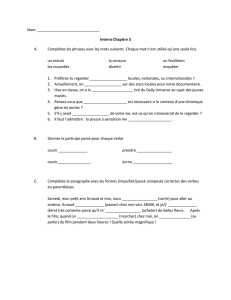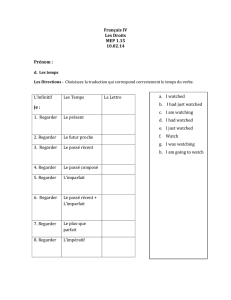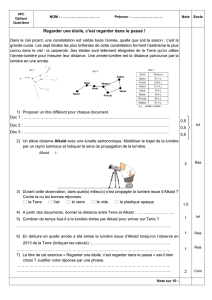GEÏNTEGREERDE PROEF

Une étude syntaxique et sémantique des verbes de
perception visuelle voir et regarder et de leur
complémentation à travers l’histoire du français
Mémoire présenté à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de
Gand en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en Historische taal- en
letterkunde par Annechien van de Wall
Promotrice : Prof. Dr. Van Peteghem
Université de Gand
2011-2012

Voir, regarder et leur complémentation à travers l’histoire du français
1
Table des matières
Table des matières ............................................................................................. 1
Introduction ........................................................................................................ 3
1 Les verbes de perception et les modalités de sens .............................. 6
1.1 Les modalités de sens et la hiérarchie ..................................................... 6
1.2 La polysémie des verbes de perception ................................................... 8
1.3 Les relations sémantiques entre les modalités de sens .......................... 10
1.4 Les verbes de perception : les extensions et la position dans le lexique
et la grammaire .................................................................................................. 11
2 Les verbes de perception visuelle en français contemporain .......... 14
2.1 Le champ des verbes de perception visuelle ......................................... 14
2.2 Voir et regarder dans le Trésor de la Langue Française ....................... 15
2.2.1 Voir dans le TLFi ................................................................................... 15
2.2.2 Regarder dans le TLFi ........................................................................... 19
2.3 La complémentation de regarder et voir ............................................... 22
2.3.1 La construction à objet direct (pro)nominal .......................................... 23
2.3.2 L’attribut de l’objet infinitif .................................................................. 24
2.3.3 L’attribut de l’objet à relative attributive .............................................. 28
2.3.4 Autres types de complémentation à fonction attribut de l’objet ........... 33
2.3.5 Comparaison syntaxique entre les différents types d’attribut de l’objet38
2.3.6 La construction transitive + complément locatif ................................... 41
2.3.7 La proposition complétive ..................................................................... 42
2.3.8 La proposition interrogative indirecte ................................................... 43
2.3.9 La construction à complément de direction .......................................... 44
2.3.10 Résumé des constructions compatibles avec regarder et voir .............. 44
2.4 La sémantique inhérente à regarder et à voir ........................................ 45
2.5 Regarder et voir dans notre corpus de français contemporain .............. 47
3 Voir et regarder à travers l’histoire .................................................... 51
3.1 L’étymologie de voir et de regarder ..................................................... 51
3.2 Voir et regarder en ancien français ....................................................... 51
3.2.1 Voir et (re)garder dans les dictionnaires de l’ancien français .............. 52
3.2.2 Voir dans le corpus d’ancien français .................................................... 53
3.2.3 Regarder dans le corpus d’ancien français ............................................ 61
3.2.4 Garder dans le corpus d’ancien français ............................................... 65
3.3 Voir et regarder en moyen français et en français de la Renaissance .. 66
3.3.1 Voir et regarder dans le Dictionnaire du Moyen Français ................... 67
3.3.2 Voir dans le corpus de moyen français et français de la Renaissance .. 69

Voir, regarder et leur complémentation à travers l’histoire du français
2
3.3.3 Regarder dans le corpus de moyen français et français de la
Renaissance ........................................................................................................ 74
3.4 Voir et regarder en français classique ................................................... 78
3.4.1 Voir et regarder dans le premier dictionnaire de l’Académie française78
3.4.2 Voir dans le corpus de français classique .............................................. 81
3.4.3 Regarder dans le corpus de français classique ...................................... 85
4 L’évolution de la complémentation et de la sémantique de voir et de
regarder ............................................................................................................. 89
4.1 L’évolution de la complémentation de voir et regarder ....................... 89
4.2 Le changement sémantique de voir et de regarder ............................... 92
Conclusion ........................................................................................................ 95
Annexes ............................................................................................................. 97
Bibliographie .................................................................................................. 136

Voir, regarder et leur complémentation à travers l’histoire du français
3
Introduction
L’objet d’étude de ce mémoire sont les verbes de perception visuelle voir et regarder. Notre
premier objectif sera de montrer la position importante de ces verbes, surtout de voir, dans
le champ sémantique de la perception. Nous étudierons, deuxièmement, les différents types
de complémentation qui accueillent ces deux verbes (tels que les attributs de l’objet, la
subordonnée complétive, etc.) tant au niveau syntaxique qu’au niveau sémantique. Nous
tenterons de comprendre comment les structures de complémentation peuvent influencer les
interprétations de voir et de regarder et la sémantique inhérente aux verbes. Ces structures
ont-elles toutes le même fonctionnement syntaxique et sémantique ? Existe-t-il d’autres
compléments, tels que des compléments circonstantiels, qui ont de l’influence sur la
sémantique des deux verbes ? Troisièmement, notre propos sera d’éxaminer les deux verbes
en question de façon diachronique. En nous appuyant sur des corpus des textes en ancien
français, en moyen français, en français de la Renaissance et en français classique, nous
tâcherons de découvrir les tendances syntaxiques et sémantiques de voir et de regarder dans
chacune des périodes. Le but final sera de décrire l’évolution des différents types de
complémentation qui accueillent les verbes de perception ainsi que leur sémantique, c’est-à-
dire de savoir comment les verbes ont évolué au niveau des sens et au niveau des extensions
de sens.
Nous avons entamé notre recherche de chaque période par des définitions que nous
avons récoltées de différents dictionnaires, à savoir le TLFi (Trésor de la Langue Française
informatisé) pour le français moderne, le Dictionnaire Historique de la langue française –
Le Robert pour les périodes anciennes, les dictionnaires bilingues le Grand Dictionnaire de
l’ancien français de Larousse et le dictionnaire de Godefroy pour l’ancien français, le
Dictionnaire du Moyen Français et le premier dictionnaire de l’Académie française édité en
1694 pour le français classique. Nous avons commenté et résumé les définitions, à cause
d’un manque de place pour ces vastes définitions dans notre étude, afin d’en retirer les sens
les plus pertinents pour chaque verbe à telle ou telle époque. Les définitions du TLFi et du
Dictionnaire du Moyen Français sont pourtant à retrouver dans leur intégralité en annexe.
Après avoir rassemblé les définitions fournies par les dictionnaires, nous avons approfondi
l’analyse des verbes voir et regarder par une étude de corpus. Nous avons consulté la
banque de données Frantext, dont nous avons tiré des exemples littéraires récentes de 2008
jusqu’aujourd’hui afin de constituer un corpus de 200 exemples pour chaque verbe en
français contemporain. Nous n’avons récolté que 150 exemples pour les autres périodes, à
cause d’un manque de temps pour analyser des corpus plus larges. Le corpus d’ancien
français a posé des problèmes : en analysant les 150 exemples de voir, nous avons rencontré
beaucoup d’emplois adverbiaux, portant un sens affirmatif, et des emplois nominaux
signifiant ‘la vérité’, que nous avons ensuite éliminés et remplacés par des formes verbales
de voir. En ce qui concerne regarder, nous nous sommes vue dans l’obligation de nous
contenter avec 22 exemples. Cependant, pendant la période de l’ancien français, le verbe
avait garder et esgarder comme synonymes. Nous avons décidé d’examiner un corpus de
garder (81 exemples dans Frantext) afin de trouver les emplois perceptifs de ce mot, dont le
nombre d’exemples est resté à 5. Il était malheureusement impossible de rechercher
esgarder dans Frantext, parce que cette base de données ne nous offre que la recherche de

Voir, regarder et leur complémentation à travers l’histoire du français
4
verbes existants en français moderne. Faute de temps, il n’a pas été possible de rechercher
esgarder dans une autre base de données. Alors, le corpus de la période suivante, le moyen
français, a été complété par des textes en français de la Renaissance afin d’avoir un éventail
de textes suffisamment large pour notre étude. Pour cette période, nous avons de nouveau
dû remplacer les exemples contenant des formes non verbales de voir pour obtenir 150
formes verbales. La recherche de regarder n’a posé aucun problème et nous avons donc
atteint le nombre de 150 exemples. Nous avons encore étudié des exemples de garder, mais
aucun sens perceptif n’a été repéré. Finalement, nous avons sans empêchement trouvé 150
formes verbales de voir et de regarder en français classique.
Après avoir rassemblé les exemples pour notre corpus, nous les avons traités dans le
logiciel Microsoft Access pour constituer notre propre base de données. En premier lieu,
nous avons indiqué si le verbe est accompagné d’un objet direct ou d’un autre complément
obligatoire, et éventuellement s’il est question d’un attribut de l’objet et de quel type
d’attribut il s’agit. Ensuite, nous avons marqué les extensions des verbes pour les classer
dans différents groupes suivant leurs sens déviant du sens perceptif pur. Il n’a pas toujours
été facile de déterminer le sens (la perception pure/ la cognition/ l’opinion/ …), mais nous
discutons des problèmes de classification en montrant les différents types de
complémentation. Nous avons ensuite indiqué le type d’objet direct (concret ou abstrait), ce
qui aide à classer les exemples selon les sens (p.ex. : un COD abstrait signale le plus
souvent un passage à la cognition). Pour le français moderne, nous avons mis en relief
l’agentivité, la télicité1 et la durativité d’une énoncé comportant voir ou regarder, en nous
basant sur l’emploi de certains adverbes (p.ex. : l’adverbe attentivement implique une
perception volontaire et agentive) ou par la séquence de verbes (p.ex. : regarder sans voir
exprime l’aspect non réussi de la perception), auxquels nous revenons plus en détail dans
notre étude. Ensuite il a été intéressant de vérifier si le verbe se trouve à la voix active ou
passive. Nous n’avons plus examiné les traits spécifiquement reliés à l’agentivité, la télicité
et la durativité pour les autres périodes de l’histoire du français pour nous concentrer sur
l’évolution de la sémantique inhérente aux verbes ou indiquée par la complémentation.
Néanmoins, le nombre d’exemples pourrait ne pas être suffisant et ceci pourrait en
conséquence influencer l’objectivité de notre travail. Néanmoins, nous sommes d’avis que
notre corpus peut servir d’un bon outil pour montrer des tendances syntaxiques et
sémantiques de voir et de regarder à travers l’histoire du français.
Pour montrer l’importance de la vision et des verbes de perception visuelle, nous
nous appuyons dans un premier temps sur Viberg (1984, 2001) qui a étudié de manière
comparative le champ des verbes de perception en général.
Dans un deuxième temps, nous nous limitons aux verbes de perception visuelle, en
exposant d’abord le champ qui s’organise autour de regarder et de voir. Les définitions du
TLFi servent de point de référence des sens que nous rencontrons. Nous entamons ensuite
l’analyse sémantique et syntaxique de la complémentation de voir et de regarder, en nous
basant sur d’autres linguistes tels que Willems (1983, 2000b, 2011), Willems et Defrancq
(2000a), Miller et Lowrey (2003) et Guimier (1998), qui se sont intéressés à quelques types
de complémentation en particulier. La sémantique inhérente à voir et à regarder ne manque
1 Ce terme a été emprunté à Willems (2011), qui réfère à l’aspect réussi de la perception.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
1
/
141
100%