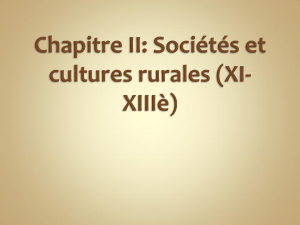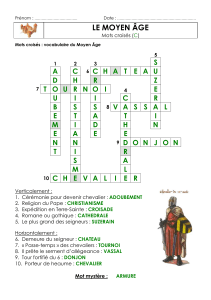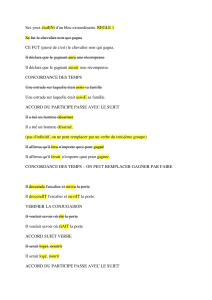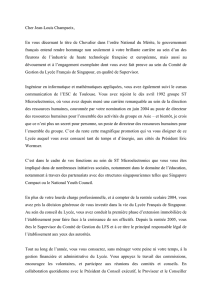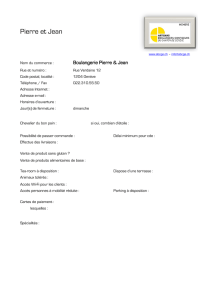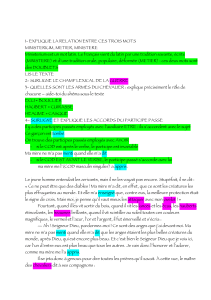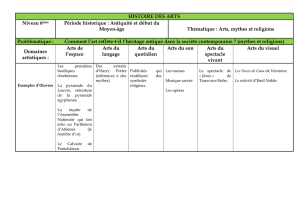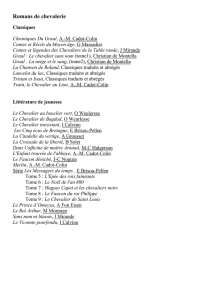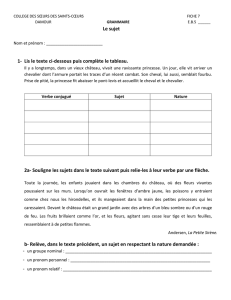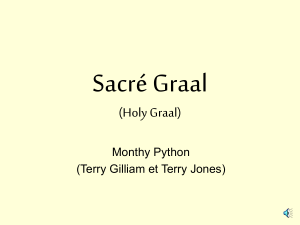Julien Chevalier Notice biographique - Quintes

Le Dr Julien Chevalier (Romans, 1860 - Paris, 1943)
Un première version de cette notice a paru dans :
Capri - Zeitschrift für Schwule Geschichte. n° 29. Oktober 2000. pp. 21-22.
La première thèse de médecine en langue française consacrée au nouveau concept psychiatrique
« d’inversion sexuelle » date de 1885. Elle est signée Julien Chevalier. Cette thèse
1, remaniée et
enrichie, sera republiée en 1893 chez Storck, imprimeur & éditeur lyonnais2. Chevalier sera cité par de
nombreux auteurs. Quelques-uns d’entre eux, comme Havelock Ellis, Wilhelm Stekel et un certain
Sigmund Freud, le citeront, curieusement, pour une théorie dont il n’est pas l’inventeur : celle de la
bisexualité de l’embryon à l’origine de l’aptitude à l’inversion. Malgré ce succès, aucune donnée
biographique concernant Julien Chevalier n’avait jamais été publiée jusqu’en 2000, de sorte que les
catalogues des différentes bibliothèques nationales (y compris celui de la Library of Congress, le
mieux documenté) ne mentionnent ni date de naissance, ni date de décès pour cet auteur. Aussi avions
nous décidé d’entreprendre des recherches afin d’obtenir un minimum de renseignement sur ce
médecin peu connu, appartenant néanmoins à l’école lyonnaise, qui, sous l’égide du Dr Alexandre
Lacassagne, a tenu un nouveau discours sur l’amour viril, dégagé du concept de dégénérescence et un
peu moins entaché d’irrationalité. Aux données biographiques qui proviennent du dossier militaire de
Julien Chevalier conservé au service historique de l’armée de terre, à Vincennes3, ainsi qu’aux trois
lettres de Chevalier adressées au professeur Lacassagne et conservées à la bibliothèque municipale de
Lyon4, sont venu s’ajouter les données du dossier de la Légion d’honneur et des relevés de l’État civil
de la ville de Romans.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 De l’inversion de l’instinct sexuel au point de vue médico-légal . Thèse présentée à la faculté de Médecine et de
Pharmacie de Lyon et soutenue publiquement le 3 novembre 1885. Lyon, Imprimerie nouvelle, 1885.!
2 L’inversion sexuelle, Psycho-physiologie, sociologie, tératologie. Préface du Dr Lacassagne. Lyon, Storck,
1893.
3 Dossier personnel (cote : 11 Yf 4989).
4 Manuscrits Lacassagne 6 079. Bibliothèque municipale de Lyon La Part-Dieu.

Julien Chevalier est le fils d’un négociant, Barthélémy Etienne Ferdinand Chevalier et de Julie
Céline Periollat. Sans être un enfant de vieux, il naît dans un ménage plutôt âgé : son père a 47 ans et
sa mère 34 ans, lorsqu’il voit le jour. Détail intéressant qu’a révélé Mme Donadieu : dans l’acte de
mariage des parents, il est précisé que de l’époux (donc la mère de Julien) est absente et incapable de
donner son consentement, en raison de son internement dans une maison de santé pour maladie
mentale :
On ne sait rien de la scolarité de Julien, une scolarité que l’on peut simplement supposer bonne sur
la base de sa future carrière. La chance de sa vie est d’entrer comme élève de l’école de Santé de
l’hôpital militaire de Lyon le 12 octobre 1882. Il y entreprend en effet sa fameuse thèse sous la
direction du professeur Alexandre Lacassagne (Cahors, 1843 - Lyon, 1824), un homme d’une grande
culture qui va créer l’école d’anthropologie criminelle lyonnaise et donner une impulsion nouvelle à
l’étude de « l’inversion sexuelle », notamment grâce à ses Archives de l’Anthropologie criminelle5.
Comme nous l’avons dit, Julien Chevalier soutient cette thèse – sur laquelle nous allons revenir – en
1885. Immédiatement après, le 10 novembre 1885, il est affecté au val de Grâce pour y faire ses
« premières armes » de médecin militaire : il est nommé médecin aide major de 2ème classe en octobre
1886.
Sa longue carrière coloniale débute au Soudan en 1893, année où son livre Une maladie de la
personnalité : l’inversion sexuelle, tiré de sa thèse, est publié à Lyon par les Editions Storck. La
France est alors en guerre au Soudan, et Julien Chevalier après deux années d’exercice difficile de son
métier dans cette région, bénéficiera d’un congé de convalescence de 6 mois pour « anémie coloniale
profonde ». Il passe ce congé dans sa ville natale, à Romans, après quoi il reprend son service, début
1896, en Algérie (Mostaganem, Tlemcen). Il y restera trois ans, avant de servir au Tonkin au tournant
du siècle (1899-1902). Puis, à nouveau, il est affecté en Algérie, où il séjournera dix ans, avant d’être
nommé, en 1912, au Maroc, nouveau protectorat français. La France a désigné cette année là, pour ce
pays, un administrateur qui aurait pu faire l’objet d’une belle analyse dans le cadre de la thèse de
Chevalier : Louis Hubert Lyautey, futur maréchal de France, et pédéraste notoire.
En 1913, le médecin principal de 2ème classe Julien Chevalier est nommé chef de l’hôpital de
campagne de Casablanca. C’est à Casablanca qu’il se trouve lorsqu’éclate la première guerre
mondiale. Il s’y marie aussi, tardivement, à l’âge de 54 ans, devant le consul de France, le 14
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Archives de l’Anthropologie criminelle, de criminologie, de médecine légale et de psychologie normale et
pathologique. Lyon, Storck et Rey. 29 volumes de 1886 à 1915. À cette école lyonnaise se rattachent par leurs
publications : Marc-André Raffalovich, les Drs Laupts (Georges Saint Paul), Emile Laurent, Eric Simac (il s’agit
du pseudonyme du Dr Guichard : cf. Kevin Dubout – Éric Simac (1874-1913) Un oublié du Mouvement de
libération homosexuel de la Belle Époque. Quintes-feuilles, 2014), Etienne Martin et Jean Arrufat, ce dernier
étant l’auteur d’une brève (35 pages) mais intéressante thèse sur Un mode d’évolution de l’instinct
sexuel (pédérastie) (Lyon, 1892).
!

novembre 1914. Il épouse une Alsacienne plus jeune que lui de dix ans, Philomène Irma Bister. Le
« jeune ménage » n’aura pas d’enfant.
Le médecin principal Julien Chevalier passe presque toute la première guerre mondiale au Maroc.
Il quitte Casablanca le 15 mai 1918 pour un congé de convalescence de 45 jours, puis est affecté à
Lille comme sous-directeur du service de santé de la région Nord. Lorsqu’il y arrive effectivement, en
novembre 1918, après une hospitalisation à Boulogne, l’armistice est déjà signé. Il est mis en congé
illimité de démobilisation sans solde, et effectue des « stages successifs » de trois mois jusqu’en 1922,
année où il où il est affecté au gouvernement militaire de Paris. Il avait atteint le grade de médecin
principal de première classe, lorsqu’il est rayé des cadres le 6 octobre 1924. Il vivra sa retraite avec sa
femme à Paris, Bd Montparnasse d’abord, puis, toujours dans le même quartier, rue Emile Duclaux. Il
aura la tristesse de voir éclater une seconde guerre mondiale et mourra à l’âge de 83 ans, le 12 août
1943, dans son appartement de la rue Emile Duclaux à Paris, laissant une veuve. Il a été nommé
successivement Chevalier de la Légion d’honneur en 1896, Officier en 1911, puis Commandeur en
1918.
Ses supérieurs hiérarchiques, qui l’ont noté tout au long de sa carrière militaire comme très
intelligent, de moralité irréprochable, très instruit, très au courant du mouvement scientifique, ne
semblent avoir jamais eu connaissance du travail de Chevalier sur « l’inversion sexuelle ». Tout au
plus, l’un de ses supérieurs, lorsqu’il était à Oran, a-t-il signalé que Chevalier, dont il souligne la
culture, a rédigé, pour mettre en garde les soldats, deux notices, l’une sur la syphilis et l’autre sur
l’alcool.
Le seul intérêt que présente aujourd’hui sa thèse de 1885 est d’ordre historique. Elle permet en
effet de faire le point sur une période charnière de l’évolution des idées médicales concernant l’amour
interviril. De ce point de vue, elle constitue un outil bibliographique incontournable. Chevalier se livre
en effet à une analyse exhaustive des articles de psychiatrie et de médecine légale parue sur l’inversion
sexuelle jusqu’à son propre travail.
En outre, les angles historique et littéraire sous lesquels il examine un fait anthropologique
séculaire est l’un des mérites principaux que l’on pourrait porter au crédit de sa thèse. Elle paraît offrir
la synthèse d’un travail d’érudition très fouillé et particulièrement étendu. Mais en réalité, tout le
chapitre que Chevalier intitule « historique des faits » a pour source quasi unique la monumentale
(huit volumes) Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l’antiquité la plus
reculée jusqu’à nos jours de Pierre Dufour (l’un des pseudonyme de Paul Lacroix, plus connu sous le
nom de plume du « bibliophile Jacob »). Chevalier s’est contenté d’en extraire méthodiquement les
parties concernant la pédérastie, en recopiant du reste certains passages. Il se garde toutefois de
mentionner cette référence dans sa bibliographie : la ruse élémentaire d’un bon plagiaire est de fournir
toutes les références qu’il connaît, à l’exclusion de celle qu’il a pillée. Il est possible que Lacassagne,
qui, dans l’un de ses cours de faculté, présente le travail de son élève quasiment comme le sien6, a
communiqué à Chevalier cet ouvrage de Paul Lacroix, qui figure dans sa très vaste bibliothèque7.
C’est du reste l’apport de l’ensemble de l’école lyonnaise sur la question de l’homosexualité qui
mérite une analyse, davantage que la contribution relativement modeste d’individualités comme Julien
Chevalier.
Jean-Claude Féray
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Manuscrit 6 124. Cours de Lacassagne. Bibliothèque municipale de Lyon La Part-Dieu.
7 Avant son décès, Alexandre Lacassagne a fait don de sa collection personnelle (12 000 livres) à la Bibliothèque
municipale de Lyon. Grâce au fonds Lacassagne, la Bibliothèque de Lyon est, en France, l’une des plus riche en
ouvrage anciens concernant l’homosexualité. Cf. Claude Roux - Catalogue du fonds Lacassagne.Lyon,
imprimerie nouvelle lyonnaise, 1922.
!
1
/
3
100%