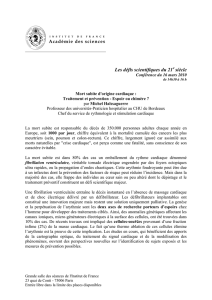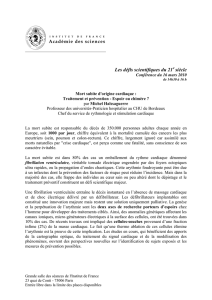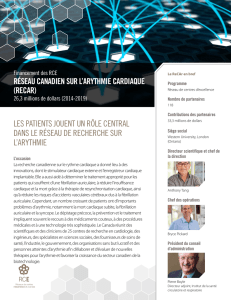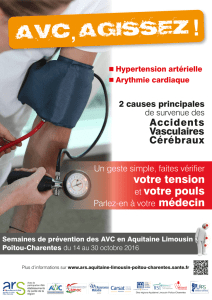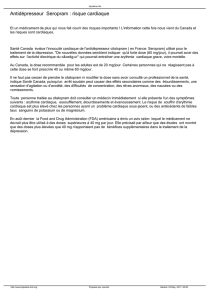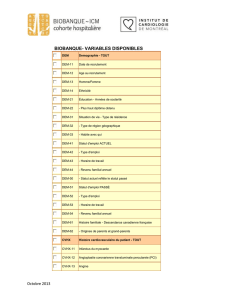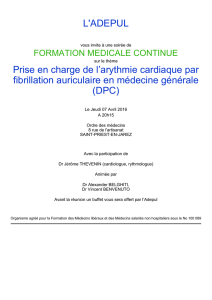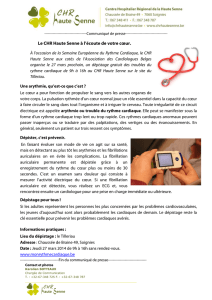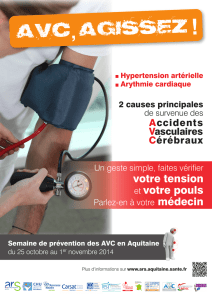Maladies cardiovasculaires et aptitude au travail

15
Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n°12, décembre 2000 - (13), n° 1, janvier 2001
progrès en
Prévention au quotidien
Les progrès de la thérapie
cardiovasculaire (par
exemple : fibrinolyse,
angioplastie coronarienne,
pontage coronarien, tech-
nologie des stimulateurs
cardiaques, “défibrillateurs
cardiaques automatiques
implantables” et médica-
ments) font que la fonction
cardiovasculaire de nom-
breux patients est restaurée
à tel point que la reprise du
travail est possible.
Toutefois, les MCV peu-
vent entraîner toute une
série de problèmes médi-
caux : nécessité de réédu-
cation physique ; comment
évaluer la capacité fonc-
tionnelle résiduelle ; le pro-
nostic de la maladie à court
et moyen terme ; le risque d’une attaque car-
diaque mettant en danger la vie des patients
et de leurs collègues ; être sûr de l’innocuité
du traitement administré vis-à-vis des perfor-
mances du sujet au travail. Il faut tenir comp-
te que, même avec un traitement idéal, beau-
coup de sujets ne peuvent reprendre le travail
pour nombre de raisons, psychologiques ou
sociales. Le travail ne peut être repris
qu’avec la coopération de différentes parties,
telles que le médecin du patient, le cardio-
logue et l’employeur (des aménagements de
travail pouvant être nécessaires par la suite).
Par conséquent, en termes techniques, la
décision de reprendre ou non le travail
implique non seulement de soupeser les
considérations médicales mais aussi le profil
psychologique du patient et les facteurs liés à
la spécificité de son travail.
Évaluation médicale et profil
psychosocial
Les études sur la reprise du travail ont
montré qu’un grand nombre d’éléments
sont à prendre en compte :
Nature exacte de l’événement cardio-
vasculaire initial qui a entraîné l’arrêt
du travail
La raison la plus commune est la coronaro-
pathie qui peut aller de l’infarctus du myo-
carde à l’angine de poitrine traitée par ponta-
ge, angioplastie ou simplement par
médicaments. Dans les coronaropathies,
quelle qu’en soit la forme, certains éléments
cliniques dominent toujours : le patient est-il
encore sujet ou non à des crises d’angor d’ef-
fort ? y a-t-il un risque d’arythmie ? quelle
est l’efficacité de la fonction ventriculaire
gauche ? tous éléments pouvant limiter sa
capacité d’exercice physique. Il est important
de noter, chez les patients
qui n’ont pas de séquelle
d’angine de poitrine, que ni
leur état cardiovasculaire
(qu’il y ait ou pas d’infar-
cissement), ni la nature du
traitement (qu’il comporte
seulement un traitement
médicamenteux ou égale-
ment un pontage) n’ont
d’importance lorsqu’il
s’agit de décider de la repri-
se du travail. La possibilité
d’une ischémie du myocar-
de silencieuse doit être
aussi prise en compte,
déterminant l’importance
du pronostic et le test d’ef-
fort maximal systématique
et/ou un Holter cardiaque
(ECG) doivent être recom-
mandés chez les patients à
risque, spécialement chez les diabétiques.
Bien que les patients tendent à reprendre le
travail trop tôt, tant après une angioplastie
coronarienne qu’après un pontage, les
chiffres démontrent que les perspectives
d’emploi à long terme sont les mêmes.
L’ h ypertension artérielle non traitée
peut rendre la reprise du travail difficile,
en partie à cause des symptômes (maux de
tête, vertiges, sensation de mal être) qui
peuvent diminuer les performances, mais
surtout parce que le fait de travailler a ten-
dance à augmenter l’hypertension. Les
efforts statiques et dynamiques peuvent
accroître d’une manière significative la
pression artérielle, et les facteurs psycho-
logiques peuvent rompre l’équilibre des
mécanismes essentiels, perturbant de ce
fait le niveau de la pression artérielle, non
seulement pendant le travail mais égale-
ment tout au long du cycle circadien.
Les sensations de malaise ou de syncope
cardiaque sont des indicateurs de risque
Maladies cardiovasculaires et aptitude au travail
Régis de Gaudemaris*
* Service de pathologie professionnelle, CHR
de Grenoble.
Les maladies cardiovasculaires (MCV) apparais-
sent généralement avant l’âge de la retraite, et
une partie de ceux qui sont atteints d’une attaque
cardiaque travaillent toujours normalement à temps
plein. En vertu de leur âge, de tels sujets sont très
expérimentés et occupent souvent des postes à res-
ponsabilité. Les coûts indirects associés aux congés
de maladie peuvent être élevés. Ainsi, la reprise du
travail est un élément important pour le patient lui-
même et pour l’employeur. À titre d’exemple, en
Angleterre en 1983, la prévalence des maladies
coronaires cardiaques parmi les travailleurs de l’in-
dustrie était de 10,4 cas pour 1 000 individus, et
cette maladie était responsable de 13 % des
retraites anticipées pour raison de santé.

16
Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n°12, décembre 2000 - (13), n° 1, janvier 2001
progrès en
Prévention au quotidien
important de rechute avec toutes leurs
conséquences vis-à-vis de l’environnement
de travail. Différentes normes ont été arrê-
tées concernant les examens physiques et les
tests fonctionnels, mais remettre un patient
au travail ne doit pas être envisagé sans avoir
réalisé une totale évaluation et avoir établi
une stratégie stable et définitive.
Les améliorations des médicaments dispo-
nibles pour le traitement des défaillances
cardiaques (IEC, bêtabloquants spécifiques)
et les techniques de rééducation ont signifi-
cativement augmenté le nombre de patients
capables de reprendre leur vie profession-
nelle. Le point le plus important sur le plan
clinique dans ce cas est de savoir comment
est géré le problème cardiaque qui a causé la
crise initiale.
Étendue de la perte fonctionnelle
La reprise du travail suscite des efforts phy-
siques supplémentaires pour des actions de
routine comme le trajet pour s’y rendre et les
déplacements sur le lieu de travail, et il en est
de même des efforts physiques liés au travail
proprement dit. Pendant un examen car-
diaque standard, la capacité fonctionnelle
d’un patient peut être évaluée par un test
d’effort (pour l’HTA et la maladie corona-
rienne) ou par un test d’effort avec mesure de
la consommation d’oxygène. Bien que ne
faisant pas partie de l’examen cardiologique
habituel, quelques-unes des nuisances tant
physiques que psychologiques liées au lieu
de travail peuvent être simulées en laboratoi-
re tout en mesurant l’effet cardiovasculaire.
Les capacités fonctionnelles pouvant être
augmentées avec de la rééducation car-
diaque, on considère qu’il faudrait adres-
ser les patients à un centre de rééducation
avant la reprise du travail. Ces centres pro-
posent des programmes spécialement
adaptés pour préparer les patients à une
variété de différents types de conditions
de travail – par exemple, transporter pro-
gressivement des charges de plus en plus
lourdes ou solliciter de plus en plus de
manipulations avec les bras.
Quand le patient a repris le travail, on peut
évaluer le stress physique en utilisant un
Holter cardiaque (ECG) ou un intégrateur
des pulsions cardiaques étalonné avec des
indices spécifiques et validés. Dans beau-
coup de lieux de travail, il est possible aussi
de se faire prendre la TA ambulatoire. Une
surveillance ambulatoire (idéalement par
Holter cardiaque et Holter tensionnel) est
d’une grande utilité pour mesurer l’impact
d’autres facteurs de stress dus au travail (par
exemple : physique, chimique, psychosocial,
ergonométrique) – particulièrement la part
qu’ils représentent – sur les paramètres car-
diovasculaires cliniquement pertinents. Avec
l’aide de telles techniques, les médecins peu-
vent moduler leur décision pour autoriser le
patient à reprendre le travail.
Pronostic et facteurs de risque associés
à un trouble cardiaque
Une reprise du travail n’en vaut la peine que
si elle s’étale sur une période suffisamment
longue. Donc il est important d’évaluer la
probabilité qu’un sujet puisse continuer son
activité professionnelle pour une moyenne,
voire une longue période. Cette estimation
du pronostic doit inclure : la probabilité des
conditions de détérioration ; l’importance
des facteurs de risque professionnels (stress,
pressions physiques importantes) ; tout autre
facteur de risque iatrogène (tabac, taux de
cholestérol, TA) ; la capacité d’investisse-
ment du patient.
Facteurs personnels entrant dans la
décision de reprise du travail
Les facteurs psychologiques et sociaux
sont plus importants que les considérations
médicales quand il s’agit d’une décision de
reprise du travail. Cela implique que le
patient devra adhérer au plan décidé ci-des-
sus, surtout si un changement de poste ou
une reconversion professionnelle sont néces-
saires. Plusieurs études ont utilisé différentes
méthodes d’analyse pour identifier les fac-
teurs clés qui déterminent ou modifient la
décision de reprise du travail. Ces critères
peuvent être classés dans de nombreux
groupes différents :
– la probabilité de reprise est inversement
proportionnelle à la durée d’arrêt de tra-
vail, quel que soit le pronostic de l’acci-
dent cardiaque ;
– les retombées psychologiques de l’acci-
dent cardiaque qui a provoqué l’arrêt du
travail se révèlent particulièrement sen-
sibles si le malaise cardiaque ou la perte
de connaissance s’est produit sur le lieu de
travail (au milieu d’autres personnes), ou
si le patient a subi une intervention chi-
rurgicale et souffert de complications de
sternotomie (par exemple : si la cicatrisa-
tion de la plaie l’a fait souffrir) ;
– l’âge du patient et le taux de pension de
retraite sont intimement liés : les plus âgés
(par exemple : les plus proches de la retrai-
te), ceux qui peuvent prétendre à une retrai-
te anticipée et ceux qui préfèrent arrêter de
travailler avant l’âge statutaire de la retraite ;
– la reprise du travail est subordonnée à la
motivation quotidienne pour se lever et aller
travailler. Les patients sont moins enthou-
siastes pour retourner à un travail monotone
ou de routine ou qui ne fait pas appel à leurs
talents personnels ou à leurs compétences ;
– le niveau d’éducation ou de formation
des patients et leur aptitude à une recon-
version est un facteur important. Quand
c’est nécessaire, un reclassement peut être
perçu comme un changement vers un tra-
vail moins physique ; certains en seront
demandeurs (par exemple : en informa-
tique). Un tel changement n’est pas tou-
jours compatible avec la formation initia-
le du patient ou de ses conséquences.
Motivations du médecin
Les médecins sont souvent réticents à faire
reprendre le travail à leurs patients, même en
présence de tests non ischémiques, en fon-
dant leur inquiétude sur le pronostic.
Le travail et son environnement
Toute information intéressante peut nor-
malement être obtenue au cours d’un
entretien approfondi avec le patient, mais

17
progrès en
Prévention au quotidien
une visite sur le lieu de travail s’avère par-
fois aussi nécessaire. Il est essentiel de tra-
vailler de concert avec les services de méde-
cine du travail et de sécurité de l’employeur.
L’entretien doit envisager toutes les compo-
santes du travail susceptibles d’intervenir
dans la décision de reprise et mettre en
lumière toutes les situations qui peuvent per-
turber l’état physique du patient.
Aspects du travail à prendre en consi-
dération
Certains travaux combinent, à des niveaux
différents, une activité physique (travail
statique et dynamique) à un stress psycho-
sensoriel. L’argument le plus fréquent
contre une reprise est que le travail
implique des efforts physiques soutenus
(tant statiques que dynamiques). Cepen-
dant, un travail qui demande un effort phy-
sique modéré prévient certainement mieux
une rechute de coronaropathie qu’un travail
totalement sédentaire. Dans le contexte de
l’insuffisance coronarienne, il est égale-
ment nécessaire d’identifier les facteurs
qui pourraient réactiver quelques
séquelles d’ischémie coronarienne, par
exemple le travail en altitude ou à des tem-
pératures extrêmes (chaudes ou froides),
ou la possibilité que le patient soit exposé
au monoxyde de carbone (d’autant plus si
le patient est toujours fumeur).
Il est particulièrement important d’identi-
fier les patients qui ont un travail à haut
risque – travail pour lequel l’opérateur,
dans le cas où un problème cardiaque
soudain (syncope cardiaque, arythmie
sérieuse) peut induire un risque ou mettre
en danger la vie d’autres personnes.
Postes de travail potentiellement nui-
sibles
Le travail en équipe peut aggraver la mala-
die cardiaque (HTA et insuffisance corona-
rienne ou cardiaque) par le changement de
rythme circadien qui régule la TA et le
pouls. Le travail de nuit ou débutant tôt le
matin (4-5 heures) coïncide avec le moment
où le système cardiovasculaire est normale-
ment au repos (où le taux des catéchola-
mines est le plus bas). D’autant plus que, si
les horaires journaliers de travail changent
constamment, il est difficile de planifier les
prises de médicaments pour couvrir effica-
cement une période de 24 heures.
Le stress psychologique lié au travail, tel
qu’il est défini par Karasek et Siegrist, peut
exacerber l’HTA et la MCV. Si les conditions
de travail sont mauvaises, l’équilibre théra-
peutique peut être déréglé et de nouveaux
symptômes peuvent apparaître. Même
quand on ne peut pas prouver un lien direct,
les patients mettent en avant ces conditions
de travail pour expliquer leur état, et il faut en
tenir compte en cas de refus de reprise du tra-
vail. Dans la plupart des études sur la reprise
du travail, la qualité psychosociale de l’envi-
ronnement du travail n’a pas été étudiée ni
incluse dans les critères du pronostic. De
plus, ces études sur le pronostic n’ont pas été
menées sur un temps assez long. Sur la base
de ces données, et en y ajoutant de nom-
breuses autres études qui démontrent un
risque excessif de morbidité des MCV parmi
les travailleurs soumis au stress et à d’autres
conditions psychosociales du travail défavo-
rables, Theorell et Karasek se sont demandé
si les patients atteints de crise cardiaque
devraient reprendre un travail stressant.
Décision du retour au travail
Il n’est possible de remettre un patient au tra-
vail qu’avec son accord. Des problèmes
apparaissent, à cause de capacités fonction-
nelles diminuées quand il est nécessaire, de
modifier les conditions de travail ou de chan-
ger complètement de travail. La décision
définitive de savoir si le patient doit
reprendre le travail est du ressort, dans le
meilleur des cas, du cardiologue en liaison
avec le spécialiste de médecine du travail.
Tous les pays (chaque État pour les États-
Unis) ont leurs propres règlements. En
Europe, tout particulièrement en France et en
Allemagne où la médecine du travail est trai-
tée par des spécialistes, le retour au travail est
plus facilement organisé avec l’entière parti-
cipation de l’entreprise, car elle est au cou-
rant de toutes les conditions particulières du
travail et des possibilités de recyclage au sein
de l’entreprise. L’approche est nécessaire-
ment plus compliquée dans les pays où la
médecine du travail est moins réglementée et
fondée surtout sur des questions de sécurité.
Questions de sécurité
Une activité est considérée à haut risque si le
travailleur met en jeu la vie des autres à l’oc-
casion d’une perte soudaine de capacité dans
l’exercice de son travail. De tels accidents
peuvent survenir lors d’un malaise profond,
d’une syncope, voire d’une mort subite. Du
point de vue cardiologique, une perte soudai-
ne de conscience est normalement due à une
arythmie aggravée par un problème car-
diaque préexistant. Bien que l’arythmie ven-
triculaire ait été considérée traditionnelle-
ment comme le risque majeur, certaines
variétés d’arythmie supraventriculaire qui
ont jusqu’à présent été considérées comme
relativement bénignes ainsi que des bradya-
rythmies peuvent également entraîner une
syncope ou une mort subite. Il est difficile
d’estimer avec précision le risque de synco-
pe, et il n’est pas toujours possible de prévoir
son apparition même quand un examen car-
diologique complet a été effectué.
Type de travail
La plupart des emplois qui présentent des
problèmes de sécurité publique sont ceux qui
concernent la conduite de véhicule (par
exemple : camion, véhicule de transport
publique, engin de travaux publics, voiture,
avion et train). Néanmoins, d’autres emplois
(grutier, manipulation de produits industriels
dangereux) sont aussi concernés. De plus,
bien que peut-être pas directement associée
au travail, la conduite d’une voiture, mode de
transport courant pour se rendre au travail,
peut avoir un effet sur la sécurité publique.
L’estimation du risque pour la conduite
d’une voiture reste compliquée, mais des
statistiques ont été faites pour les conduc-
teurs professionnels sur la route : des

18
Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n°12, décembre 2000 - (13), n° 1, janvier 2001
progrès en
Prévention au quotidien
études américaines et canadiennes démon-
trent que moins de 0,1 % des accidents de la
route sont attribuables à un problème de
santé, et que seulement 10 à 25 % de ceux-ci
sont associés à un événement cardiaque.
Dans une étude du réseau des transports
publics de Londres, 6 accidents seulement
sur une période de 20 ans ont été attribués à
un accident cardiaque du conducteur ; pen-
dant cette période, 6,8 millions de miles ont
été parcourus, ce qui correspond à 334 000
heures de conduite. Il est raisonnable de
conclure que les conducteurs asymptoma-
tiques, qui répondent aux critères actuels éta-
blis par les cardiologues, peuvent reprendre
le travail sans se mettre de manière significa-
tive en danger, ni leurs passagers, ni les
autres usagers.
Pour les accidents d’avion des lignes com-
merciales, il est rare qu’ils soient associés à
des problèmes de santé. Bien qu’un tiers des
pilotes aient été victimes d’une incapacité
passagère en vol (généralement gastro-intes-
tinale), il y a eu dans chaque cas suffisam-
ment de temps pour que le copilote prenne
les commandes. En Europe, on estime le
nombre des accidents d’aviation commercia-
le mortels à un pour 100 millions d’heures de
vol et dont seulement 1 % peut être attribué
à des problèmes médicaux. Epstein et al.
déclarent : “Une étude de l’association inter-
nationale du transport aérien (IATA), sur
36 000 pilotes à risque sur 10 ans, n’a établi
que 26 cas d’événements cardiovasculaires
ou neurologiques qui auraient pu mettre en
danger la sécurité s’ils avaient eu lieu à un
moment critique (c’est-à-dire au décollage
ou à l’atterrissage).” Il n’existe pas de chiffre
pour d’autres métiers à haut risque.
Risque de perte de conscience
L’évaluation du risque individuel de syncope
peut se faire par l’approche diagnostique
fondée sur les paramètres récemment établis
par l’American College of Physicians. Ceux-
ci prennent en compte l’historique clinique
du patient et les résultats d’une série d’exa-
mens, par exemple, ECG, électrophysiolo-
gie, Holter ou télémétrie.
La décision de reprendre ou non un poste à
haut risque dépend de la nature précise du
trouble cardiaque et de la possibilité qu’il
déclenche une arythmie sérieuse. Du point
de vue pratique, les principaux facteurs à
prendre en compte sont : la probabilité que
l’arythmie du patient réapparaisse malgré le
traitement, la probabilité que cette arythmie
puisse mener à la perte de contrôle par le
patient de toute machine ou procédure dont il
est responsable, et la probabilité que cette
perte de contrôle engendre un accident. En
ce qui concerne la conduite de véhicule, un
modèle mathématique pour évaluer ce risque
a été mis au point. Ce calcul prend en comp-
te le type de véhicule, le nombre d’heures de
conduite par an, le risque de syncope ou de
mort subite au cours de l’année, et la possi-
bilité que la perte de contrôle puisse mettre
en danger d’autres usagers de la route.
Suite à une estimation des divers risques, la
déclaration médico-scientifique de
l’American Heart Association estime que le
risque d’accident est très faible mais sou-
ligne que c’est le risque d’arythmie qui
devrait être pris en compte plus sérieuse-
ment au moment de prendre la décision de
renvoyer ou non un patient dans un travail à
haut risque. Bien que chaque cas soit à trai-
ter individuellement, en tenant compte des
particularités du travail et surtout de la
période pendant laquelle il existe un vrai
danger, les conditions spécifiques suivantes
peuvent être prises en référence :
•Ceux pour lesquels la possibilité de
reprendre un travail à haut risque est com-
plètement exclue :
– patients de la classe II ou IV de l’arrêt
cardiaque ;
– patients qui ont récemment subi un
infarctus du myocarde lié à une importante
perte de la fonction ventriculaire, accom-
pagné d’arythmie ventriculaire ou d’une
diminution du rythme cardiaque ;
– patients qui ont déjà subi un arrêt car-
diaque et qui ont été ranimés.
•Ceux qui devraient pouvoir reprendre le
travail sans problème s’ils sont asympto-
matiques. Les porteurs :
– de bradycardie ou tachycardie sinusale ;
– de tachycardies paroxystiques supraven-
triculaires ;
– de bloc artérioventriculaire de type I au
1er ou 2edegré.
•Pour tout autre type d’arythmie (dys-
rythmie ventriculaire, artérioventriculaire
sans reflux, syndrome de Wolff Parkinson
White, syndrome syncopal neural traité) :
l’avis d’un cardiologue doit être demandé
pour le diagnostic, la stratégie du traite-
ment et les décisions à prendre quant au
retour au travail.
Stimulateurs cardiaques et produits
cardiovasculaires pharmacologiques
Le port d’un stimulateur cardiaque n’ex-
clut pas automatiquement le travail en
situation à haut risque, mais il faut
prendre des mesures de sécurité particu-
lières si ce travail s’effectue dans un envi-
ronnement comportant des champs
magnétiques importants (techniciens en
électrolyse et électriciens). La décision de
remettre ou non des patients porteurs de
défibrillateurs implantés au travail ne
dépend pas de cet appareillage mais plutôt
de la raison pour laquelle cet appareillage
a été implanté. Une étude européenne,
réalisée auprès de 46 cardiologues spécia-
listes en stimulateurs cardiaques, concer-
nant les conseils à donner pour la reprise
de la conduite de véhicules aux patients
porteurs de défibrillateurs cardiaques
automatiques implantés a démontré que la
moitié des patients auxquels leur médecin
a déconseillé de conduire se sont mis à
conduire dans les six mois suivant l’im-
plantation et qu’aucun accident mortel n’a
été enregistré suite à une arythmie.
Parmi tous les médicaments qui peuvent être
prescrits, il faut faire particulièrement atten-
tion aux bêtabloquants et aux antiaryth-
miques. Les premiers peuvent entraîner une
diminution de la vigilance, une somnolence
ou une dépression, le tout étant à prendre en
compte lors de la prescription. Les antiaryth-
miques de classe I et III ne devraient pas être
utilisés dans des cas d’arythmie bénigne car,

19
progrès en
Prévention au quotidien
comme il est largement reconnu par les car-
diologues, ils peuvent d’eux-mêmes déclen-
cher une arythmie plus grave (effet pro-
arythmique). Dans tous les cas d’arythmie,
un suivi électrocardiographique continu doit
être mis en place pour vérifier que les médi-
caments agissent avant de permettre au
patient de reprendre le travail.
Considérations éthiques
Malgré le fait que beaucoup de patients
bénéficient largement d’un traitement radi-
cal, il est possible qu’il leurs soit interdit de
reprendre le travail à cause de réglementa-
tions spécifiques liées aux polices d’assu-
rance, retrait du permis de conduire ou
autres restrictions professionnelles. Le
médecin traitant la maladie cardiaque est
assujetti au secret médical, mais maintenir
ces règlements peut entraîner des problèmes
éthiques si le patient a décidé d’ignorer le
risque engendré par le retour au travail, tout
particulièrement s’il refuse de consentir à
informer totalement le médecin qui sera res-
ponsable de la décision de reprise d’un tra-
vail à haut risque. Le médecin traitant peut
être blâmé s’il refuse de garder le secret
médical, alors qu’un sens personnel de la
responsabilité exigerait que la confidentiali-
té soit rompue.
On est confronté à ce genre de problème
éthique surtout lorsqu’il s’agit de conduc-
teurs de poids lourds, pour lesquels vie pro-
fessionnelle et vie sociale sont inséparables
et qui sont souvent peu disposés à abandon-
ner leur travail. De plus, la réglementation
qui stipule les critères d’examens physiques
qu’ils doivent subir pour maintenir leurs
permis de conduire spéciaux poids lourd ou
véhicule de travaux publics ne concerne pas
toujours les patients avec des problèmes car-
diaques. La réglementation ne prend pas en
compte les erreurs des médecins, ni les
conditions de travail (par exemple : condui-
te solitaire, longues heures de travail, stress
associé à des délais de livraison, travail phy-
sique et lourd qu’implique le déchargement,
grandes variations de température).
Il est donc préférable d’initier une série
d’entretiens – éventuellement avec la parti-
cipation de la famille du patient ou d’un psy-
chologue qualifié – pour essayer de raison-
ner le patient. C’est la seule option car rien
n’interdit au patient de trouver un travail
dans une autre entreprise de transports qui
ne serait pas au courant de ses problèmes
cardiaques.
ABONNEZ-VOUS
ABONNEZ-VOUS
Tarif 2001
POUR RECEVOIR LA RELIURE
❐70 F avec un abonnement ou un réabonnement (10,67 €, 13 $)
❐140 F par reliure supplémentaire
(franco de port et d’emballage)
(21,34 €, 26 $)
MODE DE PAIEMENT
❐
par carte Visa
N°
ou
Eurocard Mastercard
Signature : Date d’expiration
❐
par virement bancaire à réception de facture
(réservé aux collectivités)
❐
par chèque
(à établir à l’ordre de Angiologie)
MEDICA-PRESS INTERNATIONAL - 62-64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 30 - E-mail : [email protected]
Votre abonnement prendra effet dans un délai de 3 à 6 semaines à réception de votre ordre.
Un justificatif de votre règlement vous sera adressé quelques semaines après son enregistre
ment.
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
❏Collectivité .................................................................................
à l’attention de ..............................................................................
❏Particulier ou étudiant
Dr, M., Mme, Mlle ...........................................................................
Prénom ..........................................................................................
Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre..........................
Adresse..........................................................................................
......................................................................................................
Code postal ...................................................................................
Ville ................................................................................................
Pays................................................................................................
Tél..................................................................................................
Avez-vous une adresse E-mail : oui ❏non ❏
Si oui laquelle.........................................................................................
Sinon, êtes-vous intéressé(e) par une adresse E-mail : oui ❏non ❏
Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,
changement d’adresse ou demande de renseignements.
1 abonnement = 21 revues “on line”
ÉTRANGER (autre que CEE)
FRANCE / DOM-TOM / CEE
❐
700 F collectivités (127 $)
❐
580 F particuliers (105 $)
❐
410 F étudiants (75 $)
❐
580 F collectivités (88,42 €)
❐
460 F particuliers (70,12 €)
❐
290 F étudiants (44,21 €)
joindre la photocopie de la carte
HTA 1/01
✁
1
/
5
100%