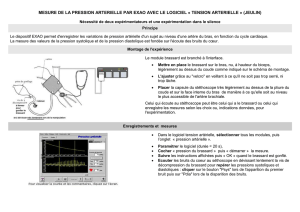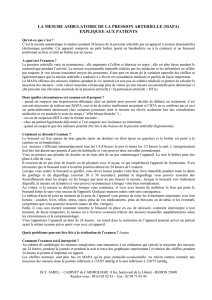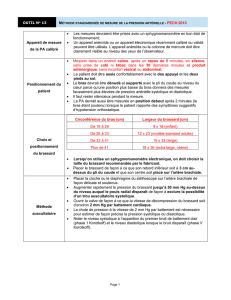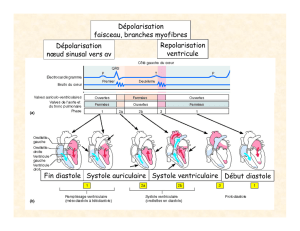Fortin_Dominique_2012_memoire - Papyrus

Université de Montréal
Mise en voix de l’intime.
Étude de cinq solos de Marie Brassard
par
Dominique Fortin
Département des littératures de langue française
Faculté des Arts et Sciences
Mémoire présenté à la Faculté des Arts et Sciences
en vue de l’obtention du grade de M.A.
en littératures de langue française
décembre, 2012
© Dominique Fortin, 2012

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales
Ce mémoire intitulé :
Mise en voix de l’intime. Étude de cinq solos de Marie Brassard
Présenté par :
Dominique Fortin
a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Jeanne Bovet, président-rapporteur
Gilbert David, directeur de recherche
Hervé Guay, membre du jury

i
Résumé
Ce mémoire se penche sur l’évolution des stratégies d’autoreprésentation et
d’autofictionnalisation dans cinq solos de Marie Brassard entre 2000 et 2011 – Jimmy,
créature de rêve, La noirceur, Peepshow, L’invisible et Moi qui me parle à moi-même dans le
futur. L’objectif de cette étude est d’analyser comment les masques vocaux contribuent au
dévoilement de soi et produisent de ce fait un sentiment d’intimité malgré l’alternance des
effets d’identification et de distanciation qu’ils suscitent. Le premier chapitre montre que, par
l’ouverture du moi sur le monde au fil des créations, les protagonistes parviennent bientôt à
dire « je » sans avoir la consistance d’un personnage, alors que le moi de l’archiénonciatrice se
dilate grâce à la perméabilité et aux permutations continuelles des thèmes, des motifs et des
personnages. Le second chapitre analyse le décloisonnement spatial qui affecte la scène et la
salle comme la performeuse et ses collaborateurs dans l’établissement d’un véritable
dialogisme. À partir de l’étude du corps en scène, le dernier chapitre examine les effets du
décloisonnement textuel et spatial, et montre que la mise en évidence du triple rôle endossé
par Brassard – auteure, actrice et agenceure scénique – oblige à reconsidérer la nature du corps
qui s’offre au regard durant la représentation, en invitant le spectateur à s’investir dans le jeu
scénique au-delà des évidences.
Mots-clés : Théâtre québécois, performance, théâtre postdramatique, autofiction, analyse de la
représentation, énonciation, intimité, solo, Marie Brassard

ii
Abstract
This dissertation focuses on the development of the strategies of self-representation
and autofictionnalisation in five one-woman shows by Marie Brassard between 2000 and 2011
– Jimmy, creature de reve, The Darkness, Peepshow, The Invisible and Me Talking to Myself
in the Future. The objective of this study is to analyze the way vocal masks contribute to self-
disclosure and thereby produce a feeling of intimacy despite the alternating effects of
identification and alienation they engender. The first chapter shows that by opening the “me”
to the world through creations, the protagonists soon come to say “I” without having the
consistency of a character, while the “me” of the archienonciator expands through continual
permeability and permutations of themes, motives and characters. The second chapter
analyzes the deregulation affecting the space stage and the audience as well as the performer
and her collaborators in the establishment of a genuine dialogism. With the study of the body
on stage as its starting point, the last chapter examines the effects of spatial and textual
decompartmentalization and shows that the display of the triple role endorsed by Brassard –
author, actress and scenic organizer – forces us to reconsider the nature of the body that offers
itself to the audience during the performance, inviting the audience member to invest himself
in stagecraft beyond what is obvious.
Keywords: Quebec theatre, performance, postdramatic theatre, autofiction, analysis of the
stage, enunciation, intimacy, one-woman show, Marie Brassard

iii
Table des matières
Introduction...........................................................................................................................1
Du monodrame à une pratique scénique polyphonique .............................................................8
Chapitre 1 : Les voix de la création...................................................................................13
1. Du rêve érotique aux paysages cauchemardesques : Jimmy, créature de rêve ?.......................13
2. Autofictionnalisation et autoreprésentation : un premier aperçu...............................................16
3. La noirceur tombe sur la ville....................................................................................................23
4. Peepshow ou les multiples facettes du désir..............................................................................30
5. L’invisible, une aventure de la perception.................................................................................35
6. Moi qui me parle à moi-même dans le futur : les traces de l’existence.....................................40
7. Le décloisonnement textuel par l’ouverture du moi sur le monde ........................................43
Chapitre 2 : Les dispositifs de l’intime .............................................................................46
1. Le corps comme dispositif sonore .....................................................................................46
1.1 Le partage du corps............................................................................................................................47
1.2 Les « masques vocaux » de Marie Brassard
........................................................................49
2. Jimmy, créature de rêve, une première exploration de l’intérieur.........................................51
2.1 L’existence en suspens.......................................................................................................................51
2.2 La matérialisation des voix intérieures
..............................................................................55
3. La noirceur sous les feux de la rampe .......................................................................................58
4. Peepshow, une escapade impudique dans les profondeurs de l’être et du désir........................64
5. Donner corps à l’invisible .........................................................................................................69
6. Moi qui me parle à moi-même dans le futur : une expérience hypnotique................................73
7. Un théâtre de l’écoute ......................................................................................................78
7.1 La musicalisation progressive du discours.........................................................................................79
7. 2 De l’écoute de soi à l’écoute de l’Autre
............................................................................81
Chapitre 3 : Les corps du moi............................................................................................84
1. Du jeu théâtral monodramatique à la performance polyphonique : le corps centripète ........... 84
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
1
/
154
100%