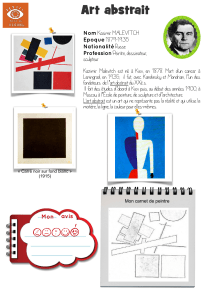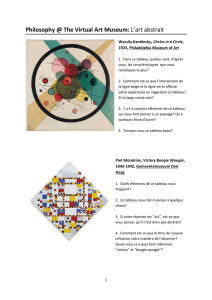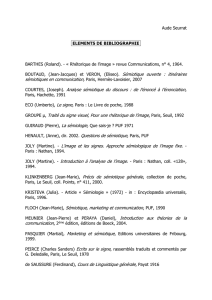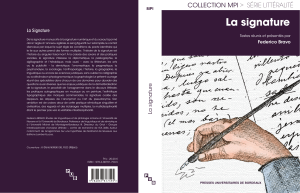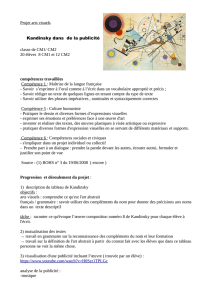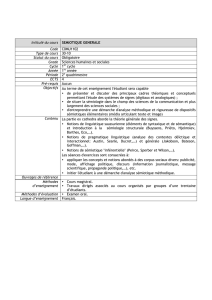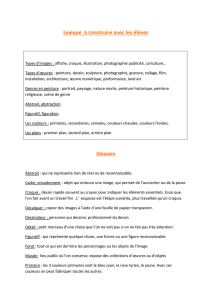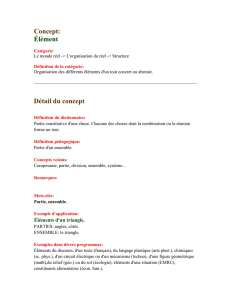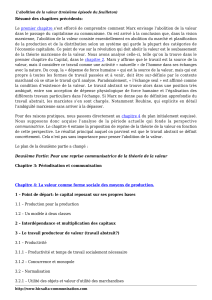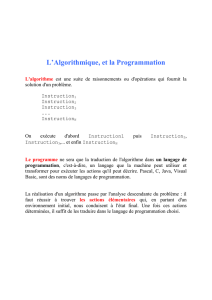Colloque Herbart Grygar L`art abstrait 1 02 2013

Mojmír Grygar « L’art abstrait du point de vue de la sémiotique » 1/32
L’art abstrait du point de vue de la sémiotique.
Mojmír Grygar (Slavisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam)
Pour citer cet article : Mojmír Grygar, «L’art abstrait du point de vue de la sémiotique »,
Les enfants de Herbart, Des formalismes aux structuralismes en Europe centrale et orientale. Filiations,
reniements, héritages, ed. Xavier Galmiche, Formalisme esthétique en Europe centrale,
formesth.com.
Regarder la langue et se demander à quel moment précis une
telle chose a « commencé » est aussi intelligent que de regarder un
ruisseau de la montagne et de croire qu’en remontant on trouvera
l’endroit précis ou il a sa source. Des choses sans nombre établiront
qu’à tout moment le ruisseau existe pendant qu’on dit qu’il nait.
Ferdinand de Saussure
La découverte de la peinture abstraite dans les années 1910-1915 fut
l’aboutissement logique des processus à l’œuvre dans la peinture européenne de la
deuxième moitié du XIX° siècle. Le dénominateur commun de ces tendances est
l’affaiblissement progressif de la fonction mimétique qu’avaient ces tableaux et l’attention
croissante portée aux moyens d’expression propres aux beaux arts. A cet égard
l’impressionnisme a joué un rôle important. En termes imagés, ce fut le déclencheur qui
mena progressivement à l’autonomisation de l’artefact et des ses propriétés, des couleurs,
des formes et des relations réciproques entre les composantes plastiques élémentaires,
ainsi qu’à l’étude de ce qui échappait à la perception immédiate, le relevé de phénomènes
temporels évolutifs : le mouvement, les phénomènes changeants de la lumière et les
processus secrets des mondes tant matériel que spirituel. La direction prise dans le
postimpressionnisme préparait le terrain d’une avant-garde tentant de dépasser les
principes établis des mouvements et des styles classiques et modernes. La découverte de la
peinture abstraite fait partie intégrante de ces tentatives d’anticiper sur l’art authentique du
présent et du futur. La parole biblique « au commencement était le Verbe » vaut aussi bien
pour les commencements de l’art abstrait : depuis longtemps, des penseurs, des savants,
des artistes d’horizons divers avaient pris conscience de la possibilité d’une expression
plastique qui ne serait pas soumise à la fonction figurative. Un exemple particulièrement

Mojmír Grygar « L’art abstrait du point de vue de la sémiotique » 2/32
intéressant d’une telle anticipation est fourni par les considérations de l’inventeur de la
machine à clavier de couleurs (clavecin oculaire), l’abbé I.B. Castel, qui avait observé que la
seule couleur, dans des formes élémentaires ou fortuites, prêtait à une expérience
esthétique. Qui plus est, il n’excluait pas la possibilité qu’on puisse « préférer un simple
point noir sur fond blanc à la plus belle et la plus riche composition (de couleurs)
1
». Au
XIX° siècle de telles anticipations de l’art abstrait sont déjà assez nombreuses : elles
trouvent à s’exprimer, souvent de manière indépendante les unes des autres, chez des
peintres, des théoriciens et des critiques d’art de type académique. Ces mouvances
s’inspiraient dans une large mesure des recherches sur la théorie des couleurs, des
perceptions optiques, acoustiques, tactiles et cinétiques, mais aussi des domaines
spécifiques de la physique, de la physiologie et de la psychologie
2
. On peut voir dans les
cours de philosophie, d’esthétique et de psychologie, depuis le XVIII° siècle au moins,
une anticipation théorique, bien que souvent latente sur l’art non figuratif. Les recherches
concernant la théorie de la connaissance et notamment la relation des perceptions et des
concepts, la langue, la sémiotique, les catégories esthétiques et tout particulièrement la
construction formelle d’œuvres artistiques qui est apparue dans le contexte de l’empirisme
anglais et de la philosophie allemande classique de l’époque de Kant, de Hegel et de leurs
disciples, posaient dans une certaine mesure la question du signe artistique qui régit les
fonctions de représentation, de référence, de dénomination. Sous cet angle, on peut
reconsidérer le rôle des chercheurs qui ont déplacé les investigations concernant l’œuvre
d’art des questions de contenu aux questions de forme. Il s’agit en premier lieu de l’œuvre
pionnière de Johann Friedrich Herbart et de ses successeurs Konrad Fiedler, Adolf
Hildebrandt, Heinrich Wölfflin, Theodor Lipps, Wilhelm Worringer et d’autres. Les
théoriciens tchèques de l’esthétique occupent dans leurs rangs une place qu’on ne saurait
négliger : Josef Durdík, Otakar Hostinský, Otakar Zich, les précurseurs de l’école de
Prague et des théoriciens structuralistes de l’art, Jan Mukařovský et ses successeurs
3
.
1
Je cite d’après le catalogue de l’exposition sur l’art abstrait au musée d’Orsay (2003-2004) Aux
origines de l’abstraction 1800-1914. Paris 2003, p. 43.
2
On trouvera de nombreuses informations sur les recherches scientifiques en rapport soit direct,
soit détourné avec le signe plastique abstrait chez les auteurs du catalogue précédemment cité :
Serge Lemoine, Étienne Jollet, Georges Roque, Michel Frizot, Arnauld Pierre, Jonathan Crary,
Jacques Le Rider, Pascal Rousseau.
3
Josef Zumr, Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa. Herbartismus a česká filosofie [Tant que nous avons
une culture, l’Europe est notre patrie. L’Herbartisme et la philosophie tchèque], Prague 1989.

Mojmír Grygar « L’art abstrait du point de vue de la sémiotique » 3/32
De manière paradoxale, c’est précisément le principe du réalisme qui, en dépassant
les canons obsolètes des esthétiques classique et romantique, contenait les germes d’un
processus qui a conduit l’objet réel à perdre progressivement de sa valeur comme sujet de
la peinture. Lorsque Courbet remplaçait le nu féminin stylisé d’Ingres qui, dans le tableau
La Fontaine, symbolisait un idéal de pureté, d’harmonie et de beauté, par une jeune
paysanne dépeinte de façon réaliste, il exprimait par là de façon manifeste le credo
esthétique du réalisme. Il convenait que l’artefact, la chose signifiante se rapproche au plus
près de la réalité représentée. Ingres soumettait le corps de la femme aux lois esthétiques
du classicisme qui éliminent toutes les imperfections du modèle vivant. Les peintres de la
génération suivante, les impressionnistes, qui voyaient la réalité autrement que Courbet :
Manet, Pissaro, Sisley, Monet, Seurat, ne croyaient plus à la possibilité de représenter
l’objet réel de façon objective : ils s’étaient rendu compte, parfois sous l’influence des
théories scientifiques de l’époque, que la réalité extérieure n’est pas facile à appréhender.
Si cela s’applique à la connaissance intellectuelle, c’est valable à plus forte raison pour la
manière de la reproduire, de l’exprimer, de la rendre dans une œuvre d’art. A la même
époque, le physicien Ernst Mach reprenait le théorème vieux de deux-cents ans de
l’évêque de Berkeley, qui affirmait que l’objet réel est un ensemble de perceptions et que
parler d’une chose en soi (Ding an sich) immuable ne fait pas sens. Les impressionnistes
n’avaient déjà plus pour but que le signifiant de l’œuvre-signe pictural fût subordonné à
l’objet représenté, comme à un phénomène objectif et affranchi des contingences du
temps et du lieu, mais ils se consacraient à l’étude des impressions visuelles fuyantes que
l’objet suscite chez le spectateur. Courbet ne se souciait pas de la couleur, il peignait avec
de la peinture bon marché et affirmait que la délicatesse devait être dans les doigts et non
dans les couleurs
4
. Pour les impressionnistes, en revanche, la perception des couleurs était
devenue une donnée fondamentale et cependant changeante, le foyer des phénomènes
visuels, une question centrale dans le traitement pictural du monde extérieur. Ce n’est pas
4
Dans une lettre à l’écrivain belge Camille Lemonnier, le médecin de Courbet, Paul Collin, fait
ces quelques remarques sur l’atelier du peintre et sur son usage de la peinture : « Il peignait avec
de la peinture achetée chez le droguiste, une peinture tout-à-fait ordinaire et bon marché… Il se
moquait des peintres qui dépensent leurs derniers sous à acheter de la peinture. ‘La délicatesse
doit être dans les doigts’, disait-il. » Gustave Courbet, cité d’après Dokumenty [Documents].
Prague 1958, 253.

Mojmír Grygar « L’art abstrait du point de vue de la sémiotique » 4/32
un hasard, mais bien le résultat d’une dialectique évolutive, si certains peintres de l’époque
où dominait l’impressionnisme refusaient que leur peinture soit seulement le résultat des
percepts et des impressions que l’objet représenté suscitait en eux. Edgar Degas, qui du
reste ne se considérait pas comme un impressionniste, était fasciné par la possibilité de
saisir le mouvement. Il s’efforçait de représenter les positions limites du corps des
danseuses ou des acrobates ; il poursuivait un pareil dessein jusque dans ses scènes de
courses hippiques. Il niait le hasard dans l’art, définissait ses tableaux comme le résultat
« d’une série de nombreuses opérations et d’interminables séries d’études
5
» et utilisait
toutes les possibilités que proposait la photographie encore peu développée de l’époque.
En se mettant à l’école de « l’œil photographique », il enrichit les possibilités de
composition dans la peinture et mit en mouvement la conception statique des paysagistes,
des portraitistes ou des peintres de genre : l’instantané rendit possible des changements
inattendus de prise de vue. Georges Seurat, l’inventeur de la méthode pointilliste, tenta de
dépasser les aléas et les facilités d’improvisation de la peinture impressionniste, par une
combinaison délibérée de taches de couleurs en accord avec les lois de l’optique, et par la
subordination de la composition aux règles sévères de la géométrie.
En 1888, le peintre Paul Sérusier, membre du groupe des Nabis, fut séduit au
cours d’une promenade par un motif de forêt et l’esquissa en vitesse sur le couvercle
d’une boîte de cigares. Son ami Maurice Denis a décrit cette esquisse, intitulée de manière
significative Talisman, comme « un paysage inachevé, traité en violet, en vermillon, en vert
Véronèse et autres couleurs pures, telles qu’elles sortent du tube. » Denis a vulgarisé
l’expérience picturale de Sérusier par une note de son journal, qui anticipe sur le concept
de la peinture non figurative : « Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de
bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface
plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées
6
». Cependant Sérusier n’était
pas à même de tirer les conclusions radicales de sa découverte. Ce n’est que trente ans
après qu’il osa renoncer au sujet, en peignant dans son tableau une composition de traces
colorées, de lignes et de formes. Il s’agit de quelques tableaux datés de 1910, qui furent
5
Bernd Growe, Edgar Degas. Prague 2004, 72. Traduit à partir de l’allemand.
6
Maurice Denis, Journal, 30 juillet 1885. Cité d’après Miroslav Lamač, Myšlenky moderních malířů
[La pensée des peintres modernes]. Prague 1968, 53.

Mojmír Grygar « L’art abstrait du point de vue de la sémiotique » 5/32
accrochées dans les expositions collectives d’art abstrait. On y voit des formes
géométriques, des objets triangulaires clairs et sombres, un cylindre en lévitation ou bien
un groupe de tétraèdres qui évoluent sur un dégradé de couleurs à l’arrière-plan
7
. Le
paradoxe de ces tableaux consiste en ce qu’ils conservent dans une certaine mesure le
principe mimétique, le peintre ayant prêté aux formes géométriques la matérialité d’objets
réels. Sérusier a peint ces toiles étranges sous l’influence de l’enseignement théologique tel
que donné au monastère bénédictin de Beuron. Desiderius Lenz, l’auteur de ce canon
esthétique, partait des éléments stylistiques de l’art antique, byzantin et égyptien, fondé sur
des rapports numériques et des formes géométriques ; l’art de Beuron devait formuler une
beauté impersonnelle, l’harmonie, la pureté.
L’art de Beuron n’usait pas des proportions mathématiques comme d’un principe
purement plastique qui régirait l’aspect de l’artefact, l’assemblage des éléments picturaux,
des couleurs, de l’espace, des lignes et de la lumière ; il y voyait avant tout un chiffre ou un
medium exprimant une vérité supérieure inaccessible à la perception sensible. Sur le
tableau de Sérusier Le Cylindre d’or, on trouve certes un objet géométrique tridimensionnel,
mais le peintre n’accordait que peu d’importance à ses propriétés chromatiques et
spatiales : pour lui, c’était la signification ésotérique du cylindre qui était décisive, comme
du trièdre ou d’autres objets magiques. Vassili Kandinsky voyait lui aussi dans sa peinture
non figurative l’expression de valeurs spirituelles secrètes, mais il s’était rendu compte que
les éléments plastiques : taches de couleur, surfaces, lignes, formes, espace et lumière, ont
leur valeur en soi.
Motivations internes et externes
Chaque phénomène naturel ou sociétal a sa motivation interne et externe. Dans les
sciences naturelles au XIX° siècle, on faisait valoir le principe de causalité, qui expliquait
les phénomènes, y compris les phénomènes de nature immatérielle, comme le résultat
d’un ensemble de causes extérieures. Au tournant du siècle, les découvertes de la physique
ont toutefois démontré que la causalité a ses limites et on a mis en avant l’examen des
conditions internes qui régissent la formation et l’efficience de phénomènes à structures
7
On a pu voir les tableaux de Sérusier inspirés par la symbolique de l’école de Beuron à
l’exposition The Spiritual Art : Abstract Painting 1890-1985, organisée par le Gemeentemuseum à La
Haye et par le County Museum of Art de Los Angeles en 1985. On en trouvera des
reproductions aux pages 20 et 70 du catalogue de l’exposition.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%