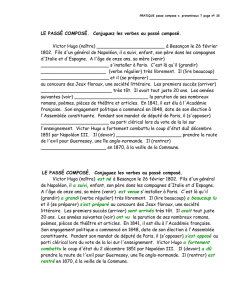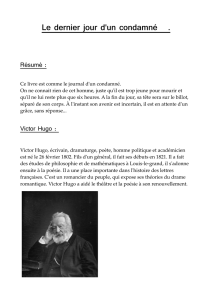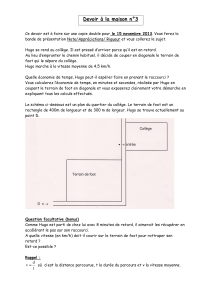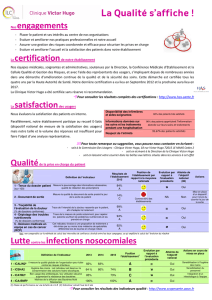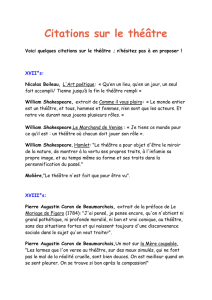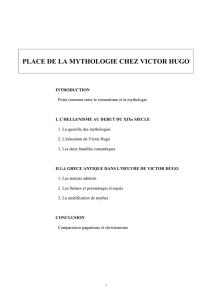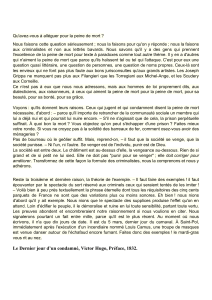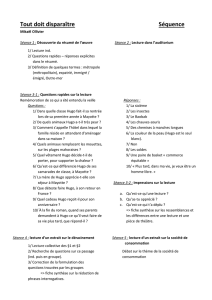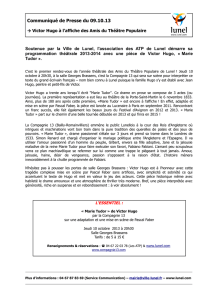Victor Hugo et l`armée - Site de l`association des AET

Victor Hugo et l'armée
DISCOURS PRONONCÉ PAR
M. Pierre MESSMER
PARIS, le jeudi 28 février 2002
Victor Hugo écrivait à son fils en 1869 : « J’ai été enfant de troupe. À ma naissance, j’ai été inscrit par mon père sur
les contrôles du Royal-Corse (oui, Corse, ce n’est pas de ma faute). C’est pourquoi, puisque j’entre dans la voie des
aveux, je dois convenir que j’ai une vive sympathie pour l’armée. J’ai écrit quelque part : J’aime les gens d’épée en
étant moi-même un. À une condition pourtant. C’est que l’épée soit sans tache ».
Le thème militaire revient avec insistance dans l’œuvre de Hugo, tout comme elle a hanté l’histoire politique de la
France du XIXe siècle. Et l’on constate avec étonnement que le sujet n’a jamais été traité comme tel et dans toute
son ampleur par les exégètes. Je vous proposerai donc quelques grandes lignes pour éveiller la curiosité et nourrir la
réflexion.
Bien qu’on se soit souvent gaussé des palinodies de l’homme qui, en une vie, passa de l’ultraroyalisme au
socialisme utopique, il me semble que sur l’armée, la pensée hugolienne se soit formée très tôt, sur le mode
ambivalent de l’amour fasciné et du rejet dégoûté.
Première pierre, ce vers extrait du poème À mon père, en 1823 :
Le poète est fidèle aux guerriers.
Cette fidélité est à la fois patriotique et familiale. Pour lui, l’armée est d’abord une affaire de famille : « La France a
le droit d’oublier » — quoiqu’il la rappelle sans cesse à son devoir de mémoire —, « la famille a le droit de se
souvenir »1. Pour Hugo, l’épopée napoléonienne est autant privée, intime, familiale que publique, collective,
nationale. Son père et ses oncles ont embrassé la carrière militaire. Le père, Joseph Léopold-Sigisbert qui s’est
engagé deux fois, avant 1789, puis en 1791, parvient au grade de général de division. L’essentiel de sa carrière a été
consacré à des missions de maintien de l’ordre, en Vendée, en Italie et surtout en Espagne, où il sert Joseph
Bonaparte. En 1814 et 1815, il défend Thionville, pendant le Blocus. C’est à lui, « mort en 1828, non inscrit à l’arc
de l’Étoile » que sont dédicacées, en 1837, Les Voix intérieures, recueil qui prend ainsi l’allure de véritable
monument en mémoire de son père, érigé par un « fils respectueux ».
Des deux oncles, tous deux soldats, l’un, François-Juste a servi à Naples puis en Espagne, avant d’être réintégré
dans l’armée, en 1819, comme major d’infanterie. L’autre est le véritable héros de la lignée. Louis-Joseph s’est
engagé à quinze ans, en 1792 ; il a participé à de grandes batailles, Fleurus, Ulm, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland,
avant de rejoindre ses frères en Espagne. La bravoure de cet homme, Victor Hugo la met en scène, dans « Le
cimetière d’Eylau », poème où il lui donne la parole :
Le soir on fit les feux et le colonel vint.
Il dit : — Hugo ? — Présent. — Combien d’hommes ? — Cent vingt.
— Bien. Prenez avec vous la compagnie entière.
— Et faites-vous tuer : — Où ? — Dans le cimetière.
— Et je lui répondis : — C’est en effet l’endroit.
Suit le récit d’une nuit de sommeil et d’un jour de combat. Victor Hugo trouve ici des accents très humains pour
parler de la vie de soldat.
Nous ne bougeâmes plus, endormis sur les morts.
Cela dort, les soldats ; cela n’a ni remords,
Ni crainte, ni pitié, n’étant pas responsable ;
Et, glacé par la neige ou brûlé par le sable,
Cela dort ; […]
Dormir, c’est essayer la mort.
Dès l’aube, le cimetière est pilonné par les canons ennemis, en batterie sur les collines qui l’entourent. La
compagnie tient bon, malgré de lourdes pertes. Le capitaine Hugo est blessé, peu avant la victoire.
Je vis mon colonel venir, l’épée en main.
— C’est bien vous, Hugo ? C’est votre voix ?
— — Oui. — Combien de vivants êtes-vous ici ? — Trois.
L’oncle, couvert de lauriers, prit sa retraite en 1823 comme colonel et fut fait maréchal de camp honoraire en 1828.
Maire de Tulle, il se rallia à Napoléon III. Notons, pour l’anecdote, que son fils rata Saint-Cyr. Quels que soient les
choix politiques de son vieil oncle, Victor Hugo le voit auréolé de la gloire de la Grande Armée, héritière de celle
des soldats de l’an II.
Les textes qui font revivre l’épopée de la Révolution et de l’Empire sont nombreux et célèbres. Ils exaltent des
hommes semblables aux héros anciens, des « hommes géants sur des chevaux colosses », comme il l’écrit dans Les
Misérables. Mêmes descriptions dans À l’obéissance passive pour chanter le peuple en armes de 1792. La guerre
révolutionnaire et impériale est surhumaine, moment sublime de l’histoire où la Liberté a trouvé dans l’armée sa
force impétueuse. Même, l’ode « À la Colonne de la place Vendôme » — écrite en 1827, à une époque où Hugo est

encore royaliste — résonne du fracas des armes de ces « demi-dieux, noirs d’une héroïque cendre ». Ce ne sont plus
des hommes qui s’affrontent, mais des forces, des principes.
C’est ce qui apparaît dans le portrait croisé qu’il fait de Wellington et de Napoléon : « Ce ne sont pas des ennemis,
ce sont des contraires ». Et Hugo d’opposer le classicisme de l’Anglais au génie romantique de Napoléon.
Son armée ne fait qu’un avec le Progrès de l’humanité — dans une vision parallèle à celle de Hegel célébrant dans
l’Empereur « l’Esprit à cheval ». La mission de l’armée française est de « protéger la patrie, propager la Révolution,
délivrer les peuples, soutenir les nationalités, affranchir le continent, briser les chaînes partout, défendre partout le
droit ». Rappel nécessaire, quand à l’armée héroïque du début du siècle a succédé « une bande du Bas-Empire » et
au vrai Napoléon, Badinguet. La Force, cette fois, s’est séparée de l’Idée et s’est retournée contre elle. Je le cite : « il
vous fait égorger, en plein XIXe siècle et dans Paris même, la liberté, le progrès, la civilisation ». Et les victoires de
cette armée-là ne lui inspirent qu’ironie :
Solférino,
Sol-Fa-Ré-Zut.
D’une certaine manière, l’armée, pour Hugo, n’a de noblesse qu’élevée dans le registre du mythe. Dès qu’il
s’approche du champ de bataille, la vision se fait plus sombre. Contrairement à Tolstoï, il ne décrit pas avec minutie
les batailles, mais des jeux de forces. Foin de la tactique militaire, à l’étrange exception de considérations
récurrentes sur l’artillerie, à propos de laquelle il se documente. Quand il évoque les techniques de combat, c’est
plutôt à la guérilla qu’il pense. Ainsi Gavroche fait l’éloge de la porte vitrée dans une barricade — « Le verre est
traître » — et un quidam dans Histoire d’un crime (1851) déclare : « Les militaires font mal les barricades, parce
qu’ils les font bien… L’entorse fait partie de la barricade ». Les images, aussi, de la guerre menée par les Vendéens,
dans Quatrevingt-treize, ne sont pas sans faire penser à nos modernes conflits.
De même, Hugo se résout mal à la brutalité de la conquête algérienne. L’aventure coloniale aurait pu le séduire :
l’armée y retrouvait son rang d’agent historique au profit de la civilisation. Toutefois, dès la seconde moitié des
années 1840, il écrivait dans un projet de discours, jamais prononcé :
Mais, dira-t-on, en Afrique comme en Afrique. Il faut bien être un peu barbare parmi ces sauvages ! Ce n’est point
là le lieu des raffinements et de la civilisation […] Messieurs, ce serait là de tous les arguments le plus déplorable,
et je ne l’accepte pas.
Il croit si peu à la capacité civilisatrice de l’armée qu’à la fin de sa vie, alors que la mission civilisatrice de l’Europe
lui apparaît comme la voie de l’histoire, il s’en remet pour l’accomplir au peuplement des autres continents par les
Européens.
Mais, bien sûr, la hargne de l’exilé de Guernesey se tourne vers l’armée de Napoléon III. Il oppose la guerre de jadis
et celle du temps présent. Là où la première était « loyale et franche », où les hommes étaient animés par « le désir
d’être grands plus que d’être vainqueurs », la seconde est qualifiée de « punique », « braconnière et faussaire ».
Les citations ne manquent pas, dans les Châtiments et dans la Légende des siècles :
Jadis les courts assauts, maintenant les longs sièges ;
Et tout s’achève, après les ruses et les pièges,
Par le sac des cités en flammes sous les cieux,
Et, comme on est moins brave, on est plus furieux ;
Ce qui fait qu’aujourd’hui les victoires sont noires.
Les défaites le sont bien plus encore ! La guerre de 1870, commencée par « un guet-apens » et conclue par « une
voie de fait », met en présence deux belligérants « dignes l’un de l’autre », selon le titre d’un poème de L’Année
terrible, paru en 1872 :
[…] Le lièvre d'un côté, de l'autre le chacal.
Rentré à Paris, sitôt la République proclamée, Victor Hugo est accueilli par la foule le 5 septembre 1870. Il fait don
à la Société des gens de lettres de ses droits d’auteur sur les Châtiments pour acheter deux canons l’un nommé
Châtiments, l’autre Victor Hugo. Et tandis qu’ils tonnent sur les fortifications de la capitale, Victor Hugo élève la
voix en faveur de la poursuite de la guerre :
Une dernière guerre ! hélas, il la faut ! oui.
Élu député de Paris, il part, dès février 1871, à Bordeaux, où va siéger l’Assemblée. Avec cent six autres députés, il
vote contre l’acceptation des conditions de paix imposées par la Prusse. Le 8 mars, contestant l’invalidation de
Garibaldi, élu député d’Alger, Hugo déclare : « Je ne veux blesser personne, mais je dirai qu’il est le seul des
généraux qui ont lutté pour la France, le seul qui n’ait pas été vaincu. » Voilà de quoi s’attirer bien des inimitiés
militaires. Empêché de parler, il quitte la tribune et signe sa lettre de démission.
Appelé à Bruxelles pour des affaires successorales, il observe de Belgique la suite des évènements. La Commune,
parce qu’elle apportait la division et non la fraternité quarante-huitarde, ne pouvait plaire à Hugo qui avait déclaré
aux représentants de la Garde nationale venus le consulter peu avant son départ : « Vous partez d’un droit pour
arriver à un crime ». Il ne pouvait non plus cautionner l’armée des Versaillais. Contrairement à la légende — qui
entraîna le refus de nombreux socialistes de participer aux funérailles nationales en 1885 —, Hugo a condamné sans
ambiguïté la répression, comme en témoignent de nombreux passages de L’Année terrible.
À Bruxelles, Victor Hugo donna l’asile aux communards, ce qui lui valut d’en être expulsé. Redevenu
parlementaire, il n’eut de cesse d’obtenir leur amnistie, présentant par trois fois une proposition de loi en ce sens.

Dans la fin de sa vie, Hugo se tint à l’écart du courant nationaliste qui s’exprima dans le discours revanchard. Sa
vision de l’avenir est, au contraire, faite de fraternité. Il plaide pour les États-Unis d’Europe, première étape avant
l’unification de l’Humanité tout entière. Dans cette vision, plus de place pour l’armée. Entretenir une armée
permanente est jugé trop coûteux, comme il le déclarait déjà au congrès de la paix en 1849 : « Il résulte des
statistiques et des budgets comparés […] que les armées permanentes coûtent annuellement à l’Europe quatre
milliards ». Constatation exacte bientôt dépassée par la flambée des dépenses militaires, mais argument moderne
que ne désavoueraient pas certains candidats, aujourd’hui.
Dans un monde réuni et pacifique, l’armée sera devenue obsolète. Dans ce monde que le rêve de Hugo plaçait au
XXe siècle — quelle erreur ! —, la République aurait « pour loi, l’incontestable ; pour unique Sénat, l’Institut ».
Notre Institut, Messieurs, dont les épées sont demeurées sans tache.
Note 1 : Les Voix intérieures, préface.
1
/
3
100%