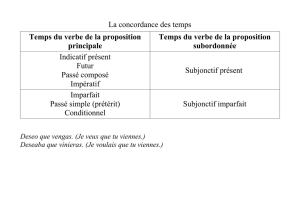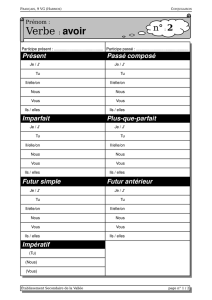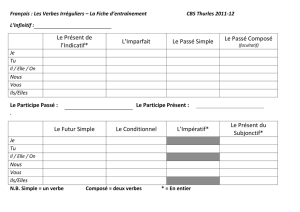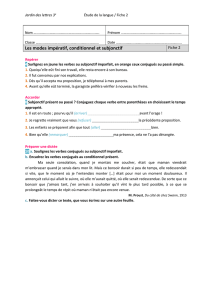Nouvelles glanures grammaticales
publicité

Bas tin, Jean
Nouvelles glanures
grammaticales
PC
2105
B3
/l
^^^
^'(^^(7'2^ 4LAM^
/^
4<:x^^yutJkA^
Qj:,>^ ty/ CA-'O-'^
Z^Mp^
X,
<o~t^-^'>>\
/
(
^
^
Vi-
J
/?^
R\
PAR
J.
BASTIN.
Prix
50 c o p.
RIGA.
Typographie
Millier,
1907.
k.
Place Herder,
1.
J
Autres ouvrages de l'auteur.
1)
Aperçu
de
(3® édition,
par
4e
le
Comité
de
section
seconde édition
la
scientifique
la
en
française
littérature
1907;
du Min. de
Chancellerie
avec M. P. Ackerman
recommandée comme xiyKoeodcmeo
collaboration
a été
de
M.
par
pub.,
l'Inst.
S.
l'Empereur
Comité
le
par
et
de
celui
la
du
Saint-Synode).
2)
Chrestomathie
littéraire (13e édition
recommandée par
1907),
recommandée
(la
7© édition a été
Circulaire Ministérielle).
comme
sons en français (1906\
3)
Les voyelles latines dans leur passage
4)
Dictionnaire français-russe (1894; recommandé).
5)
Le verbe
6)
Précis de phonétique et rôle de l'accent latin dans les verbes (1905).
7)
Etude des principaux adverbes, surtout ceux de négation (1887;
et les principaux
adverbes (1896; lexicologie
et syntaxe).
Paris,
Rue
Richelieu, 67).
8)
9)
Etude historique des participes (3e édition, 1889).
Grammaire comparée et basée sur le latin (1878 — 79), recommandée par
l'Académie
Impériale
scientifique
du Ministère de
des
sciences
l'Inst.
de Saint-Pétersbourg,
par
le
Comité
pub., par le Comité de la 4» section de la
Chancellerie de S. M. l'Empereur, par le Comité du Saint-Synode comme
un ouvrage HeaaMtHHMbiH, et par le Comité des Ecoles militaires comme
une œuvre capitale et utile.
10)
11)
Grammaire historique (1881
lexicologie avec les principales règles de la
syntaxe), recommandée comme manuel (pyKOBOflCTBo) par le Comité scientifique du Ministère de l'Instruction publique.
Glanures grammaticales (Namur, 1903), recommandées par le Comité scien;
tifique
qui
a
{Saint-Pétersbourg)
participes, et en a
et
et
par
le
Ministère
de
l'Inst.
pub.
recommandé également ma gram. de 1878—79, mon
envoyé des exemplaires
à tous les
(Belgique)
Histoire
des
athénées du royaume
aux écoles normales.
Les cinq derniers ouvrages ne sont plus en vente.
f
PAR
J.
BASTIN.
l:M^3
27
ol
k^^
^V"
RIGA.
Typographie Mû lier, Place Herder,
1907.
1.
:?.
v-
"i
?C
2/Û6'
^3
A^.:r
Ne rien moins que.
Moins (minus)
1)
et
comme
Il
=
que son frère {moins, adverbe). — C'est moins que
moindre; cela est moindre que rien).
double valeur de moins provient
cette
de ne rien moins que,
très claires par le contexte.
le
même
plus à
„Ne
Ma
qu'elle
bel
de nous
conduite
esprit
et
philosophe
(Id.,
moius que
roi).
—
savantes,
II,
—
deux sens
sont
siècle
ouvrages
Un
veut
moins que
(de
directeur
moindre) a
le
sens
moins que
d'instruire tout
Jésus-Christ
l'univers
qtte
(Id.).
dans
les
(négatif et affirmatif).
—
à
rien moins qu'à mettre au jour
rien moins que Grecz ou
aucuns de nostre nation desprisent") toutes choses escriptes en françois
Latins,
(Du
—
employait déjà ne rien moins
Sens négatif: La Boétie n'avoit pensé
ces
=
rien
(ne représentent)
Dieu ne se propose rien moins (fue
XVP
Le
9).
qu'on
dans:
Ces vêtements ne
(Bossuet).
ce
qui n'est rien
Augustin (Bourdaloue)".
saint
,,Ne rien moins que {moins, adjectif
affirm.atif,
nullement)
(n'est
Un homme
Femmes
moins que
conscience) qui n'est rien
dit Littré)
exemples suivants:
les
Placet au
langue:
la
adverbe,
alors
rendues
Dictionnaire
ici Littré, le
renseigner sur l'histoire de
rien
n'est
(Molière,
soit
Consultons
double signi-
la
toujours
significations
rien moisis que {moins est
nullement dans
signifie
comme adverbe
riche
rien {moins, adjectif
fication
langue
la
adjectif:
moius
est
De
dans
est resté
Bellay).
(Montaigne,
—
Lettre IX).
N'estans
Nous ne sommes rien moins
Sens positif:
moins sinon qu'on
Il
le
se
trouva
si
surpris
vinst assiéger (Satire
qu'inférieurs aux anciens
et
esperdu
Ménippée,
p.
qu'il
(Id.).
n'attendoit
rien
133).
Avant de recourir à l'Académie, voyons d'abord ce que
dit-on, de nos dictionnaires, pour
par les nombreux exemples que nous donnent nos meilleurs
2)
dit Bescherelle, le plus français,
finir
*)
despise
La
(latin
vieille
langue
disait
aussi
despiser (mépriser)
comme
l'anglais
despicere, mépriser).
1*
to
Ne
4
moins que.
rien
écrivains contemporains.
Ce sont eux
qui en sont
nous n'avons
les maîtres;
de ce qu'elle sera demain,
qui font la langue actuelle,
pas à nous préoccuper
langues vivantes ne cessant jamais
les
un perpétuel devenir:
rien moins que, dit Bescherelle, qui reproduit les
donnés par l'Académie, a quelquefois deux acceptions
Après le verbe être, ne rien moins g?fe signifie le
de l'adjectif qui le suit: Il n'est rien moins que
d'évoluer, étant dans
,,Nc
exemples
opposées.
'
contraire
sage
=:
avoir
le
sens positif ou
le
contexte):
selon
Vous
moins qne
de
devez
Itii
de 1835^),
rien
n'est
il
Vous pouvez vous dispenser
car
n'est
il
le
que
rien moins
ou neutre, dit l'Académie dans son
ne rien moins que serait équi-
actif
sens
de
déterminé par ce qui précède
n'était
s'il
lui (contexte),
peut
il
n'est pas votre père).
il
„Avec un verbe
3)
édition
car
(contexte),
—
est votre père).
il
substantif,
circonstance (disons:
la
reconnaissance
la
car
d'un
Suivi
négatif selon
reconnaissance envers
toute
—
sage.
de
(=
votre père
votre père (=^
voque
pas
n'est
il
:
ne
il
moins (il ne se propose rien moins) qne de vous supplanter, il
n'aspire à rien moins qu'à vous supplanter {=-- il n'est point votre concurrent).
Vous ne le regardez pas comme votre concurrent (contexte) cependant il
ne désire rien moins (il ne se propose rien moins) que de vous supplanter,
il n'aspire à rien moins qu'à vous
supplanter (== il est votre concurrent)".
Vozis
croyez
le
votre
conctirrent.
il
a d'autres vues (contexte),
désire rien
—
;
„Au
ajoute
reste,
manière de
l'Académie,
il
bon
est
cette
d'éviter
de l'équivoque qu'elle entraîne
parler, à cause
*).
Les phrases qui précèdent, prises isolément, seraient évidem-
ment équivoques, mais, grâce
très claires, et au
à
lieu d'être évitées,
d'autres cas, d'ailleurs, dans
contexte ou
la
qualité des personnes
nous éclairer sur
Je lui
l'a
—
faite ?)
à lui qu'on
m'en
faire
*)
comme
serait
Je lui
les
le
sens de
ai
entendu dire
a dites?)
—
Mon
oiî
n'ai
pas
sous
la
main,
pas d'accord avec les écrivains
lisent fort
journaux.
encore
le
dont on parle qui doivent
(est-ce lui qui
telles
donnée ou à lui qu'on
les a dites ou
l'a
choses (est-ce lui qui
ami m'a
acheté
une
et
montre
(est-ce
ma demande
de
et
pour
que
je
1878.
Si
qu'elle
ne
qu'elle aurait alors accepté l'opinion
de
à Riga,
est aujourd'hui d'un autre avis
quelques grammairiens qui
les
c'est
phrase:
la
vu donner l'aumône
dans
français,
cadeau?). Est-ce une montre qu'il a achetée à
Je
l'Académie
ai
le
de
elles sont tous les jours
plus en plus employées dans les livres
Que
elles sont toujours
un contexte,
la
dernière
qu'en 1835,
peu ou qui
il
édition
est certain
lisent fort mal.
Ne
Il
de mes
Est-ce une
payerai?
lui
moins que.
rien
5
me
montres dont je voulais
—
débarrasser?
n'y a que moi qui aime ses enfants (les miens ou ceux d'un autre?) Je l'aime
plus que nul (qu'aucun, que personne) d'entre vous (double sens: Je l'aime plus
que
n'aime
je
personne)
(aucun,
nul
vous;
d'entre
X
chez
X ou un
(dans sa maison; mais est-ce
ces phrases ne deviennent claires que grâce
de
personne dont on parle,
la
comme dans
entendues
—
Toutes
ou qu'en considération
/m
phrase: Je
que nul
plus
je les ai
autre qui les a dites?)
au contexte
la
l'aime
je
— Ces choses,
(qu'aucun, que personne) d'entre vous ne l'aime.
ai
vu donner l'aumône.
4) Quelques grammairiens demandent que l'on donne
ne rien moins que un sens toujours négatif, et que, pour
sens positif (affirmatif) on emploie ne rien de moins que:
moins que
rien
u'est
Il
rien de moins que savant
(il
savant
comme
Mais tous ceux qui parlent,
du premier au
journal „le
Temps" M. Paul
d'accord
double
selon
sens,
langage
très
dernier,
clair.
le
Il
commençons
qui
puisque
et
un exemple que
doit
en
très rare,
est
dernièrement
que ne rien moins
contexte
écrivains,
par
n'est
Il
tous ceux qui écrivent,
disait
rien de moins que, c'est toujours ne
trouve chez nos
—
dans
le
Stapfer de l'Université de Bordeaux,
n'admettre
à
savant).
est savant).
à peu près
sont
point
n'est
(il
à
le
je
avec son
qzie
rendre
toujours
le
de rencontrer ne
moins qtie que l'on
effet,
rieit
nous sommes en Russie,
dans V Anthologie
trouve
de M. A. Pachalery, ancien professeur à Odessa:
Ce
toute
(la
Comédie humaine de Balzac) n'est rien moins que
que Balzac a voulu peindre
entière
la
la
société
sens positif: Balzac a voulu peindre
(p. 139,
société humaine).
Voici,
contre Bescherelle,
d'un adjectif;
phrase,
la
sens positif avec
le
parfaitement
claire
être
grâce au
suivi
contexte,
est très correcte:
Von
ne pourra protester avec asses d'énergie contre ce procédé (contexte)
qui n'est rien
moins qu'immoral
19 août 1903, 2" page; Mauvaise
D'après
5)
tout
le
non
la
monde
raison,
à part quelques
a autorité
sur
des exemples à sens positif
Manger
de
trop
procédé est immoral
viande
;
Indépendance Belge^
Tactique).
principe admis par
le
—
(le
P.
Stapfer
langues",
comme
par
—
„que l'usage,
on trouve partout
grammairiens
les
comme
n'est
M.
ceux qui suivent
rien moins qu'un
:
empoisonnement qui
—
organes {Indcp, Belge, 22 fév. 1904).
Il ne s'agit de
Le
symptômes d'empoisonnement {ibid., 23 fév. 1904).
ministre ne viendrait rien moins que demander
son collègue des explications
{Revue pol. et litL, 1er nov. 1903).
n'a fallu rien moins que l'aplomb
Il
olympien du maître (V. Hugo) pour avoir reçu en pleine figure et sans sourciller
cette
allusion à Lamartine {Revue hebd. p. 326, 15 fév. 1902, Sotivenirs sur
agit
peu
à
peu sur
les
—
lien moins que de
cà
—
Ne
6
moins que.
rien
le dernier survivant [Garnier) dti romantisme). — Cette campagne de presse
ne vise à rien moins qu'à discréditer les deux époux {Indép. Beige,
3 mars 1902). — Les journaux allemands avancés ne tendent à rien moins
qu'à
faire
comme
prédominer l'influence allemande en Hongrie
déjà en Autriche {ièid
—
6 oct. 1902).
,
Ce ne
prédomine
elle
rien moins que
fut
renouvel-
le
du sacerdoce et de l'Empire (V. Duruy, ancien ministre
de rinst. pub.: Philippe le Bel et Boni/ace VII).
Guillaume le Conquérant
lui fit porter (à Harold) par un émissaire secret ses propositions
et ses offres,
qui n'étaient rien moins, en cas de succès, que la lieutenance du royaume
lement de
la
querelle
—
Conquête de
Thierry,
(A.
l'empire romain) n'étaient
membres une
leurs
1ère
sépulture honorable
1896,
livraison,
—
l'Angleterre).
rien moins que
3).
p.
—
Il
Les
nommer
vice-chancelier {Rev. des D. M., p. 478,
n'aspire
à
{Fk. de Ségur,
que
moins
moins qu'à être tout
Ce document n'était
rien
15 sept. 1897).
R. des D. M., 15 mai 1903\
d'une
l'indice
15 juillet 1897).
tant
révolution
—
—
le
Son héros
[ibid.,
pacte avec l'esprit
Ces événements ne sont rien
va
qui
Belgique
ambitieux
est
il
moins qu'un
rien
en
moins que de
de rien
puissant,
—
(dans
vétérans
{Revue de rinst. pub.
question
n'était
de
collèges
associations en vue d'assurer à
des
éclater
Leroy - Beaulieu
(P.
;
PEtiropéen'S.
Trouver tous ces exemples mauvais avec
ce serait dire que nos meilleurs
Voici
à
—
donner passage
rien moins qn'à affirmer
moins que de
ne
lui
(la
la
fille
chemin de
pleine
juillet
—
Il
ne
économique de
la
de rien
s'agissait
Revue bleue: Mariage de
moins qn'à attiser
indigne qui ne tend à rien
peut exister entre blancs
comme
déroit
pour épouse au duc de Chartres une princesse qui
Ces informations ne tendent
américano-japonais
mai 1906).
le
29
un discours qui ne tend
autonomie
et entière
sous
Belge,
tunnel
fer {Ind.
a fait
de M'"» de Montespan;
C'est là une politique
haine de races qui
1906).
un
à
Ind. Belge du 31
faire accepter
convenait pas
Prince).
la
positif;
Julleville,
exemples tout récents à ajouter à ceux
Le président du Conseil (de Hongrie)
Hongrie (sens
de
Petit
savent plus écrire.
de rien moins que de creuser un
là
de Behring, pour
1906).
des
encore
qui précèdent:
Il ne s'agit
écrivains ne
à
rien
jaunes {Indép. Belge,
et
moins qu'à
représenter
un
7 déc.
conflit
inévitable dans un avenir immédiat {Id., 29 déc. 1906).
Les exemples suivants ont un sens négatif:
La conquête de ce grand pays (contexte) n'est rien moins que
facile
—
Les raisons que donne Pautettr ne sont pas assez
probantes (contexte); sa thèse, selon nous, n'est rien moins que convaincante
En partant, nous n'étions
{Rev. de flnst. pub. en Belgique, 4» livraison, 1897).
rien moins que sûrs du succès de notre entreprise, tant elle était difficile
On ne petit rien reprocher à ce jeune homme, sa
{Rev. hebdomadaire).
{Rev. hebd., 7 déc. 1901).
—
—
conduite n'est rien
moins que
répréhensible
(elle n'est
Avec l'Académie française, qui est
doctrine (1835), changeons
la bonne
auront un sens tout opposé:
pas répréhensible).
(1878),
le
ou
contexte,
était ici
ces
dans
phrases
Ne
La
conquête de cet
conquête
(la
—
révoltante). —
la
—
deux nations
Cette sage
si
chrestien
14 avril
1906,
disant
propos
à
Venezuela
le
ne tend
politique
la politique
et
de son
rien moins qu'à rapprocher ces
à
positif).
de Julleville
Petit
est con-
(elle
rien
n'est
longtemps divisées (sens
Feu
6)
«jue convaincante
moins que révoltante (elle est
néfaste ne tend à rien moins qu'à déconsidérer
Cette politique
(Ind. Belge,
moins
n'est rien
Sa conduite indigne
République
Président).
rien moins «(iie facile pour l'Angleterre
Les raisons que noîts donne l'auteur sont excel-
selon nous,
lentes, sa thèse,
7
îlot n'était
—
était facile).
vaincante).
moins que.
rien
une faute dans Mont-
trouvait
David, déplorant, sincèrement ou
de
non, son adultère:
ma
J'ay péché contre toy (Dieu),
qne
Montchrestien eût
de moins que
la
tandis que ne
rien
sens négatif,
clirestien
dont
éternelle,
dans
rien
Julleville,
sens serait affirmatif,
le
moins que ne peut
comme
de
selon
avoir,
les vers suivants,
qu'un
lui,
également de Mont-
:
viendront
(Ils)
Ciel,
mort
1).
selon Petit
dire,
dtj
ne mérite rien moins
faute criminelle
mort éternelle {David, tragédie, V,
la
exterminer
rien moins que
race
cette
[Aman,
trépas
le
Et Petit de Julleville
fidelle
tragédie,
(les
ne
qui
Juifs),
mérite,
III).
encore erreur en voyant ne rien
fait
de moins que, dans:
Ne
de
songeant
moins
rien
qu'à
sortir
(Montchrestien
aujourd'hui
Hector, IV).
De dépend
moins;
songer de à
songer
de
ici
on trouve
souvent
songer
de
côté
n'a
et
chez
On
à.
rien
à
écrivains
les
XVII"
en
dirait,
avec rien
voir
du
effet
siècle
(langue
actuelle):
Ne songeant à rien moins
devient
Répétons
raison,
a
mairiens,
qu'à
donc
dit
M.
avec
ici
sur
autorité
dont
les
vains un droit qui
de
l'usage,
et
n'appartient qu'à
—
Bossuet avait déjà
grand maître des langues".
Dans
Stapfer:
langues".
—
„
le
„
sens
positif
dit
non la
gramcontenir dans
L'usage,
Obligeons
quelque part M. F. Brunetière, à se
leur rôle de greffiers
langue''.
sortir aujourd'hui,
par les vers qui suivent.
clair
les
maintenons aux seuls
écri-
eux sur „Vévoluiion de la
«L'usage est le
avant eux:
M. Stapfer nous
dit
„Temps", en août 1905,
„qu'aussi longtemps que le célèbre critique
Scherer avait eu
la
direction
l'article
qu'il a
publié dans
de ce
le
qui s'imprimait
au Journal,
employés de donner toujours la valeur
négative à ne rien moins que (ce que le Temps ne faisait pas
il
avait exigé de tous les
8
Signes orthographiques.
et la valeur affirmative à ne rien de inoins que,
mais qu'aussitôt après le départ de Scherer (1879) collaborateurs
et employés étaient retournés à leur vomissement" *^).
On s'est
auparavant)
sans
personne, de
l'avis
remède
le
proposé
les
de
était
de M. Stapîer lui-même,
ne pense à s'en servir,
personne,
comme
que
persuadé
doute
valeur;
nulle
ou presque
du Temps
collaborateurs
tous ceux qui parlent ou écrivent.
Signes orthographiques.
Dans
langue on n'avait d'autres signes orthopour distinguer les syllabes ou pour abréger
les mots.
Dans le premier cas, pour montrer qu'un mot comme
ha-i-iîe, devenu haine par contraction (cf. haïr, je hais), avait
la
vieille
graphiques que
trois
Va
on surmontait
syllabes,
oblique, ressemblant
assez
d'un
tréma n'étant pas encore connu) ce
quelques mots pour séparer
Trair
(lisez traïr)
petit
accent
à notre
fut
h que
mais
droit,
trait
Plus
aigu.
tard
l'on intercala
(le
dans
les syllabes:
tradire pour tradere,
devint tra-h-ir (trahir j
d tombé
entre voyelles), eiivair (enva-ir), envahir (invadire pour invadere), caier (ca-ier),
cahier (quaternum
dehors
voyelles),
quatre feuilles)
;
Tradiior
l'honneur),
{i long),
devenu trahitre
(tra-itre),
/ était long
;
cf.
;
deors (de-ors
(d'où hors remplaçant l'ancien
throsne,
et
pour trœdiior
(rahistrc
thronus,
{s
—
*de-foris,
moi fors :
avait
{i bref),
non prononcé,
devenu trône, o long,
f tombé
entre
tout est perdu fors
donné
mais
etc.),
aussi traitre
indiquant
que
devenu traître
(traditor) par contraction.
Pour abréger les mots on avait le même signe oblique,
marquer l'omission d'une ou de deux lettres, plus
long pour une omission évaluée sans doute comme plus importante.
Ainsi dans le Voyage de Charlemagne à Jérusalem
(XI* siècle), je trouve le petit trait, que
nous remplacerions
le trait
aujourd'hui par une apostrophe, après q, mis pour qui
que.
plus grand ou le point et virgule après q remplaçant
Dans le Voyage (double texte; édition Koschwitch) le mot
est (page gauche) est toujours représenté par —
nest par nest
(ne élidé et n agglutiné ou soudé au verbe); la conjonction et
petit pour
;
,
*)
Expression
tirée
des
qui revertitur ad vomitum
Proverbes
stnini,
sic
Cette expression s'emploie pour signifier:
mais
c'est
de Salomon,
imprudens,
XXVI,
qui
itérât
retomber dans
en abuser étrangement que de l'appliquer
ici
le
à
11:
Sicut canis,
stultitiam
suam.
péché, dans l'erreur,
nos écrivains.
Accent aigu
à
un sept
mal
(7)
un signe
par
est représentée
remarques sur
et
ressemblant
un
à
crochet
ou
(7j
fait.
Nous trouvons encore aujourd'hui ne
comme dans
tiné
9
les accents.
langue qui
vieille
la
en n) agglu-
(élidé
ne connaissait pas l'apo-
strophe, et, par conséquent ne pouvait l'employer, dans:
Naguère ou naguères {s finale caractéristique de plusieurs adverbes) ^=
il
n'y a pas
n'a guère (sous entendu de temps; n'a génère de temps signifierait
:
nennil
beaucoup de temps);
cela),
donnant nenil (nen
mieux
Non
marquer
composés
valeur,
son nasal),
le
soudé
est
non
nen
oij
nenni
nonchalant,
dans
au
joint
n'est
il
il),
=
illi
(avec
(/
tombé
que
substantif
et
mot
le
nonpareil
un
par
pas
illud^
devenu nennil (deux n pour
était nasal,
-iance;
non
signification
la
,
se
prononce
—
dans
ua-iii).
autres
les
non-payement,
tiret:
non-
etc.
Ce
que dans le
commencèrent
nous
servons
grec;
mais
à
aujourd'hui.
avec
servent à marquer
en français
tuée;
du XV1« siècle que certains
employer les accents dont nous
Ces accents furent empruntés du
courant
n'est
imprimeurs
une valeur tout autre. „En grec les accents
la tension de la voix sur la syllabe
accenn'indiquent
ils
que peut prendre une
ciation
(fermé),
e,
é,
ê;
è,
Accent aigu
L'accent
non
syllabe
met
de
suivie
sur
de r ou
d,
de
de
pronon-
{a ouvert),
à
â
les accents.
à son
Ve
a,
voir Littré.
remarques sur
et
se
aigti
différence
la
lettre:
—
o, ô; u, û".
î;
/,
que
même
fermé
une
(l'accent se con-
final
s-
finissant
serve naturellement au pluriel des mots terminés par é)\
Bonté, pré-%^x\z^\ né,
lez
(=
(latus,
près;
lattis,
pi.
large), des lé.s; Plessis
Le XVI^
siècle
-
ne
distinguer Ye final fermé,
sinon de tout
Nous
et
par l'Emile
tel
qu'il
dans
le
par
se fait
lez
=
-
se
le
à
(pi.);
l'on
de
peut
au moins
Télêmaqiie
-
de
-
chaussée;
un
lé,
etc.
servait
et
mz\% pied, lécher, léger, chez,
nez, rez
côté),
Tours,
XVII'' siècle,
le
verrons,
nés, bontés
côté; donc lez
de
l'accent
aigu
que
en dire presque
de
sa première
Fénelon
pour
autant,
moitié.
(édition de
1712)
de Rousseau (1762), que l'emploi des accents,
aujourd'hui, ne s'est à peu près bien réglé que
dernier
quart
du
XVIII*'
siècle
(aujourd'hui
encore
l'emploi des accents est loin d'être à l'abri de tout reproche).
Le XVI*
siècle,
dès
que
accents
les
furent
connus (vers
1530), écrivait: sévérité, vérité, évité; modéré,, ténacité (aujourd'hui
ténacité à côté de tenace).
Dans
le
Télémaque (1712)
je
trouve:
Accent aigu
10
mère
père,
(parfois,
m,oderer,
célèbre),
remarques sur
et
mais rarement
Telemaque, etc.
les accents.
père, tu es, vous êtes, fidèle^
:
L'accent grave n'est venu
*)
qu'assez tard, conseillé par P. Corneille, qui aurait voulu amener
une distinction entre les trois e que l'on trouvait dans aspres
(pi.
âpres), après (prép.), vérité, procès, excès, succès, écrits
:
avant
lui
Dans
après, procès, excès, etc.
:
Conte
le
Tonneau
dit
(1741), en plein XVIII® siècle, je trouve encore bénévole, obscène,
obscénité, etc., l'accent aigu sur règle,
grave
l'accent
systêm-e, vite,
y
aujourd'hui),
acceptée
contraction
dans
autres
les
l'Académie
par
mots
c
etc.,
emblème,
sur
infâme (quoique Va
l'accent sur
prononcé sûr),
sîtr (securus, seûr, seur,
quatrième,
troisième,
circonflexe
l'accent
étage,
aucun accent sur ame, grâce,
comme
long
fût
sur
comme
assurer
latin
française
sur
tombé devant
en 1740
?/,
comme
Dans PÉmile de Rousseau
contractés.
(1762), je trouve encore père, mère, frère, espèce, guère, hygiène
quatrième,
féminin;
plupart
ame, grâce, les premières pleurs (remarquons
les longues pleurs);
coutume, toujours, plutôt,
mais
placé par
le
plupart (une
presque
chez
circonflexe):
fois
aussi
tous
autres
les
plupart chez Jean-Jacques),
comme
dans
chez Montesquieu, qui
écrit
chose, pour ces participes,
les
Sermons du Père
constamment
l'on trouve
j'ai
///,
vu.,
un interreçu, etc.^
au féminin lûë, vùë, reçue,
dans
le
la
rem-
{s
plutôt, la
cotitume, couture, toidjours,
prète, on sevré les enfants, collège, lumière;
Même
écrivains
,^
ce
etc.
Conte du Tojineau
et
de Segaud, Jesttite (1752), où
ame, grâce, sans l'accent circon-
(sic)
aussi:
ne date sur Va, dans ces mots, que depuis 1798.
flexe qui
Sommes-nous
courant
devenus beaucoup plus logiques dans le
XIX* siècle? Nous écrivons encore év-é-nement,
du
mais av-è-nement;
rè-glement,
ré-glementaire;
re-ligieux, ir-ré-
te-nace, té-nacité, breyet,
ligieux, re-cë-ler, re-ce-leur, dé-ce-Ier;
breveté en prononçant ordinairement brevet, breveté; revision,
que beaucoup prononcent et écrivent révision.
En 1835,
l'Académie
elle
Au
*)
çait
Xs
estimez,
les
—
écrivait
irrésol-u-ment,
a fait disparaître l'accent
final
pluriel,
et
zelez,
dans
l'accent
mots
les
aigu
les veritez,
mais résol-ù-ment;
sur u,
écrivant
(substantifs,
du singulier
boutez,
etc.
On
œuvres de Montesquieu Voltaire écrivait
Rez (de rasus, ras) de chaussée =^ au ras
;
adjectifs,
disparaissait:
:
les
en
1878,
deux mots de
participes),
s rempla-
hommes
des
aimez,
trouve encore cette graphie dans
estimés, aimés,
(au niveau) de
bontés, sélàs, etc.
la
chaussée.
Accent aigu
la
même
1878
En
manière.
elle
nous
laisse
remarques sur
et
1835,
éternnement
dans gaine, en
l'accent
cleniùment.
et
1835, elle tc\wi^\i gaine, faîne; en 1878, elle a
En
depuis
donnait éternument,
elle
choix entre
le
11
les accents.
fait
disparaître
laissant dans faîne, qui n'avait cepen-
le
que par analogie avec gaîne (vagina, oîi / est
devenu gaine, puis gaine; fagina (i bref)
faine
A gaine, devenu gaîne
donne
(et non faîne, ni faîne).
(gaine) comparons haine ["ha(t)in«], haine, qui ne s'est jamais
dant
l'accent
long,
donnait gaine,
écrit
haîne
cela
(tout
En
illogique).
est
en 1878,
En
emmaillo-tt-aient
nos
1835,
Immortels
depuis
démaillo-t-aient;
maillo-t-ent.
En
depuis 1878.
f-è-ve,
aujourd-hui
1878,
elle
les
ils
et
et
les
les
dé-
mais f-é-verole,
f-è-ve,
en 1835, r-è-gle, mais r-é-glement,
f-è-verole;
mais
règlemerit,
règle,
goélette.
enfants
les
emmaillo-t-ent
1835, l'Académie écrivait
règlement
(adverbe),
compl-é-tement (substantif
mentaire; en 1835*),
l'Académie
1835,
donne goéland,
écrivait goéland, goélette;
régle-
adverbe); en
et
Vers les années 1875—1877
grammaticales nous promettaient que l'Académie simen partie l'orthographe en faisant disparaître Vh après
1878, complètement (subst. et adv.).
les Revoies
plifierait
t dans tous les mots ayant deux h se suivant de près, et
nous aurions eu rhytme comme rhétorique, rhume'-'''-'). L'Académie
a préféré agir ici au petit bonheur ~ elle est coutumière du
le
—
fait
après
en
le
écrivant
dans tous
t
diphtong'ue,
thongue,
années 1875
— 77
orthographe
on se berçait de
plus
simple,
1878 nos 40 Immortels
Le
*)
en
ajoutant
Dict.
Dict. général
plus
que
ici
les
l'espoir d'arriver bientôt à
une
diphtérie,
a
n'avaient
vu que
avons
une
dans
déception
la
de
édition
leur
accepté que quelques change-
donne compl-è-tement
nous
etc.
aussi
rationnelle,
que quelques-uns seulement
ignore
Vers
diphthérie,
grande lorsqu'on
été
a-t-elle
rythme (1878), mais faisant disparaître Vh
diphles autres mots ayant d'abord phth:
(adv.),
compl-é-tement
compl-è-tement
écrivent
Académie,
seule
(subst.),
Le
(subst.).
maîtresse
de
fixer
l'orthographe.
**)
Comptant sur ces promesses,
imprimée dans
l'abrégé
les derniers
de 1881
(par
mois
rythme).
j'ai
de 1877,
Je
écrit
trouve encore
dans r Histoire élémentaire de ta littérature /r.
édition de 1898).
Il
n'est pas le seul
1835, on en trouve après
été publiée.
lui
qui
la
dans
de
qui soit resté,
regardent encore
ma grammaire
que
rhyime,
la
J.
j'ai
vieille
Fleury
du
graphie
(p.
la
dans
rhythme
15 et ailleurs,
l'édition
de
dernière qui
ait
en écrivant,
comme
de 1878,
corriger
à
Accent grave.
12
ments
ceux qui demandent une orthograpiie plus
logique ne seront pas moins déçus en recevant, vers 1920, la
future édition du dictionnaire.
Il
suffit, pour en juger,
de lire
le
insignifiants, et
rapport
par
fait
M. Emile Faguet au nom de ses collègues
aux réformes proposées par la Com-
de l'Académie en réponse
mission instituée par
Ministère de l'Instruction publique (France^.
le
a à compter ni sur les Quarante ni sur
aveuglément soumis à l'orthographe dite officielle,
du dictionnaire de l'Académie.
Il
n'y
écrivains,
les
qui est celle
Accent grave.
L'accent grave se met sur les
non
e
Pè-re, mè-re, frère, fève, orfèvre; je pèle,
je j-e-tte
prép.),
mais expr-e-sse,
espèce,
;
mes,
les,
système,
prononciation
ac-cès,
syllabes ouvertes
les
etc.
dilèni\
tout cela est pour le
Remarque.
mais j'app-e-Ue,
décès,
Nous écrivons crème,
pro-cès,
J.
J.
j'achète,
mais
Rousseau
mais
des (dès,
ces,
écrivait
crème,
Nous avons
mais extrême, suprême
encore dans quelques grammaires en retard.
{e
long
en grec
Dile?nme, gemme,
{e long en latin).
la
—
tes, ses.
ce que nous trouvons
problème,
dans
deux consonnes:
suivies de
et
en
latin),
lemtne ont conservé,
gèm\ lèm\ mais femvie
mieux dans
la
(femina)
du grec
et
du
latin,
se prononce fam-ej
meilleure des orthographes possibles.
Gemme, d'abord
écrit
geme
(la
langue
vieille
que bien rarement les consonnes doubles), s'est
cependant longtemps prononcé et même écrit jamme {a nasal).
De même fem(!)na (fem'na), qui avait d'abord donné feme {i
atone tombé, ainsi que n-) dans le groupe 7nn), est devenu
famé {e monté dans l'échelle des sons, et a devenu nasal).
Pour mieux marquer la nasalité on redoubla la consonne dans
n'admettait
*)
Pour
la
chute
de
(hominem), home, devenu
dans
\'n
homme
le
groupe
nin,
{on anciennement
comparons
nasal
comme
koninem.
:
dans bonne,
=
primitivement boue
bonam), dom'na (domina), dame [a non expliqué)
damnare, daner, devenu inutilement damner, mais encore prononcé dâner et
non dam.-ner; germ.(i)narc germer; lum,(i)naria, lumière (lumiuaire, forme
semfijnare, semer; an{i)ma, an-e-me {e médiat non prononcé), anme,
savante
ame, âme (1798); * carm(i)na (carmen), charme (masculin sous l'influence de
;
,
;
carmen, neutre).
La chute de
la
voyelle atone rendait longue
la
voyelle précédente
:
as'mis
âne (depuis le XlJe siècle Xs médial ne s'est plus prononcé dans
mots); an'ma (anima), ame, qui n'avait aucun besoin d'avoir l'accent sur a
(asinus), asne,
les
pour que
la
voyelle fût longue.
prononcé dam-ner
(a
nasal),
Damner, venu
après
daner,
s'est
longtemps
se prononce maintenant drt'-ner {a fermé, tandis
que
Accent circonflexe.
mots où
les
famine on
syllabe
la
écrivit
un son
avait
femme
grave
L'accent
de 1531.
date
s'employa
11
muet de refermé: aimeè,
pour distinguer les mots /a, là; ça,
distinguer \e
tablé,
et
çà;
ensuite
servit
ctèl,
de
de charretier)
(terme
verdure,
fermeté,
Dans
etc.
ou, où;
grave
L'accent
à.
etc.,
des, dès; fa
V hiver,
V enfer,
fer,
le
pour
d'abord
guère, guerre,
(d'où: déjà); a,
j'a
marquer Ve ouvert:
à
de
lieu
avec am, an).
prononciation
la
au
mais,
nasal,
Ve de f-e-mina iem nasal
en reprenant
bonne heure dans
confondu de
13
le
Télémaque de F^énelon on
le
ne trouve pas encore (1712) l'accent grave dans aimereiit, chantèrent,
dernière,
Crète,
liim,iere,
etc.,
V Emile de Rousseau
autant de
peut en dire
et l'on
etc.,
(1762).
Accent circonflexe.
L'accent
indique
circonflexe
d'une voyelle
suppression
la
ou d'une consonne:
Gaieié,
gaîté
remerciement.,
;
éternuement, êtemûment
(d'où côté,
mais ass-u-rer,
donc
là,
a
époque
"1.
est ouvert
—
il
n'est
que Va se prononçait
Dans les mots
—
trône.
dans condamner (con-da-ner).
—
Dans
pà-tir (mais com-pa-tir)
le
pati Va est
latin
nous écrivons
;
il
bref,
et
plaît (placet),
tait (tacet).
•)
Le XVIIIe
notre langue,
arriver à
Les
de mots pour
(l'accent
mais \a y était long avant
extresme, extrême; supremus, suprême.
ne prononce plus
l'on
âme;
était long,
mots
siècle
on n'a
on
et
sans
il
ne s'occupant
certainement
a
voulu
doit
accent
:
pas
ni
femme {em
pas plus
que
le
axiome,
même
idiome,
à
mots ayant
pour grâce
arôme, tome
l'accent:
de
XVII»^
anme
simplement mieux indiquer,
tout
les
dam-ner,
pensé à remonter
en avoir été de
Vo long tout aussi bien que
ni
nasal),
daner ou dâner, famé.
faudrait retourner à l'ancienne graphie
Va
siir (contrac-
sur),
date que de 1798,
Extremtis, extrême,
Aujourd'hui que
il
indiquait
throsne {o devenu long),
l'accent ne
cependant nous écrivons
mais
non prononcé,
(s,
pâle; tkromis, throne,
grâce, infâme, âme,
cette
(lisez
etc.
tous
Pallidus, pale, pasle
long),
;
âne; coste (Costa), côte
tard l'accent
à
dévoûment
dévouetnent,
;
[as(ï)nus],
a été mis sur beaucoup
que la voyelle était longue
en réalité, que pour les yeux):
Plus
indiquer
asne
mais coteau); stlr (securus, seûr, seur
etc.,
d'oii sûreté,
tion),
remercîment
rester, arrêter;
;
et
l'histoire
par l'accent, que
pour infâme.
(atome),
Côme,
il
de
(anima) pour
chôme,
zone,
le
—
ont
dôme,
Brantôme, fantôme, symptôme.
Pourquoi,
dit
non sur arôme, sone,
l'Académie
Littré,
etc.,
la
met-elle
un accent sur
prononciation de Vo étant
la
même
cône,
dôme,
et
dans ces mots?
Accent circonflexe.
14
supresme, suprême; rot(u)lus,
devenu
pôle,
L'a est bref dans
(1540
— 1614)
est
fermé,
mais
Va
est
fermé
dans
ème, %^%\.-èmt.
suprême, où
ouvert dans patient,
est
comme dans
nous
dit
L'accent
comme ème
ne
rend
(cf.
—
La
dans problextrême,
d'écrire
probl-è-me,
cô-té
racine);
chasse
que
l'accent aigu
ii-mAes, îi-mt; re-p?-mes,
l'accent
probl-é-matique;
pas
l
'o
dans
long
coteau), rô-X\x, 2\-mâ--m^%,
re-ak,
re-^z^-tes,
etc.,
etc
l'accent disparaisse
dans tous ces derniers
La voyelle se prononce généralement brève dans:
a-rê-te, ar-rê-te, ê-tes,
dî-ne, é-pî-tre, gî-te, bû-che, flû-te,
maires donnent encore
L'Académie
la
bonheur.
fr<2/-chir,
etc.,
Elle
g<9i'tre,
règle pour
de
tout se
dérivés,
les
fait
*j.
de
l'emploi
encore
ici
au
bâtard, bâtardise-"}; fraîche, ra-
bât,
écrit
longue dans ces derniers mots
n'a pas
française
gram-
voû-it, hâ-ioX, quoique les
croù-te,
comme
voyelle
l'accent circonflexe dans
petit
dans
l'indique.
(même
-j-//"
préférable,
(cf.
circonflexe
demandent même que
(nos philologues
mots).
fi-^z'-mes,
même
mieux par
su-pré-matie
hôpital, et la voyelle n'est guère longue
il
Brantôme
et
dans
ouvert
châsse,
qu'il serait
ex-lré-mité,
ai-mâ-tes, ai-mât,
passible,
supr-^We se prononce
extr-i^wze,
syst-é-matique).
syst-è-me,
patir
écrivait
Dans passion, sans qu'aucun accent nous
tasse
Littré
— 1553)
l'accent grave se remplacerait
dans
circonflexe
—
il
eme dans
terminaison
polus, pôle,
rôle;
cependant nous avons pâtir*),
(souffrir) et
(1495
Rabelais
compatir.
Va
pati
latin
le
compatir.
de
côté
à
rolle (/ assimilé) rosle,
rotle,
etc.
goitreux, ihéàire, thé-â-tral;
-telette,
cr<?//te,
-teux, -tier, -ton; châsse, -sis, enchâsser; crête, cfêté; pâle, pâlir,
mais
-leur,
as-su-rer, etc.
s/ir,
matique, drôle, drolatique,
conique, diplôme,
cône,
;
acrimonie,
acre,
-nieux;
diplo-
grâce, gra-
cieux, etc.-"-); infâme, infamie, diiîamer; jeûner, déieuner; pôle,
que
molécule;
môle,
polaire,
coteau;
mais
lalrie,
crusse
je
croître)
voûte,
mais
voûte),
(vieux
*)
cru,
l'accent
mais non
la
crue
en 1694
L'Académie,
crûs
je
dû,
(croire),
-taille,
promu
On
-té.
("
;
(croître),
mais due,
ôoile,
écrit crtt
(participes
dans voùle
devenus
mais
(parti-
sub-
voluta, vol'ta, volte,
l'accent est
dans absoute (• absoluta)
mais est tombé dans chute
fleiite),
fr.
;
Nous n'avons pas
cheùte).
fr.
futaie,
le
dans flûte (vieux
resté
comme
mais
Nous avons
stantifs).
crusse
mais
côtoyer,
côtelette,
iconolâtrie;
(mouvoir;, mais mtte, ému,
boiter, boiteux; /ât,
cipe de
comme
(croître)
mû
indu, indue;
côté,
côte,
idolâtrie,
(1ère édit.
du
l'accent
Dict.),
dans chas, mais
écrivait
patir
(sans accent)
compatir.
**)
A
bâtard,
aussi paillard.
***)
en 1878,
En
comparer
Voir Littré ou
l'ang.
le
bancard, engendré
1835, l'Académie écrivait ^a/«<',
elle écrit ces
sur un banc; comparer
Dict. Général.
mots sans accent.
^a^i'/z/<?r,
ma\% dégainer-, dégaine;
Accent circonflexe.
il
dans
nécessaire
est
donne
(capsa
-stcre
qui
bague),
de
vient
dérivés
les
chasse,
et
l'ancien
15
chaste,
kasten) a perdu l'accent qu'il devrait avoir
avec chaton,
ainsi
petit
chaton
châsse);
ail.
enchâsser,
châssis,
châsse'^)^
non
haut
mot
(le
confondant
se
L'anglais toast (rôtie),
chat.).
de
(tête
moderne
(ail.
to
toast
donnent en français
toste, toster ou toast, toaster (même prononciation), tandis que
la contraction devrait nous faire écrire toste, tôster, ce qui nous
rapprocherait de la prononciation anglaise et de celle de Chafaire
(griller,
un
porter
rôtir,
toste)
toast,
teaubriand, qui écrivait toujours dans ses lettres toast, toaster.
n'y a pas d'accent
Il
dans racler Va
Le
{racler).
plus anciens
rascler,
mais dès
sans
Quelques-uns, conformément à
s.
les
rapporte à rasi-
l'on
de
écrit râteau-
fermé
est
que
sur racler,
mais on
culare (ras'culare),
la
latin
même
famille,
aurait
dû donner
mot
textes le
et
s'écrivait déjà
prononciation, écrivent
la
mais ce n'est pas académique et ne l'a jamais été.
Quelques-uns écrivent ckûte qui, logiquement, a autant de droit
à l'accent que flûte (voir quelques lignes plus haut).
racler,
A
la
du XVIP
fin
IS^ on
du
quarts
défini dans:
que
dire
sut)
c'est Voltaire
graphe) qui, pour
Montesquieu
falû,
et
L'accent
(Montesquieu
encore
de
purent,
ils
a
premiers
les trois
circonflexe au
On
etc.
etc.,
comme
viï,
vu,
sçû,
mots;
pu, reçu,
disparu
a
sur
à
il
peut
encore l'ancienne ortho-
amené l'orthographe
a
sçavoir,
passé
reçurent,
actuelle.
Voltaire
reçu.,
Pascal, dans ses Pensées, écrit
circonflexe
beaucoup
dans
dans
sçûre^tt (surent),
ils
savoir, su, vu, reçu, etc.
connu, fallu
reçût,
il
les accents,
écrivait
même
et
encore l'accent
put (pouvoir)
il
(maintenant
sçût
siècle,
trouve
la
quelques
:
il
fût,
etc.
du XVII^ siècle
autres, déjà dans le
fin
courant du XVII*^:
Lasdi'e (Lazarus), ladre, ladre; osiage
(*
obsidaticum, influence de *hospi-
coutume;
tatictifn),
otage, otage; côte, mais coteau; coustutne, coutume,
couture,
couture;
plutôt;
vaslet (varlet), valet (pour vassalet); joustc, joute, joute (juxta, auprès),
tousjours (XVI^
siècle),
d'où jouster, jouter, jouter, ajouster,
la
moule,
*)
mot
a
la
toujours,
ajoiiter,
C'est certainement
l'accent sur a,
mais
pour
le
distinguer
des, dès,
ozi,
coushire,
plustost,
plutôt,
ajouter; mousle (*muscula), moiile,
moule; mousche (musca), mouche; risposte
chasse
contexte permettrait-il
C'est aussi soi-disant pour éviter une confusion,
là,
toujours;
et
risposta), riposte;
(ital.
châsse
jamais
de
que ce
les
que nous avons du
dernier
confondre
?
et dti, la et
où, a et à (tous ces accents de distinction devraient disparaître).
16
Cédille.
rispaille
inconnue),
(origine
rouche, puis ruche
setier
(sextarius),
restif (restare,
;
oustarde
coudre;
ripaille
rusche
;
piestre (pedester), piètre
;
(avis
oxitarde;
tarda),
*mo'sterium),
rium,
étudier;
siaèi/ire,
cisdre, cidre;
sicfejra, sisdre,
Sporn (ancien
h*
ail.
sporon),
ail.
bosquet, bouquet, bocage
épervier,
il
même
en est de
ht
;
etc.,
;
luoutier;
épée;
espee,
studere,
estudier,
spath(u)la,
espalle,
Spierling,
ail.
*
éperlan
éperlenc,
esperlenc,
éperon;
boscum
Sparvari [Sperber),
ail.
;
bois,
(bas-latin),
esparvier, espervier,
les
amis
C'est Etienne Dolet (1509
l'accent
circonflexe
marquer
la
en
— 1546) qui,
voyelle ou
en 1609,
avec
premier, a employé
le
s'en
servit
d'une
mit l'accent
pour
(1555)
syllabe.
Dans
«jz-se,
bourg-^cz-
dernier cas, l'accent surmontait plusieurs lettres:
Poisson,
d'accord
mettaient
se
adverbes de manière.
les
Pierron
1540.
longueur d'une
de l'orthographe étymologique
s'ils
Voir plus loin
!
féminin pasnaie (de pastinaca),
le
(*pastionaticum, formé snx pastionem; pasci,
graphie
la
pascage ou pas-
s'écrivait anireiois
remplacé
etc.
Que de mots dont
leurs principes
a
ùe pasnage
devenu panag^e
etc.*)
(avis-struthio),
etc.
etc.,
auraient à changer
sie,
sestier
;
cousuere),
monasterhim (*mon'ste-
populaire),
Pacage (*pasc(u1aticum, de pascuum)
et
austruche
ostruche,
moûtier,
esperon,
quage; panais, devenu masculin,
paître),
lonche
{* cosere,
ministerhim (*min'sterium), mestier,
;
spatha,
établir;
establir,
cotisdre
;
smaragdus (*smaraldum), esmeralde, esmeraude, émeraude;
espaule, épaule;
d'oii
moustier,
mostier,
ruscd) est devenu
:
lotische (luscus),
rétif
rester),
autruche; Osterreich, Austriche, Autriche
métier {n tombe devant s dans le latin
(mot celtique
;
circonflexe
sur
le
le
/
d'une
non prononcée: bas-t-on, tos-t, fores-t**^).
Godard (1564 — 1630), en 1618, qui inaugura enfin l'usage
moderne en remplaçant par l'accent sur la voyelle précédente
précédé
i-
C'est
Xs
amuïe:
viennent
mots au
b-â-ton,
b-â-tir,
toster;
toste,
français
ang.
d'oij
t-ê-te;
for-ê-t,
toast,
to toast,
avaient
ils
d'écrire [bâton, tête, etc.) fut acceptée
t-ô-t
qui
(tostum,
Cette
disparu).
d'oij
ont rendu
ces
manière
par l'Académie française en
les mots ayant l'accent circonflexe par
ou d'une consonne disparue: gai-e-té, gaîté;
1740 dans presque tous
suite d'une voyelle
fene-s-tre, fenêtre; etc.
etc.
Cédille.
se
La cédille
met sous le
devant
*)
a,
o,
(esp. cedilla,
c
u:
zedilla^
devant se prononcer
commen-ç-a,
comme
commen-ç-ons,
Accent assez grand, surmontant
**) Accent circonflexe au-dessus du
aï,
t
de
diminutifs
eoi.
dans ces mots.
s
céda,
sourd
re-ç-u.
[s
Le
zeda),
russe)
XVI''
17
Tréma.
queue {c caudatumj, l'usage de la cédille
Avant son emploi leçon s'écrivait ieczon ou
au dessus du c, d'où l'anglais a fait
kcon, mais avec deux
le-ss-on en négligeant le c (lectionem), ou l'on écrivait receoil,
siècle l'appelait le
fut
long à
<;
à
s'établir.
^-
commencea,
il
receiù
nous reste
Au
lieu
(prononcé
cette
graphie
dottceâire, qui devrait s'écrire dou-ç-âtre (douçâtre).
maçon on
de
trouve dans
de
cza (ça);
reçu),
masson,
écrivait
Pensées de Pascal
les
orthographe que l'on
=^ leçon).
l'ang. lesson
(cf.
Tréma.
Le tréma
se
Saûl, Noël, haïr,
depuis que
Noël,
le
met sur
voyelles
écrit
mot ne peut plus
personne
que
les
On
naïf.
ne
e,
ïambe,
se lire
penserait
u:
i,
oii
jambe;
jamais
à
Israël, Moïse,
tréma est inutile
lé
inutile aussi dans
prononcer Nœl)\
mot de aiguë (aqua) dans aig'ue-marine
(pierre précieuse; émeraude d'un vert d'eau de mer; ang. seawaier-green colour), cigiië, contïgiië; Staël (prononcé stàl: M™^
aïgnë, pour distinguer le
de
Staël),
Maëstricht
aïeul, ouïr, 'S>di\ni- Sacns (= Saiiss),
Pocme, poëte (1835) s'écrivent poème,
faïence, glaïeul,
{=
Mastricht).
poète depuis 1878; goéland (1835), goélette (1835), goéland,
-lette
mots précédents finissant par ue
l'Académie française permet la double graphie aiguë ou aigiie,
Dans Fénelon (Télémaque) je trouve: les
ciguë ou cigûe; etc.
nues, jouet, epanouïe, et c'est ainsi qu'écrit encore Montesquieu.
Dans nos grammaires et manuels en retard je trouve
nous
suïons, vous suïez (suer), nous louïo7is, v. louïez (louer), que
nous sillons, etc., que n. louïons, etc.; n. arguïons, vous arguïes,
en donnant illogiquement arguer (sans tréma), qui se confond
alors avec arguer (prononcé arghé).
On ne met le tréma dans
arguer que devant e muet (j'argu-ë, j'argu-ë-rai, -rais, etc., que
(1878).
Depuis 1901,
dans
les
:
fargttë,
etc.,
chose bien
inutile
distinction), puisqu'à tous les autres
laisse partout,
quant à
la
(comme tous
temps
et
les
accents
graphie, se confondre arguer (ar-gu-er) et
argiier (ar-gher). Depuis 1878 les verbes finissant par ouer,
prennent plus nulle part
suiez (suer),
etc.,
le
uerne
tréma, on écrit: nous louions (louer), vous
mais beaucoup de
de 1835, qu'ils nous donnent
la
de
aux autres personnes on
livres
comme
la
en sont encore à l'édition
plus récente.
Le XVIII* siècle, jusque chez Montesquieu,
vi^ë, une somme dûë, la joué, il joué, il loué,
écrivait: la nuë,
etc.
2
Apostrophe.
18
Apostrophe.
L apostrophe
e
indique
suppression d'une des voyelles a
la
ne s'élide que devant
(1'/
l'âme (la âme),
L'enfant (pour le enfant), l'histoire (la histoire),
(si
agglutiné
resté
L'article est
(comme soudé) au
dans plusieurs noms propres ou communs;
mots
même
s'y est
il
Lil/e
Lorient
de
(ville
encore
est
trois
siècle),
siècle.
propres, dans lesquels
est agglutiné,
l'article
citer:
Lebrun,
Lallemand, Langlais, Loiseau,
Lesage,
Lenoir,
souvent
écrit plus
Sage, Leroux, Leblanc, Lacaille, Lacroix, Ladvocat, Lemercier, Lebègue,
Lafoniaine,
vieille
La
graphie de
(hed(e)ra),
l'ierre
d
de
laudier
(ancien
=
à l'ors
main
écrit
=
le
grand chenet)
à cette heure-là
(lat.
=
loriot
endit
(indictum
=
andier
le
le
mane,
comme
lorsque
;
=
le
(jour)
en
adverbe en 3
mots
=
matin),
armes (dans l'armée
=
(à)
à
l'en
(ital.
entendu lociim, sur un lieu élevé pour
—
,
les
dans
(de-intus)
*)
comme
foire,
dans
on
l'avenir);
disait aussi
facilement.
La
*),
alors
=
^
faire le guet)
;
amont
(ad montem), aval
atours d'une femme), atout; doi'énavant (*de-
dont (*de-unde);
(*
de-ex-hora-magis, de cette
dinde (dindon)
=
de l'Inde;
en déans""^); davantage*).
langue aurait
vieille
écrit:
Je ne
et vice versa,
crois
pas qu'en
davantage (d'avantage), hormis l'honneur,
Et le
car vous ne recevrez pas davantage (plus d'argent qu'auparavant).
XVIe siècle, heureux de connaître l'apostrophe, aurait pu écrire: Vous ne recevez
prenant cette
place vous ayez
là
(plus
qu'auparavant).
XVI»
L'abus
de
comprend très bien,
On trouve enz (intus, à
elle
enl (dedans en
Un
—
siècle se
**)
plus
d'avantage (aucun avantage),
point
le)
fou (feu)
pel (pieu) aiguisie que
la
cil
;
=
=
;
Le passage de davantage (ou d avantage) à d'avantage
comprend
congé),
(mot anglais)
ingot
le
;
hora-in-ab-ante, de cette heure en avant), désormais
(loin
y a
que lendemain
le en de
alentour
à l'entour (encore
tour); alarme
à la arme, aux
alPerta ^= ad illum erectum, sous-
l'heure
demain
ipesora), a/erte
(ad vallem), atour (dame d'
heure plus
=
lingot
;
il
aux plumes
(l'oiseau
oriot
jour fi.xé
;
lierre
la uette (uveita, petit
hora, avec Y s finale caractéristique de plusieurs adverbes
illa
=
lendit
dans le
=
comparaison),
par
raisin,
dor),
Pierre, écrit ancien-
assimilé,
=
grain
—
citons:
iedre, ierre,
nement lierre, l'apostrophe n'étant pas encore connue;
le l'ierre); Inette
donc deux fois l'article: le lierre
couleur
etc.
Fontaine.
Comme noms communs,
Lierre ^=
se
(XVe
par Villon
l'Isie
écrit
encore rOrieni au XVIII"
contentons-nous de
substantif
dans deux ou
agglutiné assez tard:
France)
s'écrivait
(ville)
Comme noms
lors
vient
s'il
vient), s'ils viennent.
il
Le
et
ils):
il,
car
dans
pas d'avantage
quelques
mots
en montrait
la
composition.
dans
la
Cantilène d'Eulalie:
l'intérieur)
getterent;
vous ne recevez
l'apostrophe
et
[(* ec)ce-illi]
au
Enz
de dens dans Aucassiii et Nicoleite:
de denz avoient
jeté (XVI, 25);
on
19
Apostrophe.
Voici d'anciens exemples qui prouvent que dans l'ancienne
langue
s'employait
l'article
devant
déjà
mots
les
soudés
ainsi
(voir Littré):
out
rois
Li
XlVe
Besancon tout
(eut)
Le
siècle).
ne
roy
lendemain (Girari de Ross.,
le
droit
au (=
voulut jusques
le
lendemain
à le)
(Bibl.
des
Le lendemain du premier jour de may (Ch. d'Orléans).
Estant
Netayer les sales et
arrivée à Limoges le lendemain (Marg. de Navarre).
coupper le lyarre (lierre; XVe siècle). Dans la toute vieille langue on Irouve
Chartes).
herrc,
edre, eedre, eyre,
y être ; on
aura dit
ensuite
le
lierre
ierre,
comprenant plus:
contraction), et plus tard, la soudure ne se
(soudure
et
le oriol,
le lierre;
le loriol (loriot), etc., etc.
loriol,
Aux mots qui précèdent ajoutons:
ApuHa (l'Apulie), devenu, dans la langue vulgaire
Lapouille^
puis séparé:
(soudé),
forme
(l'Anatolie
savante)
;
g
forme
agglutiné
l'article
La Natolie
Lanatolie,
savante)
Laguienne
,
La Guyenne.
au milieu du mot),
plusieurs des mots arabes introduits
Alambic,
alcade,
(nom
aldébaran
(al
chambre à
—
-f-
wazir
dans
le
français
=
étoiles),
aimée
visir),
alcool,
algèbre
(al
^^^'A
-f-
le
ou
coran
savant)
;
alcôve;
l'alcoran,
réunion
(al -f- dj'eèr,
Koôa
de termes),
(alcôve) signifie
:
coticher.
Davantage,
oii
de élidé
était
comme
adverbe.
Comme
reconnaissable
facilement
dans
histoire
alchimie,
alcali,
des
d'une
stantif, est resté
aussi
avec
Aratolia,
al est aussi uni Csoudéj au substantif:
l'article
alguazil
Poiiille;
Aqttitania (l'Aquitaine,
{q changé en la consonne douce
Dans
La
Ihistoire
toujours uni (soudé) au subsubstantif, le
mot
racine,
que enfant dans lenfant,
(l'enfant,
que
de
séparé
s'est
l'histoire)
la
préposition, devenant ainsi d' avantage.
Froissard
pu
n'a
écrire
que davantage ou
séparant les mots sans apostrophe.
comme on
vait
écrivons
d'avantage (adverbe)
écrire
XIP
et
Froissard (XIV* siècle, écri-
le XV!** siècle
(Littré
Voir
—
(si)
nous fuions, nous sommes perdus dayantage {Chroniques, IV,
Au XVI*
siècle, d'oili
Et que peut
éd. de 1604, p. 24).
ici
Je vous
on
le
78).
le Dict. général.
date l'emploi de l'apostrophe, on trouve
davantage pour
d'avantage un homme
parfois la graphie
voit
se
siècle):
Se
—
mot aujourd'hui
le
avantage, en
et comme nous
trompe en lui faisant
davantage;
avantage date du
avant
faisait
le
(1
—
C'est
comme
l''
de
adverbe:
valeur?
l'assiégé résiste
(Montchrestien,
d'avantage
{ibid.,
Hector
p. 25),
—
de dans (dedans) en deux mots
livrerai
cette
marchandise
et dens (de -{- enz) sans apostrophe.
endéans les trois mois (le mot a vieilli;
trouve dans Bescherelle, mais Littré
et
le Dict.
général ne
le
donnent
2*
plus).
Apostrophe.
20
Je trouve dans Brantôme:
D'arantage (de plus) quel tort tient on
—
Il
en
lui
oppulant
(II,
encore
reste
(l'aYantage
Je trouve dans
le
Encore y
Iniroductïon,
nous
L'apostrophe,
vieux français
— Voici
allasmes à son
précédé
Prince coucharent
(Brantôme, IV,
lever
Brantôme
Mais
350;
Je ne
A
la
déjà,
(=
note
dans
mot
ce
que du XVI®
siècle,
comme
(d'avantage)
aujourd'hui lendemain
ensemble,
vieille
et
langue
nous
l'eiideinaiii
eût écrit sans apo-
comme
nous
le
ferions,
l'enmatin, l'en matin):
pas de l'entretenir tout un
faillis
;
cet
159),
p.
etc.).
emploie
devant lenmafïn
l'article le
X,
date,
de,
r endemain,
siècle,
le
Et lendcmaijt nous allasmes
8
estoit
il
plus).
M.
et
ne
de
davantage, subst.
écrivait
=
au XVI®
Luy (Guise)
(III,
(IV, 273).
tant
qui dépravent le langage.
répétons,
le
substantif
davantage (adv.
d'hommes
bien d'avantage
a-t-il
employé comme
matin
stiffisammeiit)
lexique des œuvres de Brantôme (édition
Grands écrivains français,
exemple d'Henri Estienne:
strophe:
de
144).
des
le
iMadame de Nemours
à
(sens
soir à
soupper
et
encore le len-
2).
enmaiin (lenmatin avec l'article agglutiné) compain hoc die, en ce jour =^ aujoitrd'hm')^.
(in hodie
employé par Brantôme:
cet
=
rons einiity
Nos vefves (veuves) d'ennuy
des pierreries
On
trouve
aussi
(de maintenant, d'aujourd'hui) n'osent porter
Grands Ecrivains
édition des
(IX, 638,
Brantôme
dans
français).
enderier
moment), endevant (au devant).
A ces mots comparons encore comme
resté
dernier
(au
de
toute
la
langue (préposition agglutinée en certains mots au substantif):
vieille
donné
In odio, qui a
marquer,
avec an).
disait-on, le
— In-atnico
enoi,
son nasal
emd
de
{en nasal), ennui [n redoublé pour mieux
eit^
(inimicus), enenii
confondu de bonne heure, pour
(cf.
l'ang. eizemy),
où en
était nasal
son,
le
(=
an)
;
—
En est
devenu également ennemi (an-ne-mi), prononcé maintenant ènn'mù
resté nasal devant une voyelle ou h muette dans: enivrer {Q.n Suisse j'ai souvent
entendu é-nivrer), enorgueillir, énamourer, enharmonie^ enherber, et enôcher
(qui a vieilli).
Voici
—
Dans
des
en-n-^xn\, en est Vin négatif latin.
exemples
tout
opposés
oii,
par une
compré-
hension également erronée des mots, VI initiale a été prise
pour
l'article élidé:
Lasur (mot
* lyncea
d'origine persane,
(lynx, le lynx),
naturalistes disent
un
prononcé
once).
comme
luncea,
a
est devenu aznr)
devenu once (sf. les
lasîili,
lazuliie)
donné
lonce,
:
;
Apostrophe.
—
donnait diinl {d devenu
* De-itnde
Le mot, dans
don/.
autrement
écrit
fois
seulement
Ce
n'est
la
dans
XV^
sortir d'oiid
lorsque
siècle,
sortiray
—
(Id.).
On
Voir
Et
—
li
pri
dont
=
ne onque, ne onc
3).
nez?
=
ne jamais).
qui
ne
comme
Un
rei
pas
peut
dont
de
d'alentours
homme.
cet
rapprochés:
d'une forteresse,
Aleni02ir,
(la
ce)
dont (pronom)
poignée)
dor
fut
de
Les
Le mot entour
pluriel.
s'emploie
plus qu'au
est
pluriel,
et
amis intimes, serviteurs qui
sur elle de l'influence:
On
cependant,
Je crains
avec
le
sens
entours des Tuileries (d'une
ville,
dit
etc.).
d''alentour
alentour, les villages
s'emploie
ponz
ce n'est plus qu'une expression adver-
avoir
entourent une personne et ont
entours
li
siècle)
parler (72).
de parents^
sens
le
dont
oït
ai
qui ne
substantif
souvent avec
Savez (vous savez
(148).
Sespee (s'espee)
226).
— Quant à à fenfoitr,
ne
ne
est
il
(d'où) estes
(prie;
mier (merus, pur;
biale,
je
dans la CanHlène de
(IX^ siècle)
employé comme pronom:
enortet dont lei nonque chiet qued ele fuiet le nom christien (et il
ce) dont ne lui chaut qu'elle fuie (abandonne) le nom chrétien
(à
Sire,
vos
les
dont jamais
C'est un enfer
Et ailleurs:
un-d-e:
vient le songer qui
Dans le Voyage de Char/emagne à Jérusalem (XI®
est employé comme adverbe et comme pronom:
dont
resté
me
D'oiid
l'apostrophe
d de
le
dont
déjà
oti
{nonque =• nun-quam
je
(Id.).
de
l'emploi
Littré.
trouve
sainte Eulalie,
l'exhorte
s'est
d'ond avec
—
(Marot).
es entré
tu
me maine?
devers vous
du mot) et
presque jamais
fin
la
don deux
nombreux exemples que donne Littré)
les
entra en usage, que l'on trouve parfois
Pour
ne
langue,
vieille
à
/
toujours sans apostrophe (on trouve
et
qu'au
21
qu'au
sont
pluriel:
comme
restés
d'alentour.
Les
—
Comme
adverbes:
substantif,
alentours
de
la
rôder
le
ville.
mot
Cet
homme est dominé par ses entours ou ses alentours. Je ne
me fierais pas aux entours (aux alentours) de cet homme.
Comme adverbes, on écrit indifféremment:
rôde à l'entour
il
ou
alentour.
Devant
qu'il faut écrire:
Il
la
préposition
de,
à
c'est
Pentour
rôde à l'entour de notre maison (voir Besche-
Telle et le Dictionnaire général contre Littré).
Un mot
c'est sens,
curieux qui ne s'explique que par
dans sens dessus dessoîts,
compréhension erronée de
<».en
dessus dessous.
cette
qui
locution.
Henri Estienne (XV®
vieille
la
provient
Le XV®
siècle),
aussi
langue,
d'une
siècle écrivait
qui comprenait
Apostrophe.
22
que c'était, écrivait: cen dessus dessous. L'intelligence du
mot cen s'étant perdue, Vaugelas (XVII* siècle) écrivait sans
ce
dessjis
dessous.^
Sévigné suivait
de
M""*
et
orthographe.
cette
Ménage, d'accord avec Pasquier, écrivaient sens
dessus dessous, en donnant à sens la signification de direction^
Chapelain
de
et
comme
côté^
mis dessous,
qui dirait:
comme
encore
c'est
et
locution
vieille
devrait
qui devrait
côté
le
depuis
l'aurait
voulu:
signifie: ce (qui devrait être)
dessus
H.
devrait
dit Littré,
reprendre
plus
Estienne
même
à
réaliser,
dessous.
Même
vicieuse
cen
qui
L'Académie,
de sens pour
d'autant
est
sens
et
la
l'apostrophe,
Ce changement
que
ajoute-t-il,
—
prononciation.
de
dessus dessous,
c'en
(est)
Or,
écrivons.
l'emploi
l'orthographe
rectifier
bonne graphie cen.
la
facile
nous
que
ainsi
être,
dessus est
être
ont
ici
la
chose avec c'en devant derrière.
Voici quelques exemples avec ce et cen^"):
metent ce devant deriere (Rutebeuf).
Il
dessoubs ou
dessous
(Froissart,
XVI»
(Coquillart,
dessous
pot (Menagier,
(au)
la terre
II,
117).
Tout
Ballade
cotitre
2,
siècle,
On
8).
I,
(Gringoire, le
Retournez
pour
les
vous
Jeu du Prince des
cen
va
Amyot
(XVI* siècle)
que de Serres.
ainsi
desstts dessous.
—
—
sotz).
comme
Paré
les
II
derrière
cen dessus
tastonnoyt
(XVII*
dessus
dessous,
écrit très
bien cen
s'en
Littré.
ta,
sa,
s'élidaient aussi
devant les
commençant par une voyelle ou une â muette,
l'article
cen
11).
I,
comme Vaugelas
écrit:
L'Anglais Palsgrave**)
Voir
Les possessifs 7na,
substantifs
déjà
écrivait
dessus dessous.
devant
Renversez
Princes).
dessus dessoTis, cen devant derrière (Rabelais, Gargantua,
siècle) sans
lamproie ce dessus
la
tourna au duc ses armes ce dessus
s'agglutinaient
défini,
(se
soudaient)
au
et,
sub-
stantif*):
Mande (= ma
dans
le
amie),
vieux français),
tame
mamonr
(talme,
(==
ma amour; amour toujours féminin
pour ta ame (âme), sespee = sa
tarme)
espee (épée).
De
la
compréhension
ma mie {ina pris
mamour est resté ou est
a
fait
*)
erronée des mots ainsi composés on
erronément pour l'adjectif possessif);
devenu m'amour: faire des mamours
Les éditions sont mauvaises, qui font écrire c'en par Froissart, l'emploi
de l'apostrophe ne datant que du XVIe siècle (Froissart, 1337
**) Paisgrave,
maire française,
né à Londres, mort en 1554,
enseigna
fiancée à Louis XIL
le français
à la
auteur
princesse Marie,
— 1410).
la première gramsœur de Henri VIII,
de
23
Apostrophe.
OU m'amours
se (sa) spee,
parfois
se
à quelqu'un.
pour
sa,
comme
au
devenu
(sa espée) çst aussi
initial pris pour le possessif élidé,
employé souvent au féminin pour la.
Le mot mie, représentant amie,
et
existait déjà
que l'emploi
avant
conséquent,
par
longtemps,
siècle,
XIII''
Sespec
se
le
—
Remarque.
—
de l'apostrophe fût connu (preuve que ma, dans mamie, était
La graphie m'amie
déjà regardé comme étant le possessif ma).
général,
qu'à l'époque de
Dictionnaire
ne remonte, selon le
Molière (on
trouve parfois cependant,
la
dans
je crois,
la
seconde
moitié du XVI'' siècle):
Seignor, ne vos mentirai mie (miette*), mica),
mie (amicam,
dont
amie),
jalons
fort
si
il
Fabliaux
(hospites, hôtes) avoit (Méon,
et Contes,
toutes
II,
t.
Lorsqu'on trouve inainie, m'amo/cr,
maires historiques
dans
et
les
doiens (doyen) avoit une
li
estoit
p.
les
ostes
nos gram-
dans
etc.,
récentes
éditions
que
fois
4).
sur
faites
les
anciens textes, l'apostrophe n'est évidemment employée que pour
une compréhension plus facile des mots toujours écrits sans
apostrophe dans les textes originaux pour l'excellente raison que
tamie, samie
l'apostrophe était alors inconnue.
Si mamie,
s'étaient anciennement écrits mamie, f amie, -s' amie, le mot amie
y
est tellement reconnaissable
que
mie en apocopant Va initial de
des mots où l'article le, la, s'est
Le possessif
disait:
le
n'ai
la
de Joinville,
mit-,
négation, vient
mangé mie
=
je
messeigneurs
mesdemoiselles.
messire de
Joinville.
dans
(le
Dans
—
jamais
en
il
uni (soudé)) au
monseigneur,
mademoiselle,
Le premier
*)
force de
je
sire
eût
et
est resté uni au substantif
Monsieur, messieurs,
dame, mesdames,
l'on n'en
amie"^),
mot
ma
même
fait
de
est
suivant.
:
sieur,
la
maon
seigneur),
langue
vieille
Situi- vient de
* seiorem.
employé dans la vieille langue pour déterminer la
de mica {mie, avec le sens de miette: de ce pain,
n'ai mangé miette, une seule miette).
Le second
mie, altération de amie, vient de arnica, amie.
Ce n'est qu'en 1878 que l'Académie a admis iiiamour, qu'elle écrit au
m'amours: faire des m'amours à quelqu'un. Dans son édition de 1835
elle ne donne pas l'expression:
mamottrs ; elle dit seulement que
faire des
mort amotir, en s'adressant à une femme qu'on aime, se disait anciennement
aussi m'amour
pluriel
**)
Au XIV»
Les grammairiens
siècle m,07i,
nous disent
me semble que
mais
il
ainsi
agglutinés (soudés).
loin d'être toujours
à
ce fut
la
ton,
son remplacèrent en
que ce changement
bien
pour
plutôt
fut
ces
cas
ma,
amené pour
faciliter
l'intelligence
La compréhension de ces mots devait, en
portée de tous.
Il
était,
certes,
bien réduit,
sa.
ta,
l'euphonie,
des mots
être
effet,
même
au
24
Apostrophe.
de seniorem, qui a donné seigneur; sire de *seior (senior), qui donne
devenu sire {e médial disparu et contraction de si-ire en sire) dans les
Serments de Strasbourg on trouve sendra pour senire (d intercalé entre n et r).
altération
sieire,
;
La
langue
vieille
unissait
ma,
la
la, sa,
pronoms me,
les
négation ne,
au
(soudait)
verbe commençant par une voyelle:
se,
te,
substantif
l'article le,
la;
le,
au
et
possessifs
la, les
=
l'adverbe se
si;
préposition de, mais savait aussi les détacher*).
la
Je trouve à la page gauche du double
Charlemagne à Jérusalem (XI® siècle)
Se (si) vos me avez mentit (24).
La plume
du Voyage de
texte
:
aguilon en main
Sa espee
25).
A
(826).
li
gap
ma
vos
que
Un
(286).
458).
(3,
le oust
Il
ma
jo tornet
ai
vos
deïstes
est
Ma
escamel de argent (291).
(il
orioel
ma
amur
les
l'article,
le
;
Ele ue oset
Si or ne sont remplit
(854).
vos
Trancherai
Le
(290).
espee dacer (d'acier
recatet (racheté, 451).
l'eiât)
amistet et
(646).
de
testes
od
(avec
=
apud)
spee (647).
Tandis que, page
me,
se,
te,
la,
le,
droite,
négation ne,
la
possessif,
pronom
le
sont soudés
préposition de
la
au substantif ou au verbe:
Se
mavez
vos
(si)
loust
(l'efît)
sespee (458).
optatif)
Sor
854).
Au
et l'on
(si
à cette heure)
treizième
(l'on)
achatet
A
vos
ne sont remplit
même
li
dacier
me
reis
ai
'
a
Il
(praestet,
prest
jo tornet
gap
(25).
mamistet
ceinte
subj.
mamur
et
(646).
dans Berte ans grans pies,
trouve
siècle je
chose ailleurs:
doit bien reculer por le plus loing saillir (368).
XV" chez Charles
Et au
Li
Laguillon
dorioel (290).
est
Mespee
(291).
(451).
Ele noset (826).
trouverait la
Loa
La plume
mentit (24).
Un eschame dargent
en main (286).
sespee (3). Il
Tost serons au lieu
que
(je)
d'Orléans:
vouldroye
que len
(l'on)
appelle Nonchaloir
{^Départie daniour).
commencement du XIX»
mots lierre
Pazur
et
*)
les
mots
de
(i
'ferre),
lotice
siècle,
le
nombre de ceux
lingot (l'ingot),
loriot
(j'oriot)
qui eussent
ou
pu expliquer
l'altération
de
les
lazur en
en Ponce.
Remarquons qu'à
cités plus
la
page gauche
les
haut sont détachés l'un de
vers sont de 13 syllabes lorsque
l'autre.
On vient de homo (cas stijet, nominatif), homincvi (cas régime, accu=
donné ome {h latin disparu), plus tard omme, homme. On trouve déjà
si cum cm
ont (homo) dans les Sermettts de Strasbourg (IX® siècle, en 842)
devint oms par
le mot
per droit son fradra salvar dift (doit). Plus tard
analogie avec les mots ayant s final au cas stijet, pour redevenir ensuite on {n
**)
satif)
a
:
final
au lieu de
ni).
Apostrophe.
Remarquons
mots
les
25
soudés
ou
séparés
dans
vers
le
suivant (page gauche):
Plus est riche (h eniperere) de ayer (avoir)
Corrigé, page droite, par:
Plus est riches daveir et dor et de
dor
(d'or)
de dcners.
et
deniers (27).
Les mots sont le plus souvent soudés dans le texte de la
page gauche et séparés par l'apostrophe à la page droite pour
l'intelligence des mots.
Menseinez
(enseignez-moi;
quant
(entendez-moi; 67);
il
lat
conduit (245);
(l'a)
{472); iiert (non
(non audivi,
si
pruz (28)
erit,
Page droite
Dans
souvent s
li
patriarches
sen
si
ne
cunreer
(141),
nen partissent; 256); pus (puis) meu irai
536); maportez (apportez-moi; 604); je noi
sera;
tesmaer
mie
ni (n'y) a (617); mais nest (n'est)
il
(ne pas t'effrayer, ne t'effraie pas, ne te mets
etc.*)
etc.,
m'enseigniez, m'amistet, m'entendez
:
mentendez
54),
vait
quil (qu'il)
Charles, ne
pas en émoi; 674);
(ma amitié;
mamistet
19);
(l'entend)
entendu) parler (577);
n'ai
;
lot
;
etc.
Voyage (XI® siècle) de Charlemagne on trouve
pour se (= si) venant du sic (ainsi) latin ou du si
le
(conditionnel):
Se
Sout
ne
(si)
sont
eut) prise
(ainsi
comme
vestige
Si vous le croyez,
;
remarquons se non
(s'esmaie,
fable
c'est
cosi
du i dans si devant il,
aura dû être abandonné pour
soudé
un)
à
il).
—
—
ils.
éviter
Voici se à côté de si:
celle.
Se
loin (langue moderne).
Se
Gziigeinar, 2).
(si
(633—34).
testes
Nombreux exemples.
damer
il
Nest
(n'est)
vos
(d'aimer) la requeist
merveille
huem (homme)
riches
(si)
les
Si matire (matière
51).
ci
se
vos
il
=
{id.,
sesmaie
trovast
(Id.,
11).
I,
Dans
est,
Stms
197).
les
Ve peut s'élider, qu'il nous
oij
de France, Lais, Prologtce,
sujet) bien est faite {ibid.,
61
se,
vous mènera
il
lor
Si (ainsi y) seront (20).
l'élision
Quant à selle (si elle), il
une confusion de son avec
pleist a recevoir (Marie
trancherai
gap,
li
(2).
doute de ce
C'est sans
est resté
remplit
corone
les
plus
quand
anciens textes
ço
est suivi
(ce)
Ve de est, c-à-d. du second monosyllabe qui
(co'stj
=
ce
est.
Il
en
=
(=
37);
ce est avis.
Voyage,
etc.,
de
est
suivis de en: sin, gin'n, luin
même
de
qui,
si,
en, lui en, qui en:
si
sin
(si
:==
de
disparaît:
lui,
Cost avis
ainsi en) donreit a
Rodlant {Roland, 491); je luin (lui en) conquis {id., 2327—28-29).
Cost (co r=: cc cst) l'arcevesques (voir la Chrest. par G. Paris
et E.
Langlois, p. 15, vers 25; 2240 de Roland).
le) se
rendait par enl et par
lettres,
au
etc.);
el,
d'où
ad-illos (à les) par as,
{^'ad-illum),
al,
le
—
'""In-illo
pluriel es (resté
(en
dans es
devenu plus tard ans, aux,
les mots masculins
auf /vocalisé en u devant
Adverbes de manière.
26
Dans
commençant par une consonne.
tombe devant l's
als (à les), IV
La corone el (en
chief (*
le)
chies
(=
à la tête, par devant; 99).
cheïr
20);
(id.,
il
tomber) as
(cadere,
Ste Eu/.).
piez
570).
Enl
trouve
iel
aussi
mielz
{id.,
fou (feu) la
corones
les
premier
6).
Il
chief
volt
li
As
(418).
getterent (Cant.
est al rei alez {ïd.,
144).
Deus
213).
{id.,
ciel
el
vont as ostels
Il
le)
Il
Devant
al
et
(en
134).
Voyage, 10),
89).
31).
{l'd.,
(en les)^
els
suit):
tête;
{id.,
Al plus bel
les)
ïd.,
;
-put,
mulz
vint al patriarche {Voy.,
Il
(Dieu) est encore el
On
—
(à
espondes (jusqu'aux bords
de
capum,
montèrent es
es
pluriels
les
final (qui
(jel)
pour je
nel pour ne
le,
le,
nés
pour ne les:
Que
iel
(jel)
die;
(Aimeri de Narbonne)
•
iel
etc.,
(je
le)
dirai.
Vos nés
Dans Aliscans, publié en Allemagne,
dent ne sont
le
ni
soudés,
ni
séparés
ordinairement pour une
fait
(ne les)
recoverrez
mie
etc.
mots qui précècomme on
les
par l'apostrophe
compréhension
plus
facile
des
mots cités plus
haut est aussi élidée en tout le poème. Les deux mots réunis
ne se trouvent que dans nen; c'est à peine si deux ou trois
fois on trouve n en pour nen:
mots, mais
L
escut
la
voyelle finale de
(il)
ot frait (16).
D
et
l'article
des
escus et d armes (20).
N
a
home
(32);
(II)
nen (n'en) istra (143). Au bran d acier (77). S (si) a 1 escut embraciet (145).
S en sont espoentant (228). L aubère c (qu') ot vestu (319). S espee (492).
S aumosniere (son aumônière; 344). S iaume (son heaume; 1002). M espee
Qui fist t espee mauvaise la foria (forgea; 1231). L espee au pon d
(1148).
or (1470).
S a (ainsi a) la coulor muée (1703). (A Dieu) comandat s arme
(son âme; n de anima remplacé par r; dans Rou on trouve plusieurs fois
aime ; voir mon Précis de phonétique, p. 74).
Adverbes de manière.
La plupart des adverbes de majiière se composent d'un
auquel on ajoute ment, qui vient de mens, mentis (esprit),
adjectif
qui a
dans
pris
le
Mens, étant féminin,
l'adjectif,
et,
etc.
les
de
la
décadence
sens
de
manière.
(cnacT.HHBbiM'b
oCpasOM'b)
;
lenic-mcnt (Mej.neHHbiM'b o6pa-
(cMacTJiuBo, Me;i;ieHHo).
Font exception à cette règle:
Y les mots finissant par ant
mots de
le
adverbes doivent venir du féminin de
en traduisant littéralement, nous aurons:
Heureuse-mcnt
soMi),
latin
la
3^
déclinaison
latine,
oîi
et
le
ent,
qui
féminin
viennent
est
de
identique
Adverbes de manière.
Le
masculin.
au
vieux
orthographe rajeunies)
Mon
français
27
même
de
disait
(langue
ma mère
père est constant,
est
constant,
d'où l'adverbe consiattt-
devenu constamment (/ médial tombé, et n assimilé devant mj;
père est patient, ma mère est patient (d'où patientment, patiemment).
mejtt,
Ain, em, qui avaient anciennement
le
et se
prononcent
man, pa-cia-man,
comme un
véhément (vehementem) font cepen(et
non: présemment,
Lentement ne forme pas une
diffère
la
seconde
ont perdu ce
simple a ouvert: cons-ta-
véhémentement
présentement,
véhémemment).
dant:
lente de
etc.),
etc.
etc.,
Présent (praesentem),
lent,
mon
son de a nasal dans
const-am-ment, pa-tieni-ment, (pa-ciam-man,
son nasal
et
:
3»
déclinaison
exception à ces
(lentum,
latine
mots,
car
dont
lentam),
il
le
vient de
féminin
du masculin.
Aux mots de
3^ déclinaison
la
[ans,
antis;
ens,
entis)
on
peut ajouter gentihs, qui a donné gentil:
Mon
frère
est
g'entil,
ma sœur
Grand, du
au féminin
Mon
latin
est
devenu
gentille), d'où l'adverbe gentilmejit,
grandis
gentil
:
(vieille
gentiment
(/
langue;
maintenant:
tombé).
(3® déclinaison) faisait aussi
grand
comme
père est
au masculin:
grand, ma mère est grand
(vieille langue).
De ce féminin grand il nous est resté des vestiges dans
grand'mère (grand'maman), grandchose, à grandpeine, etc., où
le XVII^ siècle
a eu grand tort de séparer les mots par une
apostrophe [grand'mère, etc.), et non par un tiret comme dans
les autres mots composés; la vieille langue disait grant mère,
comme mère grant (consonne douce d du latin gran-d-is, remplacée par la forte / à la fin des mots; cf. de-un-de, don-t, dont).
Remarque. — Mais si l'emploi, de l'apostrophe, conservé
jusqu'aujourd'hui, est ici une erreur, ce n'est pas une raison de
lancer, comme le font nos grammaires, une diatribe virulente
contre les grammairiens du XVII« siècle qui ont cru devoir remplacer par l'apostrophe le prétendu e final de grande [grande
mère, grand'mère).
de
On
ne
s'occupait
pas
encore
de
l'histoire
la
les grammairiens ne pouvaient pas savoir alors
que grand, dans grand mère, était un vestige de notre vieille
langue.
Le repioche devrait être adressé, non aux grammairiens
du XVII^ siècle — ils sont innocents, ne savaient pas ce qu'ils
langue,
faisaient
—
mais à l'Académie française qui n'a pu nous donner
Adverbes de manière.
28
jusqu'ici grand-mère, comme elle nous donne grand-croix (et
non g-rand'croix), L'Académie, qui devrait être au courant de
l'histoire du français, et l'est sans doute, semble s'opiniâtrer à
l'ignorer,
par l'Académie, est erronée
—
indignés,
—
question, des
en cette
ne se distingue nullement,
elle
grammairiens du XVIP siècle.
Et si la règle, donnée par
XVII® siècle, consacrée, à
le
absurde, disent
tort,
grammairiens
les
non moins erronée, non moins absurde
est
celle
des grammaires nous disant encore aujourd'hui que pour former
ant
l'adverbe, des adjectifs terminés par
du féminin
syllabe
la
et
te,
l'on
par ent, on retranche
et
m
change n en
par assimilation
ment: Co7tstaiif, constan-te, constan-te-ment, constanment, constamment; pa/ienf, patien-te, patien-te-ment, patienment, patiemment, etc.
Cette syllabe fe n'est pas moins imagmaïre que le prétendu
e dans grande de l'ancienne langue. — On le voit, les deux
devant
règles se valent l'une l'autre avec cette différence, en faveur des
XVIP
anciens grammairiens, qu'au
à
de
s'occuper
faiseurs de
A
plus
siècle
langue,
la
on ne pensait pas encore
tandis qu'au XX® nos
grammaires ne devraient plus
tous
mots de
des
l'exception
haut
de
l'histoire
autres
les
3® déclinaison
la
adjectifs
l'ignorer.
sont
latine
dans
entrés
cités
règle
la
générale:
Grand
devenu
granment,
(grande),
:
gj'-andement ; fort
maintenant fortement {fort est une autre forme)
(/vocalisé en
(vieux
fr.
u),
sotil,
vilement;
donne
Le XVI®
le),
siècle
subtilement;
brief (brevem
bricfmcnt, briement (f tombé), brièvement,
essaya
de
faire
entrer
générale les adverbes finissant par amment,
mais
obligeantement,
ment, patientement,
viument
et
mortelment, mortellement; subtil
soutilment,
sotilment,
soiitil),
bref tonique libre
w?^;'A'/ (mortalis),
forment,
(fortis),
vil (vilis), vilment
;
aussi
dans
e
;
etc.
règle
la
emment:
constante-
tentative
ne réussit
la
pas, l'ancienne forme se retrouve partout en usage au XVII® siècle
Galantement s'exerçans
lement accroupie (Amyot). Il
il
écrit
innoccnime7tt)
je
le
corps (Rabelais).
l'a fait
trouve
11
trouva
la
chèvre
:
gentil-
mourir innocentement (Brantôme; ailleurs
aussi
chez
meschantement
lui
(au
lieu
de
méchamment).
Voici quelques exemples du vieux français:
Moult (multum,
{Berie mis
grans
tfranment
[id.,
beaucoup)
pies,
TllA).
2358).
Je
dirai
forment sont dolant
Ou
(au)
tout
bois
avec
briement
les
{id.,
la
gent
bestes,
2259).
de
son
dont
—
Il
i
païs
avoit
seroient
29
Adverbes de manière.
escoinmenie griemeiit (de *grivis, par analogie avec brevis, pour gravis ; grave
une forme savante; voir plus haut briement).
est
2)
Par analogie avec
mots en enl venant de
les
naison latine, quelques mots en enf venant de
forment
latine
aussi
par cmment,
adverbes
leurs
la o®
décli-
2" déclinaison
la
non par
et
enteinevt:
Opulent (opulentum), opulemment
tur bille minent;
3)
succulenf, succulommeiit
;
violent, violeinineut,
au
lieu
Font aussi exception
à
la
finissant par é et par ï (son
Censé, censeement,
;
impuni
poliment;
Gai
fait
Des deux
;
étotirdi,
-sèment
précisé,
;
sensé, -sèment, etc.
-diment;
j'oti,
—
réglé,
;
Poli, polie,
-liment, etc.;
mais
adjectifs finissant par ar.
gaiement ou gaîinent
(gaie) fait
vraiment
5)
uniment;
adjectifs
les
impunément.
fait
4)
tmi,
-sèment
aisé,
;
-glément (règlement, subst.) forcé, -cément
poliement,
générale
règle
turbii/ent,
;
etc.
Ve du féminin ayant disparu:
i),
censément
de opufentement,
(cf.
gaieté,
gaîté),
mais vrai (vraie)
muet
forment
de vraie disparu).
{e
Quelques
adjectifs
finissant
par
e
leurs
adverbes par émeut:
Aveugle, aveuglément (aveuglement, subst.), commode, -dément
(uniforme),
—
-mément
Prodigue
fait
l'ang. prodigal,
prodigalement
sous
français disparu
Quelques
:
de prodigalité
l'influence
prodiguement
(comparer
a vieilli).
adjectifs finissant par
Confus {<X\\\\x?>, prof us), -sèment; profond, -dément; commtin, -nèment;
expressément im.poriun (opportum) -nèment obscur, -rément.
pourrait ajouter ici précis, -cise, -cisèment (voir plus haut précisé).
exprès,
On
conforme
une consonne au mascuforment aussi leurs adverbes en ément:
6)
lin
mot
;
énorme, -mément; immense, -sèment; opiniâtre, -trément.
;
;
7)
Quelques
—
;
adjectifs
finissant
par
tt
forment aussi
main-
tenant leurs adverbes en ttmetil, les autres en zhnenl:
Absohi, -Inment ambigu, -gument; dissohi, •Va.vts.^wX; éperdu, -dnment
ingénu, -nument; résolu (irrésolu), -Inment; cru, crûment; du (indu), dûment
(indûment).
Mzf fait nuement, et mieux: miment; assidu, -dûment; goulu,
-lûment
congru (incongru), -grùment (les adjectifs finissant par u, forment
donc leurs adverbes par thnent ou ument à peu près en nombre égal).
;
;
—
;
Trailreiisemeiîi vient de
dans
la
Dumas
langue
l'adjectif
iraîlretix
peu employé
moderne,
mais que l'on trouve encore chez A.
(père; voir Bescherelle); les grammaires tirent le mot
de traître.
Bon
vais, mal,
est
formé sur le latin bene, et maumaie (mal, de malum, est aussi adjectif: cela
a pour adverbe bien,
du
latin
mal, ce n'est pas mal).
Orthographe de Fénelon.
30
L'adverbe régulier de bon est bonnement (npocTo, Ao6poil
faut dire la chose tout bonnement
cep;ïeMHo, npocTO^tymno)
(simplement)
Bo7i,
bon,
comme
elle
:
est.
mauvais sont employés comme adverbes dans: sentir
mauyais, tenir bon, coûter bon; il fait mauvais ce
Il
fait mauvais (il est dangefait mauvais marcher.
sentir
matin;
il
reux de) pousser
les
Notamment
colère.
(HMeHHO, ocoôenno) vient de 7wtant (participe
Vaugelas aurait voulu
présent de noter;
méineiit (HMeHHo)
gens en
nuitamment
;
nuitant;
remplacer par nom-
le
hohhok)
(HOHbio,
nopoio)
s'est
formé sur un adjectif
factice
niuiatitre (latin:
précipitamment vient du participe
d'une manière précipitée (TOponjiHBO, no-
noctanter)
précipita7îi, et signifie
sciente, au lieu de:
disait
me
scientent (sachant),
latin
;
qui a
meo
français
;
sciemment s'est formé sur le
donné escient: à mon escient,
mot était déjà devenu substantif dans
cn-femno)
vieux
le
à
le
bon escient,
bas
latin,
etc.
Le
qui disait:
sciente (moi sachant).
Orthographe de Fénelon
(dans
Ce
la
Télé?naque, éditions de 1700, 1712, 1725).
le
qui frappe surtout dans l'orthographe de Fénelon, c'est
disparition fréquente chez lui
lorsqu'elles ne se
ce rapport on
font
peut
nos réformateurs
le
à celle de plus de
1740,
une
du redoublement des consonnes
dans la prononciation. Sous
sentir
regarder
comme un
Bien
d'aujourd'hui.
l'Académie française
en
pas
si
elle
inspirée et
eût ajouté
5000 mots dont
vingtaine
d'années
précurseurs de
des
cette
elle
après
a changé
la
sage
eût
été
importante réforme
l'orthographe
mort
de
Fénelon.
Dans les dernières années du XVIII* siècle, dans la grammaire
du célèbre Wailly surtout (2* éd. 1802), nous trouvons le même
mouvement de réforme quant au redoublement des consonnes.
La tentative resta malheureusement encore sans résultat; allaient
Chapsal qui devaient réussir à faire accepter
l'orthographe de l'Académie comme un code de lois qu'il fallait
aveuglément adopter. C'est depuis cette époque que l'Académie
venir les Noël
regarde
et
comme un
droit légitimement
qu'une concession consentie par
les
acquis
un
fait
grammairiens,
qui n'était
acceptée en-
Orthographe de Fénelon.
suite par
écrivains,
les
s'en dessaisir
peu
bien
ne pas comprendre toute
redoublement
au
quant
l'orthographe
de
rapproche,
du
consonnes,
de
se
des
La question du redoublement des consonnes est
que les partisans de la réforme voudraient voir
Fénelon leur aurait certainement donné la main.
réformateurs.
première
résoudre,
et
Je trouve dans
Alonger
aprendre
batre
apuyer
apris (104),
abatu
flâme
et
aquerir
flater (27,
(113),
flateur
115),
(2,
couroux
aplaudir (13), aporter
(14,
11,
(184).
flamme, appaiser, appercevoir, appeller
enflâmer (76, 121), faloir
vous
elle
grote
J'ai
coline (5),
104),
(15,
23),
(6,
17),
aquis (73—90),
73),
combatant
embarasser
fraper (27), flote (10, 12, 17, 31); flotant
(127), suporter (176), charue (153),
molesse, 32, 94),
(125),
119, 121);
(63,
82), éfacer (119),
falu (76),
123),
(édition de 1712):
amolir (47, 116;
(p. 90),
(29),
abatre (31),
(33),
110,
Télémaque
le
echaper(ll, 46, 71,
(13,
Si
elle
la
bizarreries,
les
que proposait Wailly, que proposent encore aujourd'hui les
celle
(49),
d'aujourd'hui.
celle
partout à approuver,
pas
n'est
beaucoup,
moins,
la
de
incohérences
les
langue
vieille
la
notre vieille orthographe et toutes
de
Fénelon
ne veut plus
elle
ouvrages de
les
et nos grammaires historiques pour
simplicité
droit,
••').
faut avoir lu
Il
prétendu
ce
et
31
4, 5,
(1,
flate (31),
59),
suplice
cependant trouvé aussi:
et apeller.
A propos de av-a«-ture, Sal-an-te, pancher, w-an-ger, que nous trouvons
chez Fénelon, remarquons qu'au XVII« siècle on trouve encore souvent dans les
mots an au lieu de en comme dans le vieux français on ne trouve nulle part
£n chez Chrétien de Troyes. La Bruyère, Voltaire (XVlIIe siècle) écrivaient
vanger comme revanche. Dans La Bruyère on trouve: soupante, parantkèse,
Mme de Sévigné écrit: comancer, entandre, je suis contante, tandresse, confi;
dance,
Bossuet
atantat,
a
atiantion, assamb/er,
Revue de
cepandant,
contanter,
tandresse, pancher,
atandre,
contant^
-terneni,
comniancer
attantif,
(voir L. Clédat,
philol.fr., 1892, 4e trimestre).
Le mot qui
surtout
fait
jeter
de
hauts
cris
couler
et
plus
le
d'encre
moifajne (femme). Fem(i)na (fem'na) donnait cependant feme, ensuite faîne {e monté dans l'échelle des sons). Le bon roi Henri
écrivait encore famé (XVI® siècle),
et,
ce faisant, il écrivait certes mieux
que nous.
Dans fem(/)na, \'i atone tombe ainsi que n dans le groupe
contre la réforme, c'est le
—
mn
(*
fem'na).
*)
réformes
demande,
En
le
que proposait
Ministre de
l'Instruction
au contraire, revendiquer,
à tout ministre
de reprendre.
ce
n'est
pas
qu'elles se sont passées en
la
publique
qu'il aurait dû,
philologues;
demander
Commission
s'adressant à l'Académie pour lui
orthographiques
,et
(France)
qu'il sera
elle
si
réunie
a
approuvait les
à
sa
propre
abdiqué une autorité
maintenant bien
difficile
Voilà donc des littérateurs qui ont le pas sur nos
que les choses
Espagne et en Italie.
ainsi
se
passent
en Allemagne,
ni
Orthographe de Fénelon.
32
Voyons quelques
Garand,
infâme, l'ame
joiiet,
me
il
avanture,
reçût,
elle
tu
fidèle,
reçurent, fâcher, chute,
vanger,
tu envoyés,
nous trouvâmes,
ils
dussent,
épouventer,
comme
offencer (c
vous
es,
demeuroit toute interdite
maires),
gason
verd
chapitaux, tuer,
je sçay,
mais
il
otage,
de
la
nous
la joye,
Troye, playe, que j'aye, que
fonds (plusieurs
tirannique,
Ulisse,
(comme dans
ils
pour fond),
fois
par un
que (sans
Olimpe,
Dict.
le
promtement,
traits,
liés
en deux mots
eu (avoir),
réussir,
j'atens, je répons, je sens, je cours;
écrit
sçût,
coutume,
païs,
exemt de
raisiné (pour résine), hazard,
en anglais),
une grêle
grâce,
il
se joue,
Bien-tôt, aussi-tôt, par-tout, quoi
Il
abiine,
aujourd'hui très correct malgré nos gram-
(encore
l'armée greque
loiier,
veillir,
1694),
écrit:
horison,
fois),
pu (pouvoir),
êtes,
se pancher,
maladie, les differens (pour différends),
de
(deux
plutôt, soutenir, la gloire n'est dûë, toujours, sçavoir, sçû,
;
enflâmer,
plupart, aîle,
Fénelon
autres mots.
le
de l'Acad.,
authorité,
tems
Salante, les
serain,
édition
vous
je
revoi,
etc.
tiret:
pour quoique), mal-heureux,
tiret
mal-faisant, long-temps.
Il
écrit aussi:
Clairsemé, qui se trouve encore
grammaires
1835, et dans des
clairsemé.
Pourboire
ainsi
en retard.
s'écrivait déjà
dans
écrit
Depuis
de l'Acad.
Dict.
le
on
1878,
en
écrit
ert
un mot;
en un mot en 1835: Des orges clairsemées,,
des pourboires (autre temps, autre orthographe).
Dans
après
emploie,
comme
notre second
(3® personne du
singulier)
euphonique (mais plutôt analogique),
Pascal dans ses Pensées, l'apostrophe, et non
verbes
les
Fénelon,
le
/,
interrogatifs
dit
tiret:
Donne-t'il,
a-t'il
joiié,
viendra-t'il ? etc.
Légume, masculin, est employé au féminin: Les légumes qu'il avait
semées. Dans l'Emile de Rousseau (éd. de 1762), je trouve pleurs (féminin):
Les premières pleurs, des longues pleurs.
laisse souvent,
Fénelon
passé invariable,
comme
tout
avec
le
l'auxiliaire avoïr,
monde
le
participe
le
demande aujourd'hui
(vox clamantis in deserto):
(p,
est
Préface : Pour vanger Enée des maux qu'Ulisse avoit fait devant Troye
Une autre bévue que le critique a fait (p. XXVI). Le Telemaque
XXV).
Toutes les éditions que
la plus belle Poésie qu'on ait YÛ depuis Homère.
—
l'on a
vu
(1725).
Corps du livre: Les
de
la
la
rois
playe que l'amour m'avoit
sagesse
qu'il
avoit
montré
qu'il
(1700),
j'avois fait (1700), faits (1725).
avoit vaincu.
fait (éd. de 1700
montrée
J'ay
et
(1725).
reconnu
de 1725).
la
Reparer les
et
maux que
Les dieux qui nous ont préservé des mechans
Parmi tous
j'ay senti en Crète.
(1700 et 1725).
que la fortune m'a f.nit (1712). Les torts qu'ils ont souffert (1712).
nous a forcé (contraint) de l'attaquer (1712).
Les
grandeur
La valeur
malheurs que
'es
maux
Idomenée
—
Orthographe de Montesquieu.
Remarques
33
sur l'orthographe.
Orthographe de Montesquieu.
Chez Montesquieu, dans
édition des Le/ircs Persanes,
la belle
Lacour (1869, Académie des
Bibliophiles), on trouve une orthographe très capricieuse, le
même mot n'étant pas toujours écrit de la même manière en
sur
publiée
même
une
employé
fermé rendu au
tion:
pluriel
ne
grave
l'accent
mère,
la
par
1721
L.
page, défaut rare chez Fénelon.
guère
trouve
de
celle
que
pour
severe,
ténèbres,
{é
etc.);
à préposi-
trouvèrent,
ils
final
-tez,
excepté sur
nulle part,
les
Vé fermé
estimé, -mez, vérité,
par ez:
trouve
se
L'accent aigu ne se
distinguer
regley
la
je ine7ie, etc.
écrit plusieurs
Il
fois:
fidelle (plus rarement).
(nud, masculin),
Il
prophète ou prophète; fidèle (nombre
emploie
attribue, la rue
il
plutôt,
ajouter,
soupirer, flétrir,
-leur),
aigu
l'accent
aprouver,
aprendre
rafiner,
rasser, une sale,
le
faye, que
n.
(une
et
le
moïen,
jetterent, je
une
paî's,
le
apris,
j'ai
sçavoir,
ecbaper,
la
plupart;
aprobation,
(ailleurs
nous manque, on
n'y a que toi qui mérite d'être aimé
sans accent), gueres.
Le
roi
a
Maîtresse qui en a quatre-vingt
boëie),
71).
Quoi
Remarques sur
ils
aux
serain
echets,
(adj.),
quoi que (pour
ame, grâce (toujours
que dix-huit ans
n'a
qu'il
Jusques
que
hasard;
secrette (adj. fém.),
ayeux, /cw^-tems, aussi-tôt;
jo7.tè
un Ministre qui
(p.
cessites de la vie, les reritez, les beauté?,
Par l'orthographe
;
les
ernba-
;
fonds (comme
aions, \a joye,£^aye {ad], iém.), le bled, disscntion, licentieux,
bien-tôt, par-tout, tu veille, tu
Il
(ailleurs flatter,
recils,
lèverai, le
boè'tie
et
ituë
(pouvoir), vu,
abbattre, abbatu
me
le serrait,
un différent (voir Fénelon), enyvrer, pancher, -chant,
quoique).
tu
écrit:
Il
fois)
f avoue',
boue,
la
pu
flâter
toujours,
fois).
de
finissant par tie:
bouillir,
Fénelon),
(voir
apprendre,
teins, les loix,
le
feûil/e,
:
naquit,
il
ils
mots
les
l'accent circonflexe sur
seule
caffé, appeller,
pour fond),
Fénelon,
(toujours s final),
Il
vôtre mère,
empêcher
sur
écrit
il
;
met
parure, enjlâmer
Joiier, joiiet, les jolies, souiller.
vîië,
tréma sur
le
fuïe le
tumulte.
et
une
Les né-
sont aimes.
l'orthographe.
de Fénelon
comparée
à celle
de JVlon-
tesquieu, on voit que les écrivais, tout en ayant dans les grands
traits,
une orthographe commune, jouissaient encore d'une
taine liberté
dans
leur
manière d'écrire
et
de rester toujours d'accord avec eux-mêmes;
deux manières
parfois écrit de
Dans
cer-
ne se piquaient pas
différentes en
le
une
même mot est
même page.
40 dernières années du XVIII^
siècle, à partir des
grammairiens d'Olivet, Condillac, Dumarsais, Beauzée, la grammaire prétendit régenter la langue, et nous donna la plupart
des
règles
les
que
nous
trouvons
encore
aujourd'hui
dans
3
nos
Remarques sur l'orthographe.
34
Nous retrouvons
manuels.
le
même
mêmes
esprit autoritaire, les
grammaire de l'abbé Sicard (1801),
dans celle de Siivestre de Sacy (1803), dans la Grammaire des
Grammaires de Girauld-Duvivier (1811), dans la grammairecompilation de Noël et Chapsal (1823), qui se répandit bientôt
préceptes arbitraires dans
dans toutes
la
de
les écoles
France
la
position qu'occupait son
de l'étranger, grâce à
et
général de police à Lyon, Noël voulut introduire
maire
l'orthographe
et
même
la
discipline
A
eu auparavant à surveiller.
qu'il avait
excellentes
dans
que dans
la
gramsociété
la
l'exception des quelques
M. Léon Clédat,
de M.
grammaires
la
Inspec-
Ancien commissaire
de l'enseignement en 1802*).
teur général
nommé
Noël,
auteur,
principal
avec
Darmesteter-
tous nos
manuels sont encore à peu près copiés sur la grammaire de
Noël et Chapsal; qui en a lu un, les a lus tous. Dans le
JNTo
du 18 novembre 1905 de la Revue des deux Mondes, M.
Sudre,
Brunot,
F.
Larive
Ferdinand Brunetière
(celle-ci
étude sur
finissait sa belle
tions de la langue
au XVIIF
des grammairiens,
par
que
suivant
constater,
„
grammaire
est,
mon
étude sur
régenter,
presque
le
verbe
mais de
nniquement de constater:
Obligeons
rôle de
de la
rôle
le
l'on trouve
non de
littéralement exprimé dans l'épigraphe de
(1896):
Transforma-
les
en parlant des prétentions
siècle,
vœu
le
restrictions),
greffiers
grammairiens,
les
de
l'usage,
dit
M.
à se contenir
Brunetière,
aux
maintenons
et
seuls
écrivains
un
dans leur
qui
droit
n'appartient qu'à eux sur l'évolution de la langue".
Ecoutons maintenant M. Paul Stapfer:
„L'usage, non
la
raison, a autorité sur les langues".
Voir plus haut
p.
7.
Voici un article de M. Auguste Renard, professeur au lycée
de
Caen,
réforme
sur la
Grande Revue; on
le
orthographique.
avec
lira
est
Il
car
intérêt,
extrait
est
il
de
la
vraiment
intéressant:
„
L'argument
plus employé
le
public, toujours prêt à regimber
*)
XVIIe
Il
suffit
de
pour se convaincre que
maires élémentaires n'ont souvent,
racines profondes dans
Je
recommande
de M. Léon Clédat,
et
le
le
la
ainsi
capable
plus
d'émouvoir
dérange dans ses habitudes,
une grammaire historique
lire
et XVIIIe siècles
peut-être,
quand on
et les
les règles
grands
le
c'est
écrivains des
données par nos gram-
que notre orthographe
actuelle,
aucunes
langue.
surtout les excellentes grammaires c/assî'qnc et raisonnéc
sa
de Darmesteter-Sudre.
grammaire historique
et
celles
de M. Ferdinand Brunot
35
Remarques sur l'orthographe.
cehii qui consiste à dire:
vous ne
les
horreur!
Comme
il
On
plus.
la
écrira
physionomie des mots sera changée;
cinquante
l'habitude
avait
naissais, ils faisoienf, disait, avec une assurance qui nous
je co7tnaissais^
Quelle
C'est ainsi que raisonnait Bossuet,
Bossuet, qui
ans.
canionier!
léâtre, filosofie,
langue sera défigurée!"
la
y a deux cent
Voyez comme
„
reconnaîtrez
ie con-
d'écrire
sourire aujourd'hui:
fait
qui reconnoistroit ces mots?"
M. Harduin, qui n'a guère moins de bon
sens que Bossuet, ni moins d'esprit, et qui est beaucoup plus amusant. Il ne
pourra jamais, croit-il, s'habituer à manger du „beuf". Mais si! mais si! Il en
mangera, au contraire, bien plus commodément, puisqu'il n'y aura plus ^o dans
le betif.
Et si nos pères du XVIII« siècle, à qui nous devons l'orthographe
d'aujourdhui, avaient ainsi raisonné, où en serions-nous à l'heure actuelle? Nous
on
„Si
écrivoit
C'est ce que
dit
continuerions
à
ils
phantaisie,
characiere,
écrire
faisaient ...
,
aujourd'hui
encore
chyntie,
advocat,
enseigner
à
et
cette orthographe à nos enfants.
En
connu
fcnomène avec/" que nous de
Et
ils
nous
liront les
les lisons
la
science
pu en
a
être
écrivait à
concours,
on trouve ces
et trône,
ainsi
comme
sans
les
prétention d'enrayer pour eux le
oili
nos aïeux nous
„Evolution,
violente,
de l'usage.
autrefois,
d'aucune
trois
et Voltaire, jésuitte
par exemple,
de voir
orthographié autrefois phrénésie.
la
qu'il
et
temps,
lorsque
libre,
n'y avait ni
Bossuet pouvait
lorsque
sorte,
mais
décret,
l'orthographe était
lorsque
contrainte,
d'un
résultat
le
transmise?
l'ont
mais révolution, non.
oui;
Laissez faire l'usage".
du moment, phantôme ou fantôme,
l'inspiration
(car
point
crie:
le résultat
guise,
sa
sanction
ni
juste au
nous
non une mesure
être,
l'œuvre lente du temps,
Il
—
Aurions-nous
nôtre.
la
J'entends bien qu'on
chacun
\o\r frénésie
nouvelle orthographe, et
la
ne seront pas plus surpris
d'autre,
chefs-d'œuvre de notre littérature dans leur orthographe,
dans
progrès, d'arrêter
La réforme doit
on apprend
nos enfants, à qui
tout cas,
eux, n'en auront jamais
qui,
examens,
ni
suivant
écrire,
ou
le
tans,
formes dans ses manuscrits); La Bruyère, style ou
stile,
ou jésuite ; lorsque,
élèves
avaient
debvoir et devoir^
roy
la
au
et le
collège,
faculté d'écrire
roi.
et
Les
le tctns
du temps du bon
poulmon
lettres alors
Rollin,
poumon,
et
thrStte
pouvaient tomber
et
se modifier d'elles-mêmes, graduellement, sans décret.
Mais aujourd'hui,
emplois publics,
graphe
à
l'école,
l'Etat permet-il
aux examens, dans
aux
écoliers,
concours
les
pour
aux candidats, de modifier
les
l'ortho-
alfabet ou dictionaire) La forme officielle n'est-elle
Qu'un candidat, dans n'importe quel examen, fût-ce
au baccalauréat, ose appliquer l'orthographe préconisée par M. Gréard, ou celle
M. J. S. Barés, l'érudit directeur du Réformiste, et vous verrez ce qu'il lui
officielle,
d'écrire
pas devenue obligatoire?
en coûtera.
Dès
au
nom
lors,
de
n'est-ce pas
une dérision, quand on impose
une
sacro-sainte,
quand on
qu'on leur refuse
certificats,
l'Etat,
orthographe
dérogation à cette orthographe,
publics,
sion,
s'ils
y apportent
quand,
par
autorité,
^Laissez l'orthographe
faire l'usage!"
la
se
moindre modification
on maintient
modifier
cette
;
leur
interdit toute
diplômes,
n'est-ce pas, dis-je,
orthographe
d'elle-même,
à tous les Français,
laissez
immuable,
faire
le
emplois
une
déri-
de dire:
temps, laissez
M™»
Lettre de
36
Comment
de Sévigné.
que l'usage puisse changer
lorsque tous ceux qui écrivent sont rigoureusement obligés, sous
peine de passer pour ignorants, de se conformer à l'orthographe
en
veut-on,
effet,
moindre écart que se percorrigé par les grandes
C'est là un cercle vicieux dans lequel
imprimeries de France.
nous devons rester renfermés de par l'Académie et les amis de
du
de l'Académie,
dict.
un
mettrait
et
écrivain, est,
lorsque
le
son insu,
à
routine.
la
Lettre de M"»® de Sévigné.
Voici, à titre de curiosité,
moitié d'une lettre de M"®' de
la
Sévigné, où l'on trouve encore / représentant à
ou
it
V
représentant
milieu des mots,
c'est
mots,
des
initiale
voyelle
//
(//)
la
comme
et
Au
z/^^).
lettre
emploie souvent pour
v qu'elle
j
fois / et
consonne,
te
emploie pour v;
qu'elle
//
c'est
et
et
il
pour V. Nulle part on ne trouve encore l'apostrophe, connue
cependant déjà et souvent employée dans la dernière moitié du
XVP siècle; les noms, propres n'ont pas la majuscule (lettre
initiale).
\Js remplace souvent s h la seconde personne plurielle
dans
les
(ayes
=
verbes
ayez; soulages
même
trouve
nayïé
écrit
sans que Ve
iiayie
{é étant
=
qui précède
soulagez; coures
pour n'ayez,
final,
prenne
et
oii
=
courez,
l'apostrophe déjà
on
etc,),
au moins
auraient
d'autres
aigu
l'accent
—
connue);
voir
plus haut ce qui a été dit des accents (pp. 9 à 18):
ie (je)
qui
vous
ayes
ie
descrire
bonté
la
second ordinaire
auec (avec) vn
escris
incapable
suis
ie
a
dentrer
dautres
tremble depuis
dors point et sy
la
ie
teste
dors
ie
que
ie
parce
ny
quil
tandresses
qui
a
ie
nay pas
lusage
reveille avec des sursauts
me
que
enfin
ne recoy point de nouuelies de
iusquaux pieds,
me
serrement de cœur
vous,
mes extrêmes
dans
(courrier, poste)
(un)
que
tue,
vous,
voila
ma
de raison,
le
fille,
ie
ne
qui sont pires que de
empesche que je naye des lettres
mes lettres quil envoyé très
fidellement, mais il ne menvoye rien et ne me donne point de raison de celles
de Provence (Provence), mais mon cher monsieur dou cela vientil, ma fille ne
mecriteile plus, estelle malade, me prent on mes lettres, car pour les retardemens de la poste cela ne pouroit pas faire un tel desordre ha mon dieu que ie
ne pas dormir,
come
suis
ne puis comprendre ce qui
me
parle de
malheureuse de navoir personne auec qui pleurer iaurois cette consolation
On
*)
ti,
ie
iay acoustumé, dubois (Dubois)
qui
serait
(voyelle),
/
sait
que
voyelle,
(consonne).
c'est P.
et
v,
Corneille qui a
qui
serait
fait
admettre
consonne;
même
la
distinction
distinction
entre
entre
i
Lettre de
mais
auec vous,
inquiétude
de
ponctuation.
On
soulages
peine,
ma
coures (courez) dans les lieux ou
et
de
M""'
Sévigné
même
sans
confond souvent s
elle
et c\
peu de signes
séparer
à
écrit:
donc
(soulagez)
currente calamo
écrivait
penser
37
escrit
fille
pas de signes orthographiques,
le voit,
plume courant)
Elle
destre en
pas raison
nayie
mon
de Montespan au duc de Noailles.
N[<^*>
cïede,
(la
—
phrases.
ses
divercité,
conce-
quance, abcence, sertaïne, seremonie, perser (percer), consernant,
grimasse,
—
etc.
landemain,
vente,
encien,
entipathie,
conduitte,
escritte,
mais:
etc.,
(île),
comancement,
assamhler, avanture,
Elle écrit:
aparance, offance,
lenterne,
datte
suitte,
emplemeni, epou-
vandredi, mais:
—
etc.
(date),
sucomber,
abé, ocasion,
Elle
écrit:
littiere,
apellons,
platte,
ille
eclesiastique, etofe, su-
frage, tranquile, etc. etc.
Lettre de M'»^ de Montespan au duc de Noailles.
Et voici les libertés que prenait avec l'orthographe M""^ de
Montespan dans
Les grandes dames
qu'elle écrivait.
les lettres
—
parlaient très bien leur langue au XVII® siècle
même mieux
peut-être
souvent plus
que
que ne
mal
—
hommes,
les
maintenant
l'écrivent
parlaient
elles
mais
l'écrivaient
nos cuisinières.
Pour M™® de Sévigné elle-même, la grammaire et l'usage n'étaient
douce et facile discipline, n'exerçaient sur elle aucune
qu'une
L'orthographe
étroite contrainte.
comme
pas tyrannique
n'était
1815-1820 de
par
au XVII®
elle
Noël
des
l'autorité
au XVIII* siècles,
et
devenue vers
l'est
les
Chapsal
et
années
de
et
l'Académie.
ie
suis
(je)
convinquue de voste amitié
si
tant de part a se qui
me
regarde que
tinuer a an
en
être)
envoiie
oestre
(à
envoyé)
avait
(qu'il
ie
instruit a
mr
colbert
et
ie
vous
mon
{W
retour
deit (dit) quel
même
les
sy vint
elle
anneffet
hier
demanda un
et
lui
iour
dist
pour
an
me
roy
le
Colbert)
contesse de se défaire de sa charge elle
mandée
ueu (vu) prandre
ai
croy que vous serest bien ese de condist quil lavet
proposer a
viendret
mesme chose qui
a me (Mm«)
parler
me (M™e)
(qu'il)
la
la
trouuer elle
le
luy
auet
princesse
de
carignan (Carignan) et lonna (l'on n'a) point ancore sa réponse du reste tout est
fort pesible
et aprest
ysy
soupey
auec de lanbaras
lesgere
(ici)
il
le
me
fM»"') de
indisposision le
nouuelle du
roy vient dans
ma chambre
caprest
(qu'après) la
messe
vaut beaucoup mieus se voir peu auec dousceur que souuant
logis ie
maintenon (Maintenon)
duc du
vous
prie
maine (Maine)
de
faire
mest
est
est
demeurée pour quelque
auec
elle
complimant
duchesse de nouaille (Noailles) vous maubligeries ausy de
me
a
voila
toutte
me (madame)
les
la
chercher du uelours
vert pour un casrosse (carrosse), meit (mais) ie voudret bien quil ne fust pas sy
cher ca (qu'à) vostre ordinesre.
— Pour madame
(sic) le
duc de nouaille (Noailles).
Imparfait de l'Indicatif.
38
Imparfait de
mon
Voir
étude sur
l'indicatif.
verbe
le
(2"
partie,
1896);
me
je
con-
de quelques remarques que l'on ne trouve pas dans
nos grammaires^").
tenterai
ici
L imparfait
au présent. Le
ou existe en ce
moment (présent) r imparfait, de sa nature, exprime ce qui se
faisait ou existait alors, c'est à dire au moment passé dont il
est question dans le discours.
Le présent répond donc à maintenant, à présent, en ce moment (oiî nous sommes), r imparfait
répond à alors, e7i ce moment-là, en le temps (oii l'on était).
1)
de
prése7tt,
relativement
est
exprime ce
sa nature,
identique
qui se
fait
;
L imparfait,
comme
en mettant
tableauj
trouve
se
jours de l'été
de fleurs
aux
les haies
:
et la
présent,
les
On
sont couvertes
forêt retentit
des
débitent
huttes,
le
vertes de
abattu et le
Au
coin
tion
se
transforment en différents
ménage (d'après Souvestre,
du feu;
de
ce
qui
ce
2)
ménage
L imparfait
de
tous
encepté.
Mon
s'emploie
Voir
père
temps
des
bois abattu
le
retentis-
Des
d'oiseaux.
dans
et
Au
le
huttes,
Irans-
ustensiles
différents
(Souvestre,
comme
le
ou regardé
conditionnel (sans
les
chants
cou-
étaient
forêt
la
coin
du
de
fe-u ;
description de ce qui était et se faisait^
qui
(rapproché),
et
campés
formaient en
aussi bien
relatif est le
et
mille
débitaient
j
fait).
relatif prochain
il
de
et
faisant
:
les haies
fleurs
bûcherons,
description et narraest
de
sait
bois
i
ustensiies de
(en
trouvait aux plus beaux
se
jours de l'été:
de mille
chants d'oiseaux. Des bûcherons, campés
dans
de se passer)
train
beaux
plus
dépeint
raconte et
yeux du lecteur ou de l'auditeur
ou étaient en
les faits qui sont
On
le
sous
passés
que
présent pour un futur
comme
passé
Ce
tel.
futur de
condition),
(le
narration).
indéfini
futur
l'imparfait
seul
parfois
mon
étude sur le verbe, 1896, 2* partie, p. 57, § 3):
raconte en ce moment qu'il part (partira) demain pour Paris;
racontait ce matin qu'il ne partait (partirait) qu'après-demain.
Cantabam donne je ckanteve {6 changé en v, et a tonique libre donque l'on ne trouve guère que dans quelques textes bourguignons. Par
* cantavjm, * caniauain {v vocalisé en «), le mot donna chantoc, chantoue, pour
devenir ensuite chanteie par analogie avec rendeie (* rendebam, * rendeam
reddebam; 6 tombé; et e long tonique libre donnant et). Chanteie est devenu
*)
nant
e),
chantoie (XII© siècle), chantoi (e final tombé), chantois (XVI» siècle,
et
XIXe) jusqu'en 1835, où
nant [Rou, 3385).
mult
(multum,
Ariere
beaucoup,
alout, deuant (devant)
le
il
(il)
chantais:
s'est écrit
alouent
très) bien
et
auant
(avant;
chantout,
duc alout chantant
La
{id,
sor un
terre
(il)
id,
292).
cheval
8035—37).
XVIK
XYIII»
aloent purperTaillefer,
qui
tost
qui
(vite)
39
Imparfait de l'indicatif.
Le pj'cseni
3)
mêmes, dans
Sa
Sa
lettre
4)
le
mapprcnd
lettre
me
et
l'
imparfail
employés
sont
pour
eux
:
qu'il
est déjà en route,
en route,
disait qu'il était déjà
Le prése/i/ s'emploie pour
qu'il
le
vient avec un ami.
qu'il
—
venait avec un ami.
f ùnpar/ai/ pour
fiilur, et
conditionnel (futur des temps passés), dans:
Vous a-t-on déjà dit que notre ami arrive (arrivera) ici à la fin de
décembre et qu'il passe (passera) chez nous les fêtes de Noël et du Nouvel
Dans sa lettre il nous écrivait qu'il arrivait (arriverait ici) à la fin de
an?
décembre et qu'il passait (passerait) chez nous les fêtes de Noël.
—
5)
Le présent
C'est
et l'imparfait
une chose
là
ne fallait pas (qu'on ne
pareil
s'emploient pour eux-mêmes dans:
ne faut jamais oublier;
qu'il
(levait
pas) oublier
une chose
c'était là
pas à oublier)
(qui n'était
qu'il
en
un
moment.
employé pour lui-même, et n'a pas
le sens d'un condHionnel présent (futur des temps passés) comme
ou d'un conditionnel passé
L. Clédat,
le pensait d'abord M.
comme le dit M. L. Sudre en la grammaire dite de Darmesteter,
dans cette phrase de La Bruyère (II, p. 186):
L'imparfait
Maint
est
aussi
un mot qu'on ne devait pas (qu'on n'avait aucune raison d')
siècle l'ont fait en essayant, mais en
est
abandonner (comme des écrivains du XYII»
vain,
de gagner
les autres à leur exemple).
Un temps
composé;
simple ne peut jamais avoir
le
sens d'un temps
ou vice
passé indéfini peut remplacer tin fninr antérieur ou
vice versa, un plns-qne-parfaii peut remplacer un conditionnel
passé ou vice versa, mais ce serait méconnaître la signification
des temps que de dire, comme le fait M. Leôpold Sudre {Gram.
Darniesieter, syntaxe, p. 135) „que la combinaison: Si je bougeais,
on me tuait, est identique, pour le sens, à: Si j avais bougé, on
versa,
remplacer un futur simple
le
m'aurait
Il
présent peut
le
y
ou: Si j'etfssc bougé, on ni eût
tué,
a
présentant
ici
deux manières de s'exprimer
très correctes,
vue
tout
mais
points
de
une futurition relativement au
passé dont on parle: si je bougeais (moment passé), on allait
me tuer (tout de suite après) l'autre, un passé relativement au
rents:
la
l'affirmation
première
sous
tué'"''-').
des
diffé-
exprimant
;
moment de
*)
parole:
la
Même
erreur
Saint-Pétersbourg).
dans
Si j'avais
la
bougé (ou bougeais; moment
grammaire de D. Margot
(7«
édition,
p.
132,
40
Imparfait de
l'indicatif.
on m'aurait (on m'eût) tué
passé),
parle, avant
le
Citons
ici
moment où
(avant
moment où
le
je
suis maintenant).
je
quelques exemples assez curieux quant à l'emploi
des temps:
J'ai pu (je pouvais) donner
rai pas fait Corneille).
Certes,
Pompée
tête à
ta
—
,
plus je médite,
et
(sous-entendu:
moins
je
me
et
ne
je
que
figure
vous m'osiez compter pour votre créature, vous dont j'ai j)u (je pouvais) laisser
vieillir l'ambition dans les honneurs obscurs de quelque légion (Racine, Britannictis).
Vous aTOZ dû (vous deviez) premièrement garder votre gouverne-
—
ment; mais ne
débonnaire
mère
l'ayant pas
fait,
vous devoit
J'îii
dû
(je
(Voltaire,
l'Orphelin de la Chine,
III,
3).
Limparfaii, que
je
mets
passé indéfini dont
le
t-il
il
doux (La Fontaine).
et
ici
suffire
entre
prendrait
il
que votre premier
roi
flît
devais) l'imiter, mais enfin je suis
remplace-
parenthèses,
le
Evidemment
sens?
non, les deux temps ont des significations différentes
J'ai pu (dans un temps passé) faire cela, je ne puis plus
:
Je pouvais
alors
ce
(en
temps-là,
à
époque-là)
cette
le
je
faire,
faire.
le
ne
le
—
puis
plus aujourd'hui.
Dans
naître
que
les
si
phrases qui précèdent on doit cependant recon-
du passé indéfini ou de rimparfait est
se comprend facilement, c'est toutefois le coitdi-
l'emploi
très correct et
tionnel passé qu'on s'attendrait plutôt à trouver:
J'aurais pu (j'eusse pu) donner ta tête à Pompée. Vous, que
pu laisser vieillir, etc. etc.
De même La Bruyère
aurait
pu
dire,
mais
c'est
j'aurais
ce
qu'il
n'a pas fait:
Maint
est
un
quelques-uns ont, du
comme
n'aurait (n'eût) pas dû abandonner
mot qu'on
reste,
en vain essayé de
le faire.
Quinte- Curce a dit:
Deleri potuit
{en ce moment-là)
exercilus,
quis
si
être anéantie
si
ausus essct vincere:
quelqu'un
(si
l'armée
l'on) avait (si
pouvait
l'on eût)
osé
la
vaincre (l'aUaquer)
Et au point de vue du lemps où nous
ou de l'époque où
il
écrivait,
Deleri potuisset exercitus:
sommes maintenant
Quinte-Curce aurait pu dire:
aurait (eiît) pu être anéantie
l'armée
si....
Et nous pouvons, au lieu de pottvait, employer fimparfait-
futnr-périphrastique, en disant:
L'armée allait peut-être être anéantie
si
l'on avait (si
on
eitt)
osé l'attaquer.
Tite-Live a dit de son côté:
pêne hostibus dédit, ni unus vir fuisset; le pont de
aux ennemis; heureusement un homme était là
empêcher de passer), ou: le pont de bois livrait presque passage etc.
Pons sublicius
bois
livra
(pour les
5i
un
presque
homme
iter
passage
n'avait (n'ezit) été
là.
Imparfait de l'indicatif.
comme
Et
ment après
l'événement allai/
peut-être
moment passé dont on
le
41
immédiate-
ai^rivi^r
on peut également
parle,
traduire aussi, mais sous un autre point de vue:
Le pont de bois allait peut-être livrer passage aux ennemis
Viuvait (n'eûif) été
Le vieux
français connaissait déjà cette tournure:
Uestruite esteit
s'il
vile se (si) conrei
la
n'en preneit;
(il)
entremetreit {Roti., 413—419).
France ne s'en
homme
un
si
là.
ne prenait ses dispositions
(s'il
La
kar
ja
reis
li
était (serait)
ville
de
détraite
n'y prenait garde), car le roi etc. *)
Idée de fiUitrition prochaine relativement au montent passé
dont
question dans
est
il
La
ville
aurait
Wace
(aurait dit
Roman.
le
détruite
été
(eût)
Tuit (tous) estoieut
fûst (n'eût été) la
li
cuens
perdu
n'y
de
avait
pas
(eût)
Rou
(allaient être perdus,
comte;
(le
s'il
Roman
qui a écrit plus tard le
garde
pris
(Rollon).
périr) se (si)
allaient
ne
Joinville).
moment passé dont on
Ces hommes-là n'avaient pas encore péri, ils allaient
périr si le comte vé avait (n'eût) été là.
Et relativement au
moment oiî il écrivait ce fait qui aurait pu se passer longtemps
auparavant, Joinville eût pu dire:
Idée de futiirition relativement au
parle:
Tous auraient (eussent) péri
Boileau,
allusion
faisant
comte n'avait
le
si
(y^eùt) été là.
aux guerres de Louis XIV,
écrit
en parlant de Pyrrhus trop enclin aussi à guerroyer:
Pyrrhus vivoit heureux (allait vivre heureux)
il
commencer une
allait
temps avant
lui,
en pensant que
(s'il
Les
deux
répète,
le
comme
commencé une
vie heureuse)
avait
s'il
eût écouté) Cinéas.
périphrastique
je
ces faits s'étaient passés long-
pouvait dire:
Pyrrhus aurait vécu (aurait alors
écouté
—
avait (eût) écouté
s'il
de Cinéas.
les conseils pacifiques
Et Boileau,
eût écozi/é Cinéas
s'il
vie plus heureuse qu'auparavant
manières
ou par
mais
de
s'exprimer
signification
la
diffère celle des
(par
l'imparfait-futur-
conditionnel passé) sont
le
de
ces
deux mots passé
très correctes,
deux temps
diffère
et fittitr.
*) Pour bien comprendre cet imparfait ayant le sens d'un conditionnelfutur des temps passés, il faut voir les vers qui précèdent et ceux qui suivent,
n'a pas dû faire M. Sudre.
Wace met ici en scène l'archevêque de
Rouen attendant l'arrivée de Rollon, qui détruirait la ville comme Hastein l'avait
détruite.
Dans la pensée de l'archevêque la ville allait être (serait) détruite
ce que
s'il
ne se
Rollon,
rendait
auprès
qui fut adouci
sans y faire aucun mal.
par
de
Rollon
l'or
et
pour l'adoucir.
l'argent
qu'on
lui
Il
alla,
offrit,
en
et
trouver
effet,
entra
à
Rouen
42
Imparfait de l'Indicatif.
Cicéron a
aussi:
dit
esse
otioso
Licuit
Themistocli:
Il
était
loisible
(fut)
à
Thémistocle
de
vivre dans le repos: Thémistocle pouvait (aurait pu) vivre dans le repos.
Le
latin
encore
dit
:
per Meteilum licitum essct, matres illorum, uxores, sorores veuitbant*)
Si
Romam:
r avait (reùt) permis,
Métellus
Si
sœurs venaient
mères,
leurs
femmes, leurs
leurs
Rome (Cicéron, Contre Verres).
Lorsque devoir n'exprime aucune idée d^obligatioji et n'est
qu'une sorte d'auxiliaire, on peut quelquefois, avec la même
('allaient venir) à
pour la phrase, employer le prescrit ou
rimparjait ou le plns-que-parfait:
signification
indéfini,
passé
le
Ces messieurs doivent avoir passé par là avant nous, car nous ne les
ils ont dû passer avant nous,
car etc.
Ces messieurs
devaient avoir passé avant nous, ces messieurs avaient dû passer avant
—
avons pas rencontrés;
nous, car ...
Lorsque
devoir exprime
une idée
d'obligation,
deux
les
manières de parler expriment alors des idées différentes:
Il
tôt;
voulait partir hier soir,
mais
matin
mais
voulait
il
partir hier
(= probablement)
sans doute
(il
partir plus
obligé de)
a été
doit n'être parti que
le
soir
(il
n'est
aucune obligation, nous aurons
alors
exprimant un
du présent,
vue
de
point
il
parti que le soir (sens différent).
Devoir n'exprimant
des phrases équivalentes
a dû
il
fntiir,
au
secondes
les
les
premières au
vue
de
point
du
passé, dans:
1)
Il
soir (qu'il
2)
raconte
qu'il
parlira ce
Il
doit
partir
ce soir
=
il
raconte
disait tantôt qu'il devait partir =^ qu'il allait partir
partirait); conditionnel, futur de l'imparfait et des
7) Si
l'imparfait est surtout appelé
cependant aussi raconter
et
temps
indéfini ou défiini, et avec plus de vivacité,
midi
trouvèrent
se
(se
parce
Pendant
qu'il
il
sait
passés
raconte
qu'il
quittaient (quittèrent)
trouvent)
et à
midi se trouvaient (se trouvèrent)
déjà en face de l'ennemi.
parlait
lui
les
le
lendemain
matin,
doublaient (doublèrent) leur marche
et
déjà en face de l'ennemi.
frère ai'riva (arrive),
descriptif,
raconte m.ême mieux que
doublèrent (doublent) leur marche
ce soir (qu'il
temps passés\
en faisant tableau comme le présent:
Nos troupes qnittèrent (quittent)
Nos troupes
le
camp dès le lendemain matin,
le
camp dès
à
va partir ce
qu'il
soir).
ainsi,
son
:
dit quelques
Pendant
frère arrivait
qu'il
parlait
(arriva),
ainsi,
son
disait (dit)
lui
j
mots
à l'oreille, et tous
(quittent)
la salle
de l'assemblée.
*)
deux quittèrent
au grand étonnement
;
:
i
quelques mots à
l'oreille,
quittaient (quittèrent)
et
tous deux
la salle
étonnement de l'assemblée.
Certaines éditions disent venibajU (allaient être vendues).
au grand
43
Imparfait de l'Indicatif.
Voici
mêmes événements
les
que
Paul
de
château
couteau sur une assiette
se trouvait
Quelques années
d'argent,
après
On envoya
avec un couteau sur
Un
un
Sainte-Marguerite
pêcheur
l'île
Voici
une
d'autres
A Wagram,
jeta
et
que
Bernadotte
à
feu
prouvent
qui
faits
bien
bouches
un
pêcheur, qui
gouverneur.
—
château de
secret au
jour
écrivit
prisonnier
le
par
l'assiette
fenêtre....
la
porta au
la
l'assiette et
le
les
passé
uns après
ayant laissé
centre
le
l'
imparfait
des
événe-
notre ligne arrêtait
(arrêta)
raconter
les autres:
passer
victorieux
que
encore
défini,
ennemis
des
combat que Davout terminait (termina)
(rétablit) le
au
avec
arriva un événement
il
ramassa
par hasard
là
Un
Un
porfa au
grand
plus
le
défini:
envoyé
écrivait,
fenêtre.
la
qu'il
inconnu.
assiette d'argent
ments qui se sont passés
cent
par
était
(Voltaire).
peut, tout aussi
avec
jetait
passé
le
prisonnier
le
l'assiette
dans
prisonnier
trouvait
se
qui
gouverneur de
la
jour
du cardinal Mazarin
mort
la
qui n'a point d'exemple.
l'île
et
ramassait
hasard
par
là
Un
Sainte-Marguerite.
l'île
Saint -Victor
de
raconte très bien par r imparfait, et Voltaire par
En 1661, un prisonnier inconnu, portant un masque,
en
rétablissait
et
enlevant
plateau
le
(Thiers, qui emploie l'imparfait).
Le 17 septembre 1672,
senta)
Versailles
à
les
la
Femmes
troupe du
roi
représentait
savantes
de
Molière;
Bourdaloue y prêchait (a prêché, prêcha)
année on y jouait (on a joué, on joua)
par
là
que Marie-Antoinette,
la
carême;
le
le
11
qui
emploie aussi
grammaires de
l'imparjait).
s'échappait
reine,
mettre
Q\x
ici
1674
d'août
de
juillet
même
la
Voyez,
(s'est
c'est
échappée,
XVI (Imbert de Saintle pendant que des
Fleury?
J.
Le latin peut aussi
notre passé défini
Pompeius in Cumanum
vint à
représenté, repré-
mois
Malade imaginaire.
le
malheureuse
s'échappa) pour aller chercher un refuge auprès de Louis
Amand,
(a
au
Cumanum,
le
dire avec l'imparfait au lieu
venit.
lendemain matin
Ad eum
je
me
postridie
du perfec/nm,
mane vadebam: Pompée
rendais chez
lui
(j'allais le voir).
Et nous disons:
y arrivai
main matin
Les
exemples
n'entraîne
J.
(j'arrivais, je suis arrivé)
le
le
lende-
suivants
pas toujours
prouvent
l'emploi
de
aussi
que pendant que
l'imparfait,
comme
le
dit
Fleury, que la simnlianéiié peut s'exprimer par d'autres temps,
comme
je le
dis déjà
dans
Je ne sais quelles idées
couronné
(le
couronna,
le
ma grammaire
la
de
agitèrent Charlemagne
couronnait).
1878— 79--):
pendant que
le
pape
l'a
(Ernest Lavisse, qui emploie le passé
Mon étude des temps de l'indicatif et du conditionnel a été publiée
Revue de philologie française par M. Léon Clédat, professeur-doyen à
*)
dans
la
chez ces braves gens,
soir
je partais déjà (je partis, je suis parti).
Faculté des lettres de l'Université de Lyon.
44
Imparfait de l'indicatif.
Astarbé avait jeté du poison dans
indéfini).
—
Téléniaquc).
allé à la porte (Fénelon,
coupe pendant
la
que
Je n'ai pas dit un mot
roi
le
était
pendant que
—
deux hommes ont causé (caiisèreut, causaient) de leurs affaires.
Ecrives
pendant que je m'iiabillerai.
y ai bi pendant que mon frère
a joué du piano.
les
—
votre lettre
Remarquons encore
7)
présent
le
Vimparfaii, non moins
et
descriptifs que 7tarratifs dans:
Nous
voici près
du château; remarquez comme
grimpantes en
les plantes
—
Nous arrivâmes près du château; des plantes grimtapissaient tous les murs.
Une tenture noire remplaçait l'antique
tapissent tous les murs.
—
pantes en
tapisserie à personnages.
Je contemplai encore une fois ce château que le lierre
enveloppait de son tapis
vert.
—
Le chemin était
défoncé
alors
à la suite des
pluies des jours précédents.
au lieu de
Si,
rendre
vouloir
d'état exprimée par
voulons exprimer que faction
qui
état
passé dont on parle, nous
et
les autres écrivains
Nous
voici près
continuer
notre
—
Nous arrivâmes
en
voiture,
chemin avait été défoncé par
était donc encore défoncé).
—
le
verbe
après
un
état
parole,
lui
lui
le plits-qite-parfait
un état qui
homme
Cet
tenture
des plantes
en cet
des
nous ne pîimes
endroit,
chemin
le
précédents
jours
encore
au
grim-
remplacé
noire avait
avaient défoncé
qui dure
ne
(le
chemin
(le
pas
laisse
moment de
la
ne laisse pas non plus toujours après
moment passé dont on
a toujours été aimé
autrefois très aimé,
grimpantes en out
château;
passé indéfini
au
encore au
existait
Une
pluies
pluies
les
les plantes
près du
arrivâmes
les
Mais comme
toujours
un
Mérimée
dirons avec Chateaubriand,
Quand nous
route
elle
moment
:
pantes en avaient tapissé tous les murs.
l'antique tapisserie.
nous ne
parole ou au
la
du château, voyez comme
—
tapissé tous les murs.
d'action et
idée
et description^,
mais laissant après
sente,
moment de
au
encore
existe
double
la
verbe {narration
le
et l'est encore,
mais aujourd'hui tout
le
monde
—
le déteste,
parle*):
homme
Cet
il
a été
est détesté de
—
On nous avait dit que les pluies
chemin avait été défoncé par les pluies),
mais quand nous arrivâmes à l'endroit désigné, nous pûmes continuer notre route,
le chemin avait déjà été réparé (le chemin était déjà réparé; (le chemin
tout le
monde
(cet
avaient défoncé
n'était
*)
après
une
n'est plus aimé).
chemin (que
le
donc plus défoncé).
La grammaire de
de Liège,
sité
homme
le
lui
un
erreur.
nous
état qui
dit
J.
que
durait
Delboeuf
le
et
Rœrsch, anciens professeurs
plus-que-paj-fait
encore au
de
l'indicatif
à l'Univer-
laisse
moment passé dont on
toujours
parle.
C'est
Imparfait de l'indicatif.
V imparfait
8)
habitudes
des
et
comme
s'emploie
45
pour exprimer
le prése^tt,
des jugements
porter
sur
mœurs,
les
les
coutumes, les actions répétées'.
Les Romains étaient braves, nos soldats
étaient
sont
le
—
ne fnmc plus, ne pri«e plus.
je
pris^als,
paysans
nos
superstitieux,
le
sont
encore.
Dès que
—
aussi.
—
Les Egyptiens
Autrefois
fnmais
je
et
souffrance laisse (laissait)
la
quelque repos à cet homme, son esprit se réveille (se réveillait) radieux, et il
montre (montrait) autant de lucidité que de sérénité (Thiers, jugement sur
Napoléon
I).
—
Dans nos conversations
que son devoir
répéiais toujours
lui
je
était de respecter ses parents.
que l'on veut exposer en disant ce
qui fut ou ce que l'on fit dans le passé, et non ce qui était
ou se faisait pendant une époque donnée, c'est le passé défini
ou le passé indéfini qu'il faut alors employer:
des faits
Si ce sont
Romulus fnt un roi belliqueux; Numa se montra toujours un roi paciLes Romains furent braves. Rome était gouvernée par des consuls.
Pendant les cinq cents ans que dura la république, Rome fnt gouvernée par
fique.
des consuls.
exprimer que l'action
Selon que l'écrivain veut
qu'une seule fois ou
s'est
produite plusieurs fois
ne
se fait
(répétition de
employer dans la même phrase le passé défini
fois) et f imparfait (répétition des faits).
Voici
un exemple très correct que je trouve dans Eugénie Grandet
l'acte),
peut
il
(action faite
une
de Balzac.
Dans l'année 1827, son
sa
d'initier
fille
(Eugénie)
père,
au
de sa
poids
le
fortune
des
et
infirmités
lui
disait,
de s'en rapporter à son notaire (homme de confiance)
difficultés,
9) Voici
exprimée
maintenant
(rapproché) relativement au
ce que
sentant
secret
le
latin
l'idée
la
de
d'un futur prochain
parle dans
futurum periphrasticum
appelle un imperfectîtm
que
forcé
cas
*).
moment passé dont on
(imparfait-futur-périphrastique),
ftU
en
grammaire de
J.
Fleury
appelle à grand tort un imparfait-passé-antérieur:
Il
liier
*)
que
initiée
qu'il allait
partir
je
si
ne
l'avais
défendu.
(se profecturuiii esse) le soir
—
II
racontait
(== qu'il partirait
conditionnel, /?//« a des temps passés).
le soir);
ce
allait périr (perihirus erat),
matin
Une fois
suffisait à
les avares tiennent
Grandet pour
même
initier sa fille
au secret de sa fortune,
souvent caché en mourant, mais une
au secret, Grandet, excessivement
craintif et
avares, devait souvent donner ses conseils à sa
la
répétition^ n'a nullement besoin d'être
la
pensée de Balzac.
soupçonneux,
fille.
fois
comme
sa
fille
tous les
Lui disait, qui marque
changé par Ivi
dit,
ici
qui ne rendrait pas
46
Imparfait de l'indicatif.
Un
iniparfait-passé
ùt futur rapproché
ni
antérieur n'a jamais
exprimé
l'idée ni
de futur éloigné; ce n'est pas malheureu-
sement la seule grave erreur que
de J. Fleury*).
dans
l'on trouve
les
grammaires
Finissons cette étude sur l'imparfait par quelques descriptions et récits dans lesquels
on peut employer différents temps
Et puisque nous sommes
en Russie commençons par un récit (texte russe) donné à traduire,
avant Pâques 1894, à Riga, aux jeunes filles qui subissaient
leur examen pour avoir le droit d'enseigner le français dans
selon l'idée que l'on veut exprimer.
écoles:
les
Imparfait.
Pendant
—
Un
pour nourrir ses enfants
Mais
était
vieillard en
tout
qu'il
abaihi,
fait
cette
manquait
jour que
épuisées),
fit
il
avec
île
bonne
d'une
ses
santé,
trois
fils.
travaillait
il
ne nianqnaieut de rien).
(ils
commencèrent à diminuer, le
ressources
les
Un
triste.
sentait ses forces tout à
dans
vivait
jouissait
ne leur
rien
;
Payant
années
les
laboureur
jeune et
qu'il était
forces
lui
appeler ses
fils
ses
manquaient
et leur
(qu'il
pailla ainsi.
Les événements racontés par fimparfait sont mis en rapport
avec une époque donnée du passé:
Pendant
le
temps que
le
laboureur était jeune,
il
travaillait.
Tout en racontant, on décrit, on dépeint la vie de
un tableait qui se déroule devant nos yeux "••").
c'est
Dans une des
*)
nous donne
passé du
le
fausse,
il
y
éditions de sa
comme
a eu
cet
homme,
grammaire J. Fleury, à l'appui d'une règle
un passé antérietty; dans une autre,
étant
subjonctif exprime
toujours une
action d'une
iongtie
que
durée; dans une troisième, nous trouvons cette surprenante règle que, des deux
temps
(p.
l'autre
quand on raconte sans
en
défini,
conjuguant
disperser,
et
indéfini), l'un
sans
il
(nouer, attacher).
à l'auteur
p.
doute:
s'emploie lorsque
détail.
perdo,
Ailleurs
persi,
il
fait
l'on raconte
avec détail
perstim, pcrsare,
d'où
dis-persare,
donne attacher comme venant probablement du grec aptein
Un élève des 5e ou 6e classes de nos gymnases aurait appris
que disperser vient du fréquentatif di-spersare, de di-spei'go,
dispersi,
dispersum, dispergere (dispersare, spargcre répondant au grec speirein,
aacbBaTb; cbinaTb; paacbinaTb): des troupeaux
pas des
troupeaux perdus; des
flottants et en désordre,
verbe espardre,
que
n'a rien à faire avec
épars dans
blackboulées.
Hoppé
la
cheveux épars sont des cheveux dispersés,
l'on trouve encore
perdre (perdere; per
(Exercices sur
ctflTb,
campagne ne sont
mais ne sont nullement des cheveux perdus.
dans des
-f-
grammaires
la
L'ancien
du XVIIe
siècle,
dare, donner).
**) Les demoiselles, qui avaient toutes traduit par
livre d'Alph.
et
venir dispei'ser de perdre,
r imparfait
grammaire de Hoppé
et
le récit
Dalloz),
du
ont été
Imparfait de l'indicatif.
L'usage ancien,
M.
dit
E. Etienne
47
dans son Essa/ de gram-
maire du vieux français (1895) était déjà d'accord ici avec
l'usage moderne; il cite un exemple de l'emploi de riuiparfait
que
vieille
la
langue, ajoute-t-il, aurait parfaitement accepté:
homme
Cet
était très honnête
un noble usage de l'argent
comme
Ici,
des jugements,
dans
précède, ce sont des réflexions,
récit qui
le
de
tableau
le
se conduisait bien, travaillait, faisait
il
;
g'agunit.
qu'il
qui surviennent (commencèrent,
appeler,
fit
—
homme.
d'un
vie
la
Les
faits
sont au
leur parla)
passé défini.
Passé iadéftni.
—
Le
ont toujours été
les siens
forces saffaiblissaichit
a parlé
l'objet
de
sollicitude.
sa
épuisées)
{étaient
Pendant
île.
a été
qu'il
a travaillé pour nourrir ses enfants
il
il
a
appeler
fait
;
que ses
un jour
Sentant
ses enfants
et leur
ainsi.
événements
Les
avant
dans une
vieillard vivait
jeune, que ses forces le lui ont permis,
moment
le
Il
de
sont
comme
racontés
ici
passés
s'étant
parole auquel on les rapporte:
la
ne travaille plus, mais
a travaillé longtemps.
il
Remarquons, en passant, que
passé indéfini peut raconter
le
tous les événements passés, quelque anciens qu'ils soient:
la campagne qui avait d'ailleurs commencé
sous de
Il est évident que
malheureux auspices .;^«/V (p. déf.) mal pour les envahisseurs Israélites
Ils ont
dû (durent) subir une grande défaite et y ont éprouvé (éprouvèrent) de
grandes pertes. A son tour, Mésa les a poursuivis (les poursuivit) et a
envahi (envahit) les frontières d'Israël. La date de ces événements doit être
marquée dans les années du règne de Joram, fils d'Achab, qui est monté
(monta) sur le trône d'Israël en 896 avant Jésus-Christ (Revue scientifique).
Passé défini.
Cet homme vivait dans une île. Pendant tout le temps
—
qu'il
jeune
fut
s'aperçut
que
ne leur
rien
enfants,
et
enfin
ses
forces
manqua
(ils
devenait
qu'il
permirent,
le
lui
ne
manquèrent de
devenu)
(était
travailla
il
rien),
incapable de
pour ses
mais
tout
lorsqu'il
travail,
il
fit
venir ses enfants et leur parla ainsi.
Les
sont
faits
ici
mis en rapport, non avec
présent, mais
le
époque passée qui n'a plus aucun rapport avec le
Le passé défini raconte les faits dans toute leur durée,
avec leur cominencement et leur fin.
avec
une
p7'ésent.
Plus-que-parfait.
—
Un
fermier
vivait
dans une
Pendant
(aussi longtemps) qu'il avait été jeune et
permis,
il
n'avaient
avait travaillé pour
manqué
de
rien),
mais
forces s'étaient épuisées dans
il
avait fait
(il
fit)
quand
un rude
venir ses enfants et
enfin
travail
leiir
il
avec
ne leur avait
Rien
ses enfants.
île
que ses forces
avîiit
(il
eut)
ses
enfants.
le lui
avaient
manqué
senti
(ils
que ses
(que ses forces étaient épuisées),
avait parlé
ainsi.
48
—
Imparfait de l'indicatif.
Passés
Le plus-que-parfait raconte
les
(défini,
indéfini).
comme
faits
avant l'époque dont on parle ou qui est dans
avait été
Il
avait traTalllé,
jeune,
ne
il
Voici un récit
oii
cherchant
perçait
le hasard,
l'imparfait fait tableau tout en racontant:
le
conduire à sa perte (qui
A
dix heures
du
soir
homme
des buissons,
et
dès
(le
dans
condziit
domestique) se cachait
voyait
qu'il
11
se méfier),
devait (allait)
le
piège tendu).
{s'était cache')
avait vu) Bertrand,
(qu'il
la suite.
copia (l'avait
la
l'avis périlleux qui
l" avait
conduirait,
le
Joseph
confirmèrent) dans
que Bertrand était trop confiant (pour
envoyait {avait envoyé) au jeune
il
(les
tombée) entre ses mains.
(était
copiée) au crayon pensant bien
et
mois,
ses
avaient confirmés
tombait
lettre
comme si chacune des pensées
cœur d'un fer rouge, Raymond dit (p.
soupçons lui étaient venus (lui vinrent), comment
les
l'observation les
Une première
Il
avait percé) le
(lui
mère comment
sa
déf.) à
lentement,
lui
—
parle.
ne travaillait plus.
il
Alors
anciennes
moment dont on
plus au
l'était
s'étant passés
pensée:
la
derrière
revenait
il
{était
revenu) avertir son maître (Albert Delpit).
Le
plits-qiie-parfait raconte
passés avant
crime
le
le
;
comme s'étant
comme étant
événements
les
passé
narre
défini les
survenus à une époque du passé, l' imparfait nous met devant
les yeux le tableait de ce qui s'est passé.
—
Remarque.
passé indéfijii
le
passé indéfini
du narrateur
comme
En racontant
parole.
signification entre
passé défini, c'est qu'en
le
l'esprit
événements
les
et
La grande différence de
s'étant
les
faits
dans
est
présent (avec
le
passé dont on
le
moment
Aussi
parle.
du
le
passé
défini,
de
la
rien à faire avec
Le
parole).
passé
moment passé ou après
sttrven/ts au
faits
les
la
l'esprit
avant
par
le
les
récits
le
moment de
passés
narrateur se porte dans un passé qui n'a plus
raconte
racontant par
présent, et raconte
le
le
défini
moment
commencent-ils ordinaire-
ment par l' imparfiait, qui montre rétat, la situation (des personnes ou des choses) au moment oti les événements vont
arriver.
On pourrait même, pour les faits isolés comme pour
le premier événement
d'un récit oîi les événements se suivent,
enchaînés l'un après l'autre, sous-entendre toujours un imparfait-.
En
Pierre le
sait,
où
le
il
le
1702, la ville de Saint-Pétersbourg n'existait pas encore, mais en 1703
Grand
la
—
fonda.
mais l'année suivante
monde
ciel
fit le
et
Vi
la
En
les
telle
année, Carthage
Romains
la
existait pas encore, mais à
terre.
firmament
Le
qu'il
anneaux d'une chaîne).
premier
appela
ciel
jour
(les
existait encore et fioris-
détruisirent.
—
événements
se
un temps
Il y a eu
un mo^nent donné Dieu voulut créer
Le second jour
fit
il
la lumière.
suivent
comme
les
Imparfait de l'indicatif.
Et
sens, avec le passé hidéfun, sera:
le
C'est avant le
fondé
la
49
moment présent où nous sommes que
de Saint-Pétersbourg.
ville
Pierre le Grand a
longtemps avant nous que les
C'est bien
Romains ont détruit Carthage. // s''esi passé bien des siècles depuis que Dieu
Le premier jour il a fait la lumière, le second jour
le ciel et la terre.
il
a fait le firmament qu'il a appelé ciel (événements qui ne forment aucune
a créé
eux
ciiaîne entre
et qui
moment de
sont tous rapportés au
la
parole).
La différence n'est pas moins grande entre Inuparfait, qui
exprime un clat ou des faits existant déjà depuis un certain
temps à l'époque passée dont on parle et existant ou se faisant
encore à ce moment-là,
on parle
passé
et le
défini
qui exprime
passé ou après le moment passé
remarque qui termine notre opuscule).
(voir la
Cette nouvelle que vous saviez déjà alors, je ne
le
—
lendemain.
La
vous vous trompez,
ville,
nos
consilium) car
rien faire
César vit
avec
troupes
voyait
il
peu de troupes
le
(vidit)
—
arrivaient.
{videèat;
qu'il avait
avec
sns (ne l'appris) que
la
pas
encore prise en
Les ennemis fuyaient déjà quand nos
Les ennemis ne s'enfuirent "que lorsqu'ils
troupes parurent (jam fugiebant).
surent que
dont
il
changea de
César
savait,
(mntavit
dessein
pouvait
Après avoir éprouvé un échec.
trop peu d'hommes pour vaincre, et il dut
il
qu'il avait.
lui
n'était
—
ne fnt prise qu'en mars.
janvier, elle
les faits
moment
au
siirveîitts
n'ig^norait pas) qu'il ne
—
changer son plan de campagne.
Avec
le
du présent,
suivent
l'un
présent i^OMx
mis
en
passé défini on part du passé pour se
mais
sans
après
avec
l'autre;
dans
aller
rapport
arriver,
y
avec
dans
un
les
les
avoir
faits
on
racontés
faits
présent sans
rapprocher
récit
passé indéfi^ii
le
passé;
le
le
et
part
sont
se
du
tous
eux aucun
entre
enchaînement.
Au
lieu ù\x pltts-qiee-par/ait
employons
passé défini
le
relation avec le présent)
ayant eu lieu avant
Raymond a
{hier
le
ou
(\\x\
(faits
le
commence
survenus
passé indéfini
moment
le récit
dans
(faits
le
précédent,
passé
racontés
sans
comme
de la parole, nous aurons:
ou ce matin) tout raconté (raconta
tout)
à sa
mère.
comment les soupçons lui sont venus (lui vinrent, lui
étaient venus), comment le hasard, l'observation les ont (avaient) confirmés
(les confirmèrent).
Une première lettre est tombée (tomba) entre mes mains,
Il
lui
je la
a dit
copiai
(l'ai
dans
l'attirer
caclié
(lui
copiée) et
il
est
Le
piège.
caclia)
(se
Bertrand,
le
dit)
derrière
venu
t'ai
ensuite
même
des
vint)
(il
été (fut) commis, je ne
l'ai
jour,
envoyée
buissons, et
me
le dire.
(et
l'envoyai) à Bertrand pour
du soir, Joseph s'est
a vu (qu'il vit) passer
Mère, c'est ainsi que le crime a
à dix
heures
dès
qu'il
rien caclié.
4
50
Imparfait de l'indicatif.
Un
Français du Centre
du Nord, dans
et
raconterait certainement ces faits par
du Sud par
çais
remarques,
Par
oratio:
insistit
avec
le
Perfecto
latin.
C'est
ici
le
cas
imperfecio
procedit,
parfait (notre passé
le
V imparfait
avance, par
récits
mêlés de descriptions (jugements,
rendus par r imparfait.
réflexions)
peut dire
l'on
011
Donnons encore deux
passé défini.
le
(passé dêfati^ passé indéfini),
la conversation,
passé indé/ïni, un Fran-
le
défini)
le
discours
s'arrête.
il
du temps au moment où les faits vont comcommença (a commencé). Je fus (j'ai
été, je suis resté) quelque temps sans m'en apercevoir.
Je m'en aperçus (je
m'en suis aperçu) enfin, la pluie devenant (elle devenait) plus forte, et je
me réfugiai (me suis réftigié) sous un arbre. En ce moment je vis (j'ai vu)
venir un chiffonnier, la hotte au dos (il avait une hotte qu'il portait sur son
dos), son crochet à la main (il tenait un crochet à la main).
Il
était suivi
d'un roquet noir ruisscla7it (qui ruisselait) d'eau, il s'écria (s'est écrié) en
passant (pendant qu'il passait, passa ou a passé) devant moi: Quel sacré
Le
temps!
couvert
était
ciel
mencer).
L'instant
d'après
{état
pluie
la
quelle sacrée vie! (Victor Cherbuliez).
Ce matin
à 5 heures,
hennissement de quatre chevaux qui piaffaient
le
(sans doute depuis quelque temps) sous
m'habillai (me suis
liabillé) à
la
ma
hâte
fenêtre
et je
me
réveilla (m'a réveillé). Je
descendis (suis descendu).
Là,
Hans achevait (il était eit train de travailler) de charger (il chargeait depuis
un certain temps) nos bagages sans se remuer (il ne remuait pas; réflexion)
pour
ainsi
Mon
oncle,
Cependant
dire.
il
opérait avec une adresse peu
commune
(réfle.\-io7i).
que de besogne, mais le guide
paraissait se soucier peu (il ne se souciait guère) de ses recommandations.
Tout fut (a été) terminé (tout était terminé) à six heures, et nous partîmes
(nous
sommes
On
oij
partis)
(J.
Verne).
que pour raconter les événements de la journée
on peut, malgré nos grammaires, employer le passé
faut, pour cela, que le moment dont on parle soit
voit
l'on est,
défini.
faisait (réflexion) plus de bruit
lui,
Il
Or
écoulé.
narrateur n'est plus
dans
la
ma-
tout
à
tinée
du jour 011 il fait son récit. Voici le commencement d'un
où il y a douze passés définis qui se suivent dans
fait
le
ici
autre récit
la
Revue politique
et littéraire
:
Aujourd'hui nous étions encore endormis quand,
il
nous réveilla en nous priant de
lui
servir
à 5
de témoins.
nous apprîmes depuis être le comte de B., raccompagnait
pas de vue un moment. Ce fut dans la voiture du comte
rendîmes
à l'endroit
où
le
duel devait avoir
lieu.
heures du matin,
Un
et
vieillard,
ne
le
que
perdait
que nous nous
Conditionnel.
51
Conditionnel.
mon
Voir
étude
sur
pp. 56
conditionnel (1895),
le
62*).
Le conditionnel, comme mode, est appelé le mode de
parce que, dépendant de condùiotis ou de suppositions douteuses, il exprime le plus souvent des faits sur la
réalisation desquels on ne peut compter; souvent même le con1)
Virréalité,
ditionnel exprime des choses irréalisables, impossibles:
Si je
—
Paris.
demain
roi un
reçois
Si je suis
cet
ari^en/,
jour,
dira
comme
Pespère,
Je
un prince
bonheur de mes sujets {ftUur, exprimant des
sur
faits
travaillerai
je
au
desquels
réalisation
la
pour
partirai
je
hérUier,
on peut compter).
Si ie 7'ecevais demain cet argent
pour
—
Paris.
Si j'étais
bonheur du peuple.
indéfini
§ 3
temps du verbe,
excepté
parfois
ma grammaire
et
Mon
.
.
travaillerais au
je
(faits irréalisables)
conditionnel est
le
partirais
n'est pas sur), je
quelconque,
mon
(voir
de 1878—79, P^«
père raconte qu'il
(le
.
de
passé
étude
de
1896,
partie,
pp.
131 et 133):
un voyage en France;
fera bientôt
.
le futîir
par extension, de tons les temps passés
et,
seul
dont on
Si j'étais le soleil (souris, oiseau), je.
Comme
2)
rimparfait
(fait
homme
un
dira
roi,
p.
57,
racontait
il
déjà ce matin qu'il partirait **).
Dans
—
maires de 1878 et
les
1881
temps passés,
composé, on
avoir:
le sait,
je chanier-(av)ais,
au russe ôMTb;
*)
en est
il
l'infinitif
déjeuner
—
**)
Le
simultanéité,
je recevais
si
—
les
les
grammaires
conditionnel
comme
je
de
savant
Le conditionnel
de l'imparfait de
chanter-ai
(infinitif
1878—79
et
M.
avec
conditionnel étant le fjitur
le dit la
f avais)
cet
+
—
je
partout
ailleurs,
j'achèterais (après cela) des
une
L.
mon
=
qu'il
Clédat,
L.
étude sur
partirait après
Sudre,
le
F.
il
le
Brunot
verbe de 1896.
n'exprime aucune
Dans une phrase comme:
serais heureux, l'idée de recevoir ou
d'être heureux ; le conditionnel exprime
J.
Fleury.
idée de futjirition:
livres.
iinparfaitfntur-péri-
des temps passés
grammaire de
argent,
latines
futur des temps passés dans:
déjeuner
le
grammaires de M.
A^ avoir cet argent est antérieure à celle
ici,
cf.
et
le
Cf.
partir après
gram. de
comme
(si
conjuguer
chanter-ais (contraction);
qu'ii allait
ma
à
/mur
ama-bo (amabo), où bo répond à (ich) bin,
leg-am (legam) où am répond à l'ang. ain, au russe ecub.
Voir
d'accord avec
du verbe
mes gramle
de M. Adolphe Tobler,
de l'Acad. des sciences de Berlin.
Le temps appelé dans
matin
conditionnel est
le
et
phrastiqîie est équivalent à un
disait ce
même
de
avec
d'accord
toutes
de
de avoir).
indicatif présent
sont encore
pour reconnaître que
et
romaniste de l'Université
est
indicatif.
Les grammaires de M. M. Léon Clédat, Ferdinand Brunot
(1899), Darmesteter-Sudre (1897)
tous
mode
ces cas le conditionnel appartient au
Reinarqne.
Si je recevais
cet argent,
52
Conditionnel.
* Caniar-aio
(cantare-habeo),
XIX« jusqu'en 1835, où
il
*
chanter-ai;
can/a?'-a(è)cam
chanterois
chanteroi,
chanter-oie,
je chanter-eie,
(XVI«,
(cantare-habe(b)ami
XVIIe, XVIIIe
siècles et
devint chanter-ais.
Au
point de vue du passé ce sera encore le conditionnel
employé comme fîtùir, comme c'est le futur qui est
employé au point de vue du présent, dans:
veut une explication (présent),
Le jeune homme a été offensé,
l'aura. —
vou/ait une explication,
Le jeune homme se trouvait offensé,
l'aurait (futur
3)
qui
sera
il
il
il
de l'imparfait
et
des temps passés).
pour le conditionnel, comme pour le futur,
sous-entendu comme le pense M. L. Sudre (Grammaire
n'y
Il
aucun
a là,
de Darmesteter,
dite
il
syntaxe,
— 157),
156
pp.
conditionnel
et le
dans des propositions indépendantes.
M. L. Sudre, p. 156, nous dit que le conditionnel, futur dans
le passé, ne s'emploie en français moderne que dans les propos'emploie parfaitement
ici
Nous avons cependant des
sitions dépendantes.
ment identiques dans
les
exemples
futurs 7^elative-
(futur après
temps passés), où
suivants
présent, conditionnel, vrai futur, après les
propositions sont indépendantes l'une de l'autre:
La dame a beau admirer ses filles, elles n'hériteront pas du
de Bretagne avait beau admirer ses
(fttiur au point de vue du passé, Revue pol. et
exemples qui se trouvent dans mon étude de 1896, syntaxe,
France
face
seuls,
p. 301).
—
11
que
le
face,
à
corps du
oîi
sans
côte à côte,
jour et nuit,
là,
Voir
les
la
terre
bénie
(ibid.,
mon
p.
311;
(ne
Geinmi,
et
n'oserait
l'auberge,
serait
remarquons
étude sur
le
reste-
ils
la
autour de
été retrouvé
vieux guide n'aurait pas
nos grammaires voudraient bénite; voir
lère partie,
C'était fini,
parler.
ou cinq mois (L Auberge de
n'osait point sortir; il n osait point
fantôme resterait
le
retrouvé) et déposé dans
là
—
58.
quatre
voulait s'enfuir et
plus désormais, car
tant
/itt.J.
p.
Contes de
les
allaient lentement,
Ils
raient
Anne
deux exemples que j'ai trouvés ces jours-ci
Guy de Maupassant:
Voici encore
en relisant
trône.
pas du trône de
n'hériteraient
elles
filles,
le
les
ici
pas
bénie
verbe de 1S96,
64—65).
pp.
Le conditionnel n'exprime-t-il pas encore un futur dans les
exemples suivants, ou exprimerait-il la simultanéité comme le dit
et y a-t-il là quelque chose de
J. Fleury dans ses grammaires?
sous-entendu?
Ils
dans
la
arrêtèrent qu'on
diète,
événement
que
la
(Voltaire, Hist.
français emploie
ici
enT errait au
de Suède
roi
l'ambassade
proposée
pospolite monterait à cheval et se tiendrait prête à tout
le
de Charles XII;
conditionnel).
ferait pendre toute la garnison
le
russe emploie
le
(Cœur de
lion)
Richard
après qu'il attrait pris
qui l'avait blessé serait écorché (où est encore
ici
la
futîir lorsque le
la ville,
répoftdit
et
que
simultanéité?)
qu'il
l'archer
Futur
Futur
Après
conditionnel après
et
antérieur par
passé
le
I^imparfait de
on doit remplacer, en
préseui de l'indicatif, le Jittur
le
le cofiditionuei,
i^idéfini,
et
l'indicatif,
tif,
dit présent,
conditionnel passé par
le
qite-parfait de l'indicatif, ou par
que
si.
supposition)
fiitur simple par
français, le
après
et conditionnel
(condition,
SI
53
si.
du
le pliis-q ne-parfait
par
plus-
le
subjotic-
grammaires françaises appellent second condition-
les
nel passé:
Si je finis (pour
pagne.
—
le-moi.
Moscou.
finirai)
vous l'avez
Si
Si je
Moscou
j'aurais)
si
j'eusse
(si
Lorsque si
2)
demain,
travail
je
partii'ai
recevais (pour recevrais) cet argent demain,
Si j'avais (pour
route pour
mon
(pour aurez fini) avant 9 heures du
fini
n'est
reçu
reçu
cam-
la
apportez-
partirais pour
je
déjà en
je serais
argent hier,
cet
pour
soir,
cet argent hier, je serais (fusse) parti).
que dubitatif,
futur et le conditionnel
le
reprennent leur place:
Je ne sais
s'il
savais pas encore
qu'on
finira
alors
(s'il
aura
finirait
s'il
son
fini)
(s'il
travail
anrait
avant ce
son
fini)
soir.
travail
—
pour
Je ne
date
la
avait fixée.
lui
On
considérer si comme une sorte de si
exemples suivants, oiî l'on peut souvent le
remplacer par peut-être, sans doute (sens de probablement que
sans doute a très souvent), sans aucini doute, comme, etc. Ce
3)
peut
aussi
dubitatif dans les
si,
avec des expressions
comme sans
doute {probablement),
etc.,
un .9/ de modestie n'osant affirmer
positivement comme vrai ce que l'on avance, autrement dit: un
si restrictif de la pensée, un si employé dans la crainte d'être
dans l'erreur en parlant:
pourrait, je crois, être appelé
Mammon
s'il
n'est plus aujourd'hui
ne saurait se convertir,
il
mais
pousser un
cri
est
il
d'alarme,
nous avons reçue
courage
leçon.
.
.
.).
—
-gouvernement,
devons
(le
mais
à
cette
S'il
il
il
serait
et
obligé,
si,
disons:
et
etc.
—
S'il
également puéril
Figaro;
traduisons:
sachons
cependant
Il
y
il
ne
sait (sans doute) se
y aurait peu de courage à
de méconnaître la leçon que
aurait^
reconnaître
selon
tout
le
nous,
peu de
de
sérieux
la
serait injuste de ne pas accorder dans ce succès une part au
faut
uire
cependant que
prospérité (L. Passy;
Je reconnaîtrez sans
même temps
toutefois
seul maître,
le
obligé,
compter avec nos scrupules (A.
D. M., 15 mai 1903, p. 308; effaçons
convertir,
omnipotent, n'est plus
du moins, de faire l'hypocrite et de
Leroy-Beaulieu, le Règne de rargent, R. des
est
doute avec moi
reconnaître que....).
c'est à la
traduisons
— de
encore:
France agricole que nous
Il
serait injuste
ne pas accorder..
..
—
vous
mais sachons en
54
Futur
sï rappelle beaucoup
Ce
très
souvent dans
le
si.
si du vieux
le
employé
français,
sens de aùisï.
exemples
des
Voici
être
et conditionnel après
de Molière
de Racine
et
si peut
oii
remplacé par comme:
la répugnance à me voir votre belle-mère,
moins à vous voir mon beau-fils (P Avare, III, 11).
St
Si (comme) vous auriez de
pas
je n'en aurais
—
main serait trempée (comme
main
d'un sang trop
vil
sang trop
au défaut de ton bras, prête-moi ton épée {Phèdre,
vil),
n'y
Il
a
ta
là,
sous-entendu;
il
comme
n'y
dans
les
serait
trempée d'un
3® livraison
la
5).
aucun
de conditionnels
là
venant d' hypothèses reposant sur des sons-hypoihèses,
prétendu M. Waltzing dans
II,
exemples précédents,
davantage
pas
a
ta
de
pro-
comme
Revue de
la
l'a
l'Inst.
pub. en Belgique, 1896*).
Il
y a évidemment dans les exemples qui précèdent et
dans beaucoup de ceux qui vont suivre comme deux propositions coordonnées, la seconde ne dépendant nullement de la
La conjonction si n'y
première.
mais une sorte de si
tionnelle^
de doute, ne
fait
exprimer à
hypothétique
est ni
dubitatif,
condi-
ni
par son caractère
qui,
phrase qu'une affirmation mitigée,.
la
affirmation également adoucie par l'emploi du conditionnel.
Impossible de demander,
trouvent
conditionnel
le
ici
placé par l'imparfait.
pourrait
avec certains commentateurs,
fautif,
employé qu'en donnant un tout
être
en disant: Si d'un sang trop
avoir été frappée, ce que
sité
rem-
autre
comment continuer
vil
dirait
ta
main
le
sens
était trempée)))
quel
l'imparfait,
à
la
premier vers
Après
besoin Phèdre
encore de demander à Hippolyte son épée?
Nous voudrions demander au savant professeur de l'Univerde Liège comment il expliquerait par hypothèse, basée sur
sous-hypothèse, l'exemple
suivant qu'il
a dtî
lire
Revue de Belgique (2* livraison
Comme si les violences et les
1902):
opprimer
voici les échevins
les
paysans
pour exactions sur
*)
M'
soit
Dans l'exemple de Molière l'imparfait ne
phrase, et dans celui de Racine
aurait-elle
que ce conditionnel
qui
Voir,
les plaintes
contre
Clédat (1891,
l'opinion
563—573).
p.
déprédations
ne
suffiraient
la
même
pas
pour
de Hulst poursuivis
de leurs administrés.
3^ trimestre) et
gram. de Darmesteter,
(1895, pp.
et les bourgeois,
dans
de
sa
160, et la
Mr Waltzing,
Grammaire
la
Revue de philo f. fr. par
la Syntaxe
de la
Revue: Zeitschriftfur romanische Philologie
historique,
Futur
conditionnel après
et
55
si.
Voici encore un exemple de Molière {r Etourdi, IV,
si peut encore être changé par d'autres mots,
deux temps
Cela
homme)
la
si
être
(puisque),
n'avait que sept ans, et si
me
peine à
que
différents selon l'idée
pourrait-il
(=
que,
voulu exprimer:
l'écrivain a
pu
m'a
lorsqu'il
oii
2),
l'on trouve
et oii
voir,
il
(le
jeune
lorsque) son précepteur aurait de
reconnaître?
Remplaçons aurait par avait, la phrase devient absurde.
4) Après si, le vieux français employait parfois le conditionnel, ce que nous ne pourrions plus faire dans des exemples
comme
ceux qui suivent:
Se
porroies racheter, volentiers
tu le
(si)
contereie, se
Sire, je
—
(Fierabras, 623).
(je) le lairroie
vos congie en avereie (en aurais; Marie de France).
(si)
Voici un exemple (donné par Estienne Pasquier) contenant
futur et le présent du subjonctif employé après si au
XVI^ siècle:
Que Bee L'on me puisse prendre si je ne feray venir un sergent; mes-
le
!
avenir lui puisse
ne t'einprisonue.
s'il
dans
trouve
Je
Il
que si Dieu
jura
l'Empereur,
il
Mémoires de Brantôme
les
XV^
2" partie, Discours VI;
donncroit un jour la paix ou
la mer de Toscane.
luy
Darnes^
(les
siècle):
la
avec
triefve
par ses galères en
iroit
Et chez Voiture (XVII® siècle):
Je
sa part,
prie pourtant
la
je
dirois
de
la
ne prenez gueres de
plaisir
de quelle sorte tout
vous auriez honte
Malherbe
Je meure
de
le
(1,
chois'ir les
mienne
si
et
si
je
quand on vous donne
monde
439,
plus beaux et de vous les présenter
fosois,
ne sçanrois
(I,
247, 15).
dechaisné contre vous,
est
bien que
Si
de
vous
vous sçaiiriez
je suis
que
asseuré
19).
a dit:
si
je
saurols vous dire qui a
le
moins de jugement
(il,
634).
Et Pascal:
S'ils
leur
anroient aimé ces promesses
du
a
second
subjonctif)
exemple
employé
auquel on
un
Voici
Larroumet,
où
le
un
de
premier
s'attendrait
nos
nous aurions (eussions)
y
plus haut,
meilleurs
plutôt
écrivains,
passé au
lieu
du
(plus-que-parfait
a,
§ 3)
la
à
ce
et,
si,
deux
que Racine
composition attentive
et
les
sévère.
exemples qui précèdent (voir un peu
ou qui vont suivre, comme deux propositions
dans tous
p. 52,
dans ses conseils,
beaucoup perdu
Racine doit à Boileau l'habitude de
Il
252).
:
trois fois,
suivît.
I,
conditionnel
Si Boileau n'était pas toujours bien inspiré
ou
eussent conservées....
et qu'ils les
tesmoignage n'eust pas eu de force [Pensées,
les
Futur
56
coordonnées,
conjonction
une sorte de si
est
dubitatif qui pourrait
l'avons
plus
dit
l'emploi du conditionnel.
s'appliquer
aussi
toujours ce que l'on
dit
degré
des apartés
d'affirm^ation adouci par
Et ce que nous disons du conditionnel
au fîdur qui n'exprime pas non
avec le même degré de certitude:
Je reviendrai demain chez vous, je reviendrai certainement,
sans doute (comprenez: probablement),
pctit-ê/re, je reviendrai
artcun doute,
je
Si Feuillet
pour
ni
lui,
1er fév.
ne laissera pas dans
dans
l'histoire
nous plaindre
du
qu'il
ait
pour
comme
si,
Mamiel
de
littérature
plaisir,
de
lieu
trace
la
ne
il
ineffaçable
faut pas regretter
Brunetière, R. des
(F.
M.,
1).
nous aurons:
si,
pas ici.... mais ne
Attila,
ce ne
regrettons
(c'est
—
lettres
ou
Corneille compliquera,
si
pour obéir à
sera pas
effaçons
1898, p. 134,
liif.,
sera délicat
de doctorat de
la
du théâtre
fait
peut-^tre
Dans son OtJwn, dans ron
s'il
contemporain,
pas toute-
ne nous plaignons pas que ....
et
lui,
trera ses intrigues à
de
ja/zj-
etc., etc.
1891, p. 673).
Feuillet ne laissera
Et
du théâtre
l'histoire
roman
Mettons peut-cire au
(Id.
je reviendrai
reviendrai
futur s'emploie après
s'effacer, \t
plus
conditionnel*):
qu'il laissera
fois
je
reviendrai si le temps n'est pas si detestab/e qu'atijonrd'hni,
Lorsque si peut
le
sans
peiti-ctre,
comme
tous ces mots étant
le
mais
remplacé,
disparaître,
par comme,
La
première.
la
conditionnelle,
ni
même
haut,
pour modifier
l'on ajoute
peut
hypothétique,
ni
doute, sans aitctm doute,
que
si.
seconde ne dépendant pas de
la
sï n'y
comme nous
après
et conditionnel
et
si,
mettons maii
ce sera une question
délicate)
de déterminer l'influence que
genevoise ont pu exercer sur
le
les
s'il
enchevê-
sa propre inspiration
—
devant
—
ce).
dans ces thèses
qualités
développement de
ou défauts
la
au
nôtre,
moins ne pourra-t-on contester que Genève (avec la Suisse française) occupe
une place appréciable dans l'histoire de l'esprit français {Rev. hebd., 1er nov.
1902, pp. 62
— 63). —
va de soi que si l'on
Il
gnements, nous saurons,
—
Belge, 17 août 1898).
Aucun de
éclat
et sa
défendre par
la force
paix
31 janv. 1899).
M.
F.
—
les
Je
(Petit
l'ai
de
Si le
ses
et
nécessaire
Les cavaliers ont
la
de Racan,
et
Julleville,
peuple
intérêts,
il
fougue,
et,
devra
être
de quelque façon à
Litu fr.,
anglais
au bonheur
s'il
n'hésitera
n'a jamais
de
IV, p. 259).
lui
—
jamais à
pensé non plus
l'humanité (Le Figaro,
après tout,
si,
neuf fois sur
Brunetière est certainement celui de nos écrivains qui affectionne
le plus cette tournure;
çaise.
Indép.
(la
pas contribué
n'aura-t-il
son honneur
qui est
rensei-
Vie à Paris,
de Théophile
Le lyrisme
poésie?
démentira peut-être ces
besoin, les compléter
ces jugements n'est juste.
à rompre une
'")
est
drame tragique,
expulsé du
donner son
s'il
elle se
répète
plusieurs fois
dans
sa Littérature
fran-
rencontrée encore deux fois en relisant dernièrement son étude sur
Transformations de
la
langue au XVIIIe siècle {R. des D. M., 1891).
Indicatif et subjonctif après
servira qu'à se
dix, cela ne leur
un
être
faire tuer
glorieusemeut,
accompliront peut-
ils
Bc/gi\ 7 juin 1899, lère colonne, p.
utile {Indcp.
d'armes
fait
57
semble.
il
Voici un exemple de fit/ur antérieur dans Balzac
La saison où ces
pas été longue,
feuilles brillent sera bientôt passée, et
aura été calme, uniforme et sans inquiétude (voir
elle
de M. Jules Hardan,
n'aura
vie
l'
Anthologie
166; Riga, 1906, chez N. Kymmel).
p.
remplace
fîitur antérieur ne
Le
:
ma
si
3),
qui donnerait
un autre sens à
d'une vie qui
n'a pas
pas
On
indéfini,
ne parle pas
mais d'une
été longue,
passé
le
ici
phrase.
la
ici
ne sera
qui
vie
peut-être pas longue.
Voici, dans
vieux français,
le
Et voici
multum
Oratore,
H, 30,
moribus ac
in
proderunt
loci
ei
que
mortel
chétif
Regardez votre
vous
fille,
ne dirait-on pas etc.?)
au plus
si
me
je
iui (Fr; Soulié).
cou
notre
êtes,
pourra-t-il
suorum hospes, non
promuntur (Cicéron, de
argumenta
—
M
bout?
en venir à
1884,
la
rue,
—
(Molière,
diable
si,
^£t litt.,
1890).
—
l'autre
monde
le
aux gens
:s'il
Dépit amoureiix,
le
IV.
il
1).
Le
diable
n'y aurait pas quelqu'un qui
me damne
Dieu
(E. Sue,
les
si
ne dirait
l'on
Enfants de Pamour).
qu'ils attaquent, à qui nuisent-ils
inttrn. de
n'aurions pas
5i
au bourg,
donc?
ne se trouverait personne pour affirmer
.(Rev.
l'histoire
de
c'est tout
douné la peine de traverser le ruisseau pour aller
Je veux être pendu si nous ne les verrions pas sauter
serais
m'emporte
n'aimerais pas mieux vous savoir enterrée que moucharde (Mérimée).
bien
Diable
—
507:
p.
le
nous l'a métamorRegardez votre
rencontré dans
l'avais
tirer d'affaire,
Sage,
(Le
pas qu'on
dirait
1er fév.
,
Si je
si'''-')\
vous ne sauriez vous
l'on ne
si
R. des D.
phosée (M. Uchard,
fille,
— 49),
131).
Si tout fin diable
ioiieux).
2047
voluntatibus civium
quibus
ex
illi,
Autres exemples du conditionnel après
comment un
Rose,
(la
latin:
le
erit
orator
Si
futur après si\
le
de bon cuer (cœur) serviras
te garira se (si) tu
11
r Enstigncmcni.
pu nous
la
passer
de
fév.
lui
(Lecture,
Tragédie se pourrait,
n'en va pas ainsi pour
la
Comédie
à
{Litt. fr.
1899,
la
S'ils
(E. Zola,
cela,
15
pas que
—
—
si
à
à
je
C'est
claque {Rev. pol.
tu es
arrivé
de
ne sauraient nuire
le
Crapaud).
—
Et
n'en faut-il pas conclure ....
p.
123).
— Comme
15 juillet 1899,
si
nous
P Anneau).
résumer en un nom,
rigueur,
—
il
par Petit de Julleville, VI, p. 559).
Indicatif et snblonctif
après
/'/
semble.
1) Après l'impersonnel il semble les grammairiens de la famille
des Noël et Chapsal nous disent que le subjonctif est de rigueur.
•) Plusieurs
BeitrMge)
de
Berlin.
du
de ces exemples se trouvent dans
savant
romaniste
M. Adolphe
Tobler
les
de
Mélanges (Vermischte
l'Acad.
des
sciences
58
Indicatif et subjonctif après
comme
n'admettent,
Ils
semblait,
(il
voHs,
que vous avez
tne semble
Il
nous avons
nous
Littré
dictionnaire en disant
de
raison.
—
me,
nous,^
te,
à:
semble à ces vtessietirs que
Il
tort.
Mais
lent
cas où il semble
le
ou d'un substantif précédé de
leur,
lin',
que
seule exception,
dirait.
précédé d'un des pronoms
est
etc.)
semble, on
il
donne
qVi II
déjà
paraît, présente les
il
comme
faits
comme plus douteux
certitude),
bonne règle
la
dans
son
semble, 2i^tz Vincil'caù'f, alors l'équiva-
avec
plus certains (quasi-
subjonctif,
le
et
donne
il
un assez grand nombre d'exemples:
semble, d'après ce qu'il
Il
mais peut-on
le croire sur
qu'il
dit,
les faits
ou d'une
sibles
Il
raison.
même
Les grammairiens veulent
semble lorsque
a
Il
semble
qu'il ait raison,
parole?
sont
comme
présentés
//
me^
impos-
douteux,
on ne peut croire:
réalité à laquelle
me semble que mon cœur
après
subjonctif
le
veuille se
—
fendre.
nous semblait que-
Il
nous fussions seuls au monde (Montesquieu).
Après on dirait, on emploie aussi le subjonctif pour les
douteux ou impossibles, l'indicatif, dit Bescherelle,
très
2)
faits
seulement,
des
faits;
imitation
lorsqu'on
a
de
ceux que
sem,ble,
comme
trouve
l'on
emploie
rindicatif qu'on
c'est
de fortes raisons
de croire à
la vérité
mais on peut dire encore qu'à part quelques exemples,
après on
aux XVII®
presque
et
XVIIP
toujours
après
siècles,
//
me
dirait.
Voici des exemples que
je
trouve dans les Contes de
Guy
de Maupassant:
qu'on allait me saisir par
mon père et mon oncle me
précédaient armés de leurs fusils (M^'e Perlé).
Il me
semblait — quoique je
ne l'eusse jamais vu — que je reconnaîtrais mon oncle du premier coup
{Mon Oncle Jules; le jeune homme n'avait aucune bonne raison de penser
Il
les
me sembla
épaules
ainsi,
car
il
et
marchait
derrière moi,
était ridicule,
car
—
ne reconnut nullement son oncle après avoir eu tout
bien regarder).
fleuve bien
qu'on
m'emporter, ce qui
—
Il
tranquille
me sembla que ma
—
faisait
des
barque
—
qui
était
le
à
temps de
l'ancre
et
embardées gigantesques, touchant tour
tour les deux berges du fleuve {Sur l'Eau,
—
le
le
à
que l'âme
de son vieil ami rôdait autour de lui comme un oiseau de nuit {L'Atiberge de
la Gemmi).
Il me
semble que ce cri (d'oiseau) est un soupir de l'âme du;
monde
{id.,
p. 322).
p. 4).
Il
lui
semblait
Indicatif et subjonctif après
semble, on
il
59
dirait.
3) Pour // semble, suivi de l'indicatif, voir Littré et ajouter
exemples suivants à toute la demi-page de ceux que je donne
dans mon étude sur le verbe de 1896 (syntaxe, p. 74):
les
semblait qu'avec
Il
VII
Charles
peine
aujourd'luii
grands vassaux,
cites ses
(Remy Saint-Maurice, Lecture, 5 mars
Racine ont
Faguet,
(Emile
bien
eiiteiidu
ments qui
se
préparaient
même
(Gabriel
sauf les
siècle,
—
pressentiment
de l'Acad.
fr.
et
différences....
168).
p.
Dumas,
(A.
8'<*ffoiuIrait
que Molière
// semLle
quelque
Hanotaux
s'éveillait
sembla qu'elle
Il
manière,
du XVII«
avait eu
de Richelieu)
—
p. 439).
1898,
la
Grands- Maures
les
(l'oncle
qu'il
de
le théâtre
monde
le
4).
III,
//
semble
des
événe-
Richelieu à Blois,
;
—
1»' nov. 1898, p. 47).
// semble bien que son activité (celle
du père jésuite Cotton), jamais en repos, et son zèle pour la reine flnireut par
Il semble que les lettrés
le compromettre (Id., ibid., p. 777, 15 déc. 1898).
auraient dû être plus tolérants et moins injustes (G. Boissier de l'Acad. fr.,
// semble
R. des D. M., 1 déc. 1901, Jiigement de Tacite sur les Césars).
R. des D. M.,
—
—
qu'Orose aurait
«lii
M.; 1890,
R. des D.
aux païens (G.
être sévère
p.
—
159).
Il semble
Boissier, Ettides d'hist. religieuse;
que Louis XIV était
héros à mettre en opéra (R. des D. M., 15 juin 1903,
4)
Voyons
maintenant
s'il
faits
On
avoir de
dirait
que
comme
toujours,
taut
bonnes raisons de croire
pour employer l'indicatif après on dirait:
Bescherelle,
dernier des
le
Carmélite, p. 445).
la
gondoles sont des ombres qui glissent
ces
dit
le
réalité des
à la
sur
l'eau,
guidées par une petite étoile (M^e de Staël, Corinne).
les
M"'® de Staël avait-elle de
gondoles sont des omh'-es.
bonnes raisons de
croire
que
Dans les exemples cités par Bescherelle, la règle qu'il
donne permettrait d'employer tout aussi bien le subjonctif que
rindicatif et f indicatif que le subjonctif:
Dieu
monde
me pardonne
l'on
si
des années
éternelles
(peut-on
dirait qu'ils
ont seuls
l'oreille
un autre David (Bossuet).
dirait
que
ne
le livre
—
travailler
que tu es arrivé de
pas
dirait
Sue, les Enfants de l'amour).
(E.
On
pour
dirait
des années
d'Apollon (Boileau).
On
dirait
des destins ait
que
le
ciel
été ouvert à ce
On
est
éternelles
—
mort, ce
On
que prouveraient
soumis
à
—
prophète.
momies qu'elle nous a
rien au monde (Bossuet).
les
?).
dirait qu'il soit
l'ancienne Egypte ait craint que la postérité ignorât un jour ce
la
l'autre
travaillent pour
qu'ils
sa
—
On
devenu
loi.
On
dirait
que
c'était
On
que
que
laissées (Chateaubriand).
On
que Ronsard
à vous
voir assemblés en tumulte, que Rome des Gaulois craigne encore une insulte
vient
dirait qu'il
ne fasse
encore fredonner ses
idylles
gothiques (Boileau).
—
dirait
On
dirait,
(Crébillon, Catilina).
Littré
mais
sans
donne des exemples avec
donner de règles, et il
l'indicatif et
a
raison.
le
Les
subjonctif,,
écrivains
Ne
60
explétif après avant que, sans que.
emploient r indicatif lorsque
de vérité, le subjonctif
Vi ayant rien de réel.
se
lorsqu'ils
Ne explétif après avant
Après avant que,
un mot
et
pour eux un semblant
les faits ont
surtout
représentent
les
que,
comme
sans que.
après sans
que,
qui
est,
en
on ne devrait jamais employer la négation ne, qui est alors explétivc, inutile; mais pour la condamner
avec nos grammaires élémentaires, il faudrait aussi la condamner,
au même titre, dans tous les cas oii elle est encore employée
réalité,
comme
négatif,
telle:
„Je crains qu'il
qu'il vienne;
ne vienne" devrait
ne nie pas que cela ue
je
condamné, remplacé par:
être
vrai par:
soit
je crains
ne nie pas que
je
cela
que cet homme ne vous fasse du mal, qu'il vous fasse du
mal; cela n'empêche pas qu'il ne vienne (qu'il vienne) nous voir; je ne disconviens pas que cela ne soit arrivé (que cela soit arrivé); il est plus riche
que vous ne le croyez (que vous le croyez); il agit autrement qu'il ne parle
évitez
soit vrai;
(autrement
{à
moins
qu'il
qu'il
Je ne sortirai pas à moins qu'il
parle).
fasse
beau temps);
Je
ne
doute
pas
ue
qu'il
fasse
beau
ne vienne
temps
(qu'il
vienne), etc., etc.
Lorsque que remplace avant que,
crainte que, de
peur
que),
l'emploi de
la
sans
que (ajoutons de
négation est de rigueur:
Ne
permis,
l'ait
partez pas qu'on ne vous l'ait permis, sans qu'on ne vous l'ait
ou (sans négation): avant qu'on vous l'ait permis, sans qu'on vous
permis.
—
Je ne donnerai point
autre roi (Voltaire;
je
la
paix aux Polonais qu'ils n'aient élu un
avant qu'ils n'aient ou qu'ils aient élu
ne vous assomme (de
crainte,
de
peur que
je
etc.).
—
Sortez que
vous assomme ou que
je
ne
vous assomme).
Aux nombreux exemples que
je
cite
dans
mon
étude sur
verbe (1896) je me contente d'ajouter les suivants, tous pris
dans les ouvrages de nos meilleurs écrivains contemporains, et
le
que l'on peut tout aussi hardiment imiter que l'on imite encore
ceux qui écrivent avec la négation: Je ne doute pas que ces
n'y a aucun doute qu'il
il
auteurs (ne) soient recommandables;
(ne) fasse son devoir (il n'y a aucun doute qu'il fera son devoir
ou qu'il fasse son devoir, etc., etc.).
—
L'heure exquise,
c'est
face, qui se distingue
ici
ue me montât au visage
adoucir
ma
le
crépuscule,
un peu
avant
que
les
chasseurs
Je ne pouvais parler sans qu'il ne m'interrompît (Boni-
n'arrivent (A. Daudet).
blessure (A.
heureusement des grammairiens). Sans que le rouge
qu'un seul mot ne vienne
Sarcey).
Il rentre sans
Dumas, Char/cs VII chez ses Grands Vassaux, II, 2).
(F.
Ne
J'ai
explétif après avant que, sans que.
61
deux lettres auxquelles je n'ai pas cru devoir répondre avant que la
ne fût définitivement résolue (Marcel Prévost, M^i< Jaiijre, p. 116,
Fayard, 1889). Il était impossible que le Congrès se réunît à nouveau
reçu
crise actuelle
édit.
sans que
sans
question espagnole ne devînt l'objet principal de ses délibérations et
la
que
l'accord
complet
fût
entre
anciens
les
Chatcajtbriand cl la giierre d'Espagne,
emploi
omission de
et
—
négation).
la
aperçût
Sand
(G.
dans
désormais
(Anna/es pol.
la
Mon
l'agriculture).
R. des
;
et
rien
—
Vient
r Anneau,
—
p. 278),
Un
ne
concert
et
litt.,
danger vous
le
soit produit
se
-
p. 82).
chef d'armée
8
p.
554,
rallier les
garçon
s'y
ne
s'en
se
fera
ne
Rien
mot
leur
à dire
donnait sans
9 oct. 1898:
la
que
Reine
imminent sans que
paraît
(Lecture,
Gabriac,
1897,
Inspecteur au Min.
petit
les Etats-Unis n'aient
Annales pol.
le jour oîi
de providentiel ne
mon
que
1881,
Aucun
2 août 1898).
liit.,
reine n'y parût (Henri NicoUes,
de Danemark).
que
sans
le^ oct.
(C. Teyssandier,
sans
1er janv.
D. M.,
parages
ces
diminué
a
lait
de
(Marquis
Nos chiens de berger savent
moutons sans qu'aucune bête ne s'égare
de
alliés
des D. M.,
R.
Louis Robert,
ne peut être relevé de son comman1899,
juil.
dement sans que l'opinion ne s'émeuve et ne demande les raisons d'une pareille
et si grave mesure (Annales pol. et litt., 6 août 1899, Chronique politique).
Je n'ai jamais entendu ce chant grave et pathétique sans que mes entrailles
s'en soient émues, n'en aient tressailli et que les larmes m'en soient venues
aux yeux (Petit de JuUeville, Litt. fr. VI, p. 370, emploi et omission de la
—
négation, omission
après
remplaçant sans que,
qtie
règle acceptée, mais cette infraction passe
ce
qui
est
contraire à la
—
peu près inaperçue).
Peu de
lumière quelque merveille (Rev. hebd.,
ici
à
n'amène à la
21 déc. 1901, les Fouilles de Pompéi, p. 332).
Il ne passe pas d'année sans
que les patients observateurs du ciel n'ajoutent de nouvelles et nombreuses
recrues au catalogue déjà imposant des astres minuscules (Camille Flammarion,
dont le style est toujours si soigné, si recherché; Annales pol. et litt., 21 juin
jours se passent sans qu'on
—
1903).
—
latin (A.
Les enfants ont appris à
Leroy-Beaulieu, 15
ces choses qui
modèle
ont
des
{R.
de
fait
D.
M.,
juil.
lui
15
—
complètement
éteint
p. 753).
—
On
Ses bois
(A.
et sa
fixé
fût
R. des
juil.
1891,
495).
p.
—
Bien
notre
avant
chargé
le
Raymonde,
campagne mettent du
Theuriet,
R.
charbon
des
D.
sont
pour
que Marie[iiid.,
avant
M.,
Ce
pris
l'ait
de son théâtre de Trianon
alphabet
—
D. M.).
un sage avant que Lessing ne
sans doute
avait
378-79,
pp.
Antoinette ne montât sur les planches
1891, p. 856).
avant que ne
lire
1891,
qu'il
15
av.
15 av.
ne
fût
1876,
vert dans notre art bien avant
que Rousseau n'en mît dans notre littérature (Petit de Julleville, Litt. fr., VI,
Ces mots s'étaient incrustés dans
p. 782; r Art français au XVIIfi siècle).
son cœur bien avant qu'elle n'en comprît le sens [R. des D. AL, 15 mars 1891,
ièid.,
p. 263). — Napoléon I disposait du Portugal avant qu'il ne fût conquis
—
— Avant
— Cette
1891, p. 132).
1
juillet
1
déc. 1891, p. 608).
son enfant avant
1901, p. 131
;
la
qu'il
que
loi
n'ait
sept
je
Qztestion des nourrices).
ne vous
quitte
fV.
rejoint le
régiment
{id.,
qu'aucune mère ne pourra quitter
mois révolus [Annales pol. et litt., 3 mars
aucun dictionnaire avant que celui de
l'Acad. fr., 15 juin 1897; LAcad. fr. au
avant que
musique n'eût
la
prescrirait
—
Le privilège défendait d'imprimer
n'eût paru (G. Boissier de
l'Académie
XVLL
Duruy,
siècle).
Annales
—
Dites-moi votre secret
pol, et
litt.,
10 janv. 1897,
Ne
62
explétif après avant que, sans que.
—
Avant que je n'eusse terminé {Id., même page). — Je m'en doutais
vous ne m'eussiez rien dit (Robert de Bonnières, les Monach,
Il
aura fini avant que vous n'arriviez (F.
Lecture, 29 juil. 1899, p. 547).
Brunot, Gram. couronnée par l'Acad. fr., 1889).
Si tu reviens jamais faire
ton métier avant que je ne te l'ordonne moi-même, tu seras fouetté comme les
autres (E. M. de Vogue de l'Acad. fr., le Temps du
sen^agc en Russie,
p. 22).
avant que
—
—
Lechire, 16
1898, p. 29).
juil.
Les règles éditées
n'effraient pas
r Anthologie
paraît-il, nos écrivains'-).
exemples sans négation que je trouve dans
de M. A, Pachalery (Odessa):
La hache, au
tomba sur le derrière de la tête et
une plainte (Mignet, Exécnlion de Marie Shtari).
lieu d'atteindre le cou,
la blessa sans qu'elle proférât
—
Il
touché
malaisé
est
—
(Id.).
par les grammairiens
cabinets
beaucoup,
deux
Voici
de leurs
d'avoir
Et
en
crucifix
le
un
voici
exemple
main sans que
la
dans Montesquieu
pris
cœur en
le
Les
:
soit
puissances
s'élèvent sans qu'on s'en aperçoive.
Littré
cite,
sans
la
condamner,
cette
phrase
de M""^
de
Sévigné:
Ces
cris
de toute une armée
moit de Tureune) ne se peuvent pas
la
(à
représenter sans que l'on n'en soit touché.
Mais son collaborateur en grammaire, d'accord avec nos
en aucun cas, la négation après avait/
que, sans que. M. Jullien n'a évidemment pas assez lu nos écrigrammairiens, ne veut,
vains contemporains.
Voilà donc
souvent
la
nos meilleurs
négation explétive
commençant
les voici
le
plus
encore plus
paraissait
cette négation
comme
rOiscan du bon Dieji).
plus doux que l'étaient nos pères
—
là
de
les
oii
l'était
veille (Mi'e
la
Nous sommes assurément
(Julien
très
et
gram-
indispensable:
qu'elle
triste
Germain,
employant encore
peut être supprimée,
elle
oii
à omettre
maires l'exigent encore
Elle
écrivains
là
Gravière,
la
les
plus
de Saintéclairés,
Gneu.v de mer;
—
M. Anatole France nous montre le roi
1892, p. 402).
de Naples moins noir qu'on se le fait (R. des D. M., 1 janv. 1860). - Le Belge
est moins casanier qu'on le croit (Clément Lyon, P Education populaire).
Ces
R. des D. M., 15 janv.
—
[Revue bleue,
fines impressions se ressentent plus facilement qu'elles s'expriment
6 fév. 1892, p.
25 mars 1892,
fait
—
avant
lui
189).
—
p. 412).
Ils
—
sont
l'écrivain les
a
faits {id.,
(père) a inventé ou exploité plus qu'on avait
ce genre de pathétique (Lanson, Hist. de la litt.fr., 1895, p. 957).
La composition du cabinet
*)
moins infâmes que
Dumas
La négation,
il
est
beaucoup moins avancée qu'on
faut le reconnaître,
est
le
croyait hier
beaucoup plus souvent omise
après sans que, qui a un caractère négatif, qu'après avant que; nous trouverons
plus loin
la
même
différence entre plus
.
.
.que
et
moins
.
.
.
.que.
Ne
Plndcp.
(Cofrcsp. /r. de
jeunesse
eut
en
qu'il
23
Belge,
juin
—
1898).
{Annales pol.
jamais
el
mot
Le
IHt.,
l'âge,
l'est
—
En
Athalie
effet,
—
page).
Toutes
est
beaucoup
avec
fréquentes et moins tendues qu'on pourrait
de JuUeville, LUI. fr., VII,
raconte (Petit
qu'il
où
cas
négation
la
nombreux après moins, qui
A
côté de
langue
vieille
—
p.
mon
négation
la
étude
sur
Rou, ne que de paiz
—
Rou, 335—36).
—
(au
Qui mielz
roi)
les
Mielz vueil morir que honte
cuevre (couvre) que
vosist
je
sont
plutôt,
avec
devenir
'^).
A.
L'usage, non
est le
la
**)
M.
L.
—
(mais)
le roi
—
Miauz
64).
—
comme Horace
dans
raison, a autorité sur les langues (P. Stapfer).
droit qui n'appartient qu'à
*)
Mes
4963
Troyes.
grand maître des langues (Bossuet).
—
Obligeons
et
eux sur l'évolution
Comparer, plus haut,
moins que
—
fait {Cligés,
contenir dans leur rôle de greffiers de l'usage,
un
le prie;
retreite {id., reprochée).
l'a dit pour les viols, que
un perpétuel recoimnencenicjit ) Disons
Darmesteter,
qu'elles sont en un perpétuel
Peut-on avancer,
langues
ont
subj.) qu'il
là-dedans) antre les
Nombreux exemples chez Chrétien de
les
seit
négation:
(se noie;
pour precetur,
(Fabliaux).
faz?
qu'il
en
la
syntaxe,
1896,
la
nit
*).
ou voudrait mieux) estre pris an (en) Perse qu'il
murs {G'/ev. au lion, 6544—46).
eût voulu
(il
fust leans (illac-intus,
plus
dans
fréquent
très
le prit (* precet, subj.
ne agrée que plus (en) facet
(mieux)
beaucoup
verbe,
le
que en eue
Mielz volt qu'a glaive muire u (ou)
s'umilit vers
Nous valons
croyons nous-mêmes
sont
on trouve aussi foule d'exemples sans
186),
juge plus
Il
—
un caractère négatif, qu'après plus
a
de
l'emploi
(voir
omise
est
même
ses âpres sorties
142).
p.
siècles).
{id.,
beaucoup plus
furent
beaucoup mieux, déclare l'amiral Rieunier, que nous le
{Correspondance de Paris de l'Indép. Belge, 21 juin 1900).
Les
plus qu'ils
y a deux
contre les journalistes {Leclnre, 18 mars, 1899, Léopold Courier).
encore
de
—
point de vue
figure
supposer d'après
le
1898).
Au
le
Presse
la
plus
oct.
être plus parfait qu'il
doit
qu'on se
jeune
plus
de Balzac
relations
les
—
1899, p. 405, Saint Cyr, il
fév.
repris
9
à ses sujets,
déc. 1898).
11
,
joué à Saint-Cyr.,
personnage d'Athalie,
le
généralement {Leclnre, 4
litt
a
236,
p.
L'empereur François Joseph a accordé de bonne grâce,
eussent osé l'espérer (Annales pol. el
de
63
explétif après avant que, sans que.
p. 62,
avant que
les
—
L'usage
grammairiens à se
maintenons aux seuls écrivains
de
et
la
langue
sans que
(F, Brunetière).
avec plus
que,
relativement à l'emploi du ne explétif.
Nous nous
refaisons
Sudre, reconnaissant
grammairiens
(Gr.
Darmesteter,
veulent
////
la
Syntaxe,
il
y a quelques années,
donne, d'accord avec les
m'écrivait,
règle
p.
qu'il
51—52)
disant:
ou
elle
a toujours
été usité et
l'emploi de
„que
indéterminé ou inanimé ; l'emploi de
soi est restreint à un sujet
grammairiens
archaïques,
mauvaise
soi
devient,
là
où
les
depuis une
cinquantaine d'années, de jour en jour plus fréquent.
Lorsque M. Sudre,
p. 20,
jusqu'au XIX» siècle devant
un
nous
dit
adjectif
que
que
commençant par une voyelle
l'adjectif tout n'a été variable
féminin
Concordance des temps du subjonctif.
64
Concordance des temps du
sub]onctif.
Le temps du subjonctif à employer répond toujours au
temps de l'indicatif que l'on mettrait dans la phrase correspondante demandant le mode indicatif'^'). En d'autres termes, le
temps du subjonctif dépend, non du temps qu'a le verbe dans
proposition principale, mais de la pensée que l'on veut
la
exprimer. Les temps du condifiomiel sont compris dans ceux de
Vindicatif, le conditionnel, comme temps, étant le futur de
l'imparfait et de tous les temps passés (le passé indéfini seul
parfois excepté).
étant moins nombreux que ceux
temps du subjonctif doit répondre à
deux et parfois à trois temps de l'indicatif (voir mon étude
sur le verbe, 1896; pp. 85 à 98; je serai ici très court).
Les temps du
de
1)
catif et
subjonctif
chacun
l'indicatif,
des
Le présent du
répond
subjonctif
Je crois que notre ami est
n'a
de
l'indi-
route ou qu'il s'y mettra demain:
déjà en
ne crois pas que notre ami soit déjà en route
(cette
au présent
au futur simple:
femme
tonte
est
certainement
Darmesteter:
grammaires
pas
tout
aimable, etc.;
de
aimable,
je
mette demain.
ni qu'il s'y
grammaires),
disent les
grammaire
de
Brachet
il
par
A.
La règle de Brachet, dit Darmesteter, n'est bonne que pour
surannées (Revue critique, 19 décembre 1874).
les
lu
la
critique
la
les plus
Dans mes G/a7tures grammaticates de 1893 (Namur, chez Lambert-dedonne toute une page d'exemples du XIX® siècle
tout est variable, même devant entière (pp. 40—41).
Roisin. rue de l'Ange, 26) je
oîi
Les quelques erreurs que
je
trouve
chez M. Léopold Sudre n'empêchent
pas cependant que sa syntaxe historique soit
grammaire
jusqu'ici (voir la
*)
dite
La théorie basée sur les règles
bonne que pour
les
grammaires
encore en Russie dans
la
grammaire ne peut
de
la
langue.
donnent depuis
d'après Girard,
rester
des temps en
l'emploi
grammaires qui ont
si
le
bonne que
si
les
se
décident à
manuels d'Ignato-
La grammaire de D.
vieilli.
succès qu'elle mérite
les éditeurs
latin n'est
C'est celle que l'on trouve
et
dont
rajeunir
elle est attentive à
elle jouissait
le livre;
une
suivre les évolutions
y a cependant en Russie, reconnaissons-le, des grammaires qui
quelques années les règles que je donnais déjà en 1878—79
entre autres celles de A. Hoppé, N. Fenoult et Alph. Rancy
Il
(Saint-Pétersbourg),
çais; Odessa).
écoles
de
les plus surannées.
Margot retrouvera certainement tout
les
meilleure de celles qui ont paru
grammaire de D. Margot, dans
vitch et dans plusieurs autres
autrefois dans
la
de Darmesteter).
A.
Cordey (Moscou), A. Pachalery
(3»
édition,
texte
fran-
Concordance des temps du
Le passé du subjonctif répond au passé
2)
65
subjonctif.
au passé
indéfini,
défini et au futur antérieur:
Je crois que notre ami a écrit hier à sa mère:
ami ait écrit hier
même
alla
jusqu'en Orient:
et je
doute
dans
la
je
jamais
soit
qu'il
—
Observation.
signification de
ces
passé du subjonctif
avant
le
allé
loin
si
qu'il
ait fait
passé
(le
parfois
e7i
deux
exprime un
tandis que
le
L imparfait
passé
le
dé/Liiï,
la
même.
Le
qui ont
eu
avant
le
moment
rien
à faire,
nous
Comme
idée, le
passé
n'a
défini
présent.
du subjonctif ne répond qu'au passé
la
semaine.
la
si
passé
le
l'on est, c-à-d.
aura fini ce
de
fin
la
ou une action
état
passé
le
pratique
qu'il
guère
s'emploie
qu'il
n'est nullement
te7nps
l'avons déjà dit (p. 48 j, avec
3)
ne
défini
avant
passé,
l'an
ce voyage l'an passé
Je crois
l'ait fini
qu'il
moment présent où
la parole,
ne crois pas que notre
Remarquons cependant que
du subjonctif remplace
de
ne crois pas
ne crois pas
je
je
Je crois qu'il fit ce voyage
conversation que chez les Français du sud).
travail avant ce soir:
lieu
—
personne.
à
indéfini et au futur antérieur.
du subjonctif répond
à l'imparfait
de
l'indi-
au conditionnel présent ou futur:
catif et
Je crois que
ami
notre
qu'il
fût alors malade.
qu'il
pût
—
faire pareil travail.
pas espérer
qu'il
Tînt,
L imparfait
il
était
malade à
cette époque-là:
ne crois pas
je
Je crois qu'il pourrait faire ce travail: je ne crois pas
—
J'espérais qu'il viendrait hier:
vous ne pouviez
est trop occapé.
du
répond
subjonctif
aussi,
en
au
pratique,
passé défini:
homme
Cet
il
disparut un jour, et l'on ne sut jamais ce qu'il était devenu
disparut sans que l'on sût jamais depuis
tout haï qu'il était (ou qu'il fût) à
et
Rome,
lors ce
rentra
une
qu'il
devenu.
était
fois seul
le
soir
—
:
Sylla,
chez
lui,
personne n'osa l'attaquer: sans que personne osât l'attaquer.
Remplaçons ici l'imparfait par le passé du subjonctif, „sans
que l'on ait jamais su, sans qu'on ait osé f attaqtier" , répondront
mieux à: cet homme a disparu; on n'a pas osé attaquer Sylla.
\)
parfait
Il
Le plu s-que-parfait du subjonctif répond au plus-quede
l'indicatif et
ne partait
fini ses devoirs.
je
jamais qu'après
—
travail
mon ami
de
Serait-\\
parti sans
jamais
—
Sans
avant-hier soir,
l'arrivée
permis de
qu'il
Vous croyez que
vous eusse oublié.
mon
au conditionnel passé:
la
il
je
l'arrivée
n'est pas
avait fini ses devoirs:
sans qu'il eût
vous avais oublié : ne croyez pas que
de mon ami ''^aurais certainement fini
douteux que j'eusse
fini
mon
travail
ne m'avait (ne m'eût) fait perdre beaucoup de temps.
permission de ses parents?
je
ne puis croire
qu'il
partir sans leur permission.
5
si
—
se fût
Concordance des temps du
66
—
Observation.
après
permet,
çaise
On
que depuis 1901 l'Académie
sait
conditionnel,
le
subjonctif.
d'employer,
fran-
volonté,
à
le
présent ou l'imparfait du subjonctif:
Je voudrais qu'il vienne ou qu'il vînt demain.
Et
devenue
est
elle
si
jusqu'ici, elle permettra
logique
plus
de dire aussi
ne
qu'elle
été
l'a
:
Je voudrais qu'il ait ou qu'il eût fini son travail avant demain soir.
Les règles sont
5j
subjonctif,
le
possible,
sans finir
2)
quand
là
celui
ne part jamais sans finir ses devoirs
\ts finira):
(il
ne part
Il
part):
il
à
remplacé par
où cet emploi est
de l'indicatif et du
l'infinitif
l'infinitif,
préférable
ne part jamais sans
il
de
:
Il
1)
partir):
toujours
est
subjonctif
mêmes pour
les
l'emploi
et
il
jamais
qu'il finisse tous
ne partira pas sans
ne part jamais sans
il
sans les avoir finis
les
(il
devoirs
les ait
qu'il
aura finis avant de
—
Il
avant de
ne partira pas
les finisse.
qu'il
avoir fini ses
sans
les unit toujours
(il
ses devoirs.
partir):
les
(il
finis.
il
—
Il
a toujours finis
ne partira pas
ne partira pas sans
qu'il les ait finis.
ne partait jamais saits finir tous ses devoirs
avant de partir):
il
eût
on
l'a
sans
ne se déciderait jamais à partir sans
il
(il
finît.
les
qu'il
à
les finissait toujours
—
Pariiraii-il
sans
qu'il les finît.
—
ne partait
avoir finis
les
préférence
ne partait jamais sans avoir fini ses devoirs (il les avait toujours
Serait-il parti sans les
jamais sans qu'il les eût finis.
Il
4)
finis):
ne partait jamais
il
ses devoirs?
finir
de
cas,
passé.
Il
3)
en ces
présent s'emploie,
L'infinitif
l'infinitif
(il
ne
aurait donc
les
^2,%
finis
1)
Il
ne
serait jamais parti sans qu'il
finis.
6)
D'après
qui
les règles
toujours
dit
sans
que
la
nous dirons, comme
grammairiens s'en
précèdent
des
plupart
soient doutés:
Attila
était-'-A.
hai de ses sujets?
sujets (Montesquieu).
adopta Trajan,
je
ne crois pas qu'Attila fût haï de ses
Jamais prince plus accompli
le prince le
n'a
régné
Nerva
jusqu'ici:
plus accompli qui ait régné jusqu'ici (Montesquieu).
Jamais prince plus accompli n'avait régné jusque-là à est (à était, ce fitit, c'a été)
Je n'avais jamais connu
le prince le plus accompli qui eût régné jusque-là.
:
—
de meilleur
TU.
—
(c'était,
On
que
ne pourrait)
pas
voir
de
plus belle fête que l'on puisse voir.
la
(que nous
ce fut) le meilleur
c'était (c'est,
ne peut (on
c'est)
belle fête
Yue
homme:
homme
plus
—
On
celle-là; c'est {c'était, cq fiut) la plus belle fête
ayons jamais Tue,
etc.).
—
que j'eusse jamais
belle
n'a
que
fête;
Ce
_/«/
jamais vu plus
l'on ait jamais
Pourrait-on donner une
plus
belle
vous voulez faire sera certainement la plus belle que l'on piit
(que vous pussiez) nous donner.
Ce garçon se plaint-\\ d'être mal soigné?
Il se plaint
Il ne se plaint pas (ne %'est jamais plaint) qu'il soit mal soigné.
fête?
Celle que
—
—
Le présent historique; verbes qui en dépendent.
é'avoir été
mal soigné par son
dit qu'il avait été)
(il
soigne
ne se plaint pas d'avoir été mal
le
il
second:
il
se plaint
ne se plaint pas
qu'il
chose que vous eussiez
selon
Et
eût été mal soigné par
qu'il
mal soigné par
ait été
pu
l'idée
phrase des temps différents (ce que
J.
il
Fleury
Qest
mais
meilleure
la
agir.
aurons
exprimer nous
à
—
vous n'auriez pu mieux
faire;
mais
premier médecin,
le
second.
le
médecin,
premier
n'a pas été mal soigné) par
qu'il
dit
(il
67
dans
même
la
d'ignorance):
traitait
y a eu des Israélites en France sous Charlemagne, et même
nombreux: je ne crois pas qu'il y ait en alors des Israélites en
De ces deux nations, l'une
France et surtout qu'ils y fussent nombreux.
était esclave avant que vous l'eussiez soumise; l'autre, libre avant qu'elle vous
Je crois qu'il
qu'ils étaient
—
servît à remporter
des
Vous finirez
(Montesquieu).
victoires
vous ne partirez que lorsque vous en aurez reçu
avant que vous finissiez entièrement votre travail
permission de votre père.
—
Sa
lettre
Paris: je ne crois pas qu'il vienne,
—
On
et
m'apprend
votre
travail
et
ne partez pas
la
permission
et
que vous ayez obtenu
la
qu'il
a déjà quitté
qu'il ait déjà
quitté Paris.
qu'il vient,
encore moins
:
vu d'homme qui fût plus habile ouvrier d'intrigues, qui ait
acquis plus d'honneurs que lui dans ce noble métier (Theuriet). — As-tu jamais
n'a guère
douté qu'Hémon
adorât la princesse, et qu'elle ait eu, de son côté pour le
une extrême tendresse? (Racine).
Que le chancelier eût la confiance
de Louis XI, cela n'est que trop certain, mais qu'il ait oublié ses devoirs de
ministre, c'est là un fait qui n'est nullement établi (R. des D. M., 1er déc. 1860,
—
prince,
p.
Soit que le succès n'eût pas
705).
écrivains l'aient distrait,
Boursault;
de Visé
répondu
à son attente,
abandonna son
entreprise
que d'autres
soit
(E.
de Montégut,
R. des D. M.).
Le présent historique; verbes qui en dépendent.
Quand on raconte au vrai présent, tous les faits précomme étant en train de se faire dans le même temps
1)
sentés
doivent naturellement être au pi'ésent
à venir doivent être mis 2M futur;
au passé indéfini :
Ne voyez-vous pas que
conduit
ce garçon
simiilianés); les faits
(faits
les
\2i\\.'i
passés
est paresseux,
qu'il
(récit logique),
ne travaille pas,
—
—
mal?
Je lis pendant que vous écrivez.
Je sais
qu'il s'est mal conduit jusqu'ici, mais j'espère qu'il se conduira mieux à
Pendant que vous écrivez votre lettre, je m'habillerai (fait présenté
l'avenir.
qu'il
se
comme devant
très
se faire).
Mais après le présent historique, qui
d'un passé défini, on peut employer:
2)
1
le
présent ou Vimparfiaii pour
César rassemble ses troupes
qu'il
voit
les
n'a
faits
(voyait)
que
valeur
la
simultanés:
découragées
et
leur dit
(présent historique) qu'elles n'ont (n'avaient) pas devant elles un ennemi qu'elles
doivent
(qu'elles
devaient)
craindre.
—
Bientôt
à
la
poussière
se joint
5*
une
Le présent historique; verbes qui en dépendent.
68
fumée épaisse qui trouble (troublait)
(Fénelon,
l'air
emploie Ximpar/ait),
qui
Le général romain assure à César qu'il arrive (qu'il arrivait) de chez les Éburons et que tout est tranquille dans le pays (que tout y était tranquille).
2^ Le passé ùtdéfi^ii ou le plus-qtte-parfaii pour les événements qui se sont passés avant l'époque marquée par l'action
du verbe de la proposition principale:
accoîirt,
11
on
apprend qu'un malheur
lui
ou était arrivé.
est arrivé
a
et leur dit (présent) qu'il
César encourage ses soldats
(qu'il
—
donné
avait) déjà
On annonce à César que
Idoménée les remercie de
ce qu'ils l'ont (de ce qu'ils l'avaient, de l'avoir) arraché à une terre qu'il a
Les Romains battent le roi
(qu'il avait) arrosée du sang de son fils (Fénelon).
de Macédoine qui a fait (qui avait fait) une diversion en faveur d'Annibal
Le bourgmestre demande alors (présent historique) ce qu'ils
(Montesquieu).
des ordres pour lever en
de nouvelles troupes.
Italie
sans combat.
Nerviens ont fui (avaient fui)
les
—
—
ont
résoin de répondre
(ce qu'ils avaient)
Le
latin
Quod
aussi:
dit
jussi sunt (quod jussi erant) faciunt:
qu'on leur avait) ordonné;
ils
Les Helvètes répofident
son
au
Il
et qu'ils
bravoure.
(qu'ils n'ont)
arrive dans
futures, après
2iZ\\Q)X\%
ordonné.
le
jamais eu l'intention
temple de Jupiter qu'Idomenée
—
Il
fait mourir
présent historique, se met-
le
fuiitr simple ou au conditionnel présent (futur)
annonce
leur
auront
—
leur
Il
Le combat
auraient)
(n'en
(se partageraient) le
la
ils
là
pour
proynet,
cesse,
formeront
partira
qu'il
(qu'ils
bientôt et que, sous peu,
—
n'avaient
qu'ils
orné avec beaucoup de magnificence (Fénelon).
qui avait (a) vaincu sans son ordre (Montesquieu).
30 Les
n'en
font ce qu'on leur a (ce
(a)
fils
tent
ils
font ce qui leur a ou avait été
On
d'offenser le peuple romain.
avait
Louis XIV.
à
(qu'il
calmer,
les
retotirneraient
paix est
(ils
il
Bretagne
fois leur
que
la
pour
guerre finirait
retourneront) dans
(finira)
leurs foyers.
deux peuples (romain et sabin)
deux rois se partageront
n'y aura (il n'y aurait) plus entre eux
conclue:
les
formeraient) plus qu'un
commandement,
la
de montrer encore une
partirait) bientôt
l'occasion
:
seul, les
de discorde possible.
Comparons encore
Proctnnèiini (présent
latin
le
pulcherrimam prope totius
(imparfait du subjonctif ou conjonctif)
les
Gaulois (suppliant), qu'on ne
(de leurs propres mains)
le
le français:
Les Bituriges totnèent aux pieds de tous
:
forçât (qu'on ne les force) pas de mettre
les
feu à la ville la plus belle de presque toute la Gaule
(César, qui emploie Vimparfait lorsqu'il
présent du
avec
omnibus Gallis ad pedes Bituriges, ne
Galliae urbem suis manibus succendere coa:erentur
historique)
aurait
pu employer
tout
aussi
bien le
subjonctif).
Divico
constituisset
cum Caesare
atque
esse
Helvètes se rendront
(le
agit,
Helvetios in
voluisset:
latin
n'a
ici
eam partem
Divicon
qu'un
dit
ituros, ubi eos Caesar
(présent)
seul temps)
à
César
que
ou se rendraient
les
et
Le présent historique
s'établiraient ou
assignerait),
la
anra assignés,
le
aurait assignés
nous donnons
latin;
que César leur assignera
lieux
leur
les
il
français
(le
une traduction
ici
(leur
plus
est
libre).
pensée:
César assure à ses soldats qu'ils
avant que
auront
aux ennemis
secours promis
le
aura ou
auraient) pris
(qu'ils
ou
leur arrive
Helvètes promettent qu'ils s'établiront (s'établiraient)
leur
69
Le futur antérieur ou le co7iditionnel passé s'emploieront
événements qui seront passés avant répoque future
est
question dans
le
discours,
ou qui est dans
4°
pour
dont
s'établiront dans les
leur
temps que
riche en
verbes qui en dépendent.
;
dans
lieux
les
—
Les
que César
leur aurait assignés.
Ce que nous disons de Vindicatif s'applique
3)
ville
la
arrivât.
leur
aussi au
subjonctif:
César ne veut pas croire que tout soit
que
Nerviens
les
aient fai
(eussent fui)
chez
(fût) tranquille
les
César
sans combattre.
Éburons,
ne veut pas
—
croire que les ennemis se soient (se fussent) éloignés sans combat.
César
ordonne alors que des renforts soient envoyés (fussent envoyés) au plus
afin que son lieutenant
tôt,
ne soit pas (ne fût pas) enveloppé par les
ennemis.
—
peur que
les
de
se hâte alors
Il
tassent (ne profitent) d'un premier
—
toute la province.
(on croie) à
les soldats (n')aient fait
ou (n')eussent
—
lycées).
ne
point
qu'il
profi-
consternation dans
promet
lui
ne doute nullement que les chefs
fait
avec
s'accorder
conféré avec
Cyrus
ne
et
encore jusqu'à ce que
Elle puise, elle ptiise
César ajoute
qu'ils) n'aient
la
de
assiégée,
ville
la
emparent)
succès pour répandre
tout eût (ait) disparu.
général grec) de
de
secours
(ne s'en
Le monarque est enchanté que sous son règne on crût
justice (Andrieux).
la
au
courir
emparassent
ennemis ne s'en
leur
ses
devoir.
—
adversaires,
Cyrus
que
le
prie
et
(le
ceux-ci (avant
(Traduction de l'Anabasis par des professeurs de
ne
qu'il
désarmera
point
qu'il
ne
les
eût
(ait)
rétablis dans leur patrie.
Remarque
employer
historique
11
le
ne
les
ne soient
trieves
(il)
Mont
Iiistorique.
deux
—
Le vieux
du
temps
français
déjà
savait
après
subjonctif
le
préserit
:
osient les
l'an (l'on)
qu'il
les
mantiaus ainz (avant) que devant
tenist pas
tuit (tous)
fil
Cligés,
fos (fous;
(fils)
de contes ou de
done congie (permission) que
d'eue garnesissent ou
(oii)
cil
qu'il
del
le
roi
314—316).
roi (id.,
il
—
venissent;
Il
322 — 23).
Mont preïssent eue
volsissent (voudraient),
que
ne dotent pas
—
E
par
(de l'eau) et
la
preïssent
seurement, rien ne cremissent (craignissent; Rou, 9614—18).
4)
Quand on
raconte au vi^ai présent,
on
emploie cepen-
dant assez souvent le plus-que-parfait pour les actions passées,
mais alors une autre action passée est sous-entendue entre les
Le présent historique; verbes qui en dépendent.
70
deux temps, et cette action sous-entcndue,
au passé indéfini:
elle
si
exprimée,
était
serait
Voyez
bâtir
ici
ce beau terrain,
vue
belle
cette
une charmante maison, maintenant
place (sous-entendu
:
Vai fait démolir,
je
:
ou
ans
y a dix
il
je
m'étais fait
un modeste chalet qui
c'est
elle
a été détrtaie,
rem-
la
c'est
et
main-
tenant, etc.).
En rapportant
5)
les
temps
a sans doute traversé
—
Il
que
paraît
remise à son destinataire.
ma
avez) agi avec
est bien clair
pendu son
le
le
fils
fille
la
—
lettre
le
a été
Notre hôte
d'une manière
(Idem, Lettre
etc.
—
3).
Je ne
subjonctif
nous,
car
pont avant
lue
nous ne l'avons pas
car nous ne l'avons
lui,
(avait été
lue)
avant d'être
m'a confié que vous aviez (que vous
admirable (Voltaire,
que Sirven n'a pas plus noyé
pont avant nous,
est dans la
nous aurons des
phrase,
la
pont avant
Nous avions sans doute traversé
pas aperçu.
Il
dans
différents, soit à Vindicatif, soit au
Il
aperçu.
au présent qui
actions
pensée, ou au passé exprimé
sa fille
Je ne crois pas
crois pas
que
la
III,
3).
n'avait (n'a)
ait (qu
eût) traversé
qu'il
lettre
PÈcossaise,
que Calas
il
ait (eût) été lue avant
d'avoir été remise à son destinataire.
Serait-il possible que vous eussiez (que
vous ayez) agi comme notre hôte l'a raconté? Casimir m'a dit que vous
aviez (avez) été malade (G. Sand, Lettre XVII). Il m'a dit que vous aviez
(avez) éprouvé beaucoup de chagrins (même lettre).
L'antériorité est
ici
nettement exprimée par
le
contexte,
ce
passé indéfini au lieu du plus-queQuelques grammairiens prétendent que, dans tous ces
parfait.
cas, c'est le plus-que-parfait qu'il faut employer; d'autres soutiennent que c'est l'emploi du passé indéfini qui est ici de
rigueur.
Concluons donc que l'emploi des deux temps est également permis, également correct dans les exemples qui viennent
d'être donnés et autres semblables.
qui
permet d'employer
6)
le
Selon que l'on veut
en rapport avec
le
moment de la
sommes (le fait
le
passé de
mettre
la
parole, c-à-d. avec
restant
encore
la
proposition subordonnée
ou avec
7nomeni présent oii nous
on emploiera rimparfait
proposition principale,
le
vrai),
du subjonctif exprimant une idée ût futuriiion relativement au
passé qui précède, OU le présent du stibjonctif exprimant alors
une vérité de tous les temps'.
Dédit eadem natura belluis et sensum et appetitum, altero, ut conatum
haberent (habeant) ad naturales pastus capessendos, altero secernerent (secernant) pestifera a salutaribus: La nature a donné (donna) aux bêtes le sentiment et
l'appétit, afin
que par
celui-ci elles
fussent
(elles soient)
excitées à prendre
nourriture qui leur convenait (qui leur convient), et que par celui là elles
la
pussent
Subjonctif dans
bonnes ou salutaires (Cicéron).
Nous
traduirons également par les deux temps
Bible, qui emploie le passé
la
Deus,
opéra sua
a signé la
XXXVII, verset
chacun
main de tous
signât (signavit), ut
hommes
les
par
destinée
leur
ce passage
du subjonctif:
manu omnium liominum
in
Dieu
;
connaissent)
(qu'ils
71
de celles qui pouvaient (peuvent)
puissent) discerner les choses nuisibles
(elles
leur être
de
proposition principale.
la
leurs
afin
uoverint singuli
coininssent
qu'ils
œuvres (Livre
de Jod,
7).
Subjonctif dans la proposition principale.
Le subjonctif s'emploie dans la proposition principale:
1» Pour exprimer un souhait, un désir-):
Pnigsiez-vous être heureux
!
Dieu vous bénisse, vous sauve, vous soit
Le Ciel vous entendi', exauce vos
Vive ou vivent les gens d'esprit, surtout les gens de cœur {vive, au
singulier, est employé comme interjection).
Sauve qui
Grand bien vous fasse
peut.
Qui m'aime me suive. Aille qui voudra advienne que pourra
Ecrive
qui voudra!
Honni soit qui mal y pense! Grâces vous soient rendues!
Le diable m'emporte Le diable soit du grec, nous n'en voulons plus A Dieu
ne plaise Tombe Argos et ses murs Fasse le Ciel
Tombe sur moi le Ciel, pourvu que je me venge (Corneille). Dui'e à
jamais le mal s'il y faut ce remède (Idem). Je meure (que je meure) si je vous
comprends (Idem). Fasse le Ciel (faxit Deus). Dieu veuille à Dieu ne plaise
Plaise à Dieu que notre père soit encore en vie;
plût à Dieu que notre père
fût encore en vie (il est mort).
Qui m'aime me suive. Comprenne qui voudra
ou qui pourra. Qui voudra mordre y morde.
en aide,
vœux
vous
ait en
sa
garde
sainte
!
!
!
!
!
;
—
!
!
!
!
!
Dans
2°
propositions conditionnelles,
les
!
;
—
oii
la
conjonction
pas exprimée:
n'est
Je le ferai, dussé-je périr.
naîtra jamais
sortirai
pour
homme
un
aujourd'hui pour aller voir
30
puissant
Fût-il plus
Tombât-il
d'honneur.
mon
ou
qu'il
s'en aille.
des
on ne
pierres
le
du
recon-
ciel,
je
ami.
Pour exprimer un ordre ou un
Qu'il obéisse
encore,
—
conseil:
Sauve
qui
peut (conseil), se sauve
qui peut.
40
Une demande, dans
Qui vive
*)
cas,
une
Il
?
aucune de
n'y a plus
proposition
maintenant dans
principale
grammaires qui admette,
pas
plus que
l'on
n'en
en ces
admet
? Rien. Qui avez-vous rencontré? Personne. Avez-vous
Aucun. Allez-vous quelquefois au théâtre? Jamais. Avezcela? Pas (point) du tout. Avez-vous trouvé là des amis? Pas un.
Qu'avez-vous vu
fait
nos bonnes
sous-entendue,
:
rencontré des soldats
vous
l'expression:
(die mihi quis vivat).
?
Subjonctif dans
72
Un événement
50
Que
proposition principale.
la
qui peut arriver fortuitement:
votre père sache votre conduite,
—
Une
60
Vous
à
faire
concession:
comme
considéré
soit (verbe
le voulez,
Une
70
vous y prenne encore
je
^
Allons faire une promenade.
tienne.
Adrienne
ne sera pas enchanté.
il
Que
que pourra. Le croie qui voudra.
de pareilles choses, et vous verrez -).
Qu'à
adverbe).
cela
ne
Soit, je consens.
supposition:
Soit six à multiplier par huit.
Des événements
8»
Notre
fils
à venir:
aura quinze ans viennent
les
prunes
(l'été),
viennent
ven-
les
danges (Pautomne).
90 Dans:
Je ne sache pas
mitigée
(affirmation
deux
que ces
ironique)
et parfois
messieurs soient de parfaits amis.
Dans quelques expressions comme:
10"
Taille que vaille; coûte que coûte.
Nous avons
11°
un plus-que-parfait du
en réalité,
aussi,
subjonctif, traduction du subjonctif conditïojtnel
soi-disant co7iditio7înel passé (seconde forme)
S'il
promenade
m'eût écouté, il n'eût pas fait de grammaire.
si le temps eût été meilleur.
—
Remarque.
Comparons
propositions opiafives
français
le
même
peut
comme
regarder
sans que l'on
ait
—
au
J'ensse fait une
latin
dans
les
Ne Tivam,
si
hoc
tibi
propositions principales
phrases commençant, en ces cas, par
phrases exprimant par
tifs
beati.
—
On
les
dans notre
:
Valeant cives mei, sint incolumes, sint
Vivas et gaudia longa feras.
concedo.
latin,
:
la
conjonction que, ces
elles-mêmes tout ce qu'elles veulent dire
A
besoin de rien sous-entendre.
ces subjonc-
on peut comparer l'impératif latin, qui ne peut se rendre en
que par le subjonctif, à moins qu'avec certaines de nos
français
A
gatives,
temps,
part quelques exceptions,
dubitatives,
autre
ces
mots
compréhension
des
Darmesteter par M.
L. Sudre,
essentiellement à
proposition
dans
la
la
surtout dans
sont
p.
devenus
mots
120):
(voir
Le
dépendante;
proposition simple, indépendante.
les
de
la
phrases négatives,
vraies
Syntaxe
subjonctif,
toutefois
négations.
de
dit
M.
on
le
la
interro-
—
Autre
grammaire de
Sudre,
appartient
rencontre souvent
Subjonctif dans
la
73
proposition principale.
grammaires on ne regarde ces verbes comme
employés, à l'instar du latin, à la 3* personne:
ou
Qu'il boive
nos
notre visage,
imperio duo suiito,
Que
s'en aille.
qu'il
soient
regards
consules appellantor
iique
impératifs
notre maintien, que notre démarche,
conformes
toujours
des
(magistrats) aient
un pouvoir royal (soient rCTêtus, soient investis d'un pouvoir royal),
nommés consuls, qu'ils portent le nom (le titre) de consuls.
exteros, nisi publiée adscitos, ne colunto (Loi des douze Tables).
soient
Le XVII*
tenant
aux XVIII*
fait
voyait pas.
qu'il n'y
dans
On
XIX*
et
et demie
M"* Obert (la Syntaxe du
chez A. Picard, 82, Rue Bonaparte):
de
livre
cela ne tienne (Balzac, Diss. chr. V).
{M.,
Lettres,
sous-entendus
des
siècles,
en trouvera toute une page
beau
le
XVII* siècle; Paris,
A
Deos
beaucoup plus souvent que main-
siècle employait
l'a
d'exemples
pareil
et qu'ils
—
subjonctif dans la proposition principale sans chercher,
le
comme on
de
Regio
bienséance.
à la
Que deux
:
meure,
Je
mon
meure,
Je
5).
I.
enfant,
je vis
si
tu
si
jamais rien
admirable
n'es
La peste m'étouffe, si je le sais (Molière). Je sois
exterminé, si je ne tiens parole (Id., Dépit amotireux, IV, 3). Il a fait son
temps, d'autres fassent le leur! (La Font., PEunuqtie, V, 1). Son sang soit
(Corn.,
Vetive,
sur nous et
III,
sur
1).
nos
enfants
Ménechmes, V,
l'enfer,
Veuille ou non,
3).
T'adorent à jamais les esprits biensi j'en connois aucun (Regnard, les
(Bossuet).
Me confonde
heureux! (Corneille).
est contraint
il
de
le faire
aura son affaire (La Font., Contes,
III,
(Malherbe,
Teuille ou non,
Soit une vérité, soit un conte, n'importe (Corneille).
8).
II,
elle
3).
La langue actuelle a conservé quelques-unes de ces expressions en employant que au commencement des phrases, mais
a-t-elle, pour cela, changé la proposition principale en incidente?
Le XVII* siècle savait employer, au contraire, qtie devant
le subjonctif là oîi on ne le fait plus aujourd'hui, dans:
Qne
I,
puisses-tu grand soleil. .. .faire sans
Que vive
se mouche
196, 33).
veux, qu'il
et
meure qui voudra
IX,
12).
Que
en paradis
*)
P Avare,
(Molière,
cieux, qu'il considère Hécube,
puisse Astrée
î,
heureuse!
être
*)
A
tous
les
que
exemples
1896),
où
le
Qui
Testament de Pasne,
s'embarque sur
dit a sa
cours
Que
(Malherbe,
Qui se sent mor-
16).
.. .se
aux dieux
(Idem.).
je
pronom
donne
sujet
dans
croit hai
puisse son
des
Fables,
(La Font.,
famé
l'eau,
ses secrez,
se fie en famé,
il
il
56).
il
en
se pert
n'est
fait
[id.,
mon étude
s'employait
ame
être
là
sur
le
où on ne
verbe
le fait
Qui trop despend, il s'endete (Ruteil s'emboue
(vieux proverbe).
pas toujours noyé (proverbe). Quiconque
sa dame (dominatrice; la Rose, 17284—85).
Qui se fie en famé, il se lie les
17313).
plus, ajoutons encore, à titre de curiosité:
Qui
même
le
287,
*).
(1ère partie, p. 44,
beuf, le
I,
Quiconque.
3).
rendra grâce
il
fin
(Id.,
Qui
se loue,
Complément du verbe
74
de
et
l'adjectif.
des exemples de la vieille langue oili
employé comme optatif:
Damnes (Dominus) Deus me le dninst (donne) vengier
Voici
subjonctif
le
est déjà
Dieus mal
dninst
te
apud)
(là-haut) o (avec;
ta
mercis.
Diu en
2796).
Pitié
Aucassin
(aide;
doiut
me
Maït
{Id.,
et Nicoieite,
m'aide) Dieus
Bel
3080).
{id.,
Dix vos
XXII).
Complément du verbe
mon
Voir
je
étude de 1896 sur
ne donnerai
donner
faut leur
de
se
te fail a
(si)
vos
XXII).
Dieu vous
ait
i
406).
II,
l'adjectif.
verbe, (syntaxe, pp.
le
me Deus;
(Dieu)
20—27),
que quelques remarques.
ici
un adjectif ont besoin d'un complément,
complément qui leur convient.
Lorsqu'un verbe
il
{Id.,
siècle;
di
adjuvet
Dix
soit
home,
(je le)
vengiez {Raoul
soie
(* adjutet,
beueïe
et
jel
Diex,
qu'en
enfant,
longue vie (Brantôme, XVI«
et
1505).
Rois de gloire,
(si)
me
Faille
p. 228).
=
(m'ait
Se
p. 224).
(subi.) vivre tant
laist
preigrne
te
heureuse
très
perdre
(je)
Dieus
(p. 234).
de Cambrai, 2697).
Id.,
[Ancassin et Nicoieite, XXV).
toi
{Ro/atid,
Pleiist au sovrain roi que fuisse (fusse) lassus
1898).
..qu'enfant nous donnes {Alexis,
.
puisse jou
nul dit
{Id.,
et
le
Ainsi on ne dira pas:
Un
enfant doit respecter et obéir à ses parents,
parce que
pas.
Un
ayant
ici,
avoir après
respecter doit
et n'en a
enfant doit
chacun,
Mais dans
ne
et
lezir
premier
le
besoin
avoir
en
dire,
un complément
direct
respecter et obéir
obéir,
qui leur convient.
où
cas
le
absoljtmeni (sans
faitement
ses parents
respecter
complément
le
lui
faut dire:
Il
verbe
s'employer
complément), on
de
rapporter
faisant
peut
le
peut
par-
complément qu'au
dernier verbe:
Lorsque
flanc des
—
est
homme
Le jeune
ici
est
ici
répondu
a
canonnade,
la
avancera
elle
et
attaquera le
intransitif et n'a pas besoin de complément).
et a
déjà
fait
vous demandées {répondre
ce qiie
intransitif).
mains
et
levez
en
(comte),
(sut)
garde entendra
la
ennemis {avancer
que
se
il
set conter,
se repose
(Garnier,
(
fut
il
la gorge {id.,
17314 — 16). Charlemaignes de France, il fut
Voyage de Charlemagne à Jériisalem., 678). Li gentiz cuens
coupe
piez
morz
estoient
il
ne
{Id.,
XVIe
l'a
p.
siècle,
exemples au XVIIe
qu'en 1798,
il
les doit
IV,
conquérant (Roland).
(tué)
la,
s'adreca tout droit
Qui
Hippolyte,
—
promet
Grâce,
étant long sans accent
III,
quelque
On
comme
544).
comme
de France,
roys
Li
(Joinville, 85).
pas escondire {Fabliaux,
10).
siècle
la
trouve
ame,
p. 58).
chose,
il
encore
n'a pris
avec l'accent.
qui
sot
Qui biaus moz
Qui se taist, il
y
doit
beaucoup
l'accent
satisfaire
de
ces
circonflexe
Complément du verbe
même
en est de
11
homme
C'est un
de
et
On
des adjectifs.
75
l'adjectif.
ne dira pas:
enclin,
parce que eitclin ne peut pas s'employer sans complément:
C'est un homme enclin me bien, au mal, à médire, etc.
On
dit:
un enfant cher à ses pareizts; ce
C'est
cher;
livre est
un enfant
c'est
qui m'est bien cher (que j'aime tendrement),
parce que certains adjectifs peuvent être suivis d'un complément
ou
employés sans complément:
être
homme
Voilà un
—
disposé.
revu ses
d'avoir
disposé mi bien, on
Je suis content de
parents.,
mon
nuisible à voire santé, tout excès est nuisible.
comparée
ati latin,
avec
le latin.
—
toujours content.
—
homme heureux.
un
c'est
trouve toujours bien disposé, mal
le
sort, je suis
pas
F. n'a
J.
—
Son
Il
est
Ce long
livre est
heureux
travail
est
une grammaire
une grammaire comparée,
écrit
Une grammaire comparée au
latin ne dit pas la même chose que grammaire comparée:
M^ M. Bréal est
professeur de grammaire comparée au Collège de France,
mais une
grammaire pratique
On
trouve
complément ne
adjectif
chez
d'exemples où
une foule
auteurs
les
rapporte
se
qu'au
dernier
adjectif,
a publié
grec (Burnouf; raisonné
au XVI® siècle un ouvrage raisonné
complément);
n'a pas besoin de
c'est
et
basé sur
une grammaire
raisonnée; une grammaire raisonnée juste; une grammaire r.iisonnée J
dtc
^-^^Joa^j
bon sens.
On
et
le
premier
le
s'employant absolument, sans avoir besoin de complément:
Henri Estienne
le
(A. Darniesteter).
ne peut pas dire:
Le savant Maetzner
basée sur le latin,
parce que
ment
indirect,
les
écrit
une
excellente
grammaire
comparer veut après
verbe
le
a
prépositions
comparée
comme complé-
lui,
ou avec,
à
a
qu'il
mais
participe-
le
comparé, en parlant de grammaire, n'a nullement besoin
adjectif
de complément:
C'est un excellent livre de
comparée
C'est là
pouvant
sions
aujourd'hui
gnolle
un pléonasme,
être co^nparée
qui,
sur
dans
fra7içaise,
et
D'autres ont
dit-on,
qu'au latïn
tautologie).
équivalentes,
français
—
grammaire comparée.
sur
(de plusieurs langues entre elles) et basée
comme
C'est une
grammaire
le latin.
une grammaire française ne
et basée
Il
H. Estienne
y
en
au
sur
a
XVP
le latin
cependant
siècle,
(expres-
encore
basent
le
1896 l'abbé Espason Vrai Dictionnaire étymologique de la langue
en Russie M. Tacchella dans son Dictionnaire.
le grec,
basé
la
ce qu'a
fait
encore
en
langue française sur riiébreu;
on pourrait
Complément du verbe
76
même
qu'en Russie
dire
Hoppé, par
et
sur
çais,
excellentes
les
grammaires de Fenoult
basent leurs livres
„La légende de l'origine grecque du
fran-
savant romaniste Kr. Nyrop de l'Université de Copen-
dit le
hague, a encore d'autres
Nyrop, Grain,
du
français
l'adjectif.
leurs fréquentes comparaisons,
langue russe.
la
de
et
hist.,
défenseurs que
d'autres encore
423);
p.
I,
l'abbé Espagnolle (voir
font
dériver
le
La
H. Lizeray dans son livre:
celtique, entre autres
non dît latin (voir Nyrop,
grammaire comparée on peut donc ajouter:
langjie française dérive dit celtique et
Au
p. 415).
basée sur
et
dans
Voyons
ne
latin,
le
bonne
la
de
titre
fût-ce
que pour montrer qu'on
est
voie.
exemples dans lesquels le complément ne
ils sont nombreux, pourraient
condamnera qui voudra:
d'autres
se rapporte qu'au dernier adjectif;
être légion; les
Je
Il
repentante
trouvée
l'ai
prête à vous obéir (Mme de Maintenon).
et
se livrera là des batailles intéressantes et
pondance fr. de
préparées de longue vtain (Carres-
La grâce a été agréée et
1894).
Nos troupes ont été battaes et obligées de
se retirer (Thiers).
Ces élèves ont été punis et mis au cachot. Le sac fut
ramassé et porté au bureau de police (A. Daudet). Elle se dit offensée et
résolue à se venger (H. Malot). La foule se montrait menaçante et résolue à
notifiée
prisonnier
diVi
Belge,
l'Indép.
février
11
«Temps").
(le
On se trouvait là devant un crime
(C. Vigniol, Lecture).
odieux et digne des galères (Gaboriau). C'est un homme religieux et fidèle
à son prince (Fénelon). Vous trouverez en lui un homme sûr et dévoué à vos
enfoncer la porte
intérêts
(A. Daudet).
distraction
Constant).
(M^e de
me
Je
Je
l'ai
Genlis).
Me
(le
mains
et
ses
Elle
1er juil.
Cber
et
bon à rien
Il
adjectifs
de
fleurs
(est-il
même
ami du
rapporte
se
dît
à
toute
plaisir
(B.
Je suis affamé et
(Id.).
et
basé stir les
Voilà un livre écrit et basé
ennemi
Villégiatîtré).
couverts
étrangère
et
et
désireux de revoir la France (V. Hugo).
repos
ici
aux deux
(Fénelon).
Ces enfants ont besoin de repos
1895,
et
et
et
et
documents
sur des documents
participes).
Il
yeux baignés de larmes (Id.; les mains
se sentait désarmée et incapable de
1894, p. 224).
ronds
complément
infatigable
larmes?)
sérieuse
tendre
écrit (style et pensées)
plus authentiques (Planche).
homme
tif
âgé
voilà
Voilà un livre parfaitement
authentiques
un cœur
avait
sens las et désireux de vous revoir
impatient de manger.
les
trouvée
toujours
Il
levait
vers
étaient-elles
C'était
un
ciel
ses
le
baignées de
lutter (Lecture,
d'air
pur
25
avril
(R. des D. M.,
y avait sur le piano deux arbustes inconnus,
(Guy de Maupassant, Bel-Ami). Voilà un livre
Il
cher à rien
})
que le complément placé après deux
ne se rapporte à aucun des deux, mais au seul substan-
peut
arriver
qui précède:
C'était
forme
un railleur froid
et
sceptique
à son genre de vie (O. Feuillet, Hist.
de tout ce qui n'était pas cond'tme Parisienne).
pronom
Répétition du
Le complément
non aux adjectifs
77
sujet.
rapporte évidemment
se
à railleur,
ici
et
:
C'était
un
Pour
finir,
froid et sceptique railleur de tout etc.
que feu A. Darmesteter, en parlant du
et basée sur le la/in, a dit que l'on
pourrait peut-être voir quelquefois là un peu de prétention, mais
que le titre, commt fra7tçais, était correct, qu'il n'y avait là rien
contre la langue.
Dans ma Grammaire, dont on trouvera peuttitre
:
être aussi
comme
le
le
ambitieux,
titre
n' appartient
de l'usage",
nos meilleurs auteurs,
se basant
les seuls
uns de mes collègues
aux
laissant
constate,
il
et
langue"
la
sur
.
qui
droit
Mon
livre
manière d'écrire de
la
maîtres de
simplement,
Darmesteter,
tm
écrivains
F évolution de
qu'à etix stir
ne régente pas,
me suis fait tout
comme l'a reconnu
je
veut M. F. Brunetière
greffier
„le
disons
Grammaire comparée
langue.
la
Quelques-
m'ont appelé un démolisseur de gram-
maires; je suis fier de ce titre si l'on n'entend parler par là
que des mauvaises grammaires.
Dans mon ouvrage de
1878—79 on trouvera des comparaisons avec les autres langues
romanes, avec
russe.
ne
Il
le
latin,
vieux français, l'anglais,
le
donc pas
serait
parée seulement au latin
basée et comparée sur le
le
de
titre
pays
de
mon
langue
livre.
et
basée sur
latin
En
française
voir une
juste d'y
:
primaire
école
tout
déjà,
sait
le
quelques-uns interprètent
d'une
sortant
on
le latin,
comme
l'allemand,
grammaire comet encore moins
aussi
bien
d'un
qu'en
Normandie, que le français ne dit pas: comparer une langue
sur une autre, mais comparer une langue à ou avec une autre.
pronom
Répétition dn
Répétition ou omission du
propositions non-conjointes
pronom
Il
savait
pronom
sont unies
snjet.
était respecté,
des conjonctions,
par
sujet doit être exprimé ou répété
le
devant cfiaque verbe:
Elle ne se vengeait pas, car elle
parce qu'il était juste.
que Dieu défend de se venger.
Lorsque plusieurs
sujet.
Cet
élève
a
manqué
plusieurs leçons,
parce qu'il était malade.
Mais dans
les
propositions
par aucune conjonction, ou qui
des conjonctions
ne pas répéter
Je
plie et
le
et,
conjointes,
sont
ou, ni, mais,
pronom devant
je ne romps pas;
je plie
on
le
et
qui
ne sont unies
reliées entre elles
est libre
par une
de répéter ou de
second verbe:
ne romps pas.
pronom
Répétition du
78
La règle
même,
reste la
une
affirmative
à
d'une
proposition
négative à
seule chose à éviter, c'est
J.
ou employer
proposition
pronom
le
vers
le
La
de La Fontaine: je plie
vers
passage,
le
sans
répéter
d'une proposition négative à une
Mais
La Fontaine a voulu nous
si
qu'en
règle
J.
Fleury,
chez
lui
tire
on trouve
car
l'enfreindre,
à
ou vice-versa,
une proposition affirmative.
sujet,
la
passe d'une propo-
7iégative.
d'ignorance
affirmative'''').
donner par son
premier
a traité
pas.,
l'on
dureté.
la
s'appuyant sur
Fleury,
romps
que
proposition
sition
et ne
soit
sujet.
a
il
des
été le
dizaines
pronom n'est nullement répété (voir ma grammaire de 1878—79, syntaxe, p. 25 — 26j, mes Glanures gramd'exemples
oiî
le
et demie
d'exemples) d'auteurs
sur
le
verbe.,
contemporains, et mo7i étude
1896, pp. 16 — 20).
Je ne citerai ici que quelques exemples en commençant par les
œuvres d'Henri Gréville, un écrivain dont J. Fleury fait un bril-
(une page
1893
de
maticales
lant éloge parfaitement mérité:
Elle ne répondit rien,
larmes (Cléopâtre).
mains
à
son
qu'il lui
chez
{id.,
fit
mais
pas
regarda de
bons
voulut
beaux yeux mouillés de
mais joignit devant
ne répondit rien
Il
point
[id
prétextes
ses
elle,
p. 48).
ne
Elle
141).
p.
d'assez
derrière
le
un pas vers
{Folle Avoine,
tendait
tableau
retrancha
ne
Il
p.
,
dire
lui
165
;
lui les
retourna
et
vérité
la
et
se
d'exemples
foule
l'auteur).
Autres exemples:
Je
ne
(Bescherelle).
point
suis
—
Notre-Dajne de Paris).
ne répondit
r Inutile
fois sa
*)
rien et
beatite).
mère
Du
outrecuidant,
et
Dieu
prie
de
ne
l'être
jamais
Elle ne dormait pas et songeait à son beau capitaine (V.
—
Elle ne
Le jeune
homme
de La Fontaine
faire
voiture
sa
ne se résigna point
Jours d'épreuve,
Fontaine n'a jamais pensé à se
érigé
en
Hugo,
mais travaillait (Michelet).
demeurait étendue dans
(P. Margueritte,
vers
parlait pas,
p.
454,
règle
grammairien
—
,
Elle
(Guy de Maupassant,
et atttrista
Lecture,
plus d'une
10 mars 1895).
de grammaire
—
mais
La
on ne pourrait conclure que
deux choses: c'est, qu'en passant d'une proposition affirmative à une négative
on ne doit pas ou, du moins, on peut ne pas répéter le pronom sujet. Quant
au passage d'une proposition négative à une affirmative, le vers cité ne prouve
absolument rien: c'est un étrange raisonnement que celui de J. Fleury. Mais
faisons aussi de La Fontaine un grammairien pour savoir ce qu'il pense de la
question. Nous trouvons chez lui: Elle (Echo) ne répond point, et semble être
assoupie.
Je n'aime point à rire et suis un peu jaloux. — Elle ne peut plus
Et
repasser et croit s'être méprise (où est ici la répétition du pronom sujet?)
—
que d'autres exemples
pareils chez
La Fontaine!
Verbes
—
Les
voyageurs,
mettaient
dans
certains
Espagne;
Voya^-e en
le
Nous ne
d'être
nous
très bien et
p.
et
voleurs
296).
dureté:
la
traiterons
en très bon français:
rompaient comme du
pliaient pas, mais
ne
de
romps.
Mais nous dirons
Et
nécessaire,
le
Histoire
M. A. Pachalery,
voir l'Anthologie de
dirons pas, pour éviter
Je ne plie pas, mais
Ces clous ne
que
n'emportaient
pillés,
mauvais habits (Théophile Gautier,
plus
leurs
79
verbes faibles.
forts,
pas
d'ignorance
verre.
beaux
les
vers
suivants de P. Corneille:
Mes
d'essai
deux
pareils à
ne se
fois
font point
veulent des coups de maître {Le Cid.
connaître,
et
pour leurs coups
2).
II,
S'il y a quelque chose à reprocher à ces vers, c'est un peu
d'emphase,
trop
trop de déclamation, mais n'oublions pas que
Rodrigue avait dans ses veines du sang espagnol.
Et ailleurs:
J'ai
cœur dans une indifférence qui
peint votre
attend l'ordre d'un père à
détruit l'espérance, et....
I,
1).
—
Rodrigue ne
ou respire en prison {id„
vit plus,
Verbes
(Je reproduis
ici
que
ce
n'enfle
foris,
III,
dans
je disais déjà
p.
ma grammaire de
à
des
l'imitation
voyelle
du
radical,
verbes
1878
— 79,
128).
Quelques grammairiens ont voulu diviser
peuvent former leurs
5).
verbes hibks.
1ère partie,
çais,
d'aucun d'eux ni
un époux (Le Cid,
choisir
allemands, en
verbes fran-
les
verbes forts,
qui
temps au moyen d'un changement de la
et en verbes faibles,
qui ont un radical
invariable:
Re-cey-oir, je re-çoi-s, je re-çu-s, re-ç-u; ren-ir, je rien-s, je rin-s; voi-s,
je vis (je pour-vus),
band, gobun-den ;
tu;
etc.
etc.
compte que quelques-uns;
D'autres,
se
—
Cf. bieg-en (plier),
(ces verbes sont
cette division ne peut
basant
bog,
gebogen; bind-tn
nombreux en allemand;
sur la
le
donc s'appliquer
conjugaison
à
(lier),
français n'en
nos verbes).
des verbes
latins,
ont appelé verbes forts en français ceux qui ont l'accent tonique
sur la première
syllabe
du radical au présent de
verbes faibles ceux qui ont l'accent tonique au
la
l'indicatif,
même
et
temps sur
terminaison:
J'ai-me, je re-çoi-s, je di-s, je fai-s,
je fin-ls, j'é-cri-s, je
me
je dor-s, je li-s,
la-mente (ytxhts faibles).
etc.
(verbes /(?r/j)
;
Verbes
80
Mais
cette division n'est
rece-vez,
v.
Quelques passés
avec le temps
définis
à
première.
n.
comme
mais
dans
à
autres,
les
vieux
le
des
classe
la
faibles:
^^x^iÇiS
Je dis, je
je vis,
_/7j,
que tout leur passé
ainsi
la
quelques participes passés sont
et
forme forte,
la
appartenaient,
ils
pas plus acceptable que
di-s, etc.,
arrivés
français
faibles.
sont des ïonnes /or/es, mais
nous di-sons sont des iormes /azâ/es.
J'ai-me, je re-çoi-s, je
ai-mons.
verbes
forts,
fesimes, vous vedisies,
en est de
11
'j'eus
(vieux
dans
défini
oi),
fr.
des
oiirent, etc., étaient
il
même
formes
sont des
etc.,
foi'tes,
langue moderne, mais tu desis,
la
Xoxmç:?,
nous
faibles (vieille langue).
de quelques participes passés;
encore
ici
rexceptioii ne constitue pas la règle:
Eu,
brait,
ri,
chu, pu (pouvoir), pu
composé repu (re-pii), cru
dit,
fait,
avons
nous
mais
son
plu (pleuvoir), su (savoir), tu
(plaire),
Mais
avec
ment,
de
plupart
la
faible dans le
(taire),
ces
formes
les
qui
ce
crû
(croire),
(croître),
plu
etc.
avaient
participes
vieux français,
rarement employé,
(paître),
aussi
mon
dans
intermédiaires,
forme
la
trouve encore
se
parfaite-
Précis
de
leu (lisez
lu),
phonétique (1905):
on,
lu,
lu;
û, u,
eu;
eii,
etc.,
comme
cheû,
Je dis
etc.
receil a
cheu (prononcez chu),
même que
passé par receu
(lisez reçu),
premiers quarts du XYIII») pour arriver
pl-u, v-u, etc.,
il
ne reste du radical que
leii,
u)
(lisez
aurait
dû
à
reçu (XVIJe siècle
reçu
arriver à
et les trois
Dans ch-u, 1-u,
consonnes initiales, u appartenant
enfin
les
chu;
chû,
devenu eu
eil,
*).
p-u,
à la
terminaison venant du latin uium.
Je
n'avais
pas à
parler
de ces
quelques
exceptions dans
mon
Précis de phonétique (1905), personne n'admettant la division des verbes français en verbes forts et en verbes faibles,
et
quelques
les
*)
Au mot
eti
comparer *fahiimn
changé en
la
passés
et
participes
qui
précèdent
(avoir),
qui s'est arrêté dans son évolution (û, u),
(fatum,
sort,
consonne douce
d
feu (fém. feue), sans devenir /?/,
même
définis
qui a donné
fadut,
au milieu du mot), feu
[t final
/zi?
destin),
(cf.
receû, reçu,
reçu;
etc.,
fedut
on peut
(t
etc.).
médial
devenu
tombé),
II
en est
agurijem (augurium), aïlr (g disparu), etir, eur, devenu (hjeztr
La prononciation /2ur (de heur) a changé
sous l'influence de heure (hora).
comme celle de ses composés bonhetir, ma/heur, prononcés autrefois ho-nur,
mal-ur; feu, au XVI^ siècle, se prononçait aussi y«: feu (fu) mon oncle, feue
de
(fu)
ma
dans
tante.
*
Mots
qu'assez
reçu
n'ayant
81
finissant par oir, oirc.
tard
forme
la
forte
laquelle
à
ils
sont arrivés.
—
Remarque.
En exigeant l'invariabilité du radical pour reconnaître un
comme rcgiilicr, il faut au moins rejeter comme irycguliei's tous les
verbe
verbes en oir, où
re-ç-u;
etc.
change 3 ou 4
le radical
—
etc.
Voir Margot, Gr.
I,
Mots finissant par
Nous avons
nombreux
d'assez
re-cev-oir, re-çoi-s, re-çoiv-ent,
fois:
§ 42.
89, § 39, et p. 98,
p.
oir,
oire.
substantifs,
plupart verbaux,
la
venant du suffixe latin orinm, oriam. Je
ne les fais pas venir de pariicipes présents comme me le fait
Une ligne plus haut que celle qu'il a lue (voir
dire M. Sudre.
finissant par oir, oire,
mon
Précis de phonétique,
pratique,
ne
je
mots, pour leur genre
étrangers, et
un
les
pourquoi on
la
qu'une
a deux, le
une
grattoire,
un
dit
polissoir et
un
mot répondant
une
règle est toute
Ces
scientifique.
désespoir des
le
très instruits,
ne pourraient
différence de signification
une
racloir et
racloire, et
derniers féminins,
et les
polissoire,
deux formes
les
Pourquoi (un) ciboire (ciborium)
signification?
tandis que
orthographe,
ostensoir
non
à une forme
latine
[ostensoire) en
'-^
ostensoriuin
Autrefois ostensoire était féminin, pourquoi
(ostensum, montré)!
devenu masculin sous
est-il
la
premiers sont masculins
même
ayant
n'a-t-il
en France
dire
grattoir et
pourquoi
ma
que
terminaison, font
et leur
combien d'hommes, même
peut-être pas nous
entre
55), je dis
p.
donne nullement comme
la
seconde graphie?
cette
Pourquoi
terroir (* terratorium) sans e final et territoire (territorium)?
a:
Un couloir et une
Ma règle, je le
couloire,
répète,
réunir les mots en groupes.
donnent
nos
grammaires
un
est
doloir,
toute
C'est
pour
les
la
une
pratique,
même
mots
en
-peuse,
la
etc.
Si
:
donnée pour
que
règle pratique
eur qui
presque tous leur féminin en euse lorsqu'on peut
participe présent
On
doloire.
forment
les tirer
d'un
mentant, men-teur, men-teuse, trom-pant, -peur,
M. Sudre enseignait dans un pays étranger à
il
aurait mieux compris pourquoi mon livre
langue française,
a été
fait
comme
il
Pour contenter
est
fait.
les pointilleux
(mais ce
ne sera pas non
plus scientifique), disons qu'en remplaçant par oir, oire, la termi-
naison des infinitifs, nous avons plus de cent mots qui sont masculiîis,
finissant par oir, et
une vingtaine, féminins, terminés par oire.
6
82
Participe présent.
Les autres substantifs masculins finissant par oire sont:
Ciboire
mémoire
—
(ciborium),
pourboire
déboire,
composés de
(deux
boire),
le
mémoire), grimoire (autre forme de grammaire), compulsoire (terme
(la
de procédure), auditoire, conservatoire, consistoire (de consister, sens de: s'arrêter
dans un
séjourner, s'établir), directoire,
lieu,
réquisitoire, territoire (cf. terroir), vomitoire
A
mais que
pulsiim,
ces mots,
peut
l'on
comme on
ni
on
sait
purgatoire,
compulsoire (formé sur com-
pratiquement de compulser),
tirer
ne peuvent être
le voit,
laboratoire, observaréfectoire, répertoire,
(mot rarement employé).
consïsioire,
des participes présents
tifs
le
de
l'exception
interrogatoire,
promontoire,
prétoire,
oratoire,
toire, offertoire,
des
ni
tirés
infini-
*).
Pour les substantifs verbaux finissant par eur (féminin eitsè)^
que Vr final ne se prononçant plus dans ces mots dès
XII®
comme dans
siècle,
mots ont
des
plupart
la
par analogie,
suivi,
règle
la
polysyllabes,
mots
des
ces
par
finissant
eus (plus tard eux), euse.
Laàoriezis
(-rieiix
menteuse; trompeu
;
Quelques-uns
laborieuse,
laboriosus),
trompeuse;
(-peur),
etc.
menten
d'où
(-tenr)
etc.
nombreux dans
étaient
(ils
etc.,
langue)
vieille
la
font leur féminin en eresse:
Chasseresse (chasseuse),
défenderesse,
neresse est le féminin de devin,
devineuse
demanderesse (demandeuse), devide devinenr; enchanteresse, péche-
resse, vengeresse.
Les mots finissant par leur forment leur
lorsqu'on peut les
en euse
féminin
d'un participe présent, les autres forment
tirer
leur féminin en trice (du latin torem, iricem,
ou par analogie). Seules
exceptions: inspecteur, -trice, inventeur. -trice; exécuteur, -trice,
persécuteur, -trice (que l'on
pourrait,
règle
pratique,
tirer
d'un
participe présent).
Participe présent.
(Historique.)
Voici en quelques mots l'histoire du participe présent.
1)
Comme
de
riable
dans
Ils
gérondif précédé de en,
mouvement,
verbe
sont
le
participe
vieux français
le
*)
déjà
tombés en courant.
esmaiant
veillance,
Je serais cependant injuste
fait
dans
toute
ma
brochure
l'indulgence
Précis de phonétique dans
la
comme
participe d'un
inva-
toujours
était
:
nul ne voist (qui n'aille)
l'ai
et
présent
sur
Nous apprenons en enseignant.
(défaillant;
si
je
les
A/iscans,
3707).
ne reconnaissais encore
Voyelles latines,
p.
23,
du compte rendu que M. Sudre
Revue criticjite.
a
N'en
i
a
Les suriz s'en
ici,
comme
toute
la
je
bien-
donné de mon
83
Participe présent.
de
(Marie
fiihiiit
tiirnent
France,
fable
CI).
vinrent
Il
jusques
llotaiit
au
pont (Joinville).
Le participe préscni, exprimant l'action ou l'état, variait
en nombre, mais non en genre aux X* et XI" siècles, le participe
2)
n'ayant, comme en latin, qu'une seule forme pour les
deux genres (masculin et féminin):
Voilà des hommes (des femmes) aimants leurs enfants. — J'ai trouvé
présent
femmes maug-eants des confitures.
ardanz (brillants) a croc (Ville-Hardouin).
ces
Au
XII^
siècle,
en
aussi
parfois
—
participe
le
genre,
et
prenoit
Il
présent
toutes
(navires)
cependant
déjà
varie
même
en est de
il
les nés
—
au XIIP,
Du
XIV* au XVI® siècle il s'accorde toujours en nombre, et il y a
tendance à le faire accorder plus souvent en genre, mais ce
dernier accord ne devint pas règle générale:
pensa voir ces
Il
santes
filles
plenrjintes a l'entour
Lacedemoniens (Amyot,
les
santes à plusieurs personnes (Malherbe,
des sépultures
— 1593).
avoit force
1555 — 1628) — Nombreux
1513
Il
L'Anglais Palsgrave, qui nous a donné, en 1530,
grammaire
s'accorde,
mais que
française, enseigne,
comme
le
en poésie,
les autres
comme
règle,
que
participe présent ne s'accorde qu'en
oii
il
deux genres comme
reçoit les
maudisadres-
exemples.
première
la
l'adjectif verbal
en genre
adjectifs,
et
lettres
et
nombre,
en
nombre, excepté
les
deux nombres.
Mais Jacques Dubois (1531), dit Sylvius, donne, comme règle,
que le participe présent s'accorde en genre et en nombre avec
le
substantif
qu'il
même avis.
Au XVII*
Robert
qualifie.
et
Henri Estienne
Vaugelas (1585—1650)
siècle,
nous
sont
du
comme
dit,
Palsgrave, qu'on écrit:
Ces femmes,
limonade,
trouvées mangeaus des confitures, biivans de la
mangeantes des confitures, buvantes de la limonade.
je les ai
mais jamais:
Ménage, en 1672, regarde déjà comme une
avec l'accord en nombre:
Des hommes lisans
„Ce
gérondif,
est
l'infinitif,
l'Escriture,
femmes lisans
marquant
dit-il,
incapable
des
de
divers
l'action
faute d'écrire,
l'Escriture.
du
comme
verbe
comme
genres
de
divers
nombres".
La
règle
de Ménage,
par l'Académie française
décret, pensait
difficultés,
mais
mettre
fin
le
appuyé par Port Royal,
3 juin
à toutes
elle n'a fait
1679.
les
fut
acceptée
L'Académie,
par son
divergences,
que rendre plus
à toutes les
difficile
encore
6*
la
Participe passé.
Participe présent.
84
du participe présent
question
On
verbal.
de sa distinction avec
et
XVIP
trouve encore au
l'adjectif
une foule d'exemples
siècle
où le participe présent s'accorde en genre et en nombre. L'Académie eût été sage en reprenant la règle si simple des X^ et
XI* siècles:
Les principaux, voyans l'occasion favorable, se levèrent (Vaugelas).
des bergers luaugeaus
agneau
un
(La Fontaine).
Gens
affectans une vertu austère (La Rochefoucault, Méinoircs,
Madame
de Sévigné
Je vous trouve
même
écrit
méprisante
si
les clioses
Fénelon, dans son Télémaque, a
Des cordages flotans
flotans vers
la
Racine,
sur
la
côte,
et
26).
II,
encore:
du monde
vit
11
factieux,
difficiles et
(VI, 336).
écrit:
également:
eût écrit
des cordages
côte.
soit
qu'il
exprimer
voulu
ait
ou
Vactio7i
\étai^
dit aussi:
Et n'est-ce point, madame, un spectacle assez doux que
—
pleuraute à vos genoux.
Pleurante après son
char,
veuve d'Hector
la
me
vous voulez qu'on
voie.
du participe présent
grammaire de Ayer (Neuchâtel), présente des difficultés inextricables. C'est une distinction
dangereuse plutôt qu'utile que celle du participe présent et de
„La règle moderne, pour
et
de
l'adjectif verbal,
<\w' ennuyant,
et
en
verbal;
l'adjectif
Revues sont de
sens,
ce
verbal".
adjectif
la
distinction
l'excellente
dit
ennnytiix
Toutes
de Ayer.
l'avis
—
mon
Voir
bien
aussi
tout
est,
grammaires
nos bonnes
étude
sur le
verbe (1896).
—
Remarque.
en:
Ils
la
maintenant
regarde
et
On
de
On
non comme un gérondif, le
sont tombés en courant (participe
participe,
donne maintenant
préposition
nom
le
l'infinitif
à^
comme
participe
un
de
présent).
de gérondif à
ayant alors
étant
précédé
la
l'infinitif
même
précédé
valeur
que
l'ancien gérondif:
Nous avons passé
à faire (en
faisant)
de
la
la
soirée
à lire
(=
en
lisant),
à chanter (en chantant),
musique.
Participe passé.
Voici aussi, en quelques lignes, l'histoire du participe passé:
1)
Le participe
passé
sans
auxiliaire
ou
après
il
le
fait
aujourd'hui.
verbe
le
être (verbes passifs, verbes neutres), s'est toujours accordé
comme
L'Académie permet maintenant de
faire
85
Participe passé.
rentrer dans
que
générale les quelques exceptions
règle
la
admettait pour excepté, etc.
Tout le monde sortira, excepté ou exceptés
malades,
les
l'on
etc.
etc.,
2) Jusqu'au XVI^ siècle le participe des verbes auideiitellemeni pronominaux, traité comme celui des verbes passifs, s'accor-
dait avec
du
sujet
le
Au
verbe.
XVI",
des verbes
participe
le
pronominaux transitifs commence à s'accorder avec le complément direct du verbe, lorsque le complément précède:
Les cadeaux
Dans
se sont envoyés;
^?^"ils
verbes
les
essentiellement
continua à s'accorder avec
Ils
se sont repentis.
envoyé des cadeaux.
se sont
ils
pronominaux
abstenues de toute
Elles se sont
Les grammaires modernes regardent
pronom comme complément
participe
le
sujet:
le
à
ici
nourriture.
second
tort le
verbes essentiellement
direct, car les
pronominaux ne sont nullement des verbes tvansitifs.
3) Conjugué avec avoir., on peut dire, qu'à de rares exceptions
près,
passé
participe
le
ne
fait
encore
pas
avec
l'auxi-
une expression inséparable; il s'accorde, en conséquence,
dans presque tous les cas (XP, X1I^ XIII'' siècles):
liaire
La
chez
que
lettre
reçue,
j'ai
Au XÎV®
siècle,
Froissart
et
reçue une
j'ai
exceptions
les
autres
les
lettre.
deviennent
écrivains,
si
nombreuses
impossible
serait
qu'il
une règle pour l'accord ou l'inaccord, du participe con-
d'établir
jugué avec avoir,
Au XVI*
d'accord,
et
propose
et
en
il
est
de
même pour
Marot demande que
siècle,
XV®
siècle.
mettent
Accord du participe
règle de position:
la
le
les écrivains se
précédé du complément direct du verbe, invariabilité lorsque
complément
mais
suivra,
lui-même
est
dans
loin,
ses
le
œuvres,
de respecter toujours sa règle:
La
lettre
que
Rabelais
j'ai
reçue;
et les
reçu une
j'ai
lettre.
autres écrivains font encore varier à volonté
ou le laissent invariable dans tous
peut cependant dire qu'il y a tendance à le
le
participe
lorsque
ment
le
complément
direct
d'accord,
et
précède
tous
l'invariabilité à la
les
est
le
après
verbe,
variabilité
écrivains
du
du participe.
ne
XVII"
Au
invariable
le
complé-
sont
nullement
siècle
préfèrent
XVIIl* siècle,
les
complément direct précède le verbe,
mais le participe compte encore beaucoup
cas d'invariabilité, lorsque le
deviennent plus rares,
les
grammairiens
mais on
cas,
Lorsque
verbe:
le
les
laisser
Participe passé.
86
d'exemples
(voir
étude
sur
années
1815
règles que
nous
les
dans
d'invariabilité
mon
— 1820
Pour
un accord
parfait
établi entre les écrivains
s'est
d'un
suivi
pendant
XV** siècle, et surtout
nairement
invariable,
d'un
du
enfants,
le
XVP,
fut
de
participe
le
même
ces
le
est ordi-
aux
participes
invariable.
d'une
(même
mais à partir
XIV*" siècle,
verbe faire,
le
précédé
souvent
plus
le
rentrer
fit
toujours
reste
infinitif
grammairiens
Ces
en
il
pour
excepté
générale,
règle
et
Au XIX^ on
XVIII* siècles.
non
infinitif
s'accorde
participe
le
participe fait) jusque dans le courant
les ai
Voltaire
que vers
que se sont définitivement établies les
encore aujourd'hui. A part quelques
participe
le
préposition,
les
de
n'est guère
grammairiens.
et les
suivi
Ce
1896).
suivons
cas particuliers,
du
même
œuvres
les
verbe,
le
XVII''
et
dans
la
dont
le
Pour
laissé,
participe
tous-
faisaient suivre la règle générale:
lui
je les
laissés
ai
jouer au
ces pièces de théâtre,
jardin;
je
laissé jouer.
Les écrivains étaient
plus
le
souvent
ici
d'accord avec les
grammairiens, mais on trouve d'assez nombreuses exceptions:
Ces
ai
enfants, je les ai laissés
—
laissés ou laissé tomber.
leurs camarades, mais:
je
ou laissé jouer au
Ces
les ai
enfants,
je
les
ai
jardin.
Ces
livres, je
laissés
ou
laissé battre
les
laissé battre par leurs camarades.
Aujourd'hui l'Académie permet de
invariable à volonté le participe
ou de laisser
non précédé
faire varier
suivi d'un
infinitif
d'une préposition:
Ces hommes,
vus ou vu
je les ai
ou entendu chanter (fait suivi d'un
même
en est de
Il
lorsqu'un
hommes que
Pour
lorsqu'elle
eutendnes
participe passé est suivi d'un
l'on
a
trouvés ou trouvé
les
hier
errant ou errants dans
verbes pronominaux, on suivra volontiers l'Académie
permet
d'écrire:
Ces hommes se sont laissés ou laissé
Mais on ne
donne
la
suivra certes
et autres
que
Les
fruits
Le
participe,
ces cas,
je les ai
Nous nous sommes crus ou cru perdus.
cette forêt.
qu'elle
Ces femmes,
est toujours invariable).
ou d'un participe passé:
participe présent
Les
venir.
infinitif
je
invariable;
me
dans l'exemple
semblables, en écrivant:
suis laissés
l'esprit
le
aller à la boisson.
pas volontiers
de
verbe
la
ou laissé prendre.
langue
pronominal
le
veut,
a alors
doit rester,
en
pour complé-
87
Participe passé.
ment
direct
(1896)
oiî
—
nord
raconter les
que
le
ne
du
dit
j'ai
le
verbe
participe passé.
qu'au sud de
la
France on
qu'au centre
on n'emploie guère que le passé fndê/îiif pour
événements passés. Nos philologues disent même
passé défini est en train de mourir de sa belle mort;
trouve
le
de
50,
étude sur
à raconter les faits par le passé défini, tandis
au
et
Page
mon
Voir
suit.
se trouve toute l'histoire
Remarque.
aime
qui
l'infinitif
que
plus
dans
pour
livres
les
narrer
les
on
faits
l'histoire.
même du
en est de
Il
remplacé,
sud,
au
centre
au
et
passés,
Voici, sur les
indéfini.
passé antérieur défini, employé au
par
nord,
passé
le
antérieur
quelques exemples auxquels on
peut ajouter tous ceux qui se trouvent plus haut dans les pages
qui traitent de l'imparfait:
Dès que j'eus fini mes leçons, je partis (langage du sud); dès que j'ai
eu fini mes leçons, je suis parti (centre et nord).
Dès qu'il fut parti, nous
nous en allâmes aussi; dès qu'il a été parti, nous nous sommes aussi eu
allés {nous nous en sotmnes allés ne se dit plus, c'est de l'histoire ancienne).
—
—
Vous
tard.
—
saviez déjà alors
La
—
rendue) qu'en mars.
mère;
et
etc.
etc.
—
la
nouvelle; je ne l'appris (ne
pas encore prise en janvier;
ville n'était
homme racouta
Le jeune
attendîmes (avons attendu)
vie).
le
—
retour
de notre
Comme
nous
rencontrâmes (nous avons rencontré) une
tous ces cas,
c'est le
aujourd'hui en racontant,
même
à sourire,
fini remplaçant
tout (a
tout
et
le
il
et
raconté)
le
à sa
fut
même
(il
promener,
a été)
nous
femme.
passé
défini,
qui
emploie
prêterait
du passé antérieur indé-
passé antérieur défini.
Quant à l'imparfait, tout ce qui a
en réalité, un présent relatif.
ses divers emplois, de l'identifier avec le
(l'aspect imparfait)
11
nous
passé indéfini que l'on
non
en est de
vieille
—
frère.
allions
ieinps est,
P. 39,
apprise) que plus
Nous suspendîmes (nous avons suspendu) notre promenade
malade pendant toute sa
En
l'ai
ne se rendit (ne s'est
elle
de
2* ligne
la
en
été dit
11
est
prouve que ce
impossible, vu
HecoBepmenHbiH là^K^
langue russe.
bas de
la
page,
lire:
l'autre,
un passé
(au lieu de passe).
Les mots marqués d'un astérisque sont du
latin
vulgaire.
Table des matières.
Pages.
1)
Ne
2)
Signes orthographiques
3)
Accent aigu
4)
Accent grave
5)
Accent circonflexe
6)
Cédille
moins que
rien
et
3
;
8
remarques sur
les accents
9
12
13
16
v
7)
Tréma
17
8)
Apostrophe
18
9)
10)
Adverbes de manière
Orthographe de Fénelon
30
11)
Orthographe de Montesquieu
33
12)
Remarques sur l'orthographe
13)
Lettre de
14)
Lettre de
15)
Imparfait de l'indicatif
16)
Conditionnel
17)
Futur
18)
Indicatif et subjonctif après il
19)
Ne
20)
Concordance des temps du subjonctif
21)
Le présent historique; verbes qui en dépendent
67
22)
Subjonctif dans
71
23)
et
M^e
Mme
26
36
de Montespan au duc de Noailles
37
38
....
conditionnel après
explétif après
la
avant
Répétition du
25)
Verbes
26)
Mots
forts,
qtie,
et
de
51
53
si
semble
sans
57
60
qiie
64
proposition principale
Complément du verbe
pronom
24)
33
de Sévigné
74
l'adjectif
sujet
77
verbes faibles
79
finissant par oir, oire
81
82
27) Participe présent
28)
Participe passé
29)
Remarques sur
84
les passés défini, indéfini
et
sur l'imparfait
87
PC
2105
B3
Bas tin, Jean
Nouvelles glanures grammaticales
PLEASE
CARDS OR
DO NOT REMOVE
SLIPS
UNIVERSITY
FROM
THIS
OF TORONTO
POCKET
LIBRARY