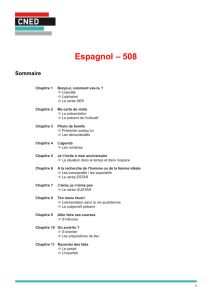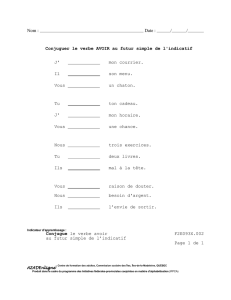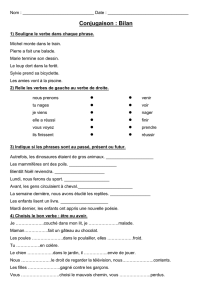Cours2 - Page personnelle de Lucy Michel

Description du français FLE (L3) – CM 1

Chapitre 1
Les parties du discours
Ce n’est pas propre à toutes les langues, mais dans la plupart des langues européennes, on peut
distinguer 9 classes grammaticales.
Différents classements pour les étudier :
— classement selon ce que ces parties de discours nous permettent de faire :
1. certaines décrivent notre expérience directe du monde : Nom, Verbe, Adj, certains Adv ;
2. d’autres décrivent les actes de langage : Pronom, Déterminant, Préposition, Conjonction,
certains Adv ;
3. d’autres ont une fonction affective : Interjection.
— classement qui oppose parties du discours varibales et invariables :
1. parties de discours variables : verbe, nom, pronom, déterminant, adjectif ;
2. parties de discours invariables : prépositions, conjonctions, adverbes ; interjections ;
1.1 Les parties du discours invariables
1.1.1 Le verbe
Partie de discours qui est très généralement considérée comme le cœur de la phrase en langue
française, parce qu’elle donne l’ancrage situationnel : le temps, la personne, le mode, la voix l’aspect.
C’est donc d’abord le verbe qui inscrit le discours dans une situation particulière.
—le temps : c’est ce qui permet de situer l’énoncé sur un axe chronologique 7→ le présent
maintenant, le passé avant, le futur après, avec toutes les nuances intermédiaires. On parle
dans la tradition grammaticale de tiroirs verbaux parce que l’information chronologique
(temps) ne suffit pas à l’analyse précise du temps, il faut pouvoir identifier le type d’emploi
en discours, donc le type d’énonciation produit :
1. les tiroirs coupés de la situation d’énonciation sont ceux qui ne fonctionnent pas de
façon déictique, i.e. qui n’entretiennent pas de lien avec la situation d’énonciation : ce
sont les temps du récit, ou de l’histoire, ou encore, dans une perspective plus énon-
ciative, on parle d’énoncés non embrayés. En fçs contemporain, certains temps sont
1

réservés à ce type d’énoncés : le passé simple et le passé antérieur. NB. en français
classique, c’est un peu différent, le passé simple et le passé antérieur peuvent
parfois être associés à des déictiques.
Ex. « Je fis un cours de linguistique » : si on veut situer le contenu de cet énoncé, il faut
a priori une explicitation textuelle des repères spatio-temporels 7→ « Mardi 24
janvier, je fis un cours de linguistique », l’information n’est pas déictique : je n’ai pas
besoin de la situation d’énonciation pour la comprendre.
2. les tiroirs ancrés dans la situation d’énonciation sont donc ceux qui fonctionnent
de façon déictique, i.e. qui entretiennent un lien avec la situation d’énonciation : les
tiroirs verbaux qui apparaissent dans ces énoncés sont ceux qu’on appelle les temps du
discours 7→ dans une perspective énonciative, on parle d’énoncés embrayés.
Les tiroirs verbaux spécialisés pour les valeurs embrayées du verbe sont le présent, le
futur et le passé composé.
NB. le présent à valeur générique, de vérité générale, gnomique est probléma-
tique. Par ex. « Les enfants sont aussi des personnes » 7→ certains considèrent que c’est
une vérité générale qui est donc coupée de la situation d’énonciation parti-
culière, puisque valable dans toutes les situations ; d’autres estiment que cette vérité
n’existe que par rapport à un contexte particulier, et n’a pas de valeur uni-
verselle, et demeure donc éminemment ancrée à la situation d’énonciation. Ex. « Les
baleines sont des poissons. »
3. il existe des tiroirs verbaux qui peuvent soit apparaître coupés de la situation d’énoncia-
tion, ou ancrés : l’imparfait, le plus-que-parfait, et les conditionnels.
Ex. « Ah oui, hier je voulais te dire un truc » 7→ ancré ; « il vit son père arriver, qui avait
la ferme intention de lui parler » 7→ coupé.
—la personne : c’est ce qui permet d’identifier la place du sujet dans l’interlocution.
1. P1 : le sujet du verbe est identique à la personne en charge du discours 7→ sujet =
locuteur, ex. « Je suis contente » ;
2. P2 : le sujet du verbe est identique à la personne qui reçoit le discours 7→ sujet =
interlocuteur, ex. « Tu es contente » ;
3. P3 : le sujet du verbe est identifié comme étant en dehors de l’interlocution 7→ sujet =
délocuté, ex. « Il est content ».
— le mode permet de situer l’énoncé sur l’axe de la virtualité : le subjonctif est du
côté du virtuel, et l’indicatif plutôt du côté de l’actuel. Mais bien sûr, ce n’est pas
tout :
1. modes personnels : subjonctif, indicatif, impératif (et parfois conditionnel selon
les analyses) 7→ impératif plutôt côté du virtuel de préactualisation, le conditionnel peut
être côté pré- ou désactualisation ;
2

2. modes impersonnels : infinitif, participe (et parfois gérondif) 7→ à l’infinitif, le
verbe peut fonctionner comme un nom, tout en conservant son rôle de sup-
port pour des compléments : « J’adore manger des gâteaux » ; les participes passés
et présents des verbes peuvent fonctionner comme des adjectifs : ex. « Pierre,
très fatigué, décida de partir » (pourrait très bien avoir un complément d’agent : « Pierre,
très fatigué de sa journée, décida de partir ») ; le gérondif peut avoir un fonctionnement
adverbial : « En attendant, tu n’as toujours pas répondu à ma question ».
Le mode principal du virtuel est le subjonctif (mais aussi impératif et conditionnel) :
— ex. « Je voudrais que tu saches analyser correctement cette phrase » 7→ le prédicat logique
« savoir analyser correctement cette phrase » n’est pas validé pour le sujet logique « tu » :
l’énoncé est donc virtuel.
— La différence entre virtuel et actuel peut notamment servir à différencier le sens de
certains énoncés similaires : ex. « Je cherche un chaton qui a les yeux verts »/ « Je
cherche un chaton qui ait les yeux verts » 7→ 1ère phrase : je connais un chaton, il a
les yeux verts, et je le cherche ; 2ème phrase : j’aimerais vraiment adopter un chaton,
et j’aimerais vraiment que ses yeux soient verts, mais je ne connais pas ce chaton, et je
ne sais même pas s’il existe . . . On parle de subjonctif de préactualisation 7→ ce qui
veut dire que le contenu est bien virtuel, il n’a pas encore été identifié, mais il est posé
comme quelque chose qui pourrait exister ;
— pour exprimer l’existence nulle : « Il n’y a pas de chat qui ait les yeux verts » 7→ subjonctif,
avec un contenu virtuel, mais ici, le contenu est absolument nié : il est posé comme
ne pouvant pas exister. On parle donc de subjonctif de désactualisation.
—la voix : c’est ce qui permet de situer l’énoncé sur l’axe de l’activité :
— voix active : sujet du v. = responsable du procès du verbe ;
— voix passive : sujet du v. = pas responsable du procès du verbe.
Ex. « La directrice a renvoyé Arthur »
1. sujet = entité agissante (responsable du procès)
2. verbe au passé composé
3. COD = entité subissante (non responsable du procès)
Ex. « Arthur a été renvoyé par la directrice »
1. sujet = entité subissante (non responsable du procès)
2. verbe au passé composé passif : fait nécessairement apparaître le verbe être
3. complément d’agent = entité agissante (responsable du procès) 7→ prépositionnel (par
ou de), alors que le COD ne l’était pas
3
1
/
4
100%