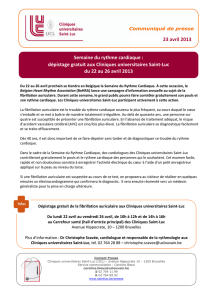Sortir d`hospitalisation : pour aller où ?

Bulletin d’information des Cliniques universitaires Saint-Luc • avril - mai 2008 • Trimestriel
Belgique - België
P.P. - P.B.
Bruxelles
Brussel
BC 10553
08
sommaire
Imagerie médicale 4
de la tête aux pieds
Chirurgie plastique 6
un visage à nouveau expressif
Cancer du sein 8
retrouver la conance
Fondation Saint-Luc 14
soutenir la recherche
La varicelle chez l’enfant 16
que faire et ne pas faire ?
Douleur aiguë
post-opératoire 18
soulager les patients
Sortir
d’hospitalisation :
pour aller où ?
Magazine d’information destiné aux médecins référents
�
�
�
Expéditeur : Cliniques universitaires Saint-Luc, 10 av. Hippocrate à 1200 Bruxelles.
Bureau de dépôt : Bruxelles X - Agréation : P501195
�
�
�

Page 2avril - mai 2008
Edito
Toujours plus haut
Nouvelles techniques en cardiologie, en chirurgie cardiaque, en
imagerie médicale, en cancérologie : les Cliniques universitaires
Saint-Luc innovent sans cesse. L’accueil et l’accompagnement des
patients continuent à faire partie, eux aussi, de nos priorités : que
ce soit aux Urgences avec la mise sur pied d’un nouveau dispositif
d’accueil ; dans le cadre d’un traitement spécique avec la mise en
route d’un accompagnement psychologique offert aux patientes
atteintes d’un cancer du sein ou encore, plus largement, pour trai-
ter la douleur post-opératoire de nombreux patients hospitalisés.
La Lucarne fait également le point sur la sortie des patients hos-
pitalisés ; particulièrement des patients qui ont bénécié de l’ap-
pui du Service social pour préparer leur sortie. Un état des lieux a
été dressé an d’en savoir un peu plus sur le devenir des patients :
comment se déroule leur séjour après l’hospitalisation ; où vont-
ils ? Dans quelle structure ? Quel est le rôle du médecin traitant ?
Autant d’aspects essentiels abordés en compagnie de Jean Des-
beek, responsable du service social des Cliniques universitaires
Saint-Luc.
Côté pratique, toujours très utile, le Vade Mecum a été remis à jour,
une version papier devrait vous parvenir dans les semaines qui
viennent. En attendant, consultez-le en ligne sur le site internet
des Cliniques à l’adresse : www.saintluc.be/ professionnel.
Bonne lecture,
Jacques Melin, Médecin-chef,
Coordonnateur général
Lucarne : Bulletin d’informations destiné
aux médecins référents.
Lucarne est une publication du Service de
communication des Cliniques universtai-
res Saint-Luc.
Éditeur responsable
Jacques Melin, Médecin-chef,
Coordonnateur général,
Avenue Hippocrate, 10
1200 Bruxelles
Coordination
Xavière Lucas
(xaviere.lucas@uclouvain.be)
Tél. 02 764 11 99
Fax. 02 764 89 02
Supervision
Thomas De Nayer (TDN)
Rédaction
Service de communication
Géraldine Fontaine (GF)
Xavière Lucas (XL)
Secrétariat
Véronique Dansart
Tél : 02 764 11 58
Fax : 02 764 89 02
Photos
Couverture : © Hugues Depasse/CAV
Intérieur : © Hugues Depasse/CAV
© DR (Document Reçu)
Mise en page
Tilt Factory
Si vous avez des idées d’articles ou des suggestions
pour améliorer cette publication, n’hésitez pas à
contacter la rédaction.
Toute reproduction, même partielle, est interdite
sauf accord préalable de la rédaction.
�

Page 3
avril - mai 2008
Lucarne # 08
La valve aortique articielle
est introduite via un cathéter
jusqu’à l’aorte.
Des endoprothèses
sur-mesure
Chirurgie de l’anévrisme aortique complexe
E
Lucarne # 08
Implanter une valve
aortique sans ouvrir
le thorax
Cardiologie
En janvier, une nouvelle technique a été expérimentée avec
succès par une équipe de cardiologues et de chirurgiens
cardiaques des Cliniques universitaires Saint-Luc.
Ils sont parvenus à implanter une valve aortique articielle,
sans recourir à une opération à coeur ouvert et sans pratiquer
d’anesthésie générale. Les deux patients, rapidement remis
sur pied, se portent bien.
Jusqu’à présent, l’unique traitement pour les patients victi-
mes d’un rétrécissement de la valve aortique était une inter-
vention chirurgicale au cours de laquelle la valve défectueuse
était remplacée sous anesthésie générale et circulation ex-
tracorporelle. Malheureusement, cette chirurgie dont les ex-
cellents résultats sont connus depuis longtemps, ne peut pas
être proposée à tous les patients. En effet, certaines personnes
jugées trop âgées ou trop fragiles, ne bénéciaient jusqu’il y
a peu d’aucun traitement curatif de leur maladie valvulaire
aortique. Désormais, chez ces patients jugés inopérables, le
cardiologue peut maintenant introduire un cathéter dans le
pli de l’aine sous anesthésie locale, et guider la prothèse dans
l’aorte à partir de l’artère fémorale. La première implantation
en Belgique francophone a été réalisée aux Cliniques universi-
taires Saint-Luc en janvier 2008. A ce jour, un peu plus de trois
cent personnes ont subi ce type de traitement dans le monde.
Dans 90% des cas, le succès est au rendez-vous. [XL]
Dr Joëlle Kefer, Service de cardiologie, tél. :02 764 28 15
Joelle.Kefer@uclouvain.be
Personne de contact
L
Les chirurgiens cardiovasculaires des Cliniques universitaires
Saint-Luc proposent désormais une alternative pour les pa-
tients souffrant d’anévrisme aortique s’étendant aux artères
viscérales. Plus question d’ouvrir systématiquement
l’abdomen, les chirurgiens placent dans l‘aorte un nouveau
type d’endoprothèse. Deux sortes de traitement existent à
l’heure actuelle pour traiter les patients souffrant d’ané-
vrisme aortique complexe : le traitement chirurgical avec
incision au niveau de l’abdomen ou du thorax et le traite-
ment endovasculaire moins invasif qui consiste à introduire
une endoprothèse dans l’aorte pour exclure l’anévrisme.
Jusqu’à présent la possibilité de mettre en place une
endoprothèse était limitée par la morphologie et la
complexité de l’anévrisme. Pour les anévrismes s’étendant
aux artères rénales et digestives, la chirurgie traditionnelle
restait la seule alternative.
Aujourd’hui, il est possible de réaliser sur mesure des endo-
prothèses comportant des orices ou des branches latérales
permettant - une fois mises en place - de continuer à irri-
guer les vaisseaux partant de l’anévrisme aortique tout en
excluant celui-ci de la circulation sanguine. Cette technique
utilisée par les chirurgiens cardiovasculaires des Cliniques
universitaires Saint-Luc permettra de traiter davantage de
patients de façon endovasculaire en leur évitant une lourde
intervention chirurgicale. [GF]
Ce cliché postopératoire
illustre l’endoprothèse
comportant des orices
ou des branches latérales
permettant de continuer
à irriguer les vaisseaux
partant de l’anévrisme
aortique tout en excluant
celui-ci de la circulation
sanguine.
Personne de contact
Pr Robert Verhelst, Service de chirurgie cardiovasculaire
et thoracique, tél. : 02 764 62 07
robert.verhelst@uclouvain.be
Actualité Médicale
�
(© HDepasse/CAV)

Page 4avril - mai 2008
L
De la tête aux pieds
Imagerie médicale
Rendre le corps
transparent ?
C’est un peu
ça. L’imagerie
par résonance
magnétique (IRM)
offre aujourd’hui
des images
étonnantes
du corps
entier. Détecté
précocement de
certaines lésions,
en moins d’une
demi-heure,
sans injection,
sans irradiation,
sans inconfort
est désormais
possible.
Les progrès récents en IRM, portant sur le maté-
riel, les logiciels, et de nouvelles séquences (para-
mètres techniques d’acquisition des images), per-
mettent aux Cliniques Saint-Luc de proposer une
imagerie du corps entier “de la tête aux pieds”.
Recherche de métastases osseuses
Dans un premier temps, pour afner la techni-
que et ses indications, nous privilégions l’étude
du squelette, en particulier pour la recherche de
localisations osseuses secondaires (métastases)
en oncologie. En effet, l’IRM offre une analyse
optimale de la moelle osseuse où se localisent
ces lésions et permet ainsi leur détection précoce
(avant qu’elles ne soient visibles par exemple
sur la radiographie ou la scintigraphie osseuse).
Ceci a des implications thérapeutiques majeures :
établir le stade exact du cancer permet d’opti-
maliser son traitement. Notre équipe se foca-
lise actuellement sur les métastases osseuses du
cancer de la prostate, particulièrement fréquent.
Une collaboration avec le service d’urologie (Prof.
B. Tombal et P. Van Cangh) a montré la valeur
ajoutée de l’IRM par rapport aux techniques exis-
tantes. Nous analysons aussi la capacité de l’IRM
d’étudier la réponse lésionnelle au traitement
(chimio-, hormonothérapie,…). Cette collabora-
tion permet d’offrir au patient une plateforme
avant-gardiste pour le diagnostic précoce et le
traitement du cancers de prostate métastatique ;
elle suscite aussi l’intérêt de l’industrie
pharmaceutique pour l’évaluation de nouveaux
traitements.
Les “tissus mous”
A terme, l’utilisation de l’IRM devrait permet-
tre de détecter non seulement les lésions osseu-
ses, mais aussi les métastases des “tissus mous”
Imagerie du corps
entier en T1 (A), Stir (B)
et diffusion (C). Patient
atteint d’un cancer de
la prostate. L’examen
détecte les métastases
osseuses (èches blan-
ches) et ganglionnaires
(èches noires).
Actualité Médicale
�
(© HDepasse/CAV)

Page 5
avril - mai 2008
Lucarne # 08
L
“CHIP”…
à ventre fermé
Chirurgie du cancer colorectal
Pr Frédéric Lecouvet,
Service de radiologie
Tél. : 02 764 27 93
frederic.lecouvet@uclouvain.be
Souffrir d’un cancer colorectal à un
stade avancé, avec carcinose péritonéale,
laissait peu d’espoir de survie à long
terme… Actuellement, la CHIP, introduite
très récemment à Saint-Luc par le Pr Alex
Kartheuser et son équipe, augmente les
chances de survie de ces patients.
La CHIP (Chimio-Hyperthermie Intra-Péritonéale) est une nouvelle tech-
nique de chimiothérapie à Saint-Luc pour les patients souffrant d’un
cancer colorectal au stade de carcinose péritonéale. Ce nouveau trai-
tement est administré à la n de l’intervention chirurgicale pendant
laquelle les organes atteints par le cancer sont enlevés. “La CHIP
combinée à l’intervention chirurgicale est très lourde et ne peut se faire
que dans certaines indications très strictes, indique le Pr Alex Kartheuser,
Responsable de l’Unité de Chirurgie Colorectale. Nous ne proposons donc
pas cette technique à tous les patients. Outre les aspects médicaux et les
complications post-opératoires potentielles, nous devons également envi-
sager la qualité de vie du patient privé d’organes intra-abdominaux tels
que le colon, le rectum, etc. La première CHIP s’est déroulée sans incident,
le patient a pu quitter les Soins intensifs et rejoindre sa chambre dès le
lendemain”, se réjouit Alex Kartheuser.
La CHIP est déjà pratiquée dans plusieurs centres hospitaliers de par le
monde. “A Saint-Luc, nous avons innové en associant l’utilisation d’une
nouvelle molécule, l’oxaliplatine, et la technique dite “ à ventre fermé” via
des drains, souligne le chirurgien. Nous espérons gagner en efcacité car
la pression dans le ventre est plus élevée et permet une meilleure diffusion
du médicament.”
Ce projet est une source d’espoir importante puisque grâce à la CHIP,
les chances de survivre à cinq ans au cancer sont de 48%, soit un
patient sur deux… [GF]
Personne de contact
Les chirurgiens
utilisent la
technique dite
“à ventre fermé”
par le biais de
drains ; la pression
plus élevée permet
une meilleure
diffusion du
médicament.
(ganglions, foie,…), actuellement recherchées par le
scanner. L’IRM pourra ainsi, dans la stadication de
certains cancers, se poser en alternative unique aux
techniques irradiantes de détection des métastases
(scintigraphie, scanner). Le cancer de la prostate est
un modèle idéal pour valider ce point.
D’autres pathologies du squelette ?
L’IRM du corps entier a un intérêt potentiel dans
toutes les pathologies affectant diffusément le
squelette, comme les pathologies hématologiques
malignes (myélome multiple, leucémies, lympho-
me) ou bénignes, les lésions multifocales des os
(exostoses à risque de dégénérescence, nécroses
épiphysaires induites par la corticothérapie, …),
et les rhumatismes inammatoires touchant de
multiples articulations.
Comment ça marche ?
Les séquences utilisées pour l’examen du corps
entier sont d’abord celles déjà employées pour
l’étude de petits segments du squelette. Les
pondérations T1 et Stir mettent en évidence les
tissus pathologiques au sein des os. De nouvelles
séquences dites en imagerie de diffusion permet-
tent une détection sélective des tissus anormaux,
en particulier des métastases osseuses et des
tissus mous. Cette technique, initialement utilisée
pour l’étude de l’accident vasculaire cérébral, est
transposée au corps entier. Sa performance est liée
à l’abaissement de ce que l’on appelle le coefcient
apparent de diffusion (ADC) dans les tumeurs par
rapport au tissu sain. Les images sont proches de
celles du Pet-Scan (tomographie à émission de
positrons dont les principes sont pourtant très
différents, reposant sur l’activité métabolique
anormale d’un tissu).
[Pr Frédéric Lecouvet]
(© HDepasse/CAV)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%
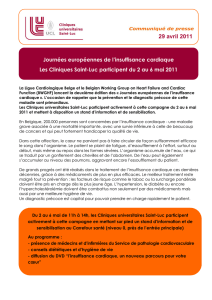
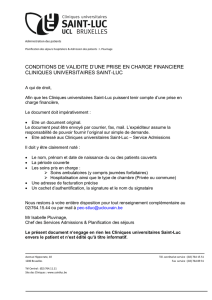
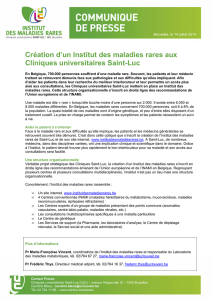
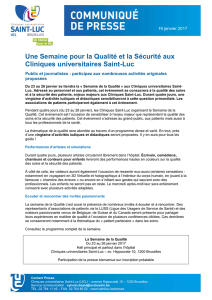
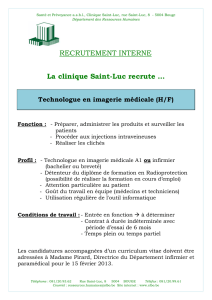
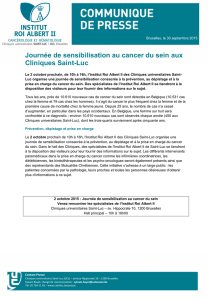
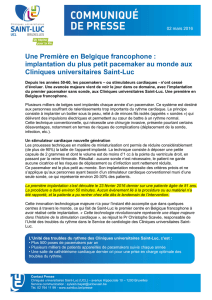
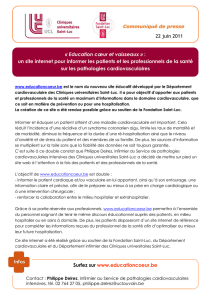
![[CP-Saint-Luc (UCL)]-Ne pas traiter le cancer de la prostate](http://s1.studylibfr.com/store/data/003100254_1-563be552124a8389be9ce2fe1b714428-300x300.png)