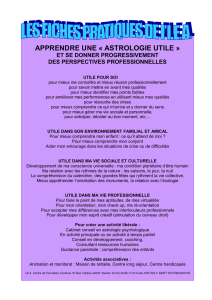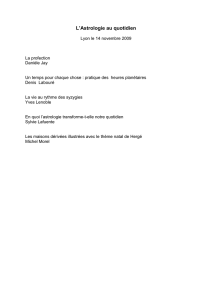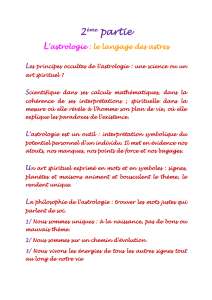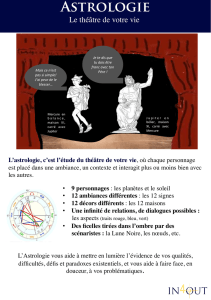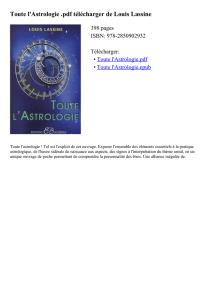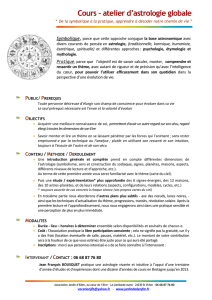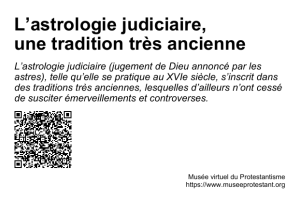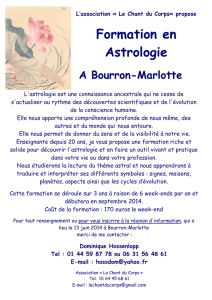RAM 2 - La question des Transneptuniens

La question des Transneptuniens
Enfin ! Cela fait plusieurs années déjà que nous avons à l’esprit le projet de traiter à fond de la
nature et des conditions de découverte des Transneptuniens – terme que nous adoptons désormais de
préférence à « Transneptuniennes », qui sous-entend le substantif « planètes », alors qu’il s’agit à nos
yeux de « facteurs » transneptuniens, de « centres actifs » astronomiquement fondés et
astrologiquement efficaces, comme l’expose Paul Bernard dans le n° 1 de la Revue d’Astrologie
mondiale (RAM). C’est d’ailleurs grâce aux discussions menées depuis 2008 avec Paul Bernard, qui a
suivi avec intérêt et bienveillance notre évolution dans ce domaine, que nous sommes enfin parvenu à
nous forger une conception solide en la matière. Auparavant déjà, Jacques Rauffet, dès l’année 2005,
nous avait initié aux travaux de l’École de Hambourg et vivement incité à poursuivre notre exploration
des Transneptuniens en astrologie mondiale. Ce n’est pas sans de longues résistances que nous y
sommes venu, mais c’est une aventure intellectuelle passionnante qui s’est ouverte ainsi à nous et nous
avons bien conscience de n’être qu’au début d’explorations à venir dans ce domaine, explorations que
devraient puissamment faciliter les outils mis à la disposition des chercheurs que sont les logiciels
d’Indices cycliques mis au point par Paul Bernard.
Aujourd’hui, les Transneptuniens ont près d’un siècle d’existence (le premier ayant été découvert
par Alfred Witte en 1923). Dans le monde entier, ils sont intégrés à la pratique de nombreux
astrologues, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, en Thaïlande et ailleurs – mais pas en France.
Sans doute parce que pèse encore sur l’École de Hambourg un jugement catégorique et hâtif d’André
Barbault, avec une formulation malheureuse et peu digne d’un grand maître de l’astrologie. Par
ailleurs, les réticences du grand astrologue français peuvent se comprendre quand l’on voit la
présentation particulièrement aride et rébarbative que prenaient les enseignements de cette École dans
ses publications. Et en l’absence de l’outil informatique - comme ce fut le cas aussi, par exemple, pour
les Directions primaires étudiées avec brio par Danièle Jay – la prise en compte des Transneptuniens
demandait une connaissance de la langue allemande et une solide culture mathématique, deux
compétences assez peu répandues, il faut bien le dire, parmi la gent astrologique française.
Ainsi, les Transneptuniens se sont imposés peu à peu, et à notre corps défendant, non seulement
dans notre pratique de l’astrologie mondiale, mais aussi, jusqu’à un certain point, dans l’étude des
thèmes individuels. Le dossier présenté dans ce numéro du RAM traitera donc de cette question qui
nous hante depuis le début de notre parcours avec l’École de Hambourg : que sont les
Transneptuniens, quelle est leur nature : des planètes, des corps physiques, ou des entités d’une autre
nature ? Question posée, en fait, dès leur « invention » (au sens du mot latin inventio – « découverte »)
par Alfred Witte puis par Friedrich Sieggrün dans les années 1920. Ce dossier est constitué de trois
éléments : l’invention des Transneptuniens ; l’intérêt que présente leur utilisation en astrologie
mondiale ; de l’École de Hambourg à l’astrologie uranienne.
Dans une première partie, nous présenterons un bref historique de la vie d’Alfred Witte et de la
fondation de l’École de Hambourg, puis nous traiterons des circonstances qui ont présidé à la
découverte des Transneptuniens. Nous présenterons succinctement la signification, les symboles et la
période de révolution des Transneptuniens et nous nous attacherons enfin à une analyse des
discussions relatives à leur nature. La seconde partie, « De l’école de Hambourg à l’astrologie
uranienne », brosse l’historique de la migration, suite à la Seconde Guerre mondiale, de cette école de
l’Allemagne vers les États-Unis, puis de son expansion actuelle à travers le monde. La dernière partie,
portera sur l’intérêt de l’utilisation des Transneptuniens en astrologie mondiale. Nous évoquerons
d’abord notre propre cheminement vers l’École de Hambourg et l’astrologie uranienne, en observant
au passage les « affinités électives » présentes dans notre thème personnel avec ces fameux
Transneptuniens. Puis nous donnerons quelques exemples dans l’histoire du XXe s. et du début du
XXIe s., en particulier le thème de l’homme sur la Lune. Et nous donnerons enfin un tableau complet
des Transneptuniens au cours des XXe et XXIe s.

2
L’INVENTION DES TRANSNEPTUNIENS
HISTORIQUE : ALFRED WITTE ET L’ÉCOLE DE HAMBOURG
Karl Brandler-Pracht - Astrologische Blätter –n°1 –Avril 1914
L’astrologue américain Gary Christen fait remonter à 1911 l’origine du système uranien (ou
symétrique) développé à Hambourg par Alfred Witte (1878-1941), dont le maître fut Karl Brandler-
Pracht (1864-1939), un astrologue autrichien désireux de combiner une astrologie scientifique avec
une approche philosophique et ésotérique inspirée du yoga et des doctrines orientales. Adepte de la
théosophie à travers les ouvrages d’Helena Blavatsky et ayant fréquenté un cercle spirite à Bâle, Karl
Brandler-Pracht enseigna une astrologie imprégnée de cet arrière- plan théosophique ; toutefois, son
premier livre d’astrologie, paru à Leipzig en 1905, était un manuel de mathématiques à l’usage des
apprentis astrologues. Il eut, parmi ses nombreux élèves, outre Alfred Witte, Wilhelm Knappich,
auteur d’un remarquable ouvrage sur l’histoire de l’astrologie, et Elsbeth Ebertin, la mère de Reinhold
Ebertin, le fondateur de la Cosmobiologie. Karl Brandler-Pracht fonda de nombreux groupes de
recherches et des sociétés d’astrologie implantées à Vienne (1908), puis à Berlin (1913), à Saint-Gall
et à Zurich (1914), puis à Munich, Leipzig et Hambourg (1920). Il créa également en 1906 une revue
ésotérique, le Zentralblatt für Okkultismus, et devint en 1910 le rédacteur en chef de la revue
Astrologische Rundschau. En collaboration avec Hugo Vollrath, il œuvra à une maison d’édition, le
Theosophisches Verlagshaus, où il dirigea une collection d’ouvrages d’astrologie (sous le titre
Astrologisches Bibliothek).

3
Édition de 1928
Alfred Witte - Regelwerk
En tant qu’astrologue professionnel, Alfred Witte (1878-1941) fut un collaborateur de la revue
Astrologische Rundschau de 1919 à 1923. Il prônait une astrologie à la fois ésotérique et
expérimentale et, selon Blake Finley, il fut en contact intellectuel avec l’astrologue Walter Koch
(1895-1970), l’auteur du système des Maisons qui porte son nom ; tous deux, s’inspirant des travaux
de Kepler, s’intéressaient aux énergies planétaires en relation avec les couleurs et la tonalité musicale.
Alfred Witte ne révolutionnait pas l’astrologie traditionnelle ; il reformulait dans des termes modernes
des concepts anciens que l’on trouve chez Kepler, Guido Bonatti et Morin de Villefranche. Toutefois,
contesté en 1923 par le milieu astrologique, il se retira, laissant à ses élèves le soin de poursuivre son
œuvre. Udo Rudolph a évoqué ce tournant intervenu lors de la deuxième Convention des astrologues
allemands à Leipzig (du 30 juin au 2 juillet 1923), au cours de laquelle de nombreux participants
avaient émis les plus vives réserves à l’égard de l’École de Hambourg. Le Regelwerk, publié en 1928,
(suivi d’une seconde édition en 1932, puis d’une troisième en 1935) fut censuré dès 1936 par les nazis,
mais conservé secrètement par Ludwig Rudolph, qui continua après la Seconde Guerre mondiale
l’œuvre d’Alfred Witte et qui publia en 1975 une anthologie d’articles de son maître sous le titre Der
Mensch. La majorité des étudiants de Witte avaient été envoyés dans des camps de concentration après
l’affaire Rudolf Hess, et Alfred Witte lui-même n’échappa à ce sort qu’au prix d’un suicide qu’il
accomplit le 4 août 1941, afin que son épouse ne fût pas privée de ses moyens de subsistance après son
départ et pour protéger sa famille d’un internement dans un camp de concentration. Après la guerre,
l’héritage de Witte fut développé, mais sous une forme très divergente, par Reinhold Ebertin, qui
rejetait au fond le système de Witte au profit d’un système personnel fondé sur les mi-points, auquel il
donna le nom de Cosmobiologie. Son ouvrage, Kombination der Gestirneinflüsse, traduit en anglais
sous le titre Combination of Stellar Influences, parut en 1940 avec l’approbation des autorités du
Troisième Reich. Reinhold Ebertin, qui avait été un élève d’Alfred Witte, s’inspirait du Regelwerk
mais en rejetant le Point Vernal et les Transneptuniens. Albert Timachev estime que l’introduction,
très critique à l’égard d’Alfred Witte, de l’ouvrage d’Ebertin connu dans le public anglo-saxon sous le
sigle COSI, fut pour beaucoup dans l’accueil défavorable du public vis-à-vis de l’École de Hambourg.
Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, le système uranien - la dénomination d’ « astrologie
uranienne » est due à Richard Svehla, un élève de Witte - héritage d’Alfred Witte et de ses
continuateurs en Allemagne, fut introduit en Amérique par Hans Niggemann.

4
De ce système, les planètes hypothétiques, qui se situent dans la zone de la Ceinture de Kuiper,
avec une périodicité orbitale qui s’étend de 262 ans à 720 ans – connues sous le nom de
Transneptuniennes ou de Transneptuniens - ne sont pas des éléments constitutifs, mais plutôt, selon
l’avis de Gary Christen, une conséquence. Elles s’intègrent avec les autres composantes du système
que sont l’arc solaire, les directions, les thèmes composites et les mi-points. Mais les Transneptuniens
représentent, toujours selon l’avis de Gary Christen, la partie la plus haute, la plus ésotérique du
système.
LES CIRCONSTANCES DE LA DECOUVERTE DES TRANSNEPTUNIENS
Albert Timachev rapporte qu’Alfred Witte inaugure sa carrière astrologique en 1913, avec la
publication d’un premier article qui porte sur les couleurs, le nombre et le ton, texte d’inspiration
keplérienne reposant sur la notion d’harmonie des sphères célestes. Le principal collaborateur de Witte
fut son élève Friedrich Sieggrün (1877-1951), spécialiste des sciences de la mer et astrologue
professionnel, qui fut le fondateur du « Cercle Kepler » de Hambourg et créa le terme d’ « École de
Hambourg ». Il semble que ce fut lui qui, selon les termes d’Albert Timachev, véhicula la légende
d’une découverte des Transneptuniens par Witte à partir de l’observation de mariages et d’autres
événements de même nature. Rappelons qu’Alfred Witte lui-même n’utilisait que les quatre premiers
Transneptuniens, les quatre suivants (découverts par Friedrich Sieggrün, furent intégrés dans le
Regelwerk en 1947 seulement, six ans après la mort d’Alfred Witte. Ainsi, en 1933, lorsque Ludwig
Rudolph publie ses Leitfaden der Astrologie – System Hamburger Schule, son texte n’inclut que les
quatre premiers Transneptuniens ; mais ce livre apporte une introduction systématique aux fondements
techniques et astronomiques de l’astrologie ainsi que des méthodes d’interprétation et une méthode
systématique de rectification des thèmes. Et de même, en 1939, lorsque Richard Svehla, publie aux
États-Unis une traduction en anglais de la troisième édition du Regelwerk (sous le titre Rulebook for
Planetary Pictures), il n’y inclut pas les interprétations relatives à Pluton ni aux quatre
Transneptuniens de Friedrich Sieggrün.
En ce qui concerne l’historique de la découverte des Transneptuniens, un important article de
Danièle Jay, Lionel Lechevallier et Jacques Rauffet a été publié en 2006 dans la revue belge
Infosophia. Ces auteurs retiennent également la date de 1923 comme le début des publications sur les
Transneptuniens, dont Alfred Witte constitue des éphémérides (celles de Cupidon, depuis 1640 ; celles
d’Hadès depuis 1400 ; celles de Kronos, depuis 1340). La dénomination des Transneptuniens fait
appel à des noms de dieux ou de héros en langue allemande – ce qui pose un problème de connotation,
de représentation différente, par exemple, dans l’esprit d’un francophone, pour qui Cupidon se réfère
plutôt à un dieu de l’amour léger, à la différence d’Eros qui représente le principe même de l’attraction
amoureuse. Plutôt que le terme grec Eros, Alfred Witte a choisi le nom latin Cupido, à cause de
l’association de Jupiter et de Vénus. Mais, comme le remarquent judicieusement les auteurs de
l’article d’Infosophia, il faut entendre ici Eros au sens de souverain principe de la mise en relation –
l’un des deux principes fondamentaux de la nature humaine ; C.G. Jung, par exemple, oppose Eros
(principe de relation) à Logos (principe de distinction). Et c’est à ce principe d’action séparatrice
qu’est Logos qu’Alfred Witte rattache le deuxième Transneptunien, qu’il nomme Hadès, et qu’il relie
au signe de la Vierge, dont le régent est Mercure/Hermès, le maître du langage. Ici, c’est le nom grec
Hadès, préféré au nom latin Pluto, qui est choisi pour désigner la planète qui règne sur le monde des
morts ; c’est que la culture germanique est orientée vers la Grèce plutôt que vers Rome, qui influence
les peuples latins.

5
L’article d’Alfred Witte sur Cupidon paraît dans
l’Astrologische Blätter de juillet 1923. Witte retrace
son éphéméride en remontant à 1640, puis il met en
évidence son influence dans les thèmes de
personnages historiques dont la biographie est bien
connue au plan de la vie affective et familiale. Il
présente la synthèse de deux études : la première sur
la princesse Louise de Prusse, qui s’est mariée le 24
mai 1913 et a eu un enfant le 18 mars 1914 ; la
seconde sur la relation de Goethe avec Christiane
Vulpius : la prise de conscience du sentiment
amoureux par le poète, le 13 juillet 1788, son
mariage, le 19 octobre 1806, la mort de Christiane
Vulpius, le 6 juin 1816. Alfred Witte précise que
c’est dans le signe du Cancer qu’il a cherché la
Transneptunienne supposée par Le Verrier. En fait,
Cupidon est sorti du Cancer en 1909, et en 1923, il se
trouvait en Lion, conjoint à Neptune. Pluton fut
effectivement observé quelques années plus tard, le
18 février 1930, sur le 18e degré du Cancer. Witte a
dû penser que sa « planète » qui faisait des mariages
ne correspondait pas à Pluton (qui se trouvait en 1923
à 10°-11° Cancer).
L’article d’Infosophia met l’accent sur les conclusions suivantes : 1° Witte a cherché la planète
évoquée par Le Verrier comme à même de perturber l’orbite de Neptune ; 2° il savait qu’au moins un
chercheur – il s’agissait de Fomalhaut en 1897, que Witte ne nomme pas - voyait cette planète revêtir
astrologiquement les traits du dieu grec des mondes infernaux, Hadès ; 3° Witte a identifié un autre
facteur dont l’action, retracée dans le passé, n’était pas de l’ordre du maître des Enfers ; 4° Witte a
dénommé cette nouvelle « planète » Cupidon, puisque ce facteur produisait des unions. Witte donne
pour titre à son article Der erste Transneptun Planet Cupido ? : sa planète est transneptunienne, mais
il n’est pas sûr qu’il n’y en ait pas une autre entre Neptune et elle ; intuition que viendra confirmer
l’observation de Pluton en 1930.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%