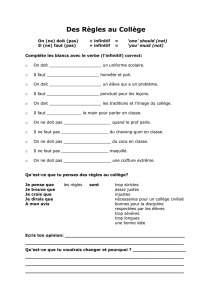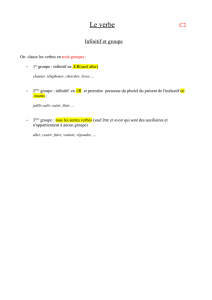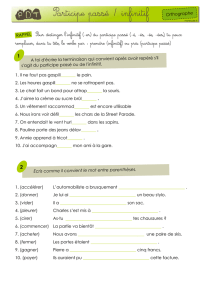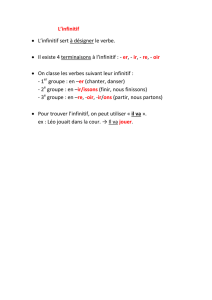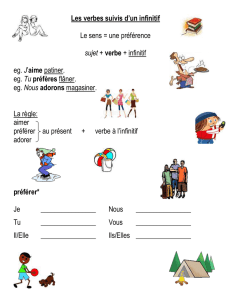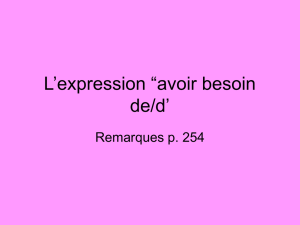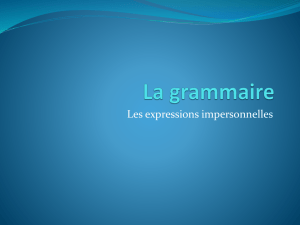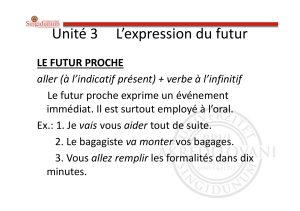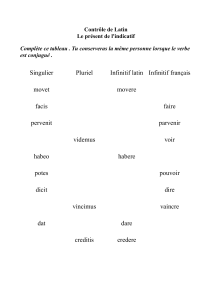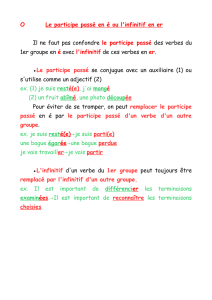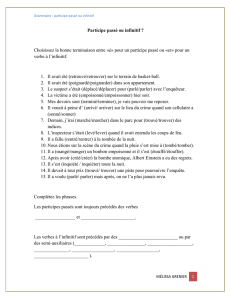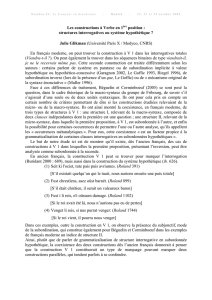LES COMPLETIVES

Envoyé par Christophe. LES COMPLETIVES
Propositions qui se substituent à des GN constituants de GV ou plus rarement sujets, CDN ou
cplt de l’Adj. On distingue les complétives introduites par que (conjonctives), les
constructions infinitives et les constructions interrogatives ou exclamatives.
Ttes peuvent être substituées par 1 GN
être coordonnées entre elles par de ou ni
complétives introduites par QUE
Cplts directs du V ( se réfèrent à des actes psychologiques, et ont dc des sujets
humains ; st pronominalisables par le)
Suites de formes impersonnelles (dépendant de vbes ou locutions verbales
impersonnelles ; dépendant d’une construction verbale attributive ; dépendant d’un
présentatif)
Sujets (au subjonctif et en tête de P)
Cplts indirects introduits par de ce que, à ce que
Cplts de N et d’ Adj
Détachées (annoncées ou reprises par un Pn neutre ou un GN
Constructions infinitives
On peut mettre en relation des syntagmes dont la tête est un infinitif (sauf inf substantivés ou
auxilliés) avec une autre structure conjonctive complétive ou circonstancielle. L’infinitif a un
sujet réalisé ou non et peut recevoir les mêmes types de cplts que ttes les formes verbales.
La construction infinitive fait apparaître le contenu propositionnel de la subordonnée comme
directement dans le champ du verbe régissant ou plus particulièrement de son sujet, alors que
la conjonctive disjoint plus nettement les deux propositions.
Qd les 2 constructions st correctes, l’intérêt de l’infinitive est de réduire l’ambiguïté, être
économique, elle est cepdt obligatoire en cas de co-référence des sujets.
Infinitif dt le sujet est identique à celui du V de la principale
Infinitif dt le sujet est différent de celui du V de la principale
Infinitif dépendant d’un tour impersonnel
Infinitif sujet
Constructions interrogatives
Il s’agit de transposition de P interrogatives, sur le plan sémantique, elles réfèrent à un savoir
en suspens
Interrogation totale (conj si pr introduire la sub)
Interrogation partielle
- interrogation porte sur un animé (introduite par le pn qui ; si interrogation
porte sur un attribut, l’inversion du sujet est obligatoire)
- interrogation porte sur un non-animé (introduite par le démonstratif ce suivi de
qui ou que)
- interrogation porte sur les circonstances
Constructions exclamatives
Pt être transposée et prendre la forme d’une proposition sub cplt d’objet d’1 verbe principal
1
/
1
100%