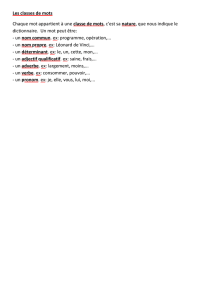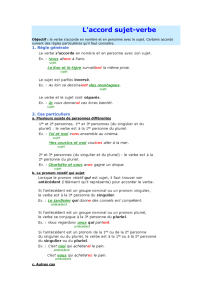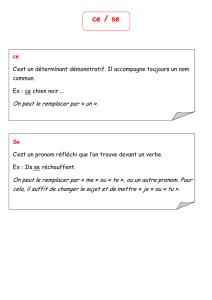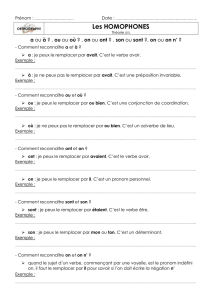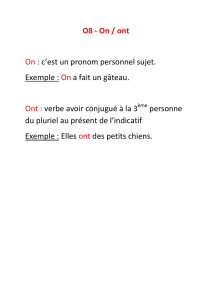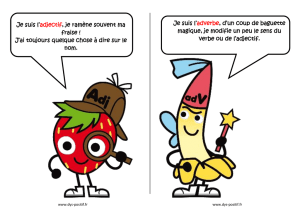mot - Chez

1
Envoyé par Céline.
LE MOT QUE dans Sylvie de Nerval.
Introduction
Le mot que est essentiel dans la langue française, ses emplois sont riches et complexes. Il peut être en
effet employé dans plusieurs types de phrase : déclaratives, interrogatives, exclamatives…, il sert à rapporter
des paroles au style direct, indirect ou indirect libre. Le mot que a une origine différente selon qu'il est
employé comme pronom, adverbe ou conjonction de subordination. Comme pronom, il vient des pronoms
latins quem (accusatif singulier masculin) ou quid (neutre singulier accusatif) qui sont à la fois des pronoms
relatifs, interrogatifs ou exclamatifs. L'adverbe que vient de l'adverbe interrogatif-exclamatif de quantité
quam. Enfin la conjonction de subordination que vient de la conjonction latine quod, cependant il faut noter
que ce n'était pas la conjonction de subordination la plus fréquente à la différence de ut ou ne.
Nous pourrons nous demander quels sont les emplois les plus fréquents de que dans cet extrait de
Sylvie, ce qui nous permettra de mesurer ainsi les innovations du français moderne par rapport au latin.
A partir des seize occurrences relevées dans ce passage, nous classerons le mot que selon qu'il est
pronom relatif ou interrogatif, adverbe ou conjonction de subordination.
I. Le pronom Que
Le pronom que, qui vient du latin quem ou quid, peut-être soit un pronom interrogatif soit un pronom
relatif, les deux pronoms ont, dès l'origine, la même forme. Nous relevons huit occurrences du pronom que
dans ce passage.
A. Que pronom interrogatif
Comme complément essentiel direct du verbe ou comme attribut du sujet, que est la forme ordinaire,
cependant, il existe des formes renforcées dans les interrogations directes. Que devient ce que dans les
interrogatives indirectes.
Pronom interrogatif simple
Les emplois de que comme pronom interrogatif neutre sont bien établis, mais restreints : que, pronom
atone, s’emploie comme régime direct à l’initial de phrase. Le pronom que, à la différence de quoi, est en effet
un clitique, c'est-à-dire qu'il ne peut s'employer qu'en prenant appui sur le verbe – immédiatement avant celui-
ci. L’exemple que l’on trouve dans le texte est : "que faites-vous donc ?" Que représente un non-animé, on
peut le remplacer en effet par quel métier faites-vous et sa fonction est d’être COD du verbe faire. Lorsque
l'interrogation commence par que complément direct essentiel, il y a inversion du sujet. Il faut noter que ce
tour est quelque peu livresque, le tour le plus courant est la forme périphrastique : qu’est-ce que…
Pronom interrogatif composé
L’interrogation peut se faire également avec le terme complexe qu’est-ce que (ou ce est une proforme).
L’occurrence que l’on peut citer est : "qu’est-ce que c’est que cela ?", dans ce tour périphrastique seul le
premier que est un pronom interrogatif, il effectue une distinction sémantique en indiquant le caractère non-
inanimé du reférent, alors que le second que est un pronom relatif qui opère une distinction syntaxique en
indiquant qu’il est attribut. L’union du pronom relatif et interrogatif présélectionnent strictement le terme sur
lequel porte l’interrogation partielle, qu’est-ce que signifie donc que l’on a affaire à un non-animé et à un
attribut.. On peut traduire cette expression par quoi est ce que cela (que cela est) est ?
Cette expression est autant employée à l’écrit qu’à l’oral, malgré quelques réserves sur sa « lourdeur » ; une
fois placée en tête de phrase, elle permet de garder l’ordre sujet-verbe sans recourir à l’inversion du sujet
lorsque l’interrogation porte sur l’objet, comme on peut le constater ici.

2
Dans une interrogative indirecte
Dans une proposition interrogative indirecte (ou percontative pour employer un terme utilisé dans la
Grammaire de la phrase française de Pierre le Goffic) qui se trouve à l'indicatif, contrairement au latin qui
introduisait l'interrogation indirecte par les mêmes mots que l'interrogation directe, que est remplacé par la
structure supplétive ce que comme nous le constatons dans l'exemple : "je demandai ce qu’ils étaient
devenus". Cette structure est constituée du pronom démonstratif ce et du pronom interrogatif que qui occupe
une fonction syntaxique dans la subordonnée en étant COD du verbe demander. Mais il faut remarquer que ce
n'a pas de lien sémantique avec le démonstratif, il n'est pas autonome sur le plan syntaxique et très lié au
relatif. Les formes composées de l'interrogation directe comme qu'est-ce que seront remplacées par cette
locution pronominale.
B. Que pronom relatif
Que occupe une place prépondérante dans le système relatif : non seulement il est très employé en tant
que pronom objet, mais il connaît de très nombreuses extensions d’emploi. Le pronom relatif cumule deux
rôles : il introduit une relative, dont il constitue l’opérateur de subordination ou subordonnant et vient se
placer en tête de la relative, quelle que soit sa fonction grammaticale dans la structure de celle-ci et il est
coréférent à son antécédent (sauf pour les relatives substantives). A ce titre, il constitue un substitut de GN et
assume une fonction dans la relative. Sa forme est essentiellement conditionnée par cette fonction : que
comme complément direct du verbe.
Que dans les relatives adjectives
Elle sont ainsi dénommées parce qu’elles constituent une expansion comme les adjectifs épithètes.
L’occurrence relevée est "ma pensée se porta sur les habits de noces que nous avions revêtus chez la tante à
Othys". Que pronom relatif est un connecteur dont la fonction est d'être régime direct du verbe subordonné,
c'est-à-dire de revêtir ; les habits de noces constituent son antécédent. Cette relative est déterminative (ou
restrictive) car elle permet de déterminer l'antécédent pour l'identifier avec précision. Le mode employé est
l'indicatif parce qu'il permet de situer avec précision le procès dans la chronologie, le narrateur se réfère à un
épisode qui est relaté dans le chapitre VI.
Que dans le tour présentatif c'est…que
C'est…que est une innovation du français, le latin ne possédait pas de tournure identique, nous
l'appelons un gallicisme. Nous pouvons relever la phrase assertive: "c’est ce qu’on appelle la mécanique".
Selon La Grammaire méthodique du français de Martin Riegel, nous pouvons la ranger parmi les relatives
substantives car contrairement à ce qui se produit pour les relatives adjectives, c’est la relative elle-même qui
donne un contenu référentiel au pronom relatif. Plus précisément, c'est une relative périphrastique, elle
constitue l’expansion d’un démonstratif (ce) de manière à former avec lui l’équivalent d’un GN : ces relatives
ont donc un statut intermédiaire entre celui des relatives adjectives et des substantives proprement dites ; elles
peuvent être indéfinies ou non. Ces relatives périphrastiques n’ont pas de véritable antécédent ; le terme qui
les introduit, comme ce, n’a qu’un sens très général. Quand au pronom relatif, il constitue une variable dont
les différentes valeurs sont déterminées par le contenu de la relative. Les relatives représentant un inanimé
sont introduites par ce, invariable, suivi d’un pronom relatif. Que a pour antécédent ce, il est COD du verbe
appeler.
Nous relevons également une phrase interrogative : "Qu’est-ce que c’est que ça ?" que nous avons
déjà citée dans la première partie pour définir le premier que. Elle présente deux tours présentatifs, les deux
derniers que sont des pronoms relatifs qui ont pour fonction d'être l'un attribut du verbe c'est, l'autre d'un verbe
être sous-entendu.
Enfin dans la phrase exclamative "ce n’est pas alors qu’un paysan aurait dansé avec elle ! ", le tour
présentatif ce n'est pas entre en corrélation avec l' outil relatif que. Il fonctionne comme un terme complétif
après un présentatif. Ce tour complexe est une formule d'extraction qui permet de former des phrases dont un

3
élément est extrait pour être mis en relief, ici c'est l'adverbe alors, complément circonstanciel de temps de la
phrase, qui est l'élément informatif de la phrase (c'est-à-dire son prédicat). Cette structure est parfois nommée
focalisation ou encore phrase clivée, comme nous le précise la grammaire d'Anne Sancier-Château. Le verbe
de la relative est au conditionnel passé première forme, il marque un irréel du passé, qui affecte un procès
situé dans un passé révolu. Le narrateur sait, au moment de l'énonciation, que le procès ne s'est pas réalisé
dans le passé, il justifie son exclamation avec la phrase qui suit, qui contient une négation exceptive.
II. L'adverbe que
Que est ici l’héritier de l'adverbe latin quam. Il marque un degré indéfini sur un prédicat. Si les
emplois exclamatifs simples et connecteurs sont restreints, les emplois intégratifs sont d'ordinaire
extrêmement étendus en particulier avec corrélation. Nous pouvons relever trois occurrences.
A. Que adverbe exclamatif
En phrase simple, que prend une valeur exclamative et marque le haut degré où l’adverbe que introduit
uniquement des énoncés exclamatifs indépendants.
Dans l'expression "qu’elle est jolie ton amoureuse, petit parisien ! " l’adverbe est senti comme portant sur
l’adjectif attribut jolie. Le mot exclamatif que est d'ordinaire placé en tête de phrase, comme c'est le cas dans
cet exemple. Dans cet emploi exclamatif, que est d’un usage restreint, et passablement livresque. Il est
concurrencé par d’autres adverbes (par comme..) ou par le tour qu’est ce que nous avons déjà vu pour les
interrogations.
B. Que adverbe exceptif
L'exemple que l'on peut donner pour illustrer ce point est : "elle ne dansait qu’avec moi, une fois par
an, à la fête de l'arc". Que marque, en association avec ne, la négation exceptive (ou restrictive), qui n’est pas
à proprement parler une négation. Elle équivaut à seulement, uniquement. Elle est restrictive en ce qu’elle
exclut de son champ tout terme autre que celui qu’elle introduit. Que se place devant le constituant sue lequel
porte la négation restrictive, il ici est suivi d’un complément d’accompagnement introduit par avec.
C. Que dans une proposition adverbiale de conséquence
Les emplois intégratifs de l’adverbe que sont particulièrement importants et vivants avec une
corrélation. Que sert à former de nombreuses locutions conjonctives comme si bien que, qu'on trouve dans la
proposition "si bien que je ne pus lui demander par quelle circonstance elle était allée à un bal masqué".
Dans cette locution, qui prend un sens consécutif et marque un résultat, bien est un adverbe de
manière, lui-même quantifié par un double système adverbial corrélatif (si + que), les éléments ne se séparent
plus. La consécutive se trouve au passé simple de l'indicatif, ce qui signifie que la conséquence est actualisée
pleinement (elle est présentée comme effectivement réalisée) et s'inscrit donc dans l'univers de croyance de
l'énonciateur.
III. La conjonction de subordination que
Que est le seul terme en qu' à accéder à un autre type d’emploi, l’emploi complétif dans lequel il est
dépourvu de fonctions dans la subordonnée et non anaphorique. La conjonction que en effet est un pur
marqueur de subordination qui n’a aucune fonction dans la subordonnée. Il sert à introduire des subordonnées
dites complétives parce qu’elles jouent fréquemment le rôle de complément, mais dont les multiples
fonctions, identiques à celles d’un GN, sont déterminées par leur position dans la principale. De fait la
subordonnée complétive conjonctive par que peut souvent être remplacée par un groupe nominal de même

4
valeur et de même statut. Le français innove par rapport au latin en introduisant beaucoup de complétives en
que.
Il faut distinguer l'emploi de que dans les propositions conjonctives essentielles et dans les propositions
conjonctives corrélatives. Il y a cinq occurrences dans ce passage.
A. Que dans les propositions conjonctives essentielles ou conjonctives pures
Ce sont des propositions conjonctives qui remplissent dans la phrase des fonctions nominales
essentielles (définition du Grevisse). Les complétives COD sont les plus fréquentes et les plus typiques, les
verbes dont elles dépendent se réfèrent à des actes psychologiques et ont donc pour sujets des êtres animés,
généralement humains. Il peut s’agir de verbes de déclaration comme dire, on en trouve un exemple dans le
texte : "C’est lui qui m’avait dit qu’on pouvait la passer l'ieau !" , la proposition conjonctive "qu'on pouvait la
passer l'ieau" est COD du verbe dire. On trouve également ce type de propositions après des verbes de
jugement comme comprendre. On peut ainsi relever la proposition "je compris que la vieille tante n’existait
plus", COD du verbe comprendre. Dans ces deux cas, le mode employé est l'indicatif, mode ordinaire après
ces types de verbe impliquant un contenu de parole ou de pensée, puisque l'énonciateur prend en charge, à des
degrés divers, le contenu asserté. Le procès peut être posé, actualisé. Le verbe principal se trouvant à un
temps du passé, l'imparfait indique la simultanéité de la subordonnée conformément à la concordance des
temps. Dans l'interrogation : "te rappelles-tu que tu m’apprenais à pêcher des écrevisses…?", que est
également COD du verbe se rappeler. L'imparfait de l'indicatif marque l'antériorité par rapport au verbe de la
principale qui se trouve au présent de l'indicatif. On remarquera que l'emploi d'une interrogation avec
inversion du sujet est surtout réservé à l’écrit, en particulier littéraire.
Enfin dans la phrase impérative "et convenez que vous étiez moins jolie autrefois", la complétive est
aussi COD du verbe convenir, l'imparfait de l'indicatif "étiez" marque l'antériorité par rapport au verbe de la
principale.
B. Que dans les propositions corrélatives
Ce sont des propositions introduites par que, et qui sont commandées par un mot de la phrase ou de la
proposition dont elles font partie (définition du Grevisse). Pour illustrer ce point, on peut faire mention de : "je
comprenais assez que Sylvie n’était pas paysanne". Assez est un adverbe d'intensité qui détermine le verbe
comprendre, il évoque le degré moyen qu'atteint un sentiment. Il appelle une proposition corrélative. Le mode
utilisé est l'indicatif parce que le procès est actualisé, l'imparfait marque comme nous l'avons vu la
simultanéité de la subordonnée par rapport au verbe de la principale qui se trouve à un temps du passé.
Conclusion
Sur les seize occurrences du texte, nous remarquons que la moitié sont des pronoms, ce qui prouve que
cet emploi hérité du latin est encore important dans notre langue. Il faut cependant remarquer que la langue
française utilise beaucoup le tour présentatif c'est que, ce qui constitue une innovation par rapport au latin.
Que est également fréquemment employé comme conjonction de subordination introduisant des complétives,
ce qui constitue une autre innovation par rapport au latin qui utilisait plus souvent d'autres conjonctions.
Enfin l'emploi adverbial est celui qui est le moins représenté.
D'un point de vue stylistique, ce passage présente la conversation qui s'engage entre le narrateur et
Sylvie le lendemain de la fête de l'arc. De nombreux que marquent les interrogations et les exclamations du
narrateur principalement (on ne trouve en effet qu'une seule phrase contenant un que prononcée par Sylvie)
qui ne reconnaît plus celle qu'il aimait., et qui cherche à rattraper le temps perdu à son retour à Loisy. Il faut
noter cependant que certains emplois de que sont livresques, comme l'interrogation "te rappelles-tu que tu
m'apprenais à pêcher des écrevisses…? que l'on traduirait plutôt à l'oral par est-ce que tu te rappelles
que….Ce passage nous permet également de connaître les réflexions du narrateur, la scène est essentiellement

5
décrite de son point de vue, les emplois de que au discours indirect et indirect libre sont aussi importants que
ceux du discours direct.
1
/
5
100%