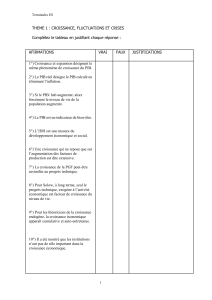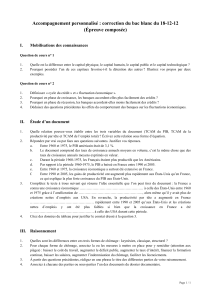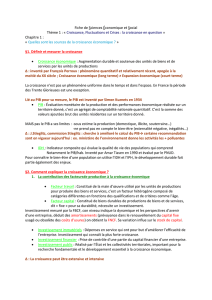croissance, fluctuations et crises

DÉBAT&CO
SELON LE DERNIER RAPPORT SUR LES PERSPEC-
TIVES ÉCONOMIQUES MONDIALES DE LA BANQUE
MONDIALE DE JANVIER 2016, LA CROISSANCE MON-
DIALE ATTEINDRA 2,9 % EN 2016, SOIT UN TAUX SU-
PÉRIEUR À CELUI DES ANNÉES PRÉCÉDENTES, MAIS
INFÉRIEUR À CE QUI AVAIT ÉTÉ ENVISAGÉ.
Si différents travaux ont été menés pour mesurer la croissance
économique à l’aide d’indicateurs alternatifs, le taux de croissance
du PIB demeure incontournable pour appréhender l’évolution de
l’activité économique. Tout en s’interrogeant sur l’intérêt et les li-
mites du PIB, les programmes de sciences économiques et sociales
(SES) engagent à réfléchir sur les sources de la croissance écono-
mique et sur son caractère instable (partie « Croissance, fluctua-
tions et crises » du programme de terminale ES). En effet, comme
l’écrivait Joseph Schumpeter en 1942 dans Capitalisme, Socialisme
et Démocratie, en rendant hommage à Karl Marx qui avait mis
cette vérité en lumière bien avant lui, « Le capitalisme, répétons-le,
constitue, de par sa nature, un type ou une méthode de transformation
économique et, non seulement il n’est jamais stationnaire, mais il ne
pourrait jamais le devenir ». Sur ce point, l’histoire économique
n’a pas pour le moment démenti ces grands auteurs, l’analyse de
la croissance économique, des fluctuations et des crises demeure
toujours d’une grande actualité.
En lien avec les programmes, il nous a semblé tout d’abord inté-
ressant d’interroger Philippe Aghion, spécialiste de l’analyse du
processus de croissance mondialement reconnu, et de rappeler
quelques éléments théoriques et factuels essentiels. Ensuite, nous
avons choisi de vous présenter un débat contemporain en écono-
mie : la « stagnation séculaire », c’est-à-dire la fin de la croissance,
est-elle inéluctable? Pour certains économistes, le tarissement de
la croissance viendrait du fort ralentissement de l’augmentation
de la productivité globale des facteurs (PGF), alors que d’autres
économistes estiment que les nouvelles technologies constitue-
raient toujours un formidable réservoir de croissance. Enfin, les
entreprises constituent un des acteurs majeurs du processus de
croissance. Leurs choix sont des indicateurs importants pour ex-
pliquer les fluctuations de la croissance et l’existence de périodes
de crise. Nous avons voulu en savoir un peu plus en interrogeant
Vinci, une des plus grandes entreprises françaises, acteur mondial
de premier plan dans le domaine de la construction n
Taux de croissance du PIB réel (en % annuel)
CROISSANCE,
FLUCTUATIONS ET CRISES
Débat&Co / page 1
Lecture : en 2015, le PIB réel en France a augmenté de
1,07 % ; il a augmenté de 2,43 % aux États-Unis et de
6,75 % en Chine.
Une grandeur économique évaluée en valeur s’exprime
au prix de l’année en cours, c’est-à-dire à prix courants
(tels qu’ils sont indiqués à une période donnée, c’est-à-
dire en valeur nominale). Une grandeur évaluée en vo-
lume s’exprime à prix constants (ou prix en valeur réelle),
ce qui revient à éliminer l’effet de variation des prix n
Source : Perspectives économiques de l’OCDE : statistiques et projections
Le site des sciences
économiques et sociales

3 QUESTIONS
À PHILIPPE AGHION
POURQUOI LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT
CONNAISSENT-ILS UNE
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
EN MOYENNE PLUS ÉLEVÉE
QUE LES PAYS DÉVELOPPÉS?
Les pays en développement
profitent du rattrapage tech-
nologique. Ils démarrent d’un
niveau de productivité plus
faible que le nôtre et peuvent,
en adoptant nos technologies,
se rapprocher de la frontière
technologique. Partant d’un
niveau de productivité très
faible, ces pays avancent à
pas de géant. Il est plus facile
de réinventer la roue que d’in-
venter la roue. En revanche,
les pays qui sont à la fron-
tière technologique ne font
plus que de petits pas pour la
repousser (en adoptant des
technologies plus avancées).
Ainsi la Chine a connu jusqu’à
une période récente, un taux
de croissance annuel moyen
très élevé, au-delà de 10 %,
alors qu‘il est à ce jour infé-
rieur à 7 % n
POURQUOI LA FRANCE
CONNAIT-ELLE UNE CROIS-
SANCE ÉCONOMIQUE EN
MOYENNE PLUS FAIBLE
QUE CELLE DES ÉTATS-UNIS
DEPUIS 30 ANS?
Il y a deux types de raisons.
La France a connu une crois-
sance forte pendant les Trente
Glorieuses, mais il s’agissait
essentiellement d’une crois-
sance de rattrapage, bien
qu’elle fut innovante dans de
nombreux domaines.
L’économie française n’a
pas su ensuite adapter ses
institutions et son mode d’or-
ganisation économique aux
nécessités de l’innovation,
c’est-à-dire une économie où,
sans arrêt, de nouvelles activi-
tés remplacent les anciennes.
Pour y parvenir, il faut un sys-
tème flexible. Or le système
français est très rigide, très
corporatiste, ce qui l’empêche
de s’adapter et d’obtenir un
niveau de croissance plus
élevé n
COMMENT FAIRE POUR QUE
LA FRANCE AUGMENTE SA
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
MOYENNE À LONG TERME?
Il faut d’abord procéder à
des réformes profondes pour
rendre l’économie plus mobile.
En particulier, il faut une véri-
table flexibilité sur le marché
du travail. Il faut mettre en
place des institutions adap-
tées facilitant l’embauche
et le licenciement, mais en
donnant parallèlement des
garanties de salaires et une
formation professionnelle.
C’est donc une grande réforme
qui est à faire.
Il faut aussi une réforme de
l’État. Il y a beaucoup trop
d’argent public gâché, en
raison notamment d’un trop
grand nombre de communes
ou de départements ; une
partie de leurs fonctionnaires
pourrait servir à autre chose.
Il faut également une réforme
de la fiscalité ; la fiscalité
actuelle est pour l’instant trop
opaque. De manière géné-
rale, il faut partout simplifier,
rendre plus transparent et
plus simple. Par exemple, il
y a beaucoup trop de caisses
d’assurance maladie: ce qui
était adapté à une économie
dans laquelle chaque per-
sonne garde son job toute
sa vie, ne l’est plus dans un
monde où on en change sou-
vent. Il faut par exemple des
régimes uniques d’assurance
maladie et de retraite.
Tout cela permettrait
d’avoir plus de réactivité
macroéconomique au niveau
européen, en mobilisant des
politiques contra-cycliques,
c’est-à-dire réactives aux
cycles économiques. Les
américains ont un système
mobile et flexible et adoptent des
politiques macroéconomiques
contra-cycliques. Tant qu’on
ne fait pas de réformes
structurelles en France, les
Allemands ne consentiront
pas à assouplir la politique
macroéconomique sur le plan
fiscal et monétaire n
Économiste,
Professeur au Collège
de France
Débat&Co / page 2

L’ESSENTIEL SUR “CROISSANCE, FLUCTUATIONS ET CRISES”
CRISE ÉCONOMIQUE
Moment de retournement de la conjoncture à la baisse
(la conjoncture étant la situation de l’économie à un
moment donné, caractérisée par un certain nombre
d’indicateurs macroéconomiques).
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Augmentation du PIB en volume généralement calcu-
lée sur un an pour une économie.
FLUCTUATIONS ÉCONOMIQUES
Phénomène caractérisé par une alternance de mou-
vements de sens contraires, d’une ou plusieurs gran-
deurs choisies (souvent le PIB en volume).
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB)
Indicateur de production au niveau national. Somme
des valeurs ajoutées + TVA + droits de douane - sub-
ventions sur les produits.
PRODUCTIVITÉ GLOBALE DES FACTEURS
Capacité d’un pays à créer des richesses autrement
qu’en accumulant du capital et du travail mais en les
combinant le plus efficacement possible. Elle reflète le
progrès technique et l’amélioration du capital humain.
PROGRÈS TECHNIQUE
Ensemble des changements résultant de l’effort d’in-
novation et de l’amélioration de la qualité des produits
et des processus de production.
Pour poursuivre http://www.melchior.fr/Glossaire-biographies.118.0.html
1929
Krach à la bourse de Wall Street ; le fameux « jeudi noir »
(24 octobre).
1973
Premier choc pétrolier, le prix du baril de pétrole passe
de 2 dollars en octobre 1973 à 12 dollars en décembre
1974 (un deuxième choc pétrolier se produit en 1979).
2000
Explosion de la bulle Internet aux États-Unis.
2008
La plus grande faillite de tous les temps aux États-Unis,
celle de Lehman Brothers le 15 septembre ; elle
marque le début de la diffusion mondiale de la
crise des « subprimes ».
2009
Chute de la croissance économique mondiale, de nom-
breux pays connaissent une croissance négative (par
exemple: -2,9 % en France ; -5,6 % en Allemagne ;
-2,8 % aux États-Unis).
La Banque de France abaisse sa prévision de croissance économique à 0,3% (au lieu
de 0,4%) au quatrième trimestre de 2015 en raison des attentats. Cette moindre
croissance, qui correspond à une perte de 500 millions d’euros, s’explique par le repli
des activités de services aux ménages (hébergement, restauration, spectacle). L’institu-
tion maintient sa prévision de croissance à 1,2% pour l’ensemble de l’année 2015.
• Définitions • Repères historiques
Pour produire davantage (croissance économique positive), il est possible d’utiliser plus de capital
physique grâce à l’investissement qui permet d’enclencher le processus d’accumulation du capital, et
d’accroître la quantité annuelle de travail, celle-ci étant égale au niveau de l’emploi (nombre d’actifs)
multiplié par la durée annuelle du travail par actif. Selon les économistes, sur la période 1996-2002,
la variation de la quantité de travail et de capital explique 60% de la croissance de l’Europe des 15. Il
existe donc un résidu qui justifie les 40 % restants, c’est-à-dire le progrès technique qui autorise une
hausse de la productivité globale des facteurs (PGF) […]. Une partie de la croissance économique ne
provient ainsi pas d’une hausse de la quantité de facteurs, mais de l’amélioration de leur utilisation
[…]. L’origine du progrès technique se trouve dans la capacité d’innovation de l’économie, la mobi-
lisation du capital humain et l’accumulation du capital technologique. Selon l’économiste autrichien
Joseph Schumpeter (1883-1950), les fluctuations économiques sont inhérentes au capitalisme: en
effet, le processus d’apparition du progrès technique et des innovations technologiques est source de
croissance, mais la croissance est un phénomène irrégulier dans le temps, ce qui explique les fluctua-
tions de l’activité économique, et le mécanisme de « destruction créatrice », « qui révolutionne inces-
samment de l’intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis
et en créant continuellement des éléments neufs» selon Joseph Schumpeter, est lié à la concurrence
comme processus dynamique. […] La croissance économique n’est pas un processus stable et continu
mais elle s’accompagne de crises ; durant lesquelles il y a alors un ralentissement de la production et
une montée du chômage.
La suite sur melchior.fr http://www.melchior.fr/Faisons-le-point.11592.0.html
A) Quel pays a connu la croissance
économique la plus élevée depuis 2000 ?
1) L’Inde
2) La Chine
3) L’Allemagne
B) Quel pays produit le plus de richesses
par an (PIB courant) ?
1) L’Inde
2) La Chine
3) Les États-Unis
C) Quel pays crée le plus de richesses par
habitant (PIB par tête) ?
1) Les États-Unis
2) Le Qatar
3) Le Luxembourg
Réponses : A2 / B3 / C3
POUR “FAIRE LE POINT ” Testez vos connaissances
PIB FRANÇAIS
2 132,4 milliards d’euros en 2014 (Insee) soit
2 829,2 milliards de dollars (Banque mondiale)
PIB MONDIAL
77 845,1 milliards de dollars en 2014
(Banque mondiale)
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL
MOYEN FRANÇAIS (OCDE)
de 1950 à 1973 : 5 %
de 2000 à 2007: 1,9 %
Chiffres clés
Débat&Co / page 3

Débat&Co / page 4
Et si la croissance ne revenait pas ? Telle
est la question centrale du livre de Patrick
Artus et Marie Paule Virard : assimilé au
progrès dans notre imaginaire collectif, le
retour de la croissance demeure l’objectif
prioritaire de la politique économique,
car elle est seule à même de garantir une
élévation des niveaux de vie, une cou-
verture des besoins sociaux et une dimi-
nution du chômage de masse qui délite
notre cohésion sociale. Or, en raison du
ralentissement de la croissance de la productivité globale des fac-
teurs (PGF), c’est-à-dire la partie de la croissance de la production
qui n’est expliquée ni par la croissance de l’emploi ni par celle du
stock de capital productif, il se pourrait bien que nous devions à
l’avenir nous habituer à des taux de croissance du PIB durable-
ment faibles.
Dans les principaux pays de l’OCDE, le sentier de croissance du
PIB n’est pas encore revenu à son niveau d’avant le début de la
crise financière de 2008, tandis que le PIB cumulé des quatre plus
grandes économies avancées (États-Unis, Japon, Royaume-Uni et
zone euro) s’éloigne irrésistiblement de sa tendance de long terme
[…]. La faute notamment à un investissement anémié et à la dé-
gradation de la situation financière des entreprises. Mais aussi à
l’essoufflement du progrès technique (effort d’innovation, qualité
des produits et organisation des processus de production) […].
Patrick Artus et Marie-Paule Virard rappellent les grandes raisons
pour lesquelles le progrès technique a tendance à ralentir dans nos
économies : la perte d’efficacité de la recherche-développement
(les investissements en R&D toujours plus coûteux – comme dans
l’industrie pharmaceutique ou l’extraction pétrolière – sont entrés
dans les rendements décroissants), l’augmentation de l’intensité
capitalistique (une quantité de capital toujours plus grande est né-
cessaire pour créer la même richesse, d’autant que les taux d’intérêt
faibles incitent à l’accumulation du capital), la réduction du poids
des secteurs où les gains de productivité sont élevés (comme l’in-
dustrie manufacturière dans le cadre d’une véritable « tertiarisation
de l’économie mondiale »), le niveau de qualification insuffisant
de la population active (l’amaigrissement du secteur industriel va
de pair avec la dégradation de la qualification des salariés), et les
délais importants entre l’apparition d’une innovation majeure
(comme Internet) et son impact sur la productivité globale des
facteurs (PGF) n
La suite sur melchior.fr
http://www.melchior.fr/Croissance-zero.12627.0.html
IDÉES ET DÉBATS
Débat scientifique en
classe: la croissance
est-elle finie?
Institutions
(droits de propriété,
droit commercial, etc)
Ressources naturelles
(matières premières)
Progrès
technique
Accumulation du
capital productif
(investissement)
Capital humain
(éducation)
Ouverture internationale
et mondialisation
(débouchés extérieurs)
CROISSANCE
ÉCONOMQUE
Les sources de
la croissance
Source : melchior.fr http://www.melchior.fr/Corriges-des-documents-de-l-et.11593.0.html

ERIK BRYNJOLFSSON
« LES MACHINES DIGITALES OUVRENT
UNE NOUVELLE ÈRE DE PROSPÉRITÉ »
POUR L’ÉCONOMISTE AMÉRI-
CAIN, QUI INSPIRE LA DIREC-
TRICE DU FMI, CHRISTINE
LAGARDE, L’ESSOR DES
TECHNOLOGIES DE L’IN-
FORMATION ANNONCE LA
PROCHAINE RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE NON PLUS
MÉCANIQUE, MAIS COGNI-
TIVE. RETROUVEZ L’INTER-
VIEW DANS
ENJEUX LES
ECHOS
, MAI 2014.
SELON VOTRE LIVRE, NOUS
SERIONS ENTRÉS DANS UNE
DEUXIÈME PHASE DE MÉ-
CANISATION DU TRAVAIL,
PLUS IMPRESSIONNANTE ET
BOULEVERSANTE ENCORE
QUE LA PREMIÈRE, AU XIXe
SIÈCLE. A QUOI LE VOYEZ-
VOUS ?
Le titre,
Le Deuxième âge de
la machine
, est en effet un
clin d’œil à cette époque où
la machine, remplaçant les
muscles des chevaux et des
hommes, a permis la méca-
nisation du travail physique…
et un formidable décollage de
l’humanité, dont le niveau et
la qualité de vie étaient res-
tés jusque-là relativement
inchangés. Aujourd’hui, la
puissance de calcul des ordi-
nateurs couplée à la démul-
tiplication des réseaux est en
train de produire un phéno-
mène similaire, à une échelle
encore inédite : la mécanisa-
tion du travail cognitif. Ce qui
laisse augurer une nouvelle
ère de prospérité. On en voit
les balbutiements avec l’ap-
parition de technologies qui, il
y a cinq ans encore, relevaient
de la science-fiction : voiture
sans conducteur, commande
vocale de smartphones, té-
lédiagnostic médical, au-
toremplissage de documents,
automates qui répondent aux
questions au téléphone ou en
ligne, logiciels capables de ré-
diger des articles simples de
résultats sportifs ou boursiers,
ou de battre nos meilleurs
étudiants au jeu « Jeopardy »
[équivalent de « Questions
pour un champion », NDLR] n
LE PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE
ROBERT SOLOW DISAIT EN
1987 :
« JE VOIS L’AVÈNEMENT
DES ORDINATEURS PARTOUT
SAUF DANS LES CHIFFRES
DE LA PRODUCTIVITÉ. »
POURQUOI A-T-IL FALLU AT-
TENDRE TRENTE ANS POUR
QUE S’OUVRE CETTE NOU-
VELLE ÈRE ?
C’est un des effets de ces lois
exponentielles, comme celle
de Moore qui veut que la puis-
sance de calcul des ordina-
teurs double tous les dix-huit
mois. L’esprit humain appré-
hende mal ce phénomène
vertigineux […]. Jusqu’ici, la
diffusion des technologies de
l’information a été une révo-
lution à bas bruit qui affectait
nos vies à la marge et qui, en
effet, dans le business, ne se
traduisait guère en gains de
productivité. Mais aux États-
Unis, ceux-ci ont recommencé
à croître depuis les années
90. Comme l’ont montré nos
travaux, il faut cinq à sept ans
en moyenne aux entreprises
pour digérer la technologie
et adapter leur organisation
et leur process pour en tirer
profit. […]
Les machines excellent ac-
tuellement aux tâches rou-
tinières, qu’elles soient
physiques ou mentales. Mais
je ne sais pas de quoi elles
seront capables demain – il y
a dix ans, je ne les imaginais
pas conduire une voiture ! En
attendant, il y a au moins trois
domaines dans lesquels les
humains ont encore l’avan-
tage. La créativité et l’esprit
d’entreprise, d’abord. Ces
deux qualités vont devenir
d’autant plus précieuses que
la digitalisation en amplifiera
les retombées. Les relations
interpersonnelles, ensuite :
vendre, éduquer, motiver, soi-
gner… tout cela requiert des
capacités empathiques qui
font encore largement défaut
aux machines. La dextérité,
enfin. Les robots sont très
maladroits : coiffeurs, jardi-
niers, plombiers ont encore de
beaux jours devant eux n
Propos recueillis par
Pascale-Marie-Deschamps
pour Enjeux Les Echos
Le 30/05/14
Erik Brynjolfsson,
économiste
Débat&Co / page 5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%