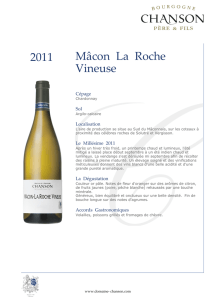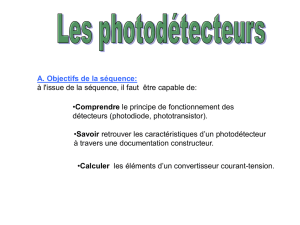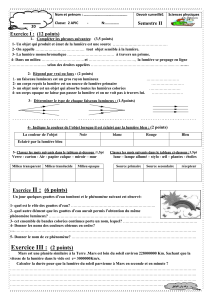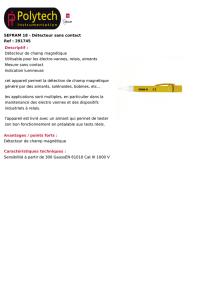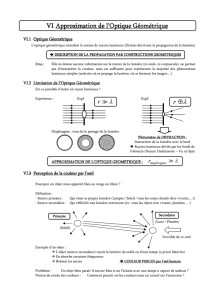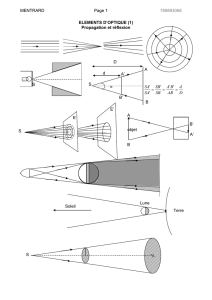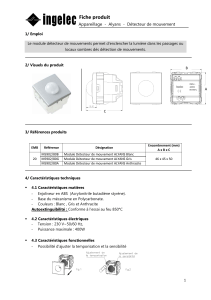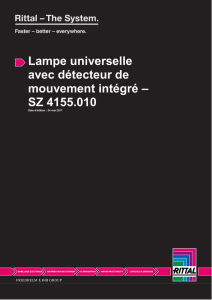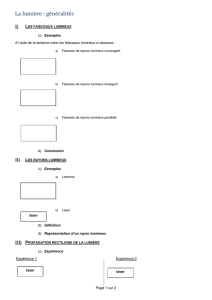juin 2003 1 L`objectif de ce cours est double: - d`une part vous

A. GALAIS juin 2003 1
L'objectif de ce cours est double:
- d'une part vous apporter les éléments nécessaires pour comprendre
le fonctionnement des photodétecteurs les plus courants. De
nombreux appareils mettent en oeuvre ces composants, citons par
exemple:
Applications à la mesure:
- mesure de vitesse (vélocimètre laser Doppler...)
- mesure de distance (télémètre laser, stéréoscopie...)
- mesure d'angle (codeur optique...)
- mesure de concentration (analyseur de gaz, opacimètre,
granulomètre...)
Application à la transmission d'information:
- photocoupleur, fibre optique
- barrière optique, code barre, photocopie
- disque optique (audio, vidéo, numérique), vision de nuit,
thermographie, etc.
- d'autre part, dans un but directement utilitaire, vous permettre de
mieux utiliser les détecteurs existants au laboratoire, en fonction de
leurs performances et du but recherché. Les montages concernés sont
en premier lieu les montages d'optique, mais l'utilisation de
composants optiques dans d'autres montages (mécanique,
électronique, ...) n'a pour limite que votre imagination !

A. GALAIS juin 2003 2
1. INTRODUCTION
L'essentiel du cours portera sur les capteurs optiques qui fournissent un signal électrique;
ceci exclut par exemple les récepteurs tels que l'émulsion photographique, les
photothermoplastes, et je ne parlerai que brièvement de l'oeil. Le principe de base des
photorécepteurs étudiés sera donc une conversion énergie lumineuse Ö énergie électrique.
C'est le principe même de cette conversion qui différencie le plus les photodétecteurs et
qui conditionne leurs caractéristiques métrologiques.
1.1. Quelques rappels de RADIOMETRIE-PHOTOMETRIE
Que mesure un photodétecteur ? La lumière est une onde électromagnétique dont le do-
maine de fréquence est extrêmement large:
Sur l'ensemble du domaine des ondes électromagnétiques, il existe une continuité
dans la description des phénomènes physiques: interférence, diffraction, polarisation...
Toutefois, pour les processus de détection du rayonnement, il existe une frontière
technologique qui distingue deux modes de détection:
- domaine radio: on mesure l'amplitude E du champ électromagnétique, les détecteurs
étant suffisamment rapides.
- domaine lumineux: on mesure la valeur efficace du champ <E²(t)>, moyennée sur le
temps de réponse du détecteur (détection quadratique).
La zone de recouvrement entre les deux modes, déterminée par les limites en temps de ré-
ponse des détecteurs, se situe dans l'IR lointain (ondes millimétriques, fréquence 10 GHz).
C'est donc le mode de détection quadratique qui nous intéresse et le photodétecteur mesure
une énergie.

A. GALAIS juin 2003 3
1.1.1. Grandeurs énergétiques (ou radiométriques)
Symbole Définition Unité
Φ
Flux lumineux (d'un faisceau)
C'est la puissance transportée par le rayonnement: elle est
définie en calculant le flux du vecteur de Poynting 1
Φ=rr
r
E∧
∫Hds
S
anglais: radiant, luminous flux
Watt
Q
Energie (d'un faisceau)
Q = Φdt
∫
anglais: radiant, luminous energy
Joule
E
Densité spatiale de flux lumineux:
reçu par une surface = éclairement. anglais: irradiance, illuminance
émis par une surface = émittance. anglais: exitance
Une surface S recevant (émettant) le flux lumineux Φ reçoit
un éclairement (a une émittance) E = Φ
S
W.m-2
I
Intensité (d'une source). Densité spatiale de flux émis (plus rarement
reçue)
anglais: intensity
Une source (considérée comme ponctuelle) émettant un flux Φ
dans un angle solide Ω a une intensité définie par I = Φ
Ω
W.sr-1
L
Luminance (d'un faisceau, d'une source). Densité spatiale de flux.
anglais: radiance, luminance
Un faisceau d'étendue géométrique U émettant un flux Φ a
une luminance définie par Φ
U
W.m-2.sr-1
Parallèlement à ces grandeurs physiques, il existe aussi des grandeurs liées à la
photométrie visuelle. Elles sont exprimées à l'aide de plusieurs unités:
1L'équation de Poynting, dérivée des équations de Maxwell, s'écrit: : divP W
tWJoule
r++ =
∂
∂0
Elle exprime la conservation de la densité de puissance. En l'absence de dissipation par effet Joule, cette relation exprime donc
simplement que la densité d'énergie rayonnée (ou apportée) par le faisceau par unité de temps est égale à la variation de densité d'énergie
émise par la source (absorbée par le récepteur). La puissance contenue dans un faisceau délimité par la surface S est donc:
Φ= =
∫∫
divPd Pds
rr
r
τ
VS
.

A. GALAIS juin 2003 4
- le lumen (lm): unité visuelle de puissance lumineuse, qui mesure donc l'impression
subjective produite sur l'oeil.
-le lux (lx): unité d'éclairement.1 lux=1 lm/m2
-la candela (cd): unité d'intensité visuelle (anciennement appelée bougie nouvelle Â1948).
1 candela = 1 lm/sr
Pour passer d'un système d'unité à l'autre, on utilise les courbes d'efficacité lumineuse
spectrale de "l'oeil standard". On établit donc deux courbes, l'une V(λ) pour la vision
diurne (vision photopique) et l'autre V'(λ) pour la vision nocturne (vision scotopique)
(figure 1).
Figure 1- Courbes de sensibilité spectrale de l'oeil
Ce sont des courbes de sensibilité spectrale relatives. La valeur du facteur de conversion
est liée d'une part aux "traditions" des éclairagistes qui ont fixé la valeur de la candela,
unité de base du Système International et d'autre part à la loi de rayonnement du corps noir
et bien evidemment à la sensibilité spectrale de l'œil moyen.
Les facteurs de conversion sont:
K =683 lm/W,au maximum de sensibilité de l'oeil (λ = 555nm) pour la vision diurne
K' =1703 lm/W,au maximum, décalé vers le bleu (λ = 507nm) pour la vision nocturne.
La candela est définie dans le système SI comme l'intensité lumineuse émise dans une
direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence
540 1012 Hz (555 nm) et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 Watt par
stéradian.
La valeur de la candela fixe en fait le coefficient de la courbe d'efficacité spectrale
photopique et permet alors d'exprimer des grandeurs de photométrie visuelles à l'aide des
unités dérivées (lumen et lux) pour des rayonnements non monochromatiques.

A. GALAIS juin 2003 5
1.1.2. Application: Calcul de flux et d'éclairement pour une lanterne.
Une ampoule quartz-iode de 100 W (celle qui équipe les lanternes utilisées en TP) a un
filament de tungstène de longueur l=40 mm, de diamètre d=0.15 mm. On suppose que 70%
de l'énergie électrique fournie est dissipée sous forme de rayonnement (ε = 0.7).
Exprimer le flux total émis par le filament. Calculer la température du filament ?
La luminance spectrale du corps noir est donnée par la loi de Planck:
L(λ) = c
e - 1
1
5 c
T
2
πλ λ
W.m-2.sr-1.nm-1 c1=3.741 1020 W.m-2.nm4
c2=1.439 107 K.nm
λ exprimé en nm
Le flux total émis par un élément de corps noir de surface dS dans un angle solide
dΩ centré autour de la direction θ (voir figure 2) s'écrit:
d = L( ).dScos .d .d
=0
ΦΩλθλ
λ
∞
∫
le terme en cosθ prenant en compte la
projection de la surface sur la direction
d'observation. En intégrant l'angle solide
par couronnes circulaires centrées sur la
normale,
dΩ = 2πsinθdθ donc
d = S. L( )d .2 sin cos .d = .S. L( )d
=0
/2
=0 =0
Φλλπθθθπλλ
θ
π
λλ
∫∫∫
∞∞
On assimile le filament à un corps noir et l'on suppose que 70 % de la puissance
électrique est rayonnée (i.e. on estime à 30 % les pertes par conduction et
convection).
επλλ
λ
.P = .S. L( )d
él
=0
∞
∫
La quantité πλλ
λ
L( )d
=0
∞
∫ représente l'énergie surfacique émise (grandeur réciproque
à l'éclairement) et s'appelle l'émittance du corps noir. Elle ne dépend que de la
température absolue de celui-ci (loi de Stefan-Boltzmann).
πλλ
λ
L( )d
=0
∞
∫ = σT4 avec
π
σ4-2-8-
23
45
.K W.m10 5.67=
c15h
k2
=
Figure 2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
1
/
57
100%