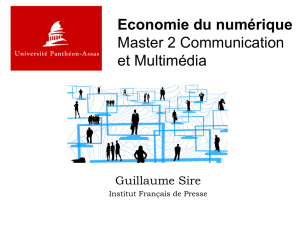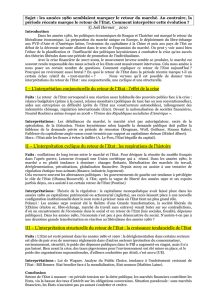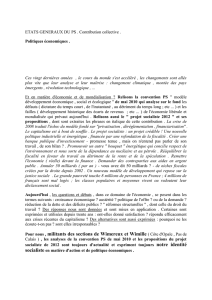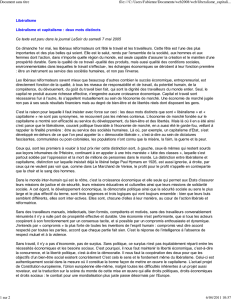Les concurrents du capitalisme libéral moderne

Les concurrents
du capitalisme libéral moderne
Pour avoir le choix de son projet politique
Colloque de Génération République
tenu à Paris, le 24 avril 2004
ACTES DU COLLOQUE
Site Internet dédié : www.concurrents-capitalisme.net

2
Sommaire général :
1) Mot des organisateurs
2) Compte-rendu des interventions
3) Biographie des intervenants
4) Lexique
5) Bibliographie
1) Mot des organisateurs
Le capitalisme libéral constitue-t-il la forme incontournable d’organisation de l’activité économique ?
Dans des secteurs identifiés (infrastructures, agriculture, services, logiciels, etc.), d’autres modèles
existent et affichent eux aussi une capacité convaincante, voire supérieure, de création de richesses.
Les connaître, les mettre en œuvre, c’est élargir le champ des possibles pour améliorer le
fonctionnement de l’économie. C’est aussi redonner des marges de manœuvre au politique qui,
actuellement, subit, plus qu’il ne les régente, les contraintes du système économique.
C’est ce thème que les intervenants, chercheurs, syndicalistes, hommes politiques ont développé au
cours de cette après midi.
Nous remercions donc pour leur participation :
-Michèle Debonneuil, chef du service économique, financier et international au Commissariat général
au Plan ;
-François Dufour, exploitant agricole, porte-parole de la Confédération Paysanne ;
-Liêm Hoang-Ngoc, économiste, maître de conférences à l'Université Paris-I-Panthéon Sorbonne ;
-Bernard Lang, chercheur à l'INRIA (Institut National de Recherches en Informatique et
Automatique) ;
-Marie-Noëlle Lienemann, responsable du secteur Entreprises au Parti Socialiste.
Les interventions, telles que résumées dans le présent document, permettent d’affirmer la possibilité,
voire l’existence, de modèles économiques alternatifs, efficaces et solidaires.
Août 2004, les organisateurs
Ont assuré l’organisation du colloque et la rédaction des actes :
Pauline Cayatte, Pierre-Marie Debreuille, Julien Landfried, Nicolas Wojnarowski

3
2) Compte-rendu des interventions
Face à la stagnation économique des pays développés, l’intérêt du recours à la puissance
publique
Liêm Hoang-Ngoc, économiste, maître de conférences à l'Université Paris-I-Panthéon Sorbonne
Doit-on considérer que l’Etat atteignit l’apogée de son
rôle économique au cours de la période des trente
glorieuses, et qu’il doit maintenant se contenter
d’accompagner des évolutions qu’il ne maîtriserait
plus, face auxquelles il ne pèserait plus ?
A partir des années 70, sous la férule des néo-libéraux,
les marchés financiers prennent un pouvoir croissant
dans l’économie mondiale, et le désengagement de
l’Etat devient la voie économique dominante. De la
politique de Raymond Barre en France au
thatchérisme britannique, on abonde dans le sens des
actionnaires, on restaure la part des profits au
détriment de celle des salaires dans la valeur ajoutée.
Dans ce contexte, l’expérience socialiste française qui intervient entre 81 et 83 apparaît comme une
parenthèse, qui n’est en général pas présentée comme un succès, alors que l’analyse fine des
indicateurs usuels montre que c’est par manque de temps que la politique économique menée alors
n’a pas pu prouver son efficacité.
Quoi qu’il en soit, le tournant de 83 est fondamental, et la France tourne de nouveau le dos à une
politique économique qui, sous bien des aspects, rappelait celle du Conseil National de la Résistance,
mise en place au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Le pouvoir économique est réorienté vers les marchés financiers et le désengagement de l’Etat est
accéléré. Le mouvement s’amplifie encore dans les années 1990 : on assiste à un véritable transfert
du pouvoir économique vers la sphère privée. Ceci fut bien évidemment accompagné d'un
remodelage complet des systèmes de propriété et de gouvernance des entreprises françaises, une
prépondérance accrue étant accordée à la rentabilité de court terme.
Face à ces évolutions, des inquiétudes n’ont pas manqué de s’élever, et la sphère politique dominante
tente aujourd’hui de trouver des réponses à ce qui s’annonce comme une menace fondamentale pour
le capitalisme français. Elle cherche des solutions qui permettraient d’accommoder « à la française »
le libéralisme économique et la souveraineté des marchés financiers, en réfléchissant par exemple à
l’actionnariat salarié. Elle ne remet cependant pas fondamentalement en cause la pertinence du
désengagement de l’état des activités stratégiques industrielles du pays.
Or, c’est ce modèle en lui-même qu’il convient de revoir. Partout à travers le monde, des exemples
nous montrent que la sphère du privé ne permet pas d’atteindre seule des situations satisfaisantes, et
par conséquent que la puissance publique se doit de garder un rôle prépondérant. Ceci apparaît
comme la traduction empirique du modèle keynésien : dans bien des domaines, notamment lorsqu’un
certain monopole est justifié économiquement, laisser la responsabilité des opérations au seul secteur
privé conduit à des situations non optimales, notamment en terme de quantités produites (et donc
d’emploi).
Ainsi, il est nécessaire de réaffirmer le caractère fondamental de la présence de l’Etat en tant
qu’acteur économique. Afin d’assurer un équilibre satisfaisant à moyen et long terme de
l’activité, le contrôle des activités industrielles stratégiques du pays doit, d’une manière ou
d’une autre, rester aux mains de la puissance publique.

4
Une nouvelle vision du développement agricole à travers le mouvement de paysans « Via
Campesina »
François Dufour, exploitant agricole, porte-parole de la Confédération
L’exemple le plus emblématique de l’échec du
libéralisme en tant qu’instrument de politique
économique et sociale, notamment dans les relations
internationales, est peut-être celui des relations
agricoles.
La façon dont l’agriculture est organisée au travers le
monde témoigne aujourd’hui d’un double échec. Echec
des relations Nord-Sud pour commencer : le
déséquilibre entre les deux zones est total. Moins de
100 millions d’exploitants agricoles concentrés dans
les pays du nord dirigent d’immenses exploitations
intensives, et produisent l’essentiel des richesses
agricoles mondiales. Dans les pays du sud, 1,4
milliards de paysans travaillent à une agriculture souvent locale, et dans les conditions les plus
démunies la plupart du temps.
Ce déséquilibre est encore amplifié par les subventions existantes dans les pays du nord, qui
permettent de protéger les agriculteurs locaux. Si on ajoute à cela un système de marché mondial
artificiel et spéculatif, qui ne ressemble aujourd’hui qu’à une autre façon de fixer les prix pour les
grandes firmes agroalimentaires et phytosanitaires, on comprend que les pays du sud n’ont en l’état
actuel aucune chance de développer leur agriculture dans des conditions d’équité avec les pays du
nord.
Mais cet échec est aussi patent dans les relations agricoles à l’intérieur des pays du nord.
L’agriculture dans ces pays s’est en effet transformée en une activité ultra-intensive, et les agriculteurs
sont devenus des fournisseurs de matière première, ayant perdu toute initiative, tout contrôle sur leur
action, au profit des grandes firmes qui sont aujourd’hui leur commanditaire.
Ce constat d’échec doit être fait par l’ensemble des organisations, nationales ou internationales, qui
travaillent sur ces questions. Malheureusement, un revirement de la politique agricole mondiale est
loin d’être à l’ordre du jour. Le constat d’appauvrissement de l’agriculture, et de ceux dont elle doit
assurer la subsistance dans les zones les plus défavorisées du globe, n’amène pour l’heure l’OMC
qu’à recommander toujours plus de libéralisme, persuadée que le seul remède possible ne peut être
que l’accélération de la « marchéisation ».
Se positionnant en force alternative, un certain nombre d’acteurs ont créé VIA CAMPESINA,
internationale paysanne réunissant plus de 800 millions paysans à travers le monde autour
d’un projet pour une agriculture différente. La charte de Via Campesina pose les droits que doit
avoir chaque paysan ou agriculteur : le droit à la subsistance, à l’égalité de traitement, mais
aussi à l’éducation, à la formation aux techniques modernes, à la qualité…
Via Campesina vise à changer les relations agricoles entre les acteurs, à les moderniser en
actant les profondes mutations qui ont marqué le monde agricole depuis 50 ans. En effet, si le
traité de Rome avait comme but de permettre à l’agriculture européenne d’assurer la fourniture de
produits agricoles sur le continent, il est évident que la situation a changé et que de tels objectifs ne
sont plus adaptés.
Enfin, et c’est certainement là le plus important, Via Campesina demande à ceux qui organisent
l’agriculture mondiale d’avoir le courage de prendre les décisions qui lui permettront de sortir
de la crise, de gérer la situation sur le long terme. Il est en effet aujourd’hui nécessaire de ne
plus protéger tel ou tel lobby politique poursuivant des motivations court-termistes, et
d’organiser les changements de règles qui permettront de restaurer une agriculture de qualité,
et surtout partagée justement à travers le monde.

5
Pour une meilleure utilisation des nouvelles technologies : le modèle alternatif des logiciels
libres
Bernard Lang, chercheur à l'INRIA (Institut National de Recherches en Informatique et Automatique)
Il y a une dizaine d’années, le secteur des logiciels
informatiques était menacé car on tendait vers le
monopole de Microsoft et de son système
d'exploitation « Windows ». Par réaction, la
communauté des chercheurs en informatique a
développé à l'attention de l'ensemble des utilisateurs
des logiciels concurrents dits « libres ».
L'évolution vers un monopole est due à la
spécificité économique de ce secteur qui constitue
un cas de « monopole naturel »:
- le coût marginal d’un logiciel est nul car les
copies sont gratuites
- peu de capitaux sont nécessaires au
développement d’un logiciel
- il existe un effet de réseau physique ou logique qui conduit à un monopole naturel.
Sur le troisième point, il s’agit bien sûr du problème de compatibilité entre les applications mais aussi
du fait que dans les entreprises, lorsque le personnel est déjà formé à l’utilisation d’un logiciel, il est
alors logique de continuer à acheter le même. Le producteur dominant a ainsi tendance à devenir
universel. Nous retrouvons alors les effets dommageables du monopole : prix arbitraire, contrôle de
l’économie et manque d’innovation.
Il est à noter que l’activité d’édition de logiciels crée peu d’emplois mais rapporte une fortune comme
la comparaison entre l'éditeur de logiciels Microsoft et la société de vente de service et de matériel
IBM le montre.
Microsoft : $ 14,5 milliards de CA $ 4,5 milliards de bénéfice 27 000 emplois
IBM : $ 81,7 milliards de CA $ 6,3 milliards de bénéfice 291 000 emplois
Par conséquent, quand on achète un logiciel « commercial », on n’a pas le droit de le modifier, ni de
l’installer sur un autre ordinateur. Le seul droit que l’on ait est celui de le « consommer ». Tout travail
de recherche et de développement dans ce domaine est implicitement propriété du monopole et, de
plus, est bridé par les freins techniques et légaux mis par l'opérateur à l'utilisation de son produit pour
des développements ultérieurs. Cet état de fait est venu heurter de manière quasi philosophiques
les fondements du fonctionnement du monde de la recherche, pourtant d’inspiration libérale.
Celui-ci a, en effet, un fonctionnement très particulier qui conjugue efficacité et liberté des acteurs. Les
chercheurs n’ont pas de souci d’ordre purement économique mais leur monde fonctionne quand
même comme une économie de marché. Ils fabriquent des modèles puis essaient de les mettre en
œuvre. Ils travaillent les uns avec les autres, ils communiquent ensemble pour avoir des informations.
Pour que la recherche avance, la coopération est indispensable. Mais il y a aussi de la concurrence
entre les différentes approches, qui sont évaluées par toute la communauté. L’évaluation est ainsi
réalisée par les pairs et évolue au cours du temps. La valeur marchande est la réputation qui se
traduit par des distinctions d'ordre aussi bien académiques que pécuniaires. Sur la base de ces trois
caractéristiques, la coopération, la concurrence et l’évaluation par les pairs, ce système a prouvé son
efficacité depuis plus de 200 ans.
Parallèlement, les chercheurs sont totalement libres sur le choix de leur sujet et sur le contenu de leur
communication. Et c’est cette liberté que Microsoft est venue entraver. Par réaction, dans les années
80, un mouvement s'est mis à développer bénévolement des logiciels plus transparents et moins
chers. Ces logiciels dits « libres » sont très différents du logiciel commercial car ils sont basés sur un
travail en collaboration pour créer un ensemble de ressources en logiciels. L'utilisateur dispose à la
fois des moyens matériels et de l’autorisation légale de les modifier.
Ainsi, le modèle de développement du logiciel libre est très semblable à celui de la recherche : il y a
de la coopération, de la concurrence et du contrôle par les pairs. Il est de plus le seul modèle qui
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%