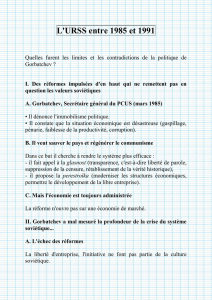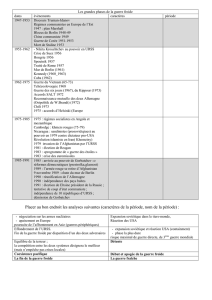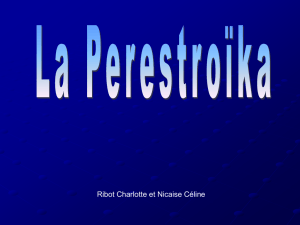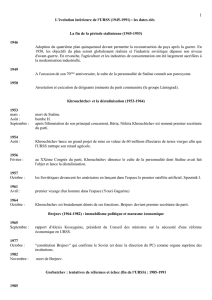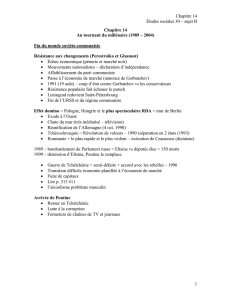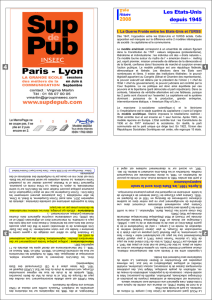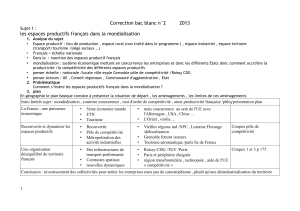télécharger cet article - l`Institut d`Histoire sociale

A
UCUN LEADER OCCIDENTAL, sauf Ronald Reagan, comme on l’a vu ce matin, ne
s’attendait à l’effondrement du régime communiste. Mais pour la plupart des
Occidentaux, la fin de la guerre froide et la libération de l’Europe de l’Est ont
été une heureuse surprise. Pas pour les dirigeants français de l’époque. Ceux-ci trou-
vaient en effet leur compte dans le monde bipolaire qui préservait la division de
l’Allemagne tandis que la compétition entre les deux superpuissances leur donnait un
sentiment d’importance auquel leur poids réel dans les relations internationales ne
leur permettait pas de prétendre.
Je vais donc examiner la réaction des dirigeants français face à Gorbatchev et
l’évolution de la position de la France face à celle de l’URSS.
L’annonce des réformes gorbatchéviennes est plutôt bien reçue à Paris par la
classe politique et plus précisément par les dirigeants socialistes de l’époque. Aux yeux
du président Mitterrand, pétri d’une certaine tradition russophile française (je cite
Hubert Védrine) : « La perspective d’une URSS ralliée au socialisme à visage humain
avait tout pour plaire […] L’hégémonisme américain était une autre raison en 1985
de retrouver à l’Est de l’Europe un contrepoids, un partenaire fréquentable (c’était un
point important que l’URSS devînt fréquentable !), forte et équilibrante ».
Les considérations idéologiques sont donc importantes pour un Président élu en
1981 sur un programme de rupture avec le capitalisme et dont le grand dessein est de
construire une communauté européenne à vocation socialiste. Je cite encore Hubert
Védrine : « Une vraie modernisation de l’URSS, à condition qu’elle aille loin, lèverait la
contradiction entre socialisme et liberté qui crucifie depuis le début du (XXe) siècle, la
gauche ». L’intérêt de la perestroïka durant ses premières années est là. On peut dire
que longtemps, les dirigeants français se sont aveuglés sur les conséquences prévisibles
N° 39
1989 et la politique étrangère de la France
Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris-Sorbonne.
par
$"'# %#!
#%% $

de la perestroïka gorbatchévienne. Le but de la diplomatie française était la construc-
tion d’une Europe de l’Ouest intégrée, de tendance socialiste, dominée par le couple
franco-allemand, lui-même dominé par la France. Le slogan favori de la diplomatie
française d’alors – « Surmonter Yalta » – voulait surtout dire « Débarrasser l’Europe
occidentale de l’influence délétère du libéralisme anglo-saxon », y compris dans
l’audio-visuel. J’ai lu les archives Gorbatchev et je m’appuie sur elles pour cette inter-
vention. Les Français étaient littéralement obsédés en 1988 par le projet d’associer
l’URSS à la création d’une télévision européenne, qui serait donc dirigée contre l’in-
fluence anglo-saxonne. Anti-américaine, en un mot. Cette conception mitterran-
dienne n’était pas incompatible au fond avec le projet de « Maison commune euro-
péenne » de Gorbatchev, fondé sur un socialisme rénové, même si au début, d’ailleurs,
les dirigeants français ont soupçonné Moscou d’avoir lancé ce projet de Maison
commune européenne en vue de torpiller les projets d’union politique et monétaire
des douze et si, pour cette raison, ils avaient été quand même assez méfiants.
Cependant, le président Mitterrand, en 1987 encore, déclarait que l’Europe de
Yalta, qui durait depuis 43 ans, allait exister encore 25 ans. Au contraire, le chancelier
Kohl était déjà conscient que quelque chose était en train de bouger à l’Est. En 1987, il
déclare ainsi à Mitterrand : « Si Gorbatchev reste, il aura l’idée d’appeler à une
neutralisation de l’Allemagne ». On a donc déjà en Allemagne le sentiment que la
question allemande va être rouverte alors que Mitterrand est fermement convaincu,
lui, que les changements introduits par Gorbatchev n’apporteront pas de bouleverse-
ments géopolitiques.
Pour le président Mitterrand et ses proches, la crise de l’URSS a cependant été très
tôt envisagée sous l’angle de ses retombées sur la question allemande. C’est même la
question essentielle aux yeux des dirigeants français, la question idéologique passant
au second plan face à cette préoccupation.
Dès 1985, Mitterrand avertit Gorbatchev : « Je ne peux pas souhaiter la reconstitu-
tion d’un pôle dominant au centre de l’Europe. » Les dirigeants français s’inquiètent
d’abord d’un renforcement de la RFA grâce à l’ouverture de l’Europe de l’Est. « Que faire
de l’Europe avec l’Est, se demande Jacques Attali le 11 juillet 1988. Nous n’avons aucune
raison de laisser les Allemands y mener seuls une politique dynamique. » Donc, les
Allemands, sensibles à ces inquiétudes françaises offraient à la France une Ostpolitik
commune franco-allemande, mais ces offres vont susciter la méfiance à Paris :
l’Allemagne ne voulait-elle pas exploiter les bonnes relations franco-polonaises tradi-
tionnelles à son profit ? Paris décide donc de mettre en œuvre une Ostpolitik à la fran-
çaise qui se traduira par une série de voyages du Président français en Europe de l’Est.
Durant cette période de 1988, Mitterrand était toujours persuadé que les Soviétiques ne
& &
au tom Ne 20 09

consentiraient jamais à la
réunification de l’Allemagne
et il ne craignait pas le
rapprochement germano-
soviétique qui, à ses yeux ne
pouvait que rendre
l’Allemagne moins atlantiste
et donc jouer un rôle, positif
à ses yeux .
Voici ce qu’il déclare en
octobre 1988 : « Le rappro-
chement entre l’URSS et la
RFA ne représente guère
d’inconvénients majeurs et présente quelques avantages : en Allemagne, le nationa-
lisme passe par le neutralisme pour éviter la dépendance à l’égard des États-Unis. »
Après avoir rencontré le Président français le 25 novembre 1988, Gorbatchev fait
une analyse très pertinente devant le politburo. Je le cite : « Mitterrand n’essaie pas de
nous éloigner de la RFA ou de l’Italie. Tout cela nous donne une plus grande marge de
manœuvre sur le continent européen. Il voit que les Américains nous cherchent noise
en Europe de l’Est. Il nous dit en substance : ensemble, unissons l’Europe. On sent
qu’il a une dent contre les États-Unis. Les Français collaborent étroitement avec Kohl,
mais le chauvinisme français est toujours là. Nous pouvons désormais dissuader Bush
de vouloir faire pression sur la Russie ». Au fond, à la veille du grand discours de
Gorbatchev de novembre 1988 où il va abandonner explicitement l’idéologie léni-
niste en politique étrangère, c’était une politique très traditionnelle que menait le
secrétaire général, et qui consistait comme d’habitude à utiliser les alliés européens
pour faire pression sur Washington.
À partir du moment où se dessine la perspective d’une réunification de
l’Allemagne, les dirigeants français vont faire preuve d’une surprenante persévérance
dans le Wishful thinking. Le 20 mai 1989, Bush et Mitterrand discutent pour la
première fois l’hypothèse d’une réunification allemande. C’est le moment où les
États-Unis, ayant analysé la situation en URSS, prennent la décision de soutenir à fond
le chancelier Kohl et l’Allemagne. C’est le moment du discours de Mayence, qui
marque une très importante évolution américaine. Mitterrand dit donc à Bush qu’il
ne croit pas à la réunification de l’Allemagne car « les Soviétiques s’y opposeront, y
compris par la force. Ce serait pour eux un casus belli ». En juillet 1989 il dit à Bush
que jamais l’URSS n’acceptera de relâcher son contrôle sur la Pologne : « cela la coupe-
1989 ET LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE
N° 39
#%% $
8 décembre 1987, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev
signent l’Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty.
© White House Photographic Office

rait de l’Allemagne de l’Est, à laquelle elle tient beaucoup – et nous aussi : il n’est pas
dans l’intérêt de l’Occident que la Pologne s’oppose à l’Union soviétique et à la RDA».
Ainsi, met-il Bush en garde contre cette politique très active que les États-Unis
lançaient en Europe de l’Est à ce moment-là. Pourtant, malgré ces déclarations, l’in-
quiétude monte chez les dirigeants français : en juillet 1989, Michel Rocard met en
garde Gorbatchev : « De même que nous devons agir avec précaution à l’égard des
pays d’Europe centrale en tenant compte de leurs liens avec l’URSS, de même l’URSS
doit faire preuve de prudence dans la question allemande, en évitant de rompre les
liens traditionnels. Autrement, l’Europe peut éclater. Ni vous ni nous n’y avons
intérêt… L’incertitude à propos de la question allemande nous inquiète. Les tenta-
tives de découpler l’Allemagne des trois puissances nucléaires seraient extrêmement
dangereuses ». En cela, l’attitude de François Mitterrand et des socialistes français est
très proche de celle de Margaret Thatcher. Le 1er septembre, Mitterrand essaie de
réconcilier le premier Ministre britannique qui s’alarme de la faiblesse de Gorbatchev
et lui dit que « jamais Gorbatchev n’acceptera une Allemagne unie dans l’Otan et que
jamais les Américains n’accepteront que la RFA sorte de l’Alliance. Alors ne nous
inquiétons pas. Disons que la réunification se fera quand les Allemands le décideront
mais en sachant que les deux grands nous en protégeront ». Mais quelques jours plus
tard, le 10 septembre 1989, Mitterrand commence à s’impatienter. Evoquant le
« désordre » dans le Pacte de Varsovie, il demande : « Combien de temps Gorbatchev
va-t-il tolérer cela ? Entre ce que Gorbatchev déclare et ce qu’il fait, le fossé se creuse.
À croire que son pouvoir est bien moindre que ce qu’il dit ». Les dirigeants français
commencent alors à s’apercevoir que Gorbatchev aussi est victime du Wishful thin-
king et qu’il surestime ses possibilités. Mitterrand est bien conscient que « la France
ne serait pas en mesure de s’opposer à la réunification si celle-ci se faisait » et il s’ac-
croche encore à l’espoir que Moscou y fera obstacle. Mais, malheureusement pour lui,
le 16 octobre, il apprend que Gorbatchev venait de faire savoir à la RFA que l’armée
soviétique n’interviendrait pas en cas de troubles. Mitterrand ne se résigne pourtant
pas : « Pour les Soviétiques le tabou, c’est l’appartenance au Pacte de Varsovie », dit-il
devant le Conseil des ministres du 18 octobre. C’est pendant cette période que Paris
revient à cette chimère de la diplomatie française : l’alliance franco-russe. Jacques
Attali proposa ainsi en ce mois d’octobre à Zagladine, l’expert auprès du Comité
central pour les affaires françaises, de recréer l’alliance franco-russe, y compris dans
sa dimension militaire, sous le camouflage de forces armées chargées de lutter contre
les catastrophes naturelles. Ce n’était pas des propos en l’air et on le trouve dans les
archives Gorbatchev, puisqu’un mois plus tard, le 29 novembre, François Mitterrand
avertit Gentscher : « Ou l’unité allemande se fait après l’unité européenne, ou vous
& &
au tom Ne 20 09

trouverez contre vous la triple alliance France-Angleterre-Russie et cela se terminera
par une guerre ». On le voit : c’est une position très dure, mais les Français étaient,
comme très souvent, emportés par leur Wishful thinking, notamment concernant
l’URSS. Ils ne comprenaient pas que Gorbatchev était lui-même sur une tout autre
longueur d’onde : pour lui, l’essentiel (et cela a toujours été ainsi dans la politique
étrangère soviétique), ce sont les relations germano-soviétiques. Les relations avec
Paris ne sont que des moyens de faire pression sur les uns ou les autres pour faire
progresser d’autres dossiers plus fondamentaux, c’est-à-dire les relations avec les
États-Unis et avec l’Allemagne. L’Union soviétique avait moins une politique euro-
péenne qu’une politique allemande. Pour Gorbatchev, l’essentiel est de garder de
bonnes relations avec Bonn. Le 3 novembre 1989, il déclare au politburo :
« L’Occident ne veut pas de la réunification de l’Allemagne mais souhaite que ce soit
l’URSS qui y fasse barrage. Ils vont nous pousser à la confrontation avec l’Allemagne
pour éviter un accord entre les Soviétiques et les Allemands ». Comme on peut le
constater, il n’était pas du tout sur la même longueur d’onde que les dirigeants fran-
çais et les Soviétiques ironisaient d’ailleurs notamment auprès des Américains,
concernant les efforts de la diplomatie française. Le 24 novembre, Attali entreprend à
nouveau Zagladine : « Notre tâche commune est de faire obstruction au processus de
réunification de l’Allemagne », lui dit-il. Le 6 décembre, il revient à la charge, toujours
devant Zagladine : « Le refus catégorique de l’URSS de s’immiscer dans les affaires
intérieures des pays frères, notamment dans le cas de la RDA, a interloqué les autorités
françaises. Elles se sont demandé si cela ne signifiait pas que l’URSS ne s’était pas déjà
rendue à l’idée de la réunification allemande et qu’elle n’entreprendrait rien pour s’y
opposer. Cette perspective a plongé les autorités françaises dans une peur proche de
la panique. La France est résolument opposée à la réunification de l’Allemagne,
même si elle comprend que celle-ci finira par arriver ». Cette réunification était donc,
comme le dit aussi Attali à Zagladine, un « cauchemar » pour les dirigeants français.
Vous avez tous entendu parler du voyage de Mitterrand à Kiev le 6 décembre
1989. Mitterrand y rencontre Gorbatchev. Il était alors furieux, sous le coup du
discours de Kohl du 28 novembre devant le Bundestag, discours dans lequel il annon-
çait son programme de réunification par étapes de l’Allemagne. Ce discours, Kohl
l’avait prononcé sans prévenir personne, ni ses alliés européens ni les Soviétiques ; et
ce qui stupéfie Gorbatchev, c’est que Kohl n’ait pas consulté l’URSS – ce qui montre à
quel point les relations germano-soviétiques étaient déjà étroites. Gorbatchev est
indigné de l’attitude cavalière de Kohl. Mitterrand veut alors profiter de ces bonnes
dispositions en plaidant pour le maintien des blocs et de l’ordre européen existant. Il
demande donc avec insistance à Gorbatchev ce qu’il compte faire. Mais là encore, il
1989 ET LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE
N° 39
#%% $
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%